8 janvier
Mort d’Achille Emperaire, à Aix, âgé de soixante-huit ans.
« Nouvelles locales. Décès », Le National, journal républicain d’Aix, 28e année, n° 1387, dimanche 16 janvier 1898, p. 2 :
« Décès. — Un artiste peintre qui a eu une certaine notoriété, en tout cas de l’originalité, M. Empéraire, est mort à Aix, à l’âge de 68 ans. C’était ce qu’on appelle communément un type, ce qu’il justifiait au physique comme en art. M. Empéraire était très estimé comme homme et ses œuvres artistiques méritaient l’attention des connaisseurs, car elles n’étaient pas banales et témoignaient d’une grande intelligence de la couleur et d’une continuelle recherche de l’art. »
« Mouvement de la population. Du 8 au 15 janvier 1898 », Le National, journal républicain d’Aix, 28e année, n° 1387, dimanche 16 janvier 1898, p. 3 :
« Décès
— Emperaire Jean, artiste peintre. 68 ans, rue Émeric-David, 15. »
13 janvier
Zola publie une lettre ouverte au président de la République, « J’accuse », à propos de l’affaire Dreyfus. À la suite à cet article, il est condamné le 23 février.
Zola, « J’accuse », L’Aurore, 13 janvier 1898 ; signé La Revue blanche, 1er mars 1898, p. 321.
Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 142 :
« Quand vers 1899, le jeune peintre Louis Le Bail lui parla de Zola, à propos de cette affaire [l’affaire Dreyfus], Cezanne se mit à rire et résuma son opinion en ces quelques mots : « on lui a monté un bateau » (2). Ce fut tout.
(2) Renseignement communiqué par M. Louis Le Bail. »
De retour à Paris, Cezanne habite à Clichy.
« Une fois encore il la quitta pourtant [la Sainte-Victoire]. Il passe l’hiver de 1898 à Paris, et à peu près toute l’année suivante. Il habitait un appartement à Clichy, tout près de son atelier [rue Hégésippe-Moreau]. Il en sortait peu. Il y fit des portraits, ses grandes natures mortes, s’enfonça de plus en plus dans le culte des Vénitiens et du Poussin, dans la désespérance aussi. »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 102.
En réalité, la famille a déménagé au 31 rue Ballu avant mai 1898 (voir plus bas), tout près de la Place de Clichy : Joachim Gasquet extrapole.
Visa de la gendarmerie sur le livret militaire de Paul junior, communiqué par Philippe Cezanne
A son retour à Paris vers le 10 décembre 1897, la famille a retrouvé d’abord son ancien appartement, « abandonné depuis 7 mois » :
Lettre d’Hortense Cezanne à Mme Chocquet, 30 décembre 1897
Il prend un atelier près de chez lui, villa des Arts, 15, rue Hégésippe-Moreau, au quatrième étage, qu’il conservera jusqu’en 1899.
Calepins cadastraux, D1P4, Archives de Paris ; Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 91-92.
Imbourg Pierre, « Cezanne et ses logis… à Paris », Beaux-Arts, n° 316, 20 janvier 1939, p. 3 :
« 15, rue Hégésippe-Moreau
Cezanne loua un atelier en 1898, 15, rue Hégésippe-Moreau, dans la « charmante cité [villa] des Arts ». Ce fut probablement son dernier domicile parisien.
Les ateliers s’y étendent sur deux étages, des appartements bourgeois leur font face. Dans la cour, une pelouse ajoute à l’atmosphère aisée de cette cité. »
Des reproductions de dessins de Forain décorent les murs. Lors d’une visite, Vollard constate que :
« Cezanne tenait Forain en grande estime. Dans son atelier de la rue Hégésippe-Moreau il y avait, piqués aux murs, toutes sortes de dessins du satirique de Doux Pays. »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 228.
« Doux pays » est le nom d’une série hebdomadaire de dessins de Forain publiées dans Le Figaro entre le 5 janvier 1894 et le 29 décembre 1898. En 1898, Forain se déchaîne par ses caricatures foncièrement antisémites et antidreyfusardes qu’il publie dans le journal hebdomadaire Psst…!, qu’il fonde en 1898 avec Caran d’Ache et le soutien actif de Degas et Maurice Barrès. Le journal paraît du 28 février 1898 au 28 janvier 1899.
La « grande estime » de Cezanne pour Forain constitue l’un des minces indices qui permettent de supposer que Cezanne était antidreyfusard, même si les dessins de Forain qu’a vus Vollard provenaient de la série du « Doux pays » et non de Psst…!
Forain, « Doux pays », Le Figaro, 40e année, 3e série, n° 5, vendredi 5 janvier 1894, p. 1.
Forain, « Doux pays », Le Figaro, 44e année, 3e série, n° 363, jeudi 29 décembre 1898, p. 3.
Forain, Doux Pays, 189 dessins, Paris, Librairie Plon, 1897, 209 pages.
Psst…!, images par Forain, Caran d’Ache, première année 1898-1899, Paris, librairie Plon, recueil des numéros 1, 28 février 1898, à 52, 28 janvier 1899.
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 228 :
« De même que Degas, Cezanne tenait Forain en grande estime. Dans son atelier de la rue Hégésippe-Moreau il y avait, piqués aux murs, toutes sortes de dessins du satirique de Doux Pays. »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 123-143, p. 125 ; repris par Vollard Ambroise, « L’atelier de Cezanne », Mercure de France, 25e année, tome CVIII, n° 402, 16 mars 1914, p. 286-295, p. 287 :
« L’atelier de la rue Hégésippe-Moreau était encore plus simplement orné que celui d’Aix. Quelques reproductions de Forain, découpées dans les journaux, faisaient le fond de la collection parisienne du maître. Ce que Cezanne appelait ses Véronèse, ses Rubens, ses Lucas Signorelli, ses Delacroix, c’est-à-dire les images à un sou pièce dont j’ai déjà parlé, était resté à Aix. Je dis, un jour, à Cezanne qu’il pourrait avoir des reproductions très belles chez Braun. Il me répondit : « Braun vend aux musées. » Il regardait comme un luxe de nabab d’acheter quelque chose à un fournisseur de musées. »
Mars
Première intention de Maurice Denis de peindre son Hommage à Cezanne :
« Saint-Germain, mars 1898
[…] Faire un tableau de Redon dans la boutique de Vollard, entouré de Vuillard, Bonnard, etc. »Denis Maurice, Journal, tome I « (1884-1894) », Paris, La Colombe, éditions du Vieux Colombier, 1957, p. 143.
7 mars
Pissarro écrit à son fils Lucien.
« Je suis allé à l’exposition de Legros chez Bing, très importante. Selon moi, ses eaux-fortes sont de beaucoup supérieures à sa peinture, quoique par-ci par-là Rembrandt est mis à contribution ! Quant à la peinture, elle m’est désagréable ; quand on aime Rembrandt comme je l’aime, je trouve les imitateurs trop au-dessous, vraiment non ! C’est par trop pénible, sourd, plutôt noir de ton et même les motifs de chaumières coniques sont par trop chipés. A quoi bon regarder en arrière et jamais la nature si belle, si lumineuse et si diverse de caractère ? Toujours dans la poussière des vieux maîtres, que l’on ne devrait pas démarquer sous prétexte de les vénérer, il me semble qu’il vaut mieux suivre leur exemple en cherchant nos éléments dans ce qui nous entoure, avec nos propres sens. Je dis peut-être une grosse bêtise, cela ne fait rien, j’y tiens ferme. J’ai vu des paysages de Courbet dernièrement, c’est autrement mieux et bien à lui, Courbet… Et Cezanne tout en ayant du caractère, cela empêche-t-il qu’il soit lui ?… A quoi bon répéter sans se lasser ce qui a été si bien fait ! Et Manet, et Degas, qui va de l’avant sans cesse, qui trouve du caractère dans tout ce qui nous entoure, ce n’est pas de l’impuissance, cela ! Cela m’a attristé de voir en somme un homme aussi bien doué que ses camarades, mais que la théorie a perdu ! Voilà, mon cher Lucien, les réflexions que j’ai eues franchement en regardant les Legros ; je n’ai pas senti le coup de fouet. »
Lettre de Pissarro, Paris, hôtel du Louvre, à son fils Lucien, 7 mars 1898 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1523, p. 458.
Printemps 1898 ?
Rewald situe à cette date l’épisode avec le baron Denys Cochin.
25 avril
Ouverture du salon de la Société nationale des beaux-arts, où le Balzac de Rodin fait scandale. Après le refus de la statue par la Société des gens de lettres, qui l’avait commandée en 1892, Mathias Morhardt, rédacteur au Temps, prend l’initiative d’une souscription pour son achat.
Lecomte, « Le triomphe du Balzac de Rodin », L’Illustration, 1er juillet 1939, p. 335-336.
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 115.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 160.
Mai
Visa de la gendarmerie sur le livret militaire de Paul junior, avec pour adresse 31 rue Ballu (renseignement communiqué par Philippe Cezanne)
Mai
Degas achète pour 200 francs un tableau de Cezanne représentant des poires vertes, qu’il décrit ainsi : « rentoilé ― sans doute un morceau de tableau ».
« Notes inédites de Degas », dans Degas, catalogue d’exposition, Paris, Grand Palais, 9 février – 16 mai 1988 ; Ottawa, musée des Beaux-arts du Canada, 16 juin 1988 – 28 août 1988 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, 27 septembre 1988 – 8 janvier 1989 (catalogue établi par la présidente du comité scientifique Jean Sutherland Boggs, Henri Loyrette, Michael Pantazzi, Gary Tinterow avec la participation de Douglas D. Druick et la collaboration d’Anne Roquebert), p. 494.
1er mai, 15 mai, 1er juillet
Signac publie, dans La Revue blanche, en trois parties, De Delacroix au néo-impressionnisme. Le texte paraîtra en livre l’année suivante aux Éditions de la Revue blanche. De courts passages de son livre concernent Cezanne.
« 1. Ceux qui, succédant à Delacroix, seront les champions de la couleur et de la lumière, ce sont les peintres que plus tard on appellera les impressionnistes : Renoir, Monet, Pissarro, Guillaumin, Sisley, Cezanne et leur précurseur admirable, Jongkind. […]
Les adeptes de la nouvelle technique n’ont fait que réunir, ordonner et développer les recherches de leurs précurseurs. La division, telle qu’ils l’entendent, ne se compose-t-elle pas de ces éléments de l’impressionnisme, amalgamés et systématisés : l’éclat (Claude Monet), le contraste (qu’observe presque toujours Renoir), la facture par petites touches (Cezanne et Camille Pissarro) ? […]
Cezanne, en juxtaposant, par touches carrées et nettes, sans souci d’imitation ni d’adresse, les éléments divers des teintes décomposées, approcha davantage de la division méthodique des néo-impressionnistes. […]
De même, la touche de Cezanne est le trait d’union entre les modes d’exécution des impressionnistes et des néo-impressionnistes. »
Signac Paul, « De Delacroix au néo-impressionnisme », La Revue Blanche, tome XVI, « I La technique de Delacroix », 1er mai 1898, p. 13-35 ; « II Les techniques de l’impressionnisme et du néo-impressionnisme », tome XVI, 15 mai 1898, p. 115-133 ; « III L’éducation de l’œil », 1er juillet 1898, p. 357-369, Cezanne p. 115, 123, 128, 129.
9 mai – 10 juin 1898
« Exposition Cezanne », Galerie Vollard, 6, rue Laffitte.
Un carton annonce l’exposition, illustré d’une lithographie (V 1264), « Composition inédite de Cezanne », réalisée d’après ses Baigneuses (FWN942-R458), et comportant au verso une liste des œuvres. Les 60 toiles exposées appartiennent au marchand.
- Nature morte
- Nature morte
- Nature morte
- Paysage
- Nature morte
- Paysage
- Paysage
- Paysage
- Nature morte
- Nature morte
- Paysage
- Nature morte
- Nature morte
- Joueur de cartes [R 708]
- Paysage
- Paysage
- Nature morte
- Paysage
- Intérieur
- Paysage
- Nature morte
- Nature morte
- Nature morte
- Nature morte
- Le fumeur
- Paysage
- Paysage
- Paysage
- Paysage
- Paysage
- Paysage
- Nature morte
- Paysage
- Fleurs
- Nature
- Fleurs
- Portrait
- Portraits
- Fleurs et fruits
- Paysage
- Nature morte
- Nature morte
- Fleurs
- Paysage
- Fleurs et fruits
- Fleurs
- Nature morte
- Marine grise [FWN60-R170]
- Fleurs et fruits
- Fleurs et fruits
- Marine
- Paysage
- Marine
- Portrait de Mme C.
- Portrait de Mme C.
- Le cabaret
- Portrait
- Le Cygne et Léda [FWN660-R447]
- Paysage
- Nature morte
Revue de presse
Y. R. [Rambosson Yvanhoé], « Petites Expositions. Exposition de peintures, dessins, eaux-fortes d’Alfred Muller (galerie Vollard) », La Plume, 10e année, n° 217, 1er mai 1898, p. 287 :
« Exposition de peintures, dessins, eaux-fortes d’Alfred Muller (galerie Vollard)
[…] (Dans une salle proche, d’intéressants Maurice Denis, M. Vollard annonce pour le 9 mai au soir le vernissage de l’exposition Cezanne). »Exposition Cezanne, Paris, Galerie Vollard, 9 mai – 10 juin 1898, carton de l’exposition au musée Granet.
T., « Au jour le jour », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 7e année, n° 2056, jeudi 12 mai 1898, p. 2.
« Une exposition des œuvres du peintre Cezanne vient de s’ouvrir dans la galerie Vollard, 6, rue Laffitte. Elle durera jusqu’au vendredi 10 juin. »
Lettre de Stéphane Mallarmé à Marie et Geneviève Mallarmé, Valvins, jeudi [12 mai 1898] ; Mallarmé Stéphane, Correspondance, tome X, Paris, Gallimard, « nrf », 1984, n° MMDCCXXIII, p. 185 :
« J’ai été maussade, la journée, en craignant que l’exposition de Redon, dont la vente appartient à l’artiste, n’enrichisse pas Vollard, comme eût fait celle, qu’il projetait, de Cezanne, toiles à lui personnellement ; »
« Échos et nouvelles. Çà et là », L’Aurore, littéraire, artistique, sociale, 2e année, n° 208, samedi 14 mai 1898, p. 1:
« ÇÀ ET LÀ
Galerie Vollard. — Exposition Cezanne jusqu’au 10 juin. Natures mortes, paysages, fleurs et fruits. »
« Au jour le jour », Le Journal du dimanche, 15 mai 1898. A voir
L’Estampe, 15 mai 1898, p. 3.
Lettres de Stéphane Mallarmé à Marie et Geneviève Mallarmé, Valvins, Lundi [16 mai 1898] ; Mallarmé Stéphane, Correspondance, tome X, Paris, Gallimard, « nrf », 1984, n° MMDCCXXX, p. 193-194 :
« Lu tout à l’heure, dans le Journal, que l’exposition Cezanne ouvrait tout de même chez Vollard, ce qui permet d’espérer ; »
« Lettres, sciences & arts. Exposition », Journal des débats politiques et littéraires, 110e année, n° 134, dimanche 15 mai 1898, p. 3 :
« Exposition. Une exposition des œuvres du peintre Cezanne vient de s’ouvrir dans la galerie Vollard, 6, rue Laffitte. Elle durera jusqu’au vendredi 10 juin. »
« Expositions nouvelles », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 21, 21 mai 1898, p. 187 :
« CONCOURS ET EXPOSITIONS
EXPOSITIONS NOUVELLES
Paris
Exposition de M. Cezanne, galerie Vollard, 6, rue Laffitte, jusqu’au 10 juin. »
Fontainas André, « Art moderne », Mercure de France, tome CXVI, n° 102, juin 1898, p. 890. A voir
Natanson Thadée, « Notes sur l’art des Salons », La Revue blanche, tome xvi, 1er juin 1898, p. 220.
« Cependant, dans la galerie de M. Vollard, a lieu une exposition d’œuvres de MM. Cezanne et Redon.
Les amateurs de peinture et tous ceux qui sont épris des arts plastiques auront goûté, dans la société de ces artistes qui comptent parmi les plus considérables de ce temps, des joies pures et intenses dont on ne sent pas le courage de parler en passant et avec des mots dont on s’est usé le relief. »
Parsons Léon [Camille Mauclair ?], « Un initiateur », La Presse, 65e année, nouvelle série, n° 2206, dimanche 12 juin 1898, p. 3.
« UN INITIATEUR
Il y a de la tristesse à penser que la salle disgracieuse où M. Vollard vient de réunir un certain nombre des œuvres de Paul Cezanne retient vraiment entre ses murs toute la vie d’un artiste, qui aspirait à d’autres gloires et dont les peintures, aux tons violents et aux attitudes de héros titanesques, auraient pu resplendir en fresques éclatantes sur les panneaux des Panthéon et des Louvre.
Il n’en sera pas ainsi, car les événements n’ont pas amené de coïncidences favorables. Paul Cezanne ne sera pas cité à côté des Puvis de Chavannes ou des Manet, qui nous donnèrent de leur conception une réalisation définitive ; sa gloire sera plus discrète, mais son nom ne sera pas oublié cependant ; c’est celui d’un initiateur.
Avant d’autres, plus célèbres que lui, il a compris que le peintre devait oublier les procédés de l’art officiel pour s’abandonner à l’« impression » directe de la nature et la rendre spontanément.
« Il se serait coupé le poignet plutôt que de retourner au Louvre gâter son œil à une de ces copies qui encrassent pour toujours la vision du monde où l’on vit. Est-ce que, en art, il y a autre chose que de donner ce qu’on a dans le ventre ? Est-ce que tout ne se réduit pas à planter une bonne femme devant soi, puis à la rendre comme on la sent ? Est-ce qu’une botte de carottes, oui, une botte de carottes, étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle, où on la voit, ne vaut pas les éternelles tartines de l’Ecole, cette peinture au jus de chique, honteusement cuisinée d’après les recettes ? Le jour viendra où une seule carotte originale sera grosse d’une révolution.
C’est ainsi ― ou à peu près ― que résonne le Claude Lantier d’un des romans les plus achevés de Zola, le peintre dont le romancier nous a décrit, dans l’Œuvre, les luttes émouvantes avec l’idéal entrevu qu’il ne savait atteindre. Mais ce Claude Lantier, ami de l’écrivain Pierre Sandoz, ce « garçon maigre, aux articulations noueuses, à la forte tête barbue », n’est-ce pas Paul Cezanne lui-même tel que nous l’a fait entrevoir Pissaro et « la petite ville provençale où le peintre et le romancier s’étaient connus en huitième, dès leur première culotte usée sur les bancs du collège », c’est Aix-en-Provence, la ville natale d’Émile Zola et de Cezanne, la ville où ils unirent leurs rêves, où ils prirent conscience d’eux-mêmes, jusqu’au jour où ; tous les deux ; ils vinrent à Paris et y passèrent ensemble leurs années de début. Chaque jeudi on dînait chez Sandoz, où il y avait réunion. Mais voici que bientôt Émile Zola est devenu riche et célèbre et le noble Cezanne ne se sent plus à l’aise dans ce milieu de l’homme « arrivé ». Il sent confusément que l’auteur de tant de romans à succès n’est plus le Pierre Sandoz des années de luttes, celui en compagnie duquel il « s’affolait de gloire », auquel il disait ses enthousiasmes, ses victoires et ses défaites héroïques.
Paul Cezanne cessa un jour de voir son ancien ami ; quelques-uns prétendent que ce fut au lendemain de la publication de l’Œuvre. Quel que soit le motif de la séparation, elle est certainement à l’honneur des deux artistes, qui ont tenu à bifurquer dans la vie le jour où ils ont cessé de suivre en art la même voie douloureuse.
Les lecteurs d’Émile Zola doivent à Claude Lantier une visite à cette galerie Vollard où se trouvent réunies les œuvres du peintre Cezanne.
Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion d’en étudier certaines, et je me souviens d’une toile où des flammes multicolores se tordent vers un ciel bleu. Vue à distance, cette œuvre inachevée représente une orgie, au bord de la mer, où des couples d’amants s’étreignent. Je ne l’ai pas revue hier dans la galerie Vollard, mais, en revanche, j’ai pu observer, sur les panneaux de droite et de gauche, des paysages, jardins d’habitation bourgeoise, qui donnent à qui s’en éloigne un peu l’impression exacte de la réalité. Les personnages qui animent parfois ces jardins sont inachevés, mais d’une allure surhumaine. Quant aux « natures mortes » qui sont à profusion, elles font regretter qu’une telle faculté décorative soit demeurée inemployée. Elles sont bien de celui qui prévoit le jour où « une seule carotte originale sera grosse d’une révolution ».
Léon Parsons. »
« Expositions nouvelles », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 23, 25 juin 1898, p. 219 :
« CONCOURS ET EXPOSITIONS
EXPOSITIONS NOUVELLES
Paris
Exposition de peintures de M. Cezanne, galerie Vollard, 6, rue Laffitte. »
« Les Œuvres de Paul Cezanne », Le National, journal de la démocratie de l’arrondissement d’Aix, 28e année, n° 1409, dimanche 26 juin 1898, p. 3.
« Les Œuvres de Paul Cezanne.
— Depuis quelques jours, les artistes et les amateurs parisiens se rendent rue Laffite pour voir une collection importante des tableaux de notre compatriote M. Paul Cezanne.
Cette exposition a ses critiques comme toutes les choses artistiques originales, mais le nombre des approbations s’est accru considérablement et l’œuvre de Paul Cezanne est aujourd’hui classée dans le monde artistique.
Nous y reviendrons prochainement. »
Autres références
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 50 :
« J’ai vu, dans le galetas du Jas de Bouffan, une toile trouée, rayée de coups de couteau, souillée de poussière, échouée là je ne sais comment et qui a été brûlée, paraît-il, avec une trentaine d’autres, et du vivant même de Cezanne, sans qu’il daignât s’en occuper. Celle-ci, fauve, craquelée, martelée, flambante, quand j’eus essuyé la couche de poussière qui la salissait, me montra, accroupie sur une nuée en forme de cygne, une créature de chair torrentueuse, le ventre tendu, les seins gonflés, le mufle brasillant, splendide et hideux sous l’envolement d’une chevelure à la fois rousse et brune, les mains caillées de sang, un énorme collier, une chaîne d’or barrant sa cuisse, et le torse fouetté, comme une Danaé, d’une pluie de rayons et de louis. Autour d’elle, en pleine aube, un cercle hurlant, abominable, tordu, d’hommes en habits, des prêtres, des généraux, des vieillards, un enfant, des ouvriers et des juges, des trognes à la Daumier, mais boursouflées de carmin, comme d’un coup de sang, des corps orageux mordus d’un dantesque arc-en-ciel de nuances baroques qui s’enroulait à eux comme un serpent, un tourbillon de bras crispés ― et sous une étoile, dans un coin noir du ciel, une blanche apparition qui se voilait les yeux.
― « Hein ? Ça plairait à Mirbeau », me fit Cezanne qui me surprit en contemplation devant cette page d’apocalypse, et d’un coup de pied il envoya la toile rouler au fond du grenier. »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 161-172 :
« X
CÉZANNE ET ZOLACézanne m’avait parlé de certaines toiles de sa jeunesse, qu’il avait données à Zola, et j’avais la plus grande envie de les voir. M. Mirbeau, devant qui j’avais exprimé ce désir, voulut bien me remettre pour Zola une lettre d’introduction, où il se gardait toutefois de lui parler de ses Cézanne. « Zola en est tellement jaloux, que je n’ose pas lui demander de vous les montrer. » M. Mirbeau expliquait seulement, dans la lettre, que j’étais à la recherche de beaux caractères typographique pour une prochaine édition du Jardin des Supplices, et que je serais très heureux de voir une adresse de sympathie récemment envoyée à Zola par un groupe de Belges partisans de Dreyfus, et imprimée avec les célèbres caractères Plantin.
À mon arrivée chez Zola, on me fit traverser un vestibule où s’étalait une immense composition de Debat-Ponsan, représentant la Vérité sortant du Puits, avec, comme devise : Nec mergitur, et comme titre : La Vérité dressant son miroir s’efforce de sortir du puits, où la maintiennent l’hypocrisie de Basile et la rude poigne de la force brutale. Puis je pénétrai dans un salon rempli d’objets de piété. Le jour entrait par deux verrières dont l’une représentait des scènes de légendes, et l’autre montrait Coupeau taillant dans une miche. J’admirai tant d’éclectisme. Il régnait en ce lieu une paix délicieuse ; et je compris alors toute la grandeur du sacrifice de Zola, quand il quittait ce home exquis pour aller défendre l’innocence, au milieu de l’atmosphère empestée des réunions publiques.
Le maître ne tarda pas à paraître portant, serré contre sa poitrine, un petit chien des plus hargneux et des plus laids, le cher adoré Pinpin, et tenant dans la main restée libre un exemplaire de la Débâcle. Il surprit mon coup d’œil à Coupeau ; son visage se fit bienveillant.
« Ah, oui ! les caractères Plantin, dit-il, après avoir pris connaissance de ma lettre d’introduction. Je tâcherai de remettre la main sur cette adresse de mes admirateurs belges ; mais je reçois tant d’adresses, de tous les coins du monde, qu’il peut s’en égarer quelques-unes. Vous n’aurez pas de peine, en tout cas, à trouver aussi bien, et même mieux, chez nos grands fondeurs d’aujourd’hui. Il n’est pas possible que, depuis Plantin, l’art de l’imprimerie soit resté rebelle au progrès, qui s’accomplissait dans tous les autres arts. »
Dans ma crainte d’éveiller les susceptibilités de Zola, je me gardais de mettre la conversation sur les « Cézanne » ; ma tactique était d’amener le maître à m’en parler de lui-même. Je me bornais à témoigner mon admiration pour tout ce qui garnissait le salon.
« Et mon Debat-Ponsan ?…. interrompit Zola. Ce qui fait si émouvante cette Vérité sortant du Puits, c’est qu’on semble entendre, devant cette toile, le cri de conscience d’un honnête homme. Quand le peintre me fut présenté, comme je lui exprimais mon admiration pour son œuvre, il me dit, les larmes aux yeux : « J’ai voulu rendre seulement l’âme « nue de l’abominable Basile, sans m’apercevoir que je peignais, du même coup, le tableau le mieux réussi de ma carrière d’artiste. Je n’ai, d’ailleurs, aucun mérite à cela : ce n’est pas ma main : c’est mon cœur qui guidait mon pinceau. » Ah ! celui-là, conclut Zola, c’est plus encore qu’un grand peintre, c’est un grand caractère ; et c’est parce qu’il est un grand caractère, qu’il est devenu un grand peintre. Quelle leçon pour les artistes qui ne cherchent pas, avant tout, à être des hommes ! Ils ne feront jamais de chefs-d’œuvre, car c’est avec son sang qu’on écrit, qu’on peint, qu’on sculpte le chef-d’œuvre…
Moi, timidement. — Il me paraît, maître, que la Vérité, et peut-être aussi le Basile, ont un peu passé de ton.
Zola. — Les plus grands maîtres noircissent à la longue : devons-nous cesser pour cela de les admirer ? »
Je m’étais approché d’un ange en ivoire suspendu au plafond par une ficelle, mais qui, avec ses ailes éployées, donnait l’illusion de planer par ses propres moyens.
« Le bel ange ! m’écriai-je.
Zola. — On le dit du treizième siècle ; mais je vous avoue que je ne me préoccupe ni des époques, ni des styles. Un artiste demande à un objet d’art de lui donner de la joie, sans plus.
Moi. — On se croirait ici dans un musée.
Zola. — Avant d’écrire un livre, je fais provision de documents. C’est avec ces mille riens charmants que j’ai fait le Rêve.
Moi. — Et vous avez découvert tous ces trésors à Paris ?
Zola. — Je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Toute cette moisson a été faite dans mon quartier, et à très bon compte. Ce ne sont pas les occasions qui manquent : mais si peu de gens savent voir !
Moi, apercevant dans un joli cadre du temps le portrait d’une fillette réchauffant un petit oiseau entre ses seins nus. — L’influence de Greuze ?
Zola, vivement. — Des connaisseurs l’attribuent même à Greuze.
Moi, découvrant, dans le voisinage de la fillette à l’oiseau, un tableau représentant un groupe de femmes nues suspendues à la voûte céleste par des chaines d’argent. — Ary Scheffer ?
Zola. — C’est là un des chefs-d’œuvre de cet amant passionné de l’idéal qui n’a produit que des chefs-d’œuvre : le Corneille de la peinture, complétant si bien notre Greuze, qui en est le Racine. »
Une telle bonhomie se lisait sur le visage de Zola que je me risquai à parler de Cézanne.
« Une question me brûle les lèvres, maître, mais j’ai tellement abusé déjà de votre longanimité…
Zola, indulgent. — Parlez !
Moi. — Les lettres que vous écrivîtes à M. Cézanne et qui nous seraient tellement nécessaires, à nous aussi, pour nous apprendre à sentir et à penser, ces lettres existent-elles toujours ? Je n’ai pas osé en parler à M. Cézanne, parce que je ne voulais pas lui donner des remords éternels si, n’ayant pas conservé ces précieux papiers, il s’était rendu compte subitement de la responsabilité qu’il encourait devant la postérité.
Zola. — Comme vous, j’ai eu peur pour ces lettres, où je donnais le meilleur de moi-même. Mais, grâce au ciel, Cézanne, malgré son insouciance, avait su garder précieusement les moindres billets que je lui écrivais. Quand je lui redemandai ma correspondance, pensant que la publication pourrait en être précieuse pour les jeunes artistes qui ne manqueraient pas de faire leur profit des conseils qu’un ami donnait, avec tout son cœur, à un ami, il me rendit le paquet, où pas une lettre ne manquait. Ah ! pourquoi mon ami ne m’a-t-il pas donné, aussi, le grand peintre sur lequel je comptais tant ?
Moi. — Quelle confiance vous aviez mise en M. Cézanne !
Zola. — Nos camarades le tenaient volontiers pour un raté, et moi je ne cessais de leur crier : « Paul a le génie d’un grand «peintre ! » Ah ! pourquoi n’ai-je pas été bon prophète en la circonstance ?
Moi. — Mais M. Cézanne était un travailleur enragé, et, de plus, il avait une imagination de poète !
Zola. — Mon cher grand Cézanne avait l’étincelle. Mais s’il eut le génie d’un grand peintre, il n’eut pas la volonté de le devenir. Il se laissait trop aller à ses rêves, des rêves qui n’ont pas reçu leur accomplissement. Suivant ses propres paroles, il s’était mis en nourrice chez les Illusions !
Moi. — Vous avez des tableaux de M. Cézanne ?
Zola. — Je les avais cachés à la campagne. Sur les instances de Mirbeau, qui voulait les voir, je les ai fait rapporter ici. Mais je ne les mettrai jamais au mur. Ma maison, vous ne l’ignorez pas, est la maison des artistes. Vous savez combien ils sont justes, mais sévères entre eux. Je ne veux pas abandonner au jugement de ses pairs le compagnon de ma jeunesse, mon ami le plus cher. Les tableaux de Cézanne sont enfermés, sous triple verrou, là, dans cette armoire, à l’abri des regards malveillants. Ne me demandez pas de les sortir, cela me fait trop de peine, quand je pense à ce que mon ami aurait pu être, s’il avait voulu diriger son imagination et aussi travailler sa forme, car, si on naît poète, on devient ouvrier.
Moi. — Vos conseils expérimentés n’ont pas manqué pourtant à M. Cézanne, maître ?
Zola. — J’ai tout fait pour galvaniser mon cher Cézanne, et les lettres que je lui ai écrites m’ont ému à un tel point que j’en conserve jusqu’aux moindres mots dans mon souvenir. C’est à son intention que j’ai produit I’Œuvre. Le public se passionna pour ce livre, mais mon ami resta indifférent. Rien ne pourra plus le sortir de ses rêveries ; de plus en plus, il s’éloignera du monde réel… »
Ces derniers mots, prononcés d’une voix tremblante, furent suivis d’un silence.
Moi. — « Mais s’il n’a pu réaliser son œuvre, M. Cézanne, du moins, dans ses lettres, disait-il des choses intéressantes sur la peinture ?
Zola, baisant tendrement son petit chien. — Tout ce qu’écrivait Cézanne était imprévu et original : mais je n’ai pas conservé ses lettres, je n’aurais voulu pour rien au monde qu’elles fussent lues par d’autres, à cause de cette forme un peu lâchée…
Moi, interrompant. — Là encore votre amitié…
Zola. — Tout cela est tellement lointain !… Je me rappelle cependant, après une de ces missives qui fleurait si bon la Provence, avoir dit à mon ami : « J’aime ces pensées étranges comme de jeunes bohémiennes au regard bizarre, les pieds boueux, la tête « fleurie. » Mais je ne pus m’empêcher d’ajouter : « Notre souverain maître, le Public, se satisfait plus difficilement. Il fait fi des princesses pauvrement vêtues… Pour trouver grâce à ses yeux, il ne suffit pas de dire, il faut bien dire. »
Au même instant, une bande d’enfants passaient sous les fenêtres de l’hôtel de Zola en criant : A bas Zola ! Conspuez Dreyfus ! « Les misérables ! » fis-je poliment, pendant que le petit chien jappait avec fureur. Mais le visage de Zola était empreint de cette sérénité des martyrs marchant au supplice.
« Non, pas des misérables, mais de pauvres égarés, qu’une trop grande lumière aveugle ! Le hibou, non plus, ne voit pas en plein midi. »
Et replongeant le nez dans la fourrure de Pinpin, il lui disait : « Tu n’es pas méchant, toi ! » Puis il murmura :
« Ils ont des yeux, et ne voient pas ; des oreilles, et n’entendent pas…
Moi. — Ce n’est pas seulement de l’aveuglement que l’on observe chez vos ennemis, mais de la haine, une haine réfléchie…
Zola. — Oui, une haine réfléchie. J’en suis bien malheureux, moi qui aurais tant aimé être aimé de tous !
Moi. — Maître, vous avez pour vous l’élite des penseurs.
Zola. — Mais la foule m’échappe.
Moi. — Les serpents de l’envie ne sont pas immortels ; un jour viendra où les yeux se dessilleront. Déjà, j’ai entendu ce cri : vive Zola !
Zola. — Demain, ceux-là même, peut-être, me hueront.
Moi. — Pourtant, ces tirages à cent cinquante mille exemplaires !
Zola. — Ne sont pas les tirages à un million d’exemplaires que Jules Mary obtient dans le Petit Journal. »
Et Zola, les yeux rêveurs, murmurait, se parlant à soi-même : « Le Petit Journal, un million d’exemplaires ! »
Pour faire diversion à ces tristes pensées, je rapportai au maître ce que l’on m’avait dit de la grosse vente à l’étranger de sa Débâcle.
Zola. — « En effet, c’est celui de mes ouvrages qui a été le plus apprécié du public.
Moi. — Et vous, maître, est-ce celui qui vous plaît le plus ?
Zola. — Un artiste préfère toujours l’œuvre qu’il va faire : je dois avouer cependant que j’ai une certaine prédilection pour la Débâcle ; nous en sommes à deux cent mille exemplaires. »
C’est sur ces mots que je pris congé de l’illustre ami de Cézanne. »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 270-273 :
« J’étais allé chez Zola avec une carte de recommandation de Mirbeau, dans l’espérance de voir quelques tableaux de la jeunesse de Cézanne, que possédait l’auteur de Nana.
En arrivant chez le romancier, dès l’antichambre, on s’arrêtait, comme malgré soi, devant une imposante composition de Debat-Ponsan représentant La Vérité sortant du puits. Deux verrières, dont l’une figurait un vénérable anachorète et l’autre un personnage de l’Assommoir, complétaient la décoration de la pièce.
Le salon voisin, où l’on me fit pénétrer, était un vrai musée. Ici, un vase sur lequel était peint un Chinois sous un parasol ; à côté, le portrait d’une fillette réchauffant entre ses seins un petit moineau ; plus loin, un tableau représentant des femmes nues. Je ne parle pas des objets de vitrine : miniatures, ivoires, etc.
Je m’étais arrêté devant un ange aux ailes éployées, retenu au plafond par une attache invisible. À ce moment, Zola entra et à peine avais-je eu le temps de le saluer que, désignant de la main l’objet que je regardais :
— Mirbeau aime beaucoup ça. Il trouve qu’il y a, dans ce morceau dû au ciseau d’un anonyme du quinzième siècle, une taille qui présage Rodin.
Puis, avec la bonhomie qui le caractérisait, Zola se mit à me faire les honneurs de ses trésors.
— Cette fillette à l’oiseau est un Greuze des dernières années de l’artiste ; ce canapé est d’époque ; le vase chinois…
— Un Ming, m’écriai-je à tout hasard.
— Non, un Jacob Petit… Ces Femmes nues, que l’artiste a représentées liées par des chaînes d’argent comme pour symboliser le destin de la courtisane… un Ary Scheffer déniché rue Lepic.
Encore que je ne voulusse rien perdre des moindres paroles du grand romancier, je ne quittais pas des yeux un affreux petit chien qui se débattait dans les bras de son maître comme s’il voulait s’élancer sur moi. Zola, alors, cajolant la vilaine bête : « Il aime bien son maître, le petit Pinpin… »
L’occasion de parler des toiles de Cézanne me fut fournie par Zola lui-même qui avait pris à la main un ivoire japonais.
— Les Japonais, hasardai-je, quelle influence ils ont eue sur les impressionnistes ! À part Cézanne, n’est-ce pas ?
— Cézanne !… Cette vie en commun que nous avons menée à Aix et à Paris ! Tous nos enthousiasmes !… Ah ! pourquoi mon ami n’a-t-il pas donné l’œuvre que j’attendais de lui ? J’avais beau lui crier : « Tu as le génie d’un grand peintre ; aie le courage de le devenir. » Hélas ! il n’écoutait aucun conseil.
Zola marchait de long en large dans la pièce, tenant toujours dans ses bras le cher Pinpin. Je me hasardai à lui parler des toiles qu’il avait de Cézanne. Le Maître s’arrêta et frappant de la main sur une armoire bretonne :
— Je les tiens enfermées là. Quand je dis à nos anciens camarades : « Paul avait le génie d’un grand peintre »… si j’allais leur mettre, en même temps, ces toiles sous les yeux !…
À ce moment, des gamins passant sous les fenêtres de l’hôtel se mirent à crier : « À bas Dreyfus ! Conspuez Zola ! »
— Oh ! m’exclamai-je dans une désapprobation polie.
— Ce sont des égarés, reprit le Maître avec bonté. Je leur pardonne.
Je demandai à Zola quel était celui de ses livres qu’il préférait.
— Un écrivain préfère le livre auquel il travaille, mais j’avoue une certaine prédilection pour ma Débâcle… Nous en sommes aux deux centième mille.
J’ai rapporté, tout au long, dans mon livre sur Cézanne, le récit de cette visite à Zola. Je m’étais appliqué à reproduire mot pour mot les paroles du maître. Or, quelques jours plus tard, je recevais du Courrier de la Presse une coupure du Bonnet Rouge. C’était un article de M. Frantz Jourdain, où j’étais traité de la belle façon : « … Si un roquet lève la patte sur Notre-Dame, Notre-Dame n’en est pas salie, non… »
Sur ces entrefaites, je reçus la visite d’un ancien procureur général de l’île de La Réunion qui avait la réputation d’un fin lettré.
— Mon cher Vollard, me dit-il sans préambule, comment vous, dont le père était un si digne homme, avez-vous pu montrer tant de platitude devant Zola ?
— Mais, repartis-je, c’est tout le contraire que me reproche M. Frantz Jourdain.
— Il peut dire ce qu’il veut, ce Frantz Jourdain, les mots sont là.
Comme je rapportais cet entretien à M. Albert Besnard, l’un des amis de l’architecte de la Samaritaine :
— Les mots sont là!… Il a trouvé ça, votre procureur général. C’est admirable.
— Cependant, hasardai-je…
Alors, Besnard, souriant :
— Allons, Vollard, ne me faites pas marcher… »
En 1896, des tableaux de Cezanne étaient accrochés aux murs du cabinet de travail de Zola à Médan :
Saint-Georges de Bouhélier, Le Printemps d’une génération, Paris, les éditions Nagel, 1946, 356 pages, p. 287.
« Il [Zola] venait d’atteindre cinquante-six ans et j’en avais vingt. […]
Son cabinet de travail donnait sur la rue. Des vitraux plaqués aux fenêtres en tamisaient la lumière. Aux murs, des tableaux de maîtres récents mettaient leur tache rude. Le portrait à l’huile de Zola par Édouard Manet, un pastel de Madame Zola dû au même artiste, des tableaux de Cezanne, des toiles de Monet en pavoisaient la surface. Le mobilier était rouge et strié de noir. ».
Xau Fernand, Émile Zola, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1880, 68 pages, p. 7 :
« Aux murs [du cabinet de travail de Zola, 23, rue de Boulogne], de nombreux tableaux, la plupart sans grande originalité, sans sérieuse valeur. Tous appartiennent à l’école impressionniste. Les plus remarquables sont le portrait que Manet a fait de M. Zola ; puis des paysages de Guillemet, Monet, Cezanne, Pissaro [sic], etc. »
Huysmans avait pu voir des tableaux de Cezanne chez Zola, mais on ne sait pas quand.
« Chez Monsieur Huysmans. Interview d’un disciple. Les soirées de Médan. Souvenirs émus. Quelques anecdotes », Le Matin, 19e année, n° 6792, mardi 30 septembre 1902, p. 2 :
« Dès ce moment, pourtant, il [Zola] était artiste, aimant les beaux tableaux, les jolies choses. Il avait un Monet, des Cezanne… Mais surtout, il aimait les chiens. »
17 mai
Cezanne envoie sa souscription à Geffroy pour l’acquisition du Balzac de Rodin.
« Paris, 17 Mai 1898,
Cher monsieur Geffroy,
Je suis heureux de m’associer à la souscription dont vous voulez bien me faire part, Et je m’inscris pour 40 francs sur la liste des admirateurs du génie de Rodin.
Et regrettant par suite de circonstances accidentelles et indépendantes de ma volonté de ne pouvoir me rendre à votre bonne invitation, je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments,
P. Cezanne »
Adresse sur l’enveloppe :
« Monsieur Gustave Geffroy,
30, quai de Béthune,
Paris »
Cachet de la poste : « PARIS – 84 Bard DE CLICHY 4 H 17 MAI 98 »Lettre de Cezanne à Geffroy, datée « Paris, 17 Mai 1898 » ; coll. privée, Paris, musée des Lettres et Manuscrits.
Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cezanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 46.
De nombreux artistes, hommes de lettres, musiciens et critiques (Geffroy, Arsène Alexandre, Georges Lecomte, Forain, Monet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Besnard, Vuillard, Blanche, Signac, Luce, Carpeaux, Bourdelle, Maillol, etc.) y participent. Selon Vollard, Cezanne aurait tenu à souscrire pour montrer que les admirateurs de Rodin n’étaient pas tous dreyfusards. Renoir (antidreyfusard) souscrit pour 100 francs, Monet et Mirbeau pour 500 francs chacun ; Degas, très antidreyfusard, ne souscrit pas ; Vollard non plus. Pour mettre fin à la polémique, Rodin annulera la souscription et fera rembourser les participants.
Vollard Ambroise, En écoutant Cezanne, Degas, Renoir, 1938, p. 69.
Leseur Frédérique, « La souscription de 1898 », 1898 : le Balzac de Rodin, Paris, musée Rodin, 1998, p. 149-192.
Dans un article sur la sculpture de Rodin, Henri Rochefort évoque Cezanne, sans le nommer :
« Les Précieux ridicules
J’ai déjà reçu, à propos du Balzac de Rodin, un si fort stock de lettres, demandes d’avis et de consultations, que je suis bien obligé d’y répondre. Je crois même, en y répondant franchement, me montrer plus sérieusement l’ami de l’éminent sculpteur que ne le sont les esthètes qui, après l’avoir écrasé sous leurs adorations, finiront par l’y ensevelir tout à fait.
Sa statue de Balzac, évidemment éclose dans ces fumées spéciales, n’est pas l’impuissance, mais c’est tout au moins l’erreur. En art comme en politique, on compte un certain nombre d’anarchistes amateurs, dont c’est la spécialité de remplacer tout par rien. J’en ai connu un, peintre autrefois de quelque valeur, qui récemment s’écriait tout joyeux :
« Quel bonheur ! Je viens de m’apercevoir que je ne sais plus dessiner ! »
Ce sont sans doute les artistes et les critiques de cette école négative qui ont persuadé à Rodin qu’il savait trop dessiner et qu’il lui était indispensable de se corriger au plus tôt de ce vilain défaut. Aussi, quand ils ont vu l’image de l’auteur de la Comédie humaine au point où ils la rêvaient, sont-ils, dans leur enthousiasme tombés à la renverse. Car tomber à la renverse est encore une des particularités de ces spécialistes. »
Rochefort Henri, « Les Précieux ridicules », L’Intransigeant, n° 6518, 29 floréal, jeudi 19 mai 1898, p. 1.
Geffroy Gustave, « Le square de Rodin », L’Aurore, littéraire, artistique, sociale, 3e année, n° 638, mardi 18 juillet 1899, p. 1 :
« Le Square de Rodin
On annonce à la fois que Rodin a obtenu de la ville de Paris l’autorisation d’exposer son œuvre, en 1900, au petit square du pont de l’Alma, et que la Société des gens de lettres a accepté le Balzac de Falguière, qui sera donc probablement érigé sur la place du Palais-Royal.
Ces deux nouvelles sont intéressantes à publier en regard l’une de l’autre.
Nous aurons le Balzac de Falguière, au Palais-Royal ou ailleurs. Je ne crois pas qu’il nous soit possible d’y échapper. Mais cela est surtout regrettable pour Falguière, lequel a manifesté avec éclat que le savoir-faire, l’adresse, l’ingéniosité et toutes les autres charmantes qualités dont il peut être pourvu, sont impuissantes à certaines réalisations. Rodin, au dernier Salon, a d’ailleurs représenté, avec une évidente malice, son camarade Falguière un peu fatigué par son effort impossible. L’échec du nouveau Balzac, on peut le dire sans offenser la vérité, a été absolu. Il a été constaté par tous, par la critique des uns, par le silence des autres. S’il avait été, en effet, victorieux, le Balzac de Falguière aurait suscité un mouvement d’enthousiasme aussi considérable que le mouvement de dénigrement déchaîné par le Balzac de Rodin. L’enthousiasme était loin ! Ce fut le néant, l’indifférence chez les adversaires, la consternation chez les partisans. En 1898, au moins, on riait, et de quel rire !
En 1899, tout le monde se serait, mis d’accord pour pleurer.
Que la Société des gens de lettres ait reconnu Balzac à travers cette enveloppe vide, et qu’elle ait décidé de changer ce plâtre en marbre, il n’y a rien là pour nous étonner. La France est encombrée de statues de ce genre, et une de plus ou de moins, à Paris ou ailleurs, cela n’est pas pour changer nos habitudes.
La nouveauté, c’est que la demande de Rodin ait été accueillie, et que le petit square du pont de l’Alma, à l’angle du cours la Reine et de l’avenue Montaigne, lui ait été accordé pour exposer ses œuvres à l’écart, loin de la cohue de l’Exposition. La requête du sculpteur a été ardemment soutenue par le ministre de l’instruction publique, M. Georges Leygues, favorable aux lettres et aux arts, qui a eu l’initiative d’un classement du Louvre, et qui devrait bien, ceci dit incidemment, achever cette œuvre de haute utilité Le premier rapporteur qui eut à examiner, au Conseil, la pétition de Rodin, pour ce qui concerne le budget des promenades et des jardins de Paris, M. Escudier, se montra également parfait. Et enfin, le second rapporteur, M. John Labusquière, parlant au nom de la quatrième commission, chargée comme on sait, des relations de la Ville de Paris avec les artistes, aura eu la bonne fortune, par sa droite raison et par sa chaude éloquence, de parachever l’œuvre d’équité.
Tout cela n’est pas pour surprendre, et tous ces concours donnés à l’art étaient attendus. La surprise, c’est que ces convictions aient entraîné avec elles les hésitations et les hostilités. Le projet de Rodin, si simple pourtant, né de l’idée naturelle de montrer tout entière sa part de travail au grand rendez-vous de 1900, ce projet n’avait pas été bien accueilli de tous. Les mêmes plaisanteries qui servirent contre le Balzac firent rage, et tous ceux qui prétendent à diriger l’art ne montrèrent aucune faveur à l’acte individuel d’un isolé. Tenez pour certain qu’il y a un syndicat — un vrai, celui-là — qui favorise le banal et le médiocre, au détriment de la véritable force originale et puissante.
L’œuvre d’un artiste comme Rodin, on l’a bien vu l’an dernier, risque d’avoir contre elle la majorité, mal conduite et égarée par les habiles. Il n’est pas de sarcasmes qui n’aient été décochés contre l’artiste et contre ses rares défenseurs. La somme de réflexion et de volonté représentée par une œuvre comme le Balzac fut défigurée au point qu’on lui substitua je ne sais qu’elle sottise infatuée, quelle impuissance aboutissant à la grossièreté d’une ébauche. Il est bien difficile d’opposer des raisonnements et des démonstrations à des arrêts exprimés d’un tel ton. Comment faire admettre aux plaisants journalistes et aux critiques infatués que Rodin n’avait négligé aucun détail de sa statue, mais qu’il avait subordonné tous les détails à la masse, et que ce bloc, dénoncé comme à peine dégrossi, était fait au contraire d’une infinité de nuances significatives, bien à leur place, commandées par le souci de l’harmonie ?… Me voici encore à vouloir discuter et convaincre, alors qu’il ne faut attendre que le verdict du temps.
Ce verdict est plus proche qu’on ne pourrait le croire. Il n’y a pas tant d’années que les toiles d’Édouard Manet, de Claude Monet, de Paul Cezanne, d’autres encore, étaient traitées d’infâmes barbouillages au nom de l’École des Beaux-Arts et de l’Institut. Aujourd’hui, ces « barbouillages » ont place historique, continuent la grande tradition de la peinture, entrent dans nos musées malgré les fureurs, sont disputés par les musées étrangers et par les amateurs du monde entier. Ceux qui ont défendu le Balzac parce qu’ils ont senti sa beauté et aperçu qu’il nous ramenait, des jeux puérils de notre sculpture, à la grande tradition oubliée, ceux-là sont donc bien tranquilles, et sont les premiers à s’amuser des bourrasques de la chronique parisienne et des pétards des nouvelles à la main.
Les vraies réponses, ce sont les œuvres. Dans son square du pont de l’Alma, Rodin va répondre à ses détracteurs. Il va montrer, à l’univers que nous convions, ses travaux, ses recherches, ses inquiétudes, ses conquêtes, tout son labeur obstiné, la pensée toujours en travail. En réalité, c’est son atelier qu’il ouvre à la foule. Qu’elle vienne, cette foule, qu’elle vienne sans parti pris, avec sa naïveté, avec son innocence, qu’elle laisse les ricanements à ceux qui croient pouvoir prononcer et juger du haut de leur ignorance. Rodin, si l’on sait recevoir enseignement de son art, est un maître précieux. Pendant quarante années, il a appris, il apprend encore, et il offre à tous ce qu’il a trouvé.
Ceux qui n’ont pas deviné encore les trésors de sa science et l’infinie poésie de ses conceptions, vont être édifiés. Ils vont être mis, non seulement en face de la réunion des grandes œuvres aperçues aux Salons, l’Ève, le Baiser, le Victor Hugo, etc. ; mais ils vont, pour la première fois, se trouver en présence de la Porte de l’Enfer et de tant d’études de chaque jour, rêvées par l’esprit, observées sur la nature, façonnées par les mains de ce travailleur infatigable. Au milieu de toutes ces formes vivantes, je souhaite que se dresse le Balzac, devenu bronze, et je suis persuadé qu’il apparaîtra comme le résultat logique de ce labeur, comme la grande découverte heureuse qui a récompensé l’artiste de son obstination, de son vouloir acharné. Vous verrez que ce Balzac, refusé par la Société des gens de lettres, surgira dans la lumière avec sa force concentrée, son expression géniale, et que nous saurons le garder, cette fois, comme un chef-d’œuvre qu’il est. La ville de Paris, qui a su donner un square, pour une année, au sculpteur, saura bien donner pour toujours, une place à son œuvre.
Gustave Geffroy. »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 153-154 :
« Comme il était timide et faible dans la vie, Cezanne éprouvait de la méfiance à l’égard du militaire lâché en liberté, mais ce même militaire, bien tenu en main, et prêt à marcher sans barguigner contre les ennemis du dehors, et aussi du dedans, lui apparaissait un bienfait des Dieux. On comprend que l’amour de sa chère armée l’ait rendu antidreyfusard. C’est ainsi qu’après une lettre publique de Rodin, où le maître déplorait qu’il n’y eût à peu près exclusivement que des dreyfusards parmi les souscripteurs de son Balzac, Cezanne manifesta l’intention d’envoyer un bulletin de souscription au susdit Balzac. — « Ce Rodenn pense bien. C’est un brave homme ; il faut l’encourager. » »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 249 :
« — Monsieur Renoir, j’ai [Vollard] entendu dire à Cezanne qu’il mettait le Balzac au-dessus de toute la sculpture d’aujourd’hui.
— Et pas seulement, fit Renoir. Ce Balzac, d’un tel ensemble et si décoratif !… Ce n’est pas étonnant si Rodin a tant de gens contre lui… »
1er Juin
Cezanne demande à Geffroy de faire parvenir à qui de droit sa souscription pour le Balzac de Rodin.
« Paris, 1 juin 1898.
Cher Monsieur Geffroy,
Je me permets de
vous adresser un mandat
poste de 40 fr. montant
de ma souscription et
vous prie de
vouloir bien en faire
verser la valeur au
comité chargé de recevoir
les adhésions. Je n’ai pu
apprendre entre les mains
de qui j’eusse pu moi même
effectuer le versement.
Dans mon embarras, j’ai
pensé pouvoir recourir à
vous. —
Je vous prie d’agréer mes
excuses et mes plus sincères
salutations.
Paul Cezanne »
Lettre de Cezanne à Geffroy, datée « Paris, 1 juin 1898 ». Live Auction University Archives, September 29, 2021, 10:30 AM EST, Wilton, CT, US : « A 2pp autograph letter in French signed by Post-Impressionist artist Paul Cézanne (1839-1906) as « Paul Cézanne » at the top of the second page. Written in Paris, France on June 1, 1898 on bifold paper. The third and fourth pages are blank. Expected wear including light paper folds and toning. There is a ghost impression of an envelope flap found on the third blank page, along the edge of which is foxed. Else very good to near fine. 5.25″ x 8.125. » Accompanied by its original transmittal envelope also engrossed by Cézanne. The envelope is postmarked, bears a cancelled stamp, and is neatly letter-opened at top. Provenance: Ex-Noel Goldblatt (ca. 1926-2003) of the famous Goldblatt’s Department Store, to a prominent Los Angeles, California collector. Ex-Sotheby’s 1979 and then hidden away for 40+ years! »
11 juin
Lettre de Cezanne à Montfort :
« Paris, 11 juin 1898,
Cher Monsieur,
Je suis en Possession de l’œuvre littéraire, que vous avez bien voulu me faire parvenir par l’intermédiaire de Joachim Gasquet. J’aurai le plus grand plaisir à en prendre connaissance et, lorsque l’occasion se présentera, vous voudrez bien me permettre de parler avec vous des choses de l’Art, qui nous intéressent tant.
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments,
P. Cezanne »Lettre de Cezanne à Monfort, datée « Paris, 11 juin 1898 » ; coll. privée, Paris, musée des Lettres et Manuscrits.
Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cezanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 47.
Eugène Montfort (1877-1936), écrivain et co-fondateur du mouvement naturiste, avait publié, à cette date, Sylvie, ou les émois passionnés, Chair, et Exposé du naturisme, discours prononcé au congrès de Bruxelles les 19-20 février 1898.
17 juin
Le collectionneur Maurice Leclanché échange à Vollard La Moisson (FWN651-R301) contre L’Estaque, effet du soir (FWN60-R170).
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 954 numéros, p. 137.
22 juin
Cezanne remercie Gasquet de ce qu’il a écrit sur sa peinture, à l’occasion d’un compte rendu du livre de l’historien aixois Charles de Ribbe sur La Société provençale à la fin du Moyen Âge, paru dans le numéro de mars-avril des Mois dorés. Gasquet considère la peinture de Cezanne comme un témoignage sur la Provence, « presque » à l’égal de l’œuvre de Frédéric Mistral.
Par opposition, Cezanne qualifie Geffroy de « vulgaire ». D’après Vollard, ses relations avec le critique se seraient détériorées à la suite de sa demande de réaliser le portrait de Clemenceau, que le peintre commence, puis abandonne : « Un beau matin, j’ai tout foutu en plan, la toile, le chevalet, Clemenceau, Geffroy… » Quelques années plus tard, Geffroy démentira ce propos.
« Paris, 22 juin 1898.
Mon cher Gasquet,
Après avoir lu les superbes lignes dans lesquelles vous exaltez le sang provençal, je ne puis me résoudre à garder le silence, tout comme si je me trouvais en présence d’infortune d’un vulgaire Geffroy.
Il n’y a qu’une chose à dire, c’est que la tâche accomplie est inégale à l’éloge que vous en faites. Mais vous êtes coutumier du fait et vous voyez à travers un tel prisme que pour vous remercier toute parole devient pâle.
Voudriez-vous être assez aimable pour dire à Paul [son fils] quel jour je pourrais vous revoir ?
En vous adressant mes remerciements les plus vifs, je vous prie de faire agréer mes respects à Madame Gasquet.
Paul Cezanne »Lettre de Cezanne à J. Gasquet, 22 juin 1898 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, P. 265-266.
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 112.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 195.
Gasquet Joachim, « Le sang provençal », Les Mois dorés, mars-avril 1898, p. 373-381 :
« LE SANG PROVENÇAL
D’uno raço que regreio
Sian bessai li proumié gréu ;
Sian bessai de la patrio
Licepoun emai li priéu,
F. Mistral.Quand j’eus achevé de lire ce livre honnête et fort qu’est la Société provençale à la fin du Moyen-Âge, songeant à ce merveilleux passé de ma race et tâchant d’évoquer les belles destinées que l’avenir lui garde, je levai les yeux et dans les derniers rayons du couchant, contre le mur, je vis vivre dans son humble cadre la vieille femme en prière que peignit Cézanne avec toute sa foi. Je sortis, emportant dans mes yeux le souvenir de cette peinture sobre et profonde et pensant aussi à la solide vie des vieux provençaux qu’aime M. de Ribbe, et tandis que j’allais à travers l’air vif, sur les boulevards, autour de la cité que le soir, endormait, et qu’enchantaient les premières étoiles, je songeais confusément à l’œuvre de ces deux hommes qui, sans se connaître peut-être, dans la même ville, soutenus par des espoirs et courage identique, travaillaient tous deux, humbles et vigoureux, à l’accomplissement, par des moyens divers, de la même tâche et des mêmes idées. Nous leur devons le même respect. Ils ont compris le monde selon qu’ils le devaient. Je crois qu’ils sont heureux. […]
Notre pays est fort. L’idée de la Provence dort sous les oliviers, les campagnes robustes l’enserrent, les pins l’embaument, le soleil l’exalte ; elle est attendrie par la mer. Elle est partout, je ne la trouvais nulle part. Mais un jour, cette idée que toutes ces terres rouges, ces rochers, ces pins lumineux ces plaines ou ces monts recèlent, en mille endroits, éparpillée, confuse, un jour, je l’ai vue, en contemplant les toiles de Cézanne, jaillir soudain en sa forte synthèse, en sa splendeur unique, à la fois campagnarde et mystique, car elle règne en une réalité magnifique dans toute l’œuvre de ce peintre épris de la seule clarté. Cette âme provençale que M. de Ribbe, en ses veilles d’historien, évoqua pour nous, loin de nos villes muettes, cette foi qu’il nous donna par de patriotiques exemples, Paul Cézanne, en nous initiant à ses contemplations, nous l’apporta aussi, il nous le révéla par cette sorte de sainteté lumineuse dont il imprègne ses paysages. L’attitude tourmentée ou pensive de ses roches, le rouge sang qu’il fait couler en tumulte sous la terre déchirée, la gravité des horizons, les flammes de la mer, les rêveries de l’eau, la douceur, la chasteté des lignes qui s’enlacent dans ses tableaux avec une austère tendresse, les moissons que le soleil brûle, la rivière que les enfants vont quitter, l’air enfin, l’air qui se souvient, l’air qui pense, qui sait, qui veut, l’air vivant, éblouissant qui baigne toutes ces images champêtres, qui fait de toutes ces toiles comme autant d’autels dédiés au Père du soleil et du vent, Seigneur inconnu du temps et des espaces, ― toutes ces nobles formes évoquées mettent en nous quelque chose de religieux, nous indiquent que des paroles vont jaillir, comme aux temps bibliques, des arbres et des pierres, tout attend un sauveur, le monde veut un maître, l’âme de la Provence veut descendre en quelqu’un.
Il y a dans l’atelier du Jas-de-Bouffan quelques toiles où se reposent de leurs travaux de robustes paysans, au teint nourri de soleil, aux puissantes épaules, aux mains sacrées par les plus lourds labeurs. Un surtout, dans sa blouse bleue, décorée de son foulard rouge, les bras ballants [R 826], est admirable dans sa rudesse comme la pensée d’un coin de terre qui se serait soudain incarnée dans cette chair grossière et magnifique, cuite par le soleil et fouettée par le vent. D’autres, dans une salle de ferme, jouent aux cartes, en fumant. D’autres sont nus. Tous sont sains, équilibrés, on les sent d’esprit juste, ils sont tranquilles, ils n’ont d’autres soucis que d’aimer la terre et de la féconder. Ils sont si simples que les mauvais riches seraient tentés de les mépriser. C’est d’eux pourtant que j’ai appris à connaître tout à fait ma race. J’ai reçu d’eux une belle leçon. Ils m’ont donné l’horreur de l’artificiel et du convenu. Ils m’ont vraiment parlé, et leurs naïves paroles ont retenti en moi comme un hymne à la santé. Ces hommes sereins m’ont enseigné que les sources profondes de l’énergie dorment en eux. Ils font le pain et le vin. Les nourritures saines rendent les pensées fortes. Nourrissons nos yeux du spectacle des saisons. Dieu se répand à travers le monde. Il a pétri la terre à la ressemblance de je ne sais quelle vérité. Tout correspond à tout. Nos destins sont inscrits dans la courbe des paysages. Rien n’est inutile. Tout sert à la vie de l’âme. Une montagne est un être de force et de joie qui soutient nos conceptions défaillantes. Chaque fois que j’ai vu dans le soir se coucher le soleil au-delà des monts, sur la mer et les arbres, l’idée de la justice m’a habité avec pus de puissance et de mélancolie. À l’Aube, le sang bat, heureux et libre. Que notre vie se consume et renaisse entre les mains divines de la joie. Voilà ce que l’œuvre de ce grand peintre m’enseigna, quand je l’ai méditée, emportant dans mes yeux toutes ces calmes lignes qui s’enlacent, se complètent, s’unissent selon une logique colorée et forment pour l’âme qui les aime une écriture symbolique où l’on peut lire les plus graves leçons. De ces toiles surgit l’âme de la Provence contemporaine, en ce qu’elle a de beau encore, de robuste et de sain. Ces paysans, ces rochers, ces arbres valent mieux que les hommes sans tristesse et sans joie de nos villes. Certains de ces paysages, pourtant lumineux, demeurent tristes ; c’est qu’ils semblent comprendre que plus personne digne d’eux ne vient les visiter. Ils sont morts, les hommes à qui ils correspondent, et c’est justement dans les livres de M. de Ribbe que dorment leur mémoire, leur gloire et leur beauté.
La rustique et noble peinture de Paul Cézanne déroule devant notre imagination les mêmes renseignements que M. de Ribbe adresse à notre raison. Ces deux hommes se complètent parfaitement l’un l’autre. Ils nous disent ce qu’ils savent, tantôt avec fougue, tantôt avec bonhomie. Tous deux, par la copie constante des êtres de leur race, avec des faits, expérimentalement, ont presque réalisé, dans leur domaine propre, une chose aussi magnifique et sincère que ce que réalisa, dans l’épopée, le lyrisme et le drame, l’auteur du Rhône et de Calendal.
Joachim Gasquet. »
Il est probable que c’est à la suite de cette reprise de contact entre Gasquet et Cezanne, lequel se trouve à Paris et propose de le « revoir », qu’ils ont dû quelquefois visiter ensemble le Louvre. Gasquet rédigera bien plus tard, « à Fontlaure — l’hiver 1912-1913 », selon sa femme, des propos qu’il a recueillis de Cezanne, rassemblés sous forme de « conversations, imaginaires », dans la deuxième partie de son livre intitulée « Ce qu’il m’a dit… »
Gasquet Marie, « Biographie de Joachim Gasquet », dans Gasquet Joachim, Des Chants de l’amour et des hymnes, Paris, Ernest Flammarion, éditeur, 1928, 235 pages, p. 56.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 125-157 :
« Deuxième partie
Ce qu’il m’a dit…J’ai dit à peu près tout ce que j’ai appris, soit en le fréquentant, soit d’après ceux qui l’approchèrent, tout ce que je sais de la vie de Cézanne. C’est une vie de saint. Le moins possible j’y ai mêlé ses théories sur l’art, ne rapportant une de ses conversations que lorsqu’elle pouvait faire saillir un point caché de son caractère, éclairer un des côtés de son âme mystérieuse. Ces matières sont infiniment délicates. Si objectif que l’on se veuille, toujours un peu de soi inconsciemment y pénètre. Et puis je ne suis pas peintre, et j’ai peur, si respectueux que je me sente, de trahir peut-être, et bien malgré moi, la doctrine profonde, renseignement qu’on pourrait dégager de tous ces propos. Pourtant ma mémoire fidèle les a recueillis avec pitié. Je vais essayer de les transcrire tels quels, m’aidant de ses lettres, autant de celles qu’il m’adressa que de celles que j’ai pu me procurer ou qui furent publiées par ceux qui les reçurent, comme la précieuse correspondance que nous communique M. Émile Bernard à la suite de ses Souvenirs. Toutes les fois que je le pourrai, je transcrirai les paroles mêmes de Cézanne. Je n’inventerai rien ― que l’ordre dans lequel je les présente. Après de longues méditations, je me suis décidé à les grouper toutes ! pour mieux en marquer la portée, en trois grands dialogues. Autour de trois conversations, imaginaires, entre cent autres que j’eus en réalité avec lui, dans les champs, au Louvre et dans son atelier, j’ai ramassé tout ce que j’ai pu recueillir et tout ce dont j’ai pu me souvenir de ses idées sur la peinture : il parlait, et je crois qu’il pensait, ainsi.
LE MOTIF
« La nature est plus en profondeur qu’en surface. »
Ce jour-là, dans le quartier de la Blaque, non loin des Mille, à trois quarts d’heure d’Aix et du Jas de Bouffan, sous un grand pin, au bord d’une verte et rouge colline, nous dominions la vallée de l’Arc. Il faisait bleu et frais, un premier matin d’automne dans la fin de l’été. La ville, cachée par un pli de coteau, se devinait à ses fumées. Nous tournions le dos aux étangs. À droite, les horizons de Luyne et le Pilon du Roi, la mer qu’on devine. Devant vous, au soleil virgilien, la Sainte-Victoire, immense, tendre et bleuâtre, les vallonnements du Montaiguet, le viaduc du Pont de l’Arc, les maisons, les frissonnements d’arbres, les champs carrés, la campagne d’Aix.
C’est le paysage que Cézanne peignait. Il était chez son beau-frère. Il avait planté son chevalet à l’ombre d’un bouquet de pins. Il travaillait là depuis deux mois, une toile le matin, une l’après-midi. L’œuvre était « en bon train ». Il était joyeux, sa séance touchait à sa fin.
La toile lentement se saturait d’équilibre. L’image préconçue, méditée, linéaire dans sa raison, et qu’il avait dû, à son habitude, ébaucher d’un trait rapide de fusain, se dégageait déjà des taches colorées qui la cernaient partout. Le paysage apparaissait comme un papillotement, car Cézanne avait lentement circonscrit chaque objet, échantillonnait, pour ainsi dire, chaque ton ; il avait, de jour en jour, insensiblement, d’une harmonie sûre, rapproché toutes ces valeurs, il les liait entre elles d’une clarté sourde. Les volumes s’affirmaient, et la haute toile maintenant tendait à ce maximum d’équilibre et de saturation qui, selon Elie Faure, les caractérise toutes. Le vieux maître me souriait.
Cézanne :
― Le soleil brille et l’espoir rit au cœur.
Moi :
― Vous êtes content, ce matin ?
Cézanne :
― Je tiens mon motif… (Il joint les mains.) Un motif, voyez-vous, c’est ça….
Moi :
― Comment ?
Cézanne :
Eh ! oui… (Il refait son geste, écarte ses mains, les dix doigts ouverts, les rapproche lentement, lentement, puis les joint, les serre, les crispe, les fait pénétrer l’une dans l’autre.) Voilà ce qu’il faut atteindre… Si je passe trop haut ou trop bas, tout est flambé. Il ne faut pas qu’il y ait une seule maille trop lâche, un trou par où l’émotion, la lumière, la vérité s’échappe. Je mène, comprenez un peu, toute ma toile, à la fois, d’ensemble. Je rapproche dans le même élan, la même foi, tout ce qui s’éparpille… Tout ce que nous voyons, n’est-ce pas, se disperse, s’en va. La nature est toujours la même, mais rien ne demeure d’elle, de ce qui nous apparaît. Notre art doit, lui, donner le frisson de sa durée avec les éléments, l’apparence de tous ses changements. Il doit nous la faire goûter éternelle. Qu’est-ce qu’il y a sous elle ? Rien peut-être. Peut-être tout. Tout, comprenez-vous ? Alors je joins ses mains errantes… Je prends, à droite, à gauche, ici, là, partout, ses tons, ses couleurs, ses nuances, je les fixe, je les rapproche… Ils font des lignes. Ils deviennent des objets, des rochers, des arbres, sans que j’y songe. Ils prennent un volume. Ils ont une valeur. Si ces volumes, si ces valeurs correspondent sur ma toile, dans ma sensibilité, aux plans, aux taches que j’ai, qui sont là sous nos yeux, eh bien ! ma toile joint les mains. Elle ne vacille pas. Elle ne passe ni trop haut, ni trop bas. Elle est vraie, elle est dense, elle est pleine… Mais si j’ai la moindre distraction, la moindre défaillance, surtout si j’interprète trop un jour, si une théorie aujourd’hui m’emporte qui contrarie celle de la veille, si je pense en peignant, si j’interviens, patatras ! tout fout le camp.
Moi :
― Comment, si vous intervenez ?
Cézanne :
L’artiste n’est qu’un réceptacle de sensations, un cerveau, un appareil enregistreur… Parbleu, un bon appareil, fragile, compliqué, surtout par rapport aux autres… Mais s’il intervient, s’il ose, lui, chétif, se mêler volontairement à ce qu’il doit traduire, il y infiltre sa petitesse. L’œuvre est inférieure.
Moi :
― L’artiste, en somme, serait donc pour vous inférieur à la nature.
Cézanne :
― Non, je n’ai pas dit cela. Comment, vous coupez dans ce bateau ? L’art est une harmonie parallèle à la nature. Que penser des imbéciles qui vous disent : le peintre est toujours inférieur à la nature ! Il lui est parallèle. S’il n’intervient pas volontairement… entendez-moi bien. Toute sa volonté doit être de silence. Il doit faire taire en lui toutes les voix des préjugés, oublier, oublier, faire silence, être un écho parfait. Alors, sur sa plaque sensible, tout le paysage s’inscrira. Pour le fixer sur la toile, l’extérioriser, le métier interviendra ensuite, mais le métier respectueux qui, lui aussi, n’est prêt qu’à obéir, à traduire inconsciemment, tant il sait bien sa langue, le texte qu’il déchiffre, les deux textes parallèles, la nature vue, la nature sentie, celle qui est là… (il montrait la plaine verte et bleue) celle qui est ici… (il se frappait le front) qui toutes deux doivent s’amalgamer pour durer, pour vivre d’une vie moitié humaine, moitié divine, la vie de l’art, écoutez un peu… la vie de Dieu. Le paysage se reflète, s’humanise, se pense en moi. Je l’objective, le projette, le fixe sur ma toile… L’autre jour, vous me parliez de Kant. Je vais bafouiller, peut-être, mais il me semble que je serais la conscience subjective de ce paysage, comme ma toile en serait la conscience objective. Ma toile, le paysage, tous les deux hors de moi, mais l’un chaotique, fuyant, confus, sans vie logique, en dehors de toute raison ; l’autre permanente, sensible, catégorisée, participant à la modalité, au drame des idées… à leur individualité. Je sais. Je sais… C’est une interprétation Je ne suis pas un universitaire. Je n’oserais pas m’aventurer ainsi devant Dumesnil… Ah ! bon Dieu, que j’envie votre jeunesse ! tout ce qui bouillonne là ! Mais le temps me pousse… J’ai peut-être tort de blaguer comme cela…. Pas de théories ! Des œuvres… Les théories perdent les hommes. Il faut avoir une sacrée sève, une vitalité inépuisable pour leur résister. Je devrais être plus rassis, comprendre qu’à mon âge tous ces emballements ne me sont plus guère permis… Ils me perdront toujours.
Il s’était rembruni. Souvent, après un éclat d’enthousiasme, il retombait ainsi accablé. Il ne fallait pas alors essayer de le tirer de sa mélancolie. Il devenait furieux. Il souffrait… Après un long silence. Il avait repris ses pinceaux, regardait successivement sa toile et son motif.
Non. Non. Tenez. Ça n’y est pas. L’harmonie générale n’y est pas. Cette toile ne sent rien. Dites-moi quel parfum s’en dégage. Quelle odeur dégage-t-elle ? voyons…
Moi :
― La senteur des pins.
Cézanne :
― Vous dites cela parce que deux grands pins balancent leurs branches au premier plan… Mais c’est une sensation visuelle… D’ailleurs l’odeur toute bleue des pins, qui est âpre au soleil, doit épouser l’odeur verte des prairies qui fraîchissent là chaque matin, avec l’odeur des pierres, le parfum de marbre lointain de la Sainte-Victoire. Je ne l’ai pas rendu. Il faut le rendre. Et dans les couleurs, sans littérature. Comme le font Baudelaire et Zola qui par la simple juxtaposition des mots embaument mystérieusement tout un vers ou toute une phrase. Quant la sensation est dans sa plénitude, elle s’harmonise avec tout l’être. Le tourbillonnement du monde, au fond d’un cerveau, se résout dans le même mouvement que perçoivent, chacun avec leur lyrisme propre, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez…. Et l’art, je crois, nous met dans cet état de grâce où l’émotion universelle se traduit comme religieusement, mais très naturellement, à nous. L’harmonie générale, comme dans les couleurs, nous devons la trouver partout. Tenez, si je ferme les yeux et que j’évoque ces collines de Saint-Marc, vous savez, le coin du monde que j’aime le mieux, c’est l’odeur de la scabieuse qu’elles m’apportent, le parfum que je préfère. Toute l’odeur forestière des champs, je l’entends pour moi dans Weber. Au fond des vers de Racine je sens un ton local, à la Poussin, comme sous certaines pourpres de Rubens s’éploie une ode, un murmure, un rythme à la Ronsard.
Vous savez que lorsque Flaubert écrivait Salammbô, il disait qu’il voyait pourpre. Eh bien ! quand je peignais ma Vieille au chapelet [R 808], moi, je voyais un ton Flaubert, une atmosphère, quelque chose d’indéfinissable, une couleur bleuâtre et rousse qui se dégage, il me semble, de Madame Bovary. J’avais beau lire Apulée, pour chasser cette obsession qu’un moment je craignis dangereuse, trop littéraire. Rien n’y faisait. Ce grand bleu roux me tombait, me chantait dans l’âme. J’y baignais tout entier.
Moi :
― Il s’interposait entre vous et la réalité, entre vos yeux et le modèle ?
Cézanne :
― Pas du tout. Il flottait, comme ailleurs. Je scrutais tous les détails des vêtements, la coiffe, les plis du tablier, je déchiffrais le sournois visage. C’est bien après que j’ai constaté que la face était rousse, le tablier bleuâtre, comme ce ne fut qu’une fois le tableau fini que je me souvins de la description de la vieille servante au comice agricole. Ce que j’essaie de vous traduire est plus mystérieux, s’enchevêtre aux racines mêmes de l’être, à la source impalpable des sensations. Mais, c’est cela même, je crois, qui constitue le tempérament. Et il n’y a que la force initiale id est le tempérament qui puisse porter quelqu’un au but qu’il doit atteindre. Je vous disais tout à l’heure que le cerveau, libre, de l’artiste doit être comme une plaque sensible, un appareil enregistreur simplement, au moment où il œuvre. Mais cette plaque sensible, des bains savants l’ont amenée au point de réceptivité où elle peut s’imprégner de l’image consciencieuse des choses. Un long travail, la méditation, l’étude, des souffrances et des joies, la vie l’ont préparée. Une méditation constante des procédés des maîtres. Et puis, le milieu où nous nous mouvons habituellement… ce soleil, écoutez un peu… Le hasard des rayons, la marche, l’infiltration, l’incarnation du soleil à travers le monde, qui peindra jamais cela, qui le racontera ? Ce serait l’histoire physique, la psychologie de la terre. Tous plus ou moins, êtres et choses, nous ne sommes qu’un peu de chaleur solaire emmagasinée, organisée, un souvenir de soleil, un peu de phosphore qui brûle dans les méninges du monde. Il fallait entendre mon ami Marion là-dessus. Moi, je voudrais dégager cette essence. La morale éparse du monde c’est l’effort qu’il fait peut-être pour redevenir soleil. C’est là sa notion, son sentiment, son rêve de Dieu. Partout un rayon frappe à une porte obscure. Une ligne partout cerne, tient un ton prisonnier. Je veux les libérer. Les grands pays classiques, notre Provence, la Grèce et l’Italie telles que je les imagine, sont ceux où la clarté se spiritualise, où un paysage est un sourire flottant d’intelligence aiguë… La délicatesse de notre atmosphère tient à la délicatesse de notre esprit. Elles sont l’une en l’autre. La couleur est le lieu où notre cerveau et l’univers se rencontrent. C’est pourquoi elle apparaît toute dramatique, aux vrais peintres. Regardez cette Sainte-Victoire… Quel élan, quelle soif impérieuse du soleil, et quelle mélancolie, le soir, quand toute cette pesanteur retombe… Ces blocs étaient du feu. Il y a du feu encore en eux. L’ombre, le jour, a l’air de reculer en frissonnant, d’avoir peur d’eux ; il y a là-haut la caverne de Platon : remarquez quand de grands nuages passent, l’ombre qui en tombe frémit sur les roches, comme brûlée, bue tout de suite par une bouche de feu. Longtemps je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte-Victoire, parce que j’imaginais l’ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas, tandis que, tenez, regardez, elle est convexe, elle fuit de son centre. Au lieu de se tasser, elle s’évapore, se fluidise. Elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l’air. Comme là-bas, à droite, sur le Pilon du Roi, vous voyez au contraire que la clarté se berce, humide, miroitante. C’est la mer… Voilà ce qu’il faut rendre. Voilà ce qu’il faut savoir. Voilà le bain de science, si j’ose dire, où il faut tremper sa plaque sensible. Pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d’abord les assises géologiques : Songez que l’histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, où deux tourbillons, deux danses chimiques se sont combinées. Ces grands arcs-en-ciel, ces prismes cosmiques, cette aube de nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois monter, je m’en sature en lisant Lucrèce. Sous cette fine pluie je respire la virginité du monde. Un sens aigu des nuances me travaille. Je me sens coloré par toutes les nuances de l’infini. À ce moment-là, je ne fais plus qu’un avec mon tableau. Nous sommes un chaos irisé. Je viens devant mon motif, je m’y perds. Je songe, vague. Le soleil me pénètre sourdement, comme un ami lointain, qui réchauffe ma paresse, la féconde. Nous germinons. Il me semble, lorsque la nuit redescend, que je ne peindrai et que je n’ai jamais peint. Il faut la nuit pour que je puisse détacher mes yeux de la terre, de ce coin de terre où je me suis fondu. Un beau matin, le lendemain, lentement les bases géologiques n’apparaissent, des couches s’établissent, les grands plans de ma toile, j’en dessine mentalement le squelette pierreux. Je vois affleurer les roches sous l’eau, peser le ciel. Tout tombe d’aplomb. Une pâle palpitation enveloppe les aspects linéaires. Les terres rouges sortent d’un abîme. Je commence à me séparer du paysage, à le voir. Je m’en dégage avec cette première esquisse, ces lignes géologiques. La géométrie, mesure de la terre. Une tendre émotion me prend. Des racines de cette émotion monte la sève, les couleurs. Une sorte de délivrance. Le rayonnement de l’âme, le regard, le mystère extériorisé, l’échange entre la terre et le soleil, l’idéal et la réalité, les couleurs ! Une logique aérienne, colorée, remplace brusquement la sombre, la têtue géométrie. Tout s’organise, les arbres, les champs, les maisons. Je vois. Par taches. L’assise géologique, le travail préparatoire, le monde du dessin s’enfonce, s’est écroulé comme dans une catastrophe. Un cataclysme l’a emporté, régénéré. Une nouvelle période vit. La vraie ! Celle où rien ne m’échappe, où tout est dense et fluide à la fois, naturel. Il n’y a plus que des couleurs, et en elles de la clarté, l’être qui les pense, cette montée de la terre vers le soleil, cette exhalaison des profondeurs vers l’amour. Le génie serait d’immobiliser cette ascension dans une minute d’équilibre, en suggérant quand même son élan. Je veux m’emparer de cette idée, de ce jet d’émotion, de cette fumée d’être au-dessus de l’universel brasier. Ma toile pèse, un poids alourdit mes pinceaux. Tout tombe. Tout retombe sous l’horizon. De mon cerveau sur ma toile, de ma toile vers la terre. Pesamment. Où est l’air, la légèreté dense ? Le génie serait de dégager l’amitié de toutes ces choses en plein air, dans la même montée, dans le même désir. Il y a une minute du monde qui passe. La peindre dans sa réalité ! Et tout oublier pour cela. Devenir elle-même. Être alors la plaque sensible. Donner l’image de ce que nous voyons, en oubliant tout ce qui a paru avant nous.
Moi :
― Est-ce possible ?
Cézanne :
― Je l’ai tenté.
Il baissa la tête, puis la releva brusquement, dominant le paysage et dévorant sa toile d’une longue caresse des yeux. Il eut un sourire pâle.
Qui sait ? Tout est si simple et si compliqué.
Moi :
― Vous disiez qu’il faut tout oublier. Pourquoi alors cette préparation, toute cette méditation devant le paysage ?
Cézanne :
― Hélas, parce que je ne suis plus innocent. Nous sommes des civilisés. Le souci classique est en nous, que nous le voulions ou non. Je veux m’exprimer lucidement en peinture. Il y a une espèce de barbarie, plus détestable que l’école même, chez les faux ignorants : on ne peut plus être ignorant aujourd’hui. On ne l’est plus. Nous apportons la facilité en naissant. Il faut la briser ; elle est la mort de l’art. Quand je songe à ces premiers hommes qui ont gravé leurs rêves de chasse sous la voûte d’une caverne ou à ces bons chrétiens qui ont peint leur paradis à fresque sur la paroi des cimetières, qui se sont faits, qui se sont tout fait, leur métier, leur âme, leur impression… Être ainsi devant un paysage. En dégager la religion. Il me semble à certains jours que je peins naïvement. Je suis le primitif de ma propre voie. Je voudrais avec la foi de ma gaucherie, écoutez un peu, atteindre la formule… pleinement réaliser. Car, on a beau dire, c’est la pire des décadences que de jouer à l’ignorance et à la naïveté. Sénilité. On ne peut plus ne pas savoir aujourd’hui, apprendre par soi-même. On respire son métier en naissant. Mal. Et il faudrait au contraire régler tout cela. De toutes parts, on baigne dans cette vaste école laïque qu’est la société. Oui, il y a un classicisme, celui qui correspond à ces écoliers-là, que j’abomine plus que tout. Alors j’imagine que comme pour Dieu, ainsi que disait l’autre, si un peu de science en éloigne, beaucoup y ramène. Oui, beaucoup de science ramène à la nature. Par insuffisance comprise du pur métier.
Moi :
― Insuffisance du métier ?
Cézanne :
― Oui, le métier abstrait, finit par dessécher, sous sa rhétorique qui se guinde en s’épuisant. Voyez les Bolonais. Ils ne sentent plus rien… Il ne faut jamais avoir une idée, une pensée, un mot à sa portée, lorsqu’on a besoin d’une sensation. Les grands mots, ce sont les pensées qui ne sont pas à vous. Les clichés sont la lèpre de l’art. Tenez, la mythologie, en peinture, on peut la suivre à la trace, c’est l’histoire du métier envahissant. Quand on a peint des déesses, à la fin, on n’a plus peint de femmes. Faites le tour des Salons. Un bougre ne sait pas rendre les reflets de l’eau sous les feuilles, il y colle une naïade. La Source d’Ingres ! Qu’est-ce que ça a à faire avec l’eau… Et vous, en littérature, vous tartinez, vous criez : Vénus, Zeus, Apollon, quand vous ne pouvez plus dire, avec émotion profonde : écume de la mer, nuages du ciel, force du soleil. Y croyez-vous à ces patraques olympiennes ? Alors ?
Rien n’est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.
Moi :
― Mais Véronèse, Rubens, Velasquez, Tintoret ? Tous ceux que vous aimez ?…
Cézanne :
― Eux ! Ils avaient une telle vitalité que, dans tous ces arbres morts, ils faisaient recirculer la sève, leur sève à eux, leur vie prodigieuse… Leurs chairs ont un goût de caresse, une chaleur de sang… Quand Cellini secouait la tête saignante au bras de Persée, il avait vraiment tué, senti un jet tiède engluer ses doigts… Un meurtre par an, c’était sa moyenne… Ils n’avaient pas d’autre vérité. C’était leur nature, ces corps de dieux et de déesses. Ils y glorifiaient l’homme en face des madones et des saints auxquels ils ne croyaient plus. Voyez combien leur peinture religieuse est froide. Tintoret constamment excède ses sujets, s’intéresse à lui. Le Saint Jérôme du Titien, à Milan, avec toutes ses bêtes, son escargot, ses rochers qui pullulent, est-ce un ascète, un stoïcien, un philosophe, un saint ? On ne sait pas. C’est un homme. Un vieillard chenu avec sa pierre dans la main, tout prêt à en frapper l’énigme, le silex du mystère, pour en faire jaillir une étincelle de vérité. Cette vérité, elle monte dans toute la couleur rousse du farouche tableau. Elle ne tombe pas des bras de la croix qu’on ne voit d’abord pas, qui est là parce que le tableau a été commandé par quelque ordre ou quelque église. Voilà un peintre… Ils sont de vrais païens. Il y a dans cette renaissance une explosion de véracité unique, un amour de la peinture et des formes qu’on n’a plus retrouvé… Les jésuites viennent. Tout est guindé. On apprend, on enseigne tout. Il faut la révolution pour qu’on redécouvre la nature, que Delacroix peigne sa plage d’Étretat, Corot ses masures de Rome, Courbet ses sous-bois et ses vagues. Et avec quelle lenteur pénible, quelles étapes ! On arrange… Rousseau, Daubigny, Millet. On compose un paysage, comme une scène d’histoire… Je veux dire, du dehors. On crée la rhétorique du paysage, une phrase, des effets qu’on se passe. La machination de la toile que Dupré, disait Rousseau, lui avait apprise. Corot lui-même. J’aime mieux une peinture plus assise. On n’a pas encore découvert que la nature est plus en profondeur qu’en surface. Car, écoutez un peu, on peut modifier, parer, bichonner la surface, on ne peut toucher à la profondeur sans toucher à la vérité. Un besoin salubre d’être vrai vous prend. On ficherait sa toile à bas, plutôt que d’inventer, d’imaginer un détail. On veut savoir.
Moi :
― Savoir ?
Cézanne :
― Oui, je veux savoir. Savoir pour mieux sentir, sentir pour mieux savoir. Tout en étant le premier dans mon métier, je veux être simple. Ceux qui savent sont simples. Les demi-savants, les amateurs font les demi-réalisations. Vous savez, au fond, il n’y a d’amateurs que ceux qui font de la mauvaise peinture. C’est Manet qui l’a dit à Gauguin Je ne voudrais pas être un de ces amateurs-là. Alors je veux être un vrai classique, redevenir classique par la nature, par la sensation. Avant, j’avais des idées confuses. La vie ! La vie ! Je n’avais que ce mot-là à la bouche. Je voulais brûler le Louvre, pauvre couillon. ! Il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre… Mais Zola m’a très bien empoigné quand même, dans L’Œuvre, vous ne vous en souvenez peut-être pas, lorsqu’il beugle : « Ah ! la vie ! la vie ! la sentir et la rendre dans sa réalité, l’aimer pour elle, y voir la seule beauté vraie, éternelle et changeante…
Sa mémoire hésita, puis il acheva d’un trait.
…ne pas avoir l’idée bête de l’ennoblir en la châtrant, comprendre que les prétendues laideurs ne sont que les saillies des caractères, et faire vivre, et faire des hommes, la seule façon d’être Dieu ».
Iléclate d’un large rire.
Oui, c’est assez ça… Mais il y a mieux. La simplicité, le direct. Tout le reste n’est que bafouillage, montage de bourrichon. Je vous tartine ce matin, je ne sais pas pourquoi. Au fond, je ne pense à rien, quand je peins. Je vois des couleurs. Je peine, je jouis à les transporter telles que je les vois sur ma toile. Elles s’arrangent au petit bonheur, comme elles veulent. Des fois, ça fait un tableau. Je suis une brute. Bien heureux si je pouvais être une brute…
Il réfléchit.
La santé est le premier des biens pour un peintre ? Pour tous. Ce qui m’empêche de réaliser, c’est que je ne suis pas toujours en bonne santé… bien portant.
Ilm’épie, me regarde en dessous. Une colère sournoise le travaille. Il essaie de rompre les chiens.
Ce vieux chemin est une voie romaine. Ces routes des romains sont toujours admirablement situées. Suivez-en une. Ils avaient un sens du paysage ; de tous ses points elle fait tableau. Nos ingénieurs s’en foutent bien, du paysage.
Il éclate.
Et moi donc !… Vous le sentez aussi bien que moi, voyons, que je suis patraque. Les yeux, oui, les yeux !… Je vois les plans se chevauchant… Les lignes droites me paraissent tomber.
Parfois. Alors qu’est-ce que vous voulez que je fiche ?… Tout cela c’est de la blague.
Il cligne des y eux.
Tant qu’on n’a pas peint un gris, on n’est pas un peintre.
Il me sent attristé. Sa bonté reprend le dessus.
Écoutez un peu… J’étais à Talloires. Pour un patelin tempéré, en voilà un. Des gris, en veux-tu, en voilà ! Et des verts. Tous les verts de gris de la mappemonde. Les collines environnantes sont assez hautes, il m’a semblé ; elles paraissent basses, et il pleut !… Il y a un lac entre deux goulets, un lac d’anglaises. Les feuilles d’albums tombent tout aquarellées des arbres. Assurément, c’est toujours la nature… Mais pas comme je la vois. Comprenez-vous ?… Gris sur gris. On n’est pas un peintre, tant qu’on n’a pas peint un gris. L’ennemi de toute peinture est le gris, dit Delacroix. Non, on n’est pas un peintre tant qu’on n’a pas peint un gris.
Moi :
― La Provence souvent est grise.
Cézanne :
―Jamais. Argentée peut-être. Bleue, bleutée… Jamais grise, pas plus grise que crue, jaune, tapageuse, en confettis comme la galvaudent tous ces observateurs qui ne regardent rien… Oui, le sol ici est toujours vibrant, il a une âpreté qui réverbère la lumière et qui fait clignoter les paupières, mais sentez comme il est toujours nuancé, moelleux. Une cadence le prolonge.
N’aime que les jeux et la danse,
Ne cherche en tout que la cadence,
comme dit votre ami Magallon C’est très provençal. Rien ici ne pétarade. Tout s’intensifie, mais dans la plus suave harmonie. Il n’y aurait qu’à se laisser aller. Si j’étais toujours vaillant comme vous autres, si j’avais cette magnifique puissance cérébrale d’un Titien qui peignit jusqu’à cent ans, le bougre… Si la peste ne l’avait pas emporté, il peindrait encore… Si je pouvais, je travaillerais toujours et sans trop de fatigue, et vous verriez alors. Je serais le grand peintre des simples. La nature parle à tous. Eh bien ! jamais on n’a peint le paysage. L’homme absent, mais tout entier dans le paysage. La grande machine bouddhiste, le nirvâna, la consolation sans passions, sans anecdotes, les couleurs ! Il n’y aurait qu’à accumuler, à se laisser fleurir ici. Cette terre vous porte… Tenez, de loin, à Paris, je la sens encore. Promettez-moi, si je la quitte… j’ai beau être distant par vous et par l’âge… je me recommande à vous pour que vous m’écriviez de temps en temps… que les anneaux qui me rattachent à elle ne se brisent pas tout à fait, que je ne me sente jamais détaché tout à fait d’elle où j’ai toujours ressenti, même à mon insu… Rendre la pareille aux autres. À leur insu ! les faire ressentir à leur insu. Tout l’art !… Oui, je vais au développement logique de ce que nous voyons et ressentons par l’étude sur nature, quitte à me préoccuper du procédé ensuite, les procédés n’étant pour nous que de simples moyens pour arriver à faire sentir au public ce que nous ressentons nous-mêmes et à nous faire agréer. Les grands que nous admirons ne doivent avoir fait que cela… Si nous déjeunions ?
Le carnier était pendu à une branche. La bouteille fraîchissait dans une rigole. Nous nous assîmes près d’un petit bassin, à l’ombre ensoleillée des pins. Le déjeuner fut frugal, mais comme Phèdre, sous son platane, au bord de l’Ilissus, tout en mangeant, Cézanne parlait. La campagne ondulait sous la caresse bleue d’un vaporeux midi. Les routes blanches, les toitures heureuses, les bouquets d’arbres, la rivière entre les coteaux, tout semblait, au pied de la Victoire, participer à notre entretien. Un chien était venu, à qui le vieux maître jetait des tranches de pain.
Je bavarde beaucoup aujourd’hui. Et pourtant les causeries sur l’art sont presque inutiles.
Moi :
― Ne croyez-vous pas qu’elles rapprochent les artistes ?
Cézanne :
― On voit Un tableau tout de suite ou on ne le voit jamais. Les explications ne servent de rien. À quoi bon commenter ? Tout cela, ce sont des à-peu-près. Il faut bavarder comme nous le faisons, parce que c’est amusant, comme nous buvons un bon coup de vin. Sans quoi le travail qui fait réaliser un progrès dans un art est un dédommagement suffisant de ne pas être compris des imbéciles. Écoutez un peu, le littérateur comme vous s’exprime avec des abstractions, tandis que le peintre concrète, au moyen du dessin et de la couleur, ses sensations, ses perceptions. Si elles ne sont pas sur sa toile, perceptibles à l’œil des autres, ce n’est pas tout ce qu’on pourra raconter autour d’elles, qui les rendra assimilables. Je n’aime pas la peinture littéraire. Écrire sous un personnage ce qu’il pense et ce qu’il fait, c’est avouer que sa pensée ou son geste ne sont pas traduits par le dessin et par la couleur. Et vouloir forcer l’expression de la nature, tordre les arbres, faire grimacer les rochers, comme Gustave Doré, ou même raffiner comme Vinci, c’est encore de la littérature. Il y a une logique colorée, parbleu. Le peintre ne doit obéissance qu’à elle. Jamais à la logique du cerveau ; s’il s’y abandonne, il est perdu. Toujours à celle des yeux. S’il sent juste, il pensera juste, allez. La peinture est une optique, d’abord. La matière de notre art est là, dans ce que pensent nos yeux… La nature se débrouille toujours, quand on la respecte, pour dire ce qu’elle signifie.
Moi :
― Elle signifie donc quelque chose pour vous ? N’est-ce pas ce que vous mettez en elle ?
Cézanne :
― Peut-être… Et même, tout au fond, vous avez raison. La nature, j’ai voulu la copier, je n’arrivais pas. J’avais beau chercher, tourner, la prendre dans tous les sens. Irréductible. De tous les côtés. Mais j’ai été content de moi lorsque j’ai découvert que le soleil, par exemple, ne se pouvait pas reproduire, mais qu’il fallait le représenter par autre chose… par la couleur. Tout le reste, les théories, le dessin qui est une logique, à sa manière, une logique bâtarde, entre l’arithmétique, la géométrie, et la couleur, le dessin, qui est une nature morte, les idées, les sensations mêmes ne sont que des détours. On croit parfois prendre des raccourcis, on allonge. Il n’y a qu’une route pour tout rendre, tout traduire : la couleur. La couleur est biologique, si je puis dire. La couleur est vivante, rend seule les choses vivantes. Au fond, je suis un homme, n’est-ce pas ? J’ai, quoi que je fasse, la notion que cet arbre est un arbre, ce rocher un rocher, ce chien un chien…
Il s’arrête soudain de manger et de parler. Il époque quelqu’un ou quelque idée qui l’étonne.
Et encore je ne sais pas. Avec des paysans, tenez, j’ai douté parfois qu’ils sachent ce que c’est qu’un paysage, un arbre, oui. Ça vous paraît bizarre. J’ai fait des promenades parfois, j’ai accompagné derrière sa charrette un fermier qui allait vendre ses pommes de terre au marché. Il n’avait jamais vu Sainte-Victoire. Ils savent ce qui est semé, ici, là, le long de la route, le temps qu’il fera demain, si Sainte-Victoire a son chapeau ou non, ils le flairent à la façon des bêtes, comme un chien sait ce qu’est ce morceau de pain, selon leurs seuls besoins, mais que les arbres sont verts, et que ce vert est un arbre, que cette terre est rouge et que ces rouges éboulés sont des collines, je ne crois pas réellement que la plupart le sentent, qu’ils le sachent, en dehors de leur inconscient utilitaire. Il faut, sans rien perdre de moi-même, que je rejoigne cet instinct, et que ces couleurs dans les champs éparses me soient significatives d’une idée comme pour eux d’une récolte. Ils sentent spontanément, devant un jaune, le geste de moisson qu’il faut commencer, comme je devrais, moi, devant la même nuance mûrissante, savoir par instinct poser sur ma toile le ton correspondant et qui ferait onduler un carré de blé. De touche en touche ainsi la terre revivrait. À force de labourer mon champ un beau paysage y pousserait… Rappelez-vous Courbet et son histoire des fagots. Il posait son ton, sans savoir que c’était des fagots. Il demanda ce qu’il représentait, là. On alla voir. Et c’était des fagots. Ainsi du monde, du vaste monde. Il faut, pour le peindre dans son essence, avoir ces yeux de peintre qui, dans la seule couleur, voient l’objet, s’en emparent, le lient en soi aux autres objets. On n’est jamais ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins maître de son modèle, et surtout de ses moyens d’expression. Il faut les adapter à son motif. Ne pas le plier à soi, mais se courber à lui. Le laisser naître, germer en vous. Peindre ce qu’on a devant soi et persévérer à s’exprimer le plus logiquement possible, d’une logique naturelle s’entend ; je n’ai jamais fait autre chose. Vous n’imaginez pas les découvertes qui vous attendent alors. Allez, pour les progrès à réaliser, il n’y a que la nature, et l’œil s’éduque à son contact. Il devient concentrique à force de regarder et de travailler.
Moi :
― Comment concentrique ?
Cézanne :
― Je veux dire que dans cette orange que je pèle, tenez, dans une pomme, une boule, une tête, il y a un point culminant et ce point est toujours malgré le terrible effet : lumière, ombre, sensations colorantes, est toujours le plus rapproché de notre œil. Les bords des objets fuient sur un autre placé à votre horizon. Lorsqu’on a compris ça….
Il sourit.
… Eh bien, on n’a rien compris, si on n’est pas un peintre. J’en ai fait des théories… Bon Dieu !…
Il sort un chiffon de papier de sa poche.
J’ai écrit à un peintre que vous ne connaissez pas, qui était venu me voir et qui en fait, lui, des théories. Je lui dis, je lui ai écrit, pour résumer :
Il lit d’une voix traînante, timide, dogmatique.
« Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un objet, d’un plan, se dirige vers un point central. Les lignes parallèles à l’horizon donnent l’étendue, soit une section de la nature ou, si vous aimez mieux, du spectacle que le Pater omnipotens aeterne Deus étale devant vos yeux. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Or, la nature, pour nous, hommes, est plus en profondeur qu’en surface, d’où la nécessité d’introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air ».
Oui… Je fais mieux de peindre que d’écrire, hein ? Je ne dégote pas encore Fromentin.
Il froisse le papier en boule, le jette. Je le ramasse. Il hausse les épaules.
C’est à quelqu’un du bâtiment que j’écrivais ça. Un jour de pluie. Il est impossible par un temps pluvieux de pratiquer en plein air toutes ces théories que je vous développe et qu’au fond je sais justes. Mais la persévérance nous conduit à comprendre les intérieurs comme tout le reste. Les vieux culots seuls obstruent notre intelligence, qui a besoin d’être fouettée… Tout ce que je vous raconte, la sphère, le cône, le cylindre, l’ombre concave, tous mes culots à moi, les matins de fatigue, me mettent en train, me surexcitent. Je les oublie vite, dès que je vois. Il ne faudrait pas qu’ils tombent entre les pattes des amateurs. Je vois d’ici ce qu’ils deviendraient entre les mains des Rose-Croix ou peinturlureurs de cet acabit. C’est comme l’impressionnisme. Ils en font tous aux Salons. Oh ! bien sagement. Moi aussi, je ne le cache pas, j’ai été impressionniste. Pissarro a eu une énorme influence sur moi. Mais j’ai voulu faire de l’impressionnisme quelque chose de solide et de durable comme l’art des musées. Je le disais à Maurice Denis. Renoir est un habile. Pissarro un paysan. Renoir a été peintre sur porcelaines, écoutez un peu… Il lui en est resté quelque chose de nacré dans son immense talent. Quels morceaux il a établis tout de même. Je n’aime pas ses paysages. Il voit cotonneux. Sisley ?… Oui. Mais Monet est un œil, l’œil le plus prodigieux depuis qu’il y a des peintres. Je lui enlève mon chapeau. Courbet, lui, avait l’image toute faite dans son œil. Monet l’a fréquenté, vous savez, là-bas, dans sa jeunesse, sur la Manche. Mais une tache verte, écoutez un peu, ça suffit pour nous donner un paysage, comme un ton de chair pour nous traduire un visage, nous donner une figure humaine, oui. Ce qui fait que nous sortons peut-être tous de Pissarro. Il a eu la veine de naître aux Antilles, là il a appris le dessin sans maître. Il m’a raconté tout ça. En 65 déjà il éliminait le noir, le bitume, la terre de Sienne et les ocres. C’est un fait. Ne peins jamais qu’avec les trois couleurs primaires et leurs dérivés immédiats, me disait-il. C’est lui, oui, le premier impressionniste. L’impressionnisme, quoi ? c’est le mélange optique des couleurs, comprenez-vous ? La division des tons sur la toile et la reconstitution dans la rétine. Il fallait que nous passions par là. Les falaises de Monet resteront comme une série prodigieuse, et cent autres toiles de lui. Quand je pense qu’on lui a recalé son Été au Salon ! Tous les jurés sont des cochons. Il ira au Louvre, allez, à côté de Constable et de Turner. Foutre, il est encore bien plus grand. Il a peint l’irisation de la terre. Il a peint l’eau. Ces cathédrales de Rouen que nous avons vues ensemble, vous rappelez-vous ? Qu’est-ce que vous me bafouilliez, comme le père Geffroy, que c’était là la peinture qui correspondait à Renan, aux dernières hypothèses atomistiques, au ruissellement biologique, au mouvement de tout ? Si vous voulez. Mais dans la fuite de tout, dans ces tableaux de Monet, il faut mettre une solidité, une charpente à présent… Ah ! si vous voyiez comme il peint ! C’est le seul œil, la seule main qui puissent suivre un coucher de soleil, dans toutes ses transparences, et le nuancer, du coup, sans avoir à y revenir, sur sa toile. Puis c’est un grand seigneur qui se paie les meules qui lui plaisent. Un coin de champ lui va, il l’achète. Avec un grand larbin et des chiens qui montent la garde pour qu’on ne vienne pas l’embêter. Il me faudrait ça. Et des élèves. Établir une tradition impressionniste, en dégager les caractéristiques ! Une école ? Non, non, une tradition. Poussin sur nature.
Il rêve.
Moi, vous comprenez, je procède très lentement, la nature s’offrant à moi très complexe, et les progrès à faire étant incessants. Le Louvre est un bon livre à consulter ; je n’y ai pas manqué, mais ce ne doit encore être qu’un intermédiaire. L’étude réelle et prodigieuse à entreprendre, c’est la diversité du tableau de la nature. J’en reviens toujours à ceci : le peintre doit se consacrer entièrement à l’étude de la nature et tâcher de produire des tableaux qui soient un enseignement.
Moi :
― Un enseignement ? Pour qui ? Un art social peut-être ?
Cézanne :
-Ah ! fichtre, non… Ou c’est peut-être le nom qui me fait peur. Mais un enseignement pour tous, c’est bien ce que je cherche… la compréhension de la nature au point de vue du tableau, le développement des moyens d’expression. Que chacun s’exprime. Moi, je vous le disais ce matin, j’ai besoin de connaître la géologie, comment Sainte-Victoire s’enracine, la couleur géologique des terres, tout cela m’émeut, me rend meilleur. Quand on ne peint pas mollement, écoutez un peu, mais d’une façon calme et continue, ça ne peut manquer d’amener un état de clairvoyance, très utile pour nous diriger avec fermeté dans la vie. Tout se tient. Comprenez-moi bien, si ma toile est saturée de cette vague religiosité cosmique, qui m’émeut, moi, qui me rend meilleur, elle ira toucher les autres en un point peut-être qu’ils ignorent de leur sensibilité. J’ai besoin de connaître la géométrie, les plans, tout ce qui tient ma raison droite. L’ombre est-elle concave ? me suis-je demandé. Qu’est-ce que ce cône là-haut ? tenez. De la lumière ? J’ai vu que l’ombre sur Sainte-Victoire est convexe, renflée. Vous le voyez comme moi. C’est incroyable. C’est ainsi… J’en ai eu un grand frisson. Si je fais par le mystère de mes couleurs partager ce frisson aux autres, n’auront-ils pas un sens de l’universel plus obsédant peut-être, mais combien plus fécond et plus délicieux ? L’autre soir, en revenant à Aix, nous avons parlé de Kant. J’ai voulu me placer à votre point de vue. Les arbres sensibles ? Qu’est-ce qu’il y a de commun entre un arbre et nous ? Entre un pin tel qu’il m’apparaît et un pin tel qu’il est en réalité ? Hein, si je peignais ça… Ne serait-ce pas la réalisation de cette partie de la nature qui tombant sous nos yeux nous donne le tableau ? Les arbres sensibles !… Et dans ce tableau n’y aurait-il pas une philosophie des apparences plus accessible à tous que toutes les tables de catégories, que tous vos noumènes et vos phénomènes ? On sentirait en le voyant la relativité de toutes choses à soi, à l’homme. Je voudrais, me disais-je, peindre l’espace et le temps pour qu’ils deviennent les formes de la sensibilité des couleurs, car j’imagine parfois les couleurs comme de grandes entités nouménales, des idées vivantes, des êtres de raison pure. Avec qui nous pourrions correspondre. La nature n’est pas en surface ; elle est en profondeur. Les couleurs sont l’expression, à cette surface, de cette profondeur. Elles montent des racines du monde. Elles en sont la vie, la vie des idées. Le dessin, lui, est tout abstraction Aussi ne faut-il jamais le séparer de la couleur. C’est comme si vous vouliez penser sans mots, avec de purs chiffres, de purs symboles. Il est une algèbre, une écriture… Dès que la vie lui arrive, dès qu’il signifie des sensations, il se colore. À la plénitude de la couleur correspond toujours la plénitude du dessin. Au fond, montrez-moi quelque chose de dessiné dans la nature. Où ? Où ? Ce que les hommes bâtissent, droit, dessiné, les murs, les maisons, regardez, le temps, la nature les fichent de guingois. La nature a horreur de la ligne droite. Et zut pour les ingénieurs ! Nous ne sommes pas des agents-voyers. Ils se tourmentent bien des couleurs, ceux-là… Tandis que moi… Oui, oui, la sensation est à la base de tout.
Il fouille de nouveau dans ses poches.
Passez-moi mon papier.
Il le défroisse, le parcourt. Il me le rend. Il en retrouve un autre lambeau.
J’avais encore noté ceci.
Il lit :
« Les sensations colorantes qui donnent la lumière sont cause d’abstractions, qui ne me permettent pas de couvrir ma toile, ni de poursuivre la délimitation des objets, quand les points de contact sont ténus, délicats ; d’où il ressort que mon image ou tableau est incomplet. D’un autre côté les plans tombent les uns sur les autres, d’où le serti néo-impressionniste qui circonscrit les contours d’un trait noir, défaut qu’il faut combattre à toute force. Or, la nature consultée nous donne les moyens d’atteindre ce but. »
Moi :
― Et c’est ?
Cézanne :
― Les plans dans la couleur, les plans ! Le lieu coloré où l’âme des plans fusionne, la chaleur prismatique atteinte, la rencontre des plans dans le soleil. Je fais mes plans avec mes tons sur la palette, comprenez-vous… Il faut voir les plans… Nettement… Mais les agencer, les fondre. Il faut que ça tourne et que ça s’interpose à la fois. Les volumes seuls importent. De l’air entre les objets pour bien peindre. Comme de la sensation entre les idées pour bien penser. Le bitume est plat. La logique est courte. On peint dans des caves où il n’y a plus de plans. On se garrotte dans les syllogismes où il n’y a plus d’intuition. Du carton. Il faut que ça renfle ! Comprenez-vous ? Il faut apparenter les contrastes dans l’apposition juste des tons. La moindre défaillance d’œil fiche tout à bas. Et moi, c’est terrible, mon œil se colle au tronc, à la motte. Je souffre à l’en arracher, tant quelque chose me retient.
Moi :
― Oui, je l’ai remarqué, vous restez vingt minutes parfois entre deux coups de pinceau.
Cézanne :
― Et les yeux, n’est-ce pas ? ma femme me le dit, me sortent de la tête, sont injectés de sang… Une espèce d’ivresse, d’extase me fait chanceler comme dans un brouillard, lorsque je me lève de ma toile…. Dites, est-ce que je ne suis pas un peu fou ?… L’idée fixe de la peinture…. Frenhofer… Balthasar Claës… des fois, vous savez, je me le demande.
Je lui montrai sa toile. Sous le grand pin, inachevée, elle s’approfondissait partout jusqu’au mystère de l’être, aux racines de l’énigme, fragment de diamant brisé où tout le soleil du monde se fut réfracté dans l’allégement d’une pesanteur équilibrée. Une musique intérieure s’en dégageait, l’esprit comblait les vides. Pas encore couverte, les fils roux du tissu béaient comme un regard d’aveugle. Ces verts graves, les bleus pensifs, à côté des tons plus légers, des carrés encore mornes, se répondaient déjà, soutenaient l’entablement du mont, la montée allègre de l’air, les colonnes verdoyantes du ciel, les deux arbres, qui, à droite, à gauche, enlaçaient au-dessus des terres, dans la même caresse, leurs strophes de branchages amis… Il venait de ce rayonnement de couleurs précises une telle évidence que le vieux maître lui sourît. Il reporta les yeux sur l’immense paysage, tout pareil, moins humain, aussi beau.
Copier… copier, oui… Il n’y a que ça. Mais les tempéraments ! La peinture reconnaîtra les siens. Je veux, moi, me perdre en la nature, repousser avec elle, comme elle, avoir les tons têtus des rocs, l’obstination rationnelle du mont, la fluidité de l’air, la chaleur du soleil. Dans un vert mon cerveau tout entier coulera avec le flot séveux de l’arbre. Il y a devant nous un grand être de lumière et d’amour, l’univers vacillant, l’hésitation des choses. Je serai leur olympe, je serai leur dieu. L’idéal au ciel s’épousera en moi. Les couleurs, écoutez un peu, sont la chair éclatante des idées et de Dieu. La transparence du mystère, l’irisation des lois. Leur sourire nacré ranime la face morte du monde évanoui. Où est hier, avant-hier ? la plaine et le mont que j’ai vus ? Dans ce tableau, dans ces couleurs. Mieux que dans vos poèmes, puisque plus de sens matérialisés y participent, la conscience du monde se perpétue dans nos toiles. Elles marquent les étapes de l’Homme. Depuis les rennes aux parois des cavernes jusqu’aux falaises de Monet aux murs des marchands de porcs, on peut suivre la route humaine… Des chasseurs, des pêcheurs qui peuplent les souterrains d’Égypte, des marivaudages de Pompéi, des fresques de Pise et de Sienne, des mythologies de Véronèse et de Rubens un témoignage monte, un esprit se dégage, partout le même, et qui est la mémoire objectivée, la mémoire peinte de l’homme concrétisé dans ce qu’il voit. Nous ne croyons vraiment que ce que nous voyons. Nous voyons dans la peinture tout ce que l’homme a vu. Tout ce qu’il a voulu voir. Nous sommes le même homme. J’ajouterai un anneau à cette chaîne colorée. Mon chaînon bleu. L’apport de la nature vraie, le paysage qui rentre dans l’intelligence, le positivisme du paysage, ce que nous sentons, nous, les civilisés, devant un paysage, ce paysage où ont passé les hordes saliennes, où nous bavardons de Darwin et de Schopenhauer. La consolation hindoue du nirvana naturel sur nos sens fatigués, à la dernière étape. Sous le dramatique des nuages la paix des blés qui poussent… La divinité inapprochable, invisible, le soleil !… Des systèmes, un système… Oui, il en faut un… Mais ce système établi, copier. On a un système tout fait, et on l’oublie, on copie. Voilà les grands. Voilà les peintres. Les Vénitiens. Avez-vous vu à Venise ce gigantesque Tintoret, où la terre et la mer, le globe terraqué se suspendent au-dessus des têtes, avec l’horizon qui se déplace, la profondeur, les lointains marins, et les corps qui s’envolent, l’immense rotondité, la mappemonde, la planète jetée, tombant, roulant en plein éther ? À son époque ! Il nous prophétisait. Il avait déjà cette obsession cosmique qui nous dévore. Eh bien ! je suis sûr qu’en peignant il ne pensait à rien, qu’à son plafond, à équilibrer des volumes, à juxtaposer des valeurs. À bien peindre. Mais bien peindre, c’est, malgré soi, exprimer son époque dans ce qu’elle a de plus avancé, être au sommet du monde, de l’échelle des hommes. Les mots, les couleurs ont un sens. Un peintre qui sait sa grammaire et qui pousse sa phrase à l’excès, sans la rompre, qui la calque sur ce qu’il voit, qu’il le veuille ou non, traduit sur sa toile ce que le cerveau le mieux informé de son temps a conçu et est en train de concevoir. Giotto répond à Dante, Tintoret à Shakespeare, Poussin à Descartes, Delacroix… à qui ? Ce qui est insensé, c’est avoir une mythologie préformée, des idées d’objets toutes faites, et de copier ça au lieu du réel, ces imaginations au lieu de cette terre. Les faux peintres ne voient pas cet arbre, votre visage, ce chien, mais l’arbre, le visage, le chien. Ils ne voient rien. Rien n’est jamais le même. Eux, une espèce de type fixe, embrumé, qu’ils se passent les uns aux autres, flotte toujours entre leurs yeux ― ont-ils des yeux ? ― et leur modèle. Oui, il faut de grandes lois, des principes, et après les grandes secousses, les émotions intellectuelles où leur constatation vous jette, innocemment copier la nature. Je suis un cérébral, tant que vous voudrez, mais je suis aussi une brute. Je philosophe, je cause, je bavarde avec vous. Devant mes tubes, mes brosses à la main, je ne suis plus que peintre, le dernier des peintres, un enfant. Je sue cœur et sang. Je ne sais plus rien. Je peins. C’est un peu comme les gens qui se croient honnêtes parce qu’ils obéissent au code. L’honnête homme a son code dans le sang. Le génie se fait en vivant son propre code. Oui, oui, le génie, qui n’ignore rien des autres, se fait sa propre méthode.
Moi :
― Une méthode ?
Cézanne :
― Et toujours la même. Le vrai. Il la trouve, mais c’est toujours la même au fond. La mienne, voyez-vous, je n’en ai jamais eu d’autre, c’est la haine de l’imaginatif. Je voudrais être bête comme chou. Ma méthode, mon code, c’est le réalisme. Mais un réalisme, entendez-moi bien, plein de grandeur, sans s’en douter. L’héroïsme du réel. Courbet, Flaubert. Mieux encore. Je ne suis pas romantique. L’immensité, le torrent du monde dans un petit pouce de matière. Croyez-vous que ce soit impossible ? La perpétuité colorée du sang. Rubens.
Il alla, contre un buisson, prendre l’autre toile, le même motif, plus apaisé, plus tendre, qui attendait.
Je suis une vieille bête… Ma méthode c’est d’aimer le travail.
Il suspendit son carnier à l’arbre. Il but une gorgée à même la bouteille.
Rubens… Rubens… Écoutez un peu. Ce n’est plus de notre temps, tout ça. Le soir du monde tombe. La peinture, avec tout, s’en va… Bien heureux qu’on me fiche la paix et si on me laisse crever dans mon coin en travaillant.
Il s’installa, à dix pas de l’autre, devant son nouveau motif, le motif de l’après-midi. Il avait pris ses pinceaux et ses brosses, une seconde palette, toute préparée. Il regarda la toile. Le soleil descendait.
Moi :
― Qui sait ? maître…
Cézanne :
― Ne m’appelez pas maître.
Moi :
― Nous sommes peut-être à un grand tournant. Vous êtes un précurseur.
Il se redresse. Sa toile l’attire comme un visage.
C’est en vous peut-être, dans une de ces toiles qu’on cherchera, un jour, ce qu’ont pensé et senti tous ces gens d’aujourd’hui, ces hommes qui vous ignorent.
Il entre le cou dans les épaules. Il cligne des yeux sur le paysage. Il a choisi un pinceau. Il fouille avec sur sa palette, il le balance. Il pose une touche… Il m’a oublié, et ces hommes, cet avenir dont je lui parle, et ce paysage lui-même peut-être. Il ne voit plus que des couleurs. J’ai pris mon livre, mais c’est lui que je voudrais déchiffrer, je ne lis pas. Il me jette un dernier regard.
Cézanne :
― Travaillons. »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 12-13, 159-186.
« Je le revois, au Louvre, en arrêt devant la Bataille des Cimbres et des Teutons évoquant, sous les tons maussades de la toile enfiévrée de Decamps, cette ruée de peuples peut-être, peut-être en sa nostalgie d’Aix l’entonnoir rugueux, les pentes tragiques des Infernets où Decamps établit sa mêlée, ou encore, plus probablement, juxtaposant aux valeurs du vieux peintre sa vision et ses soucis à lui, ce tourment de rendre, avec son métier direct et précis, ce grand frisson du passé qui le secouait. C’est ce que Zola appelait son romantisme, Zola, qui eut une si forte influence sur toute la jeunesse et la carrière de Cézanne, mais que l’histoire n’émut jamais.
Je le revois, dans la salle des États, se retournant brusquement vers moi avec son visage de narquois enthousiasme.
« ― Hein ! le bougre, comme il a peint ça sombre et chaud… Vous savez ce qu’il a dit, Decamps, en arrivant sur notre colline des Pauvres, devant tout ça ?… « Qu’est-ce que je suis allé fiche en Orient ?… » Oui. Je tiens le propos d’Emperaire… N’empêche que ça chante bien, chez nous, d’un dramatique autrement clair !… La poussière ensoleillée, la sueur des chevaux, l’odeur du sang, toute votre littérature, nous peintres, nous devons l’enfoncer dans nos tons… Qu’on ne me dise plus que ce n’est pas possible. Tenez, regardez… » Et il m’entraîna devant l’Entrée des Croisés à Constantinople.
Ce goût des vibrantes évocations, qu’il mit toujours une sorte de sainteté à étouffer en lui par horreur de l’à peu près et soumission parfaite de son art à la totale vérité, il le tenait sans doute de sa race. » […]LE LOUVRE
« L’Idéal du bonheur terrestre ?…
Avoir une belle formule. »Nous sortions de la Galerie des Machines, du Salon. Nous étions venus revoir le Balzac de Rodin. Cézanne en avait acheté une photographie, pour me l’offrir… Il était onze heures, nous déjeunâmes rapidement et nous allâmes au Louvre, sur l’impériale de Passy-Hôtel-de-Ville, le long des quais.
Il faisait un jour clair de printemps cérébral, un après-midi de Paris. Des verts tendres pointaient aux arbres. La Seine s’ensoleillait. Toute la vieille histoire, par-delà les ponts, miroitait vers la Cité. Les midinettes flânaient. On les voyait, sur les bancs des Tuileries, qui achevaient leurs frites. Des enfants couraient le long des voitures pour offrir aux jeunes couples des touffes de violettes. Les passants s affairaient vers la rumeur des boulevards. Mais, le long des berges, tout était attendri, printanier et calme. L’Institut, le Louvre, Notre-Dame se couronnaient d’une gloire légère. Après un bon café, Cézanne expansif, souriait.
Cézanne :
― Hein ?… Notre vieille France se chauffe au soleil et met le nez à la fenêtre. Voyez… La tradition ! Je suis plus traditionnel que l’on ne croit. C’est comme Rodin. On ne saisit pas du tout ce qui le caractérise, au fond. C’est un homme du moyen âge qui fait d’admirables morceaux, mais qui ne voit pas l’ensemble. Il lui faudrait être encadré, comme ces vieux imagiers, au porche d’une cathédrale. Rodin est un prodigieux tailleur de pierres, avec tous les frissons modernes, qui réussira toutes les statues qu’on voudra, mais qui n’a pas une idée. Il lui manque un culte, un système, une foi. Sa porte de l’enfer, son monument au travail, c’est quelqu’un qui lui a soufflé ça et vous verrez qu’il ne les bâtira jamais. Mirbeau, je pense, est derrière son Balzac. Par exemple, il l’a attrapé, calé, d’une intelligence prodigieuse, avec ses yeux qui lampent le monde et se closent passionnément sur lui, des yeux qui ont l’air d’avoir noirci dans tout le café dont s’abreuvait continuellement Balzac. Et les mains, qui sous la houppelande maîtrisent toute la vie de ce chaste. C’est épatant !……Et ce bloc, vous savez, il est fait pour être vu de nuit, éclairé par dessous, violemment, à la sortie du Français ou de l’Opéra, dans cette fièvre nocturne du Paris où l’on imagine le romancier et ses romans, hein !… Je ne voulais pas diminuer Rodin, écoutez un peu, en disant ce que je disais. Je l’aime, je l’admire beaucoup, mais il est bien de son temps, comme nous tous. Nous faisons le morceau. Nous ne savons plus composer.
Moi :
― Mais ne croyez-vous pas qu’il y ait souvent dans un portrait comme celui de la mère de Rembrandt, dans une nature morte comme la raie de Chardin, je n’ose pas dire, comme dans vos pommes, autant d’art et de pensée que dans une scène d’histoire, une allégorie païenne ou catholique ?
Cézanne :
― Ça dépend, ça dépend… Vous comprenez, si vous comparez un Chardin à un Lesueur, un portrait de Velasquez ou de Rembrandt à une ripaille de Jordaens, mes pommes à un paysage de Troyon, c’est incontestable. Mais attendez. J’attends d’être arrivé au Louvre pour vous répondre. On ne parle bien de peinture que devant de la peinture. Rien n’est plus dangereux pour un peintre, vous savez, que de se laisser aller à la littérature. S’il coupe dans ce pont, il est foutu. J’en sais quelque chose. Le mal que Proudhon a fait à Courbet, Zola me l’aurait fait. Il n’y a que Baudelaire qui ait parlé proprement de Delacroix et de Constantin Guys. J’aime beaucoup que Flaubert, vous savez, dans ses lettres, s’interdise rigoureusement de parler d’un art dont il ignore la technique. C’est tout lui… Ce n’est pas que je désire que le peintre soit un ignorant. Au contraire. Aux grandes époques ils savaient tout. Les artistes, aux vieux temps, étaient les maîtres d’enseignement de la foule. Tenez, vous voyez Notre-Dame là-bas. La création et l’histoire du monde, les dogmes, les vertus, la vie des saints, les arts et les métiers, tout ce qu’on savait alors était enseigné par son porche et ses vitraux. Comme dans toutes les cathédrales de France, d’ailleurs. Le Moyen Âge apprenait sa foi par les yeux, comme la mère de Villon…
Le paradis où sont harpes et luths…
C’était la vraie science, et c’est tout l’art religieux. Ce que l’abbé Tardif, votre ami, dit qu’on trouve dans saint Thomas, le peuple le cherchait dans les statues du portail, à son église. Cet ordre, cette hiérarchie, cette philosophie, allez, ça valait la Somme, et pour nous c’est plus vrai, puisque c’est plus beau et que nous le comprenons encore sans efforts. Tout ce symbolisme, dont on parle, car on prétend que la kabbale, elle aussi, a sa place dans les rosaces, tout le mysticisme intellectuel s’est endormi sous la rouille gothique des pierres ; je n’en sais rien, je n’en veux rien savoir. Mais la vie est toujours là… Que voulez-vous ? Quand les formes de la Renaissance éclatèrent avec le paganisme des temps passionnés, le peuple eut beau détourner les yeux du réalisme décharné de ses chapelles, il s’en souvint toujours. Ça donna une amertume tonique à sa vie. La rhétorique des grandes machines ne put jamais le prendre tout à fait. Pas plus que moi, il n’aime la peinture oratoire, le peuple. Oui, la galerie des batailles à Versailles, mais ce n’est pas de la peinture qu’il regarde là. Il y lit une espèce de journal, de grand journal mural, des images d’Épinal, comme au Panthéon la Sainte-Geneviève Mais dans le château, dans le parc, il n’est jamais remué, à Versailles, comme dans une église ou dans une arène. Il a le sens de la grandeur chevillé au corps. Chez nous, en Provence, ça lui vient des Romains, ici, dans le Nord, des cathédrales… C’est épatant, tout de même. Écoutez un peu, voilà, je suis classique ; je me dis, je voudrais être classique, mais ça m’ennuie. Versailles m’embête, la cour carrée m’embête. Il n’y a que la place de la Concorde, ça c’est beau. La vie !… la vie !… Et pourtant, voyez comme tout cela est compliqué ; la vie, le réalisme sont bien plus dans le XVe et dans le XVIe siècles que dans les allongements des primitifs. Je n’aime pas les primitifs. Je connais mal Giotto. Il faudrait que je le voie. Je n’aime que Rubens, Poussin et les Vénitiens… Il est plus facile, écoutez-moi bien, de signifier Dieu par une croix que par l’expression d’un visage.
Nous étions arrivés ; nous descendions du tramway.
Moi :
― Si vous voyiez les Duccio de Sienne… Il y a tout dans ces petites scènes. Les unes sont dramatiques comme un Tintoret, avec des verts, des roux livides, les autres, comme Jésus devant Pilate, ont le tragique simple, sont composées avec la pureté d’un acte de Racine ; et les femmes au tombeau, devant le grand Ange, aucun bas-relief antique n’a leur noblesse et leur désespoir triomphant. C’est beau comme la Victoire attachant sa sandale. Si vous voyiez !…
Cézanne :
― Je suis trop vieux maintenant pour m’en aller courir l’Italie… Et puis, il me semble qu’il y a tout dans le Louvre, qu’on peut tout aimer et comprendre par lui.
Moi :
― Tout… Sauf peut-être les fresques, le mouvement franciscain de la peinture ombrienne, et ce qui en est né, Masaccio, Gozzoli… Mais qu’est-ce que l’Italie et cet art pourraient vous ajouter, à vous ? On dirait que vous en êtes sorti et que vous l’avez médité toute votre vie.
Cézanne :
― Je vous étonnerai peut-être. Je n’entre presque jamais dans la petite salle des primitifs. Ce n’est pas de la peinture pour moi. J’ai tort, j’ai peut-être tort, je l’avoue ; mais que voulez-vous, quand je suis resté une heure en contemplation devant le Concert champêtre ou le Jupiter et Antiope du Titien, quand j’ai dans les yeux toute la foule mouvementée des Noces de Cana, que voulez-vous que me fassent les maladresses de Cimabue, les naïvetés de l’Angelico et même les perspectives d’Uccello… Il n’y a pas de chair sur ces idées. Je laisse ça à Puvis. J’aime les muscles, les beaux tons, le sang. Je suis comme Taine, moi, et de plus, je suis peintre. Je suis un sensuel.
Nous montions le grand escalier Daru.
Tenez. Regardez-moi ça… la Victoire de Samothrace. C’est une idée, c’est tout un peuple, un moment héroïque dans la vie d’un peuple, mais les étoffes collent, les ailes battent, les seins se gonflent. Je n’ai pas besoin de voir la tête pour imaginer le regard, parce que tout le sang qui fouette, circule, chante dans les jambes, les hanches, tout le corps, il a passé en torrent dans le cerveau, il est monté au cœur. Il est en mouvement, il est le mouvement de toute la femme, de toute la statue, de toute la Grèce. Quand la tête s’est détachée, allez, le marbre a saigné… Tandis que là-haut, vous pouvez, avec le sabre du bourreau, couper le cou à tous ces petits martyrs. Un peu de vermillon, des gouttes de sang, ça… Ils sont déjà tout envolés en Dieu, exsangues. On ne peint pas des âmes. Et tenez, les ailes de la Victoire, on ne les voit pas, je ne les vois plus. On n’y pense plus, tant elles apparaissent naturelles. Le corps n’a pas besoin d’elles pour s’envoler en plein triomphe. Il a son élan…. Tandis que les auréoles, autour du Christ, des Vierges et des Saints, on n’aperçoit qu’elles. Elles s’imposent. Elles me gênent. Que voulez-vous ? On ne peint pas des âmes. On peint des corps ; et quand les corps sont bien peints, foutre ! l’âme, s’ils en avaient une, l’âme de toutes parts rayonne et transparaît.
Nous entrions dans le petit salon de la Source.
Ingres non plus, parbleu, n’a pas de sang. Il dessine. Les primitifs dessinaient. Ils coloriaient, ils faisaient, en grand, du coloriage de missel. La peinture, ce qui s’appelle la peinture, ne naît qu’avec les Vénitiens. À Florence, Taine raconte que tous les peintres d’abord étaient des orfèvres. Ils dessinaient. Comme Ingres… Oh ! c’est très beau, Ingres, Raphaël, et toute la boutique. Je ne suis pas plus bouché qu’un autre. J’ai le plaisir de la ligne, quand je veux. Mais il y a là un écueil. Holbein, Clouet ou Ingres n’ont que la ligne. Eh bien !, ça ne suffit pas. C’est très beau, mais ça ne suffit pas. Regardez cette Source… C’est pur, c’est tendre, c’est suave, mais c’est platonique. C’est une image, ça ne tourne pas dans l’air. Le rocher de carton n’échange rien de son humidité pierreuse avec le marbre de cette chair mouillée… ou qui devrait l’être. Où y a-t-il pénétration ambiante ? Et puisqu’elle est la source, elle devrait sortir de l’eau, du rocher, des feuilles ; elle est collée contre. À force de vouloir peindre la vierge idéale, il n’a plus peint un corps du tout. Et ce n’est pas que ce lui fût impossible, à lui. Rappelez-vous ses portraits et cet Age d’or que j’aime. C’est par esprit de système. Système et esprit faux. David a tué la peinture. Ils ont introduit le poncif. Ils ont voulu peindre le pied idéal, la main idéale, le visage, le ventre parfaits, l’être suprême. Ils ont banni le caractère. Ce qui fait le grand peintre, c’est le caractère qu’il donne à tout ce qu’il touche, la saillie, le mouvement, la passion, car il y a des sérénités passionnées. Eux en ont peur, ou plutôt ils n’y ont pas songé. Par réaction peut-être contre toute la passion, les tempêtes, la brutalité sociale de leur époque.
Moi :
― David y trempait jusqu’au cou pourtant.
Cézanne :
― Oui, mais je ne connais rien de plus froid que son Marat ! Quel héros étriqué ! Un homme qui avait été son ami, qui venait d’être assassiné, qu’il devait glorifier aux yeux de Paris, de la France entière, de toute la postérité. L’a-t-il assez rapetassé avec son drap et délavé dans sa baignoire ? Il pensait à ce qu’on dirait du peintre et non à ce qu’on penserait de Marat. Mauvais peintre. Et il avait eu le cadavre devant les yeux… J’aime des morceaux dans le Sacre pourtant, l’enfant de chœur, la tête entre les chandeliers, on dirait déjà du Renoir… Il était mieux à l’aise avec ces parvenus qu’avec le sacré cœur de l’autre promené dans les rues de Paris. Tenez, quelque chose d’immonde, ce sont ses caricatures. Elles m’ont révélé, du coup, toute la mécanique grinçante de cet esprit. Mais voilà de la peinture.
Nous entrions dans le Salon carré. Il se planta devant les Noces de Cana. Le melon en arrière, sous son bras son pardessus traînait. On l’eût dit en extase.
Voilà de la peinture. Le morceau, l’ensemble, les volumes, les valeurs, la composition, le frisson, tout y est… Écoutez un peu, c’est épatant !… Qu’est-ce que nous sommes ?… Fermez les yeux, attendez, ne pensez plus à rien. Ouvrez-les… N’est-ce pas ?.. On ne perçoit qu’une grande ondulation colorée, hein ? une irisation, des couleurs, une richesse de couleurs. C’est ça que doit nous donner d’abord le tableau, une chaleur harmonieuse, un abîme où l’œil s’enfonce, une sourde germination. Un état de grâce colorée. Tous ces tons vous coulent dans le sang, n’est-ce pas ? On se sent ravigoté. On naît au monde vrai. On devient soi-même, on devient de la peinture… Pour aimer un tableau, il faut d’abord l’avoir bu ainsi, à longs traits. Perdre conscience. Descendre avec le peintre aux racines sombres, enchevêtrées, des choses, en remonter avec les couleurs, s’épanouir à la lumière avec elles. Savoir voir. Sentir… Surtout devant une grande machine comme en bâtissait Véronèse. Celui-là, allez, il était heureux. Et tous ceux qui le comprennent, il les rend heureux. Il est un phénomène unique. Il peignait comme nous regardons. Sans plus d’efforts. En dansant. Ces torrents de nuances lui coulaient du cerveau, comme tout ce que je vous dis me coule de la bouche. Il parlait en couleurs. C’est épatant, je ne sais presque rien de sa vie ! Il me semble que je l’ai toujours connu. Je le vois marcher, aller, venir, aimer, dans Venise, devant ses toiles, avec ses amis. Un beau sourire. Un regard chaud. Un corps franc. Les choses, les êtres lui entraient dans l’âme avec le soleil, sans rien qui les lui sépare de la lumière, sans dessin, sans abstractions, tout en couleurs. Ils en sortaient, un jour, les mêmes, mais, on ne sait pourquoi, habillés d’une gloire douce. Tout heureux comme s’ils avaient respiré une mystérieuse musique. Celle qui rayonne, voyez, de ce groupe, au milieu, que les femmes et les chiens écoutent, que les hommes caressent avec leurs fortes mains. La plénitude de la pensée dans le plaisir et du plaisir dans la santé, écoutez un peu, je crois que c’est Véronèse, la plénitude de l’idée dans les couleurs. Il couvrait ses toiles d’une vaste grisaille, oui, comme ils faisaient tous à cette époque, et c’était sa première emprise, comme un morceau de la terre avant que le jour, l’esprit se lève…
Moi :
― Comme vous, lorsque vous méditez la géologie de vos paysages, que vous les esquissez en vous…
Cézanne :
― Oh ! moi, moi… Je suis un petit enfant, écoutez un peu, là-devant… Ce que je vois, vous comprenez, c’est ce métier formidable, et si naturel, si aisé, pour eux. Ils avaient ça dans la main et les yeux, d’atelier en atelier. Le dessous, les dessous. Je disais bien. Il préparait, d’une immense grisaille… L’idée décharnée, anatomique, squelettique de son univers, la charpente douce qu’il lui fallait, et qu’il allait habiller de nuances, avec ses couleurs et ses glacis, en tassant les ombres. Un grand monde pâle, ébauché, encore dans les limbes… il me semble que je le vois, tenez, entre le tissu de la toile et la chaleur prismatique du soleil… On empâte tout de suite aujourd’hui, on attaque grossièrement comme un maçon, et l’on se croit très fort, très sincère… Va te faire fiche. On a perdu cette science des préparations, cette vigueur fluide que donnent les dessous. Modeler, non, moduler. Il faut moduler… Aujourd’hui ! on revient, on gratte, on regratte, on épaissit. C’est un mortier. Ou bien, les plus sommaires, les Japonais, vous savez, ils cernent brutalement leurs bonshommes, leurs objets, d’un trait brut, schématique, appuyé, et en teintes plates on remplit jusqu’au bord. C’est criard comme une affiche, peint comme au pochoir, à l’emporte-pièce. Rien ne vit. Tandis que voyez-vous cette robe, cette femme, cette créature, contre cette nappe, où commence sur son sourire l’ombre, où la lumière caresse-t-elle, boit-elle, imbibe-t-elle cette ombre, on ne sait pas. Tous les tons se pénètrent, tous les volumes tournent en s’emboîtant. Il y a continuité… Je ne nie pas que des fois, sur nature, il n’y ait de ces effets brusques d’ombre et de lumière, par bandes violentes, mais ce n’est pas intéressant. Surtout, si ça devient un procédé. Le magnifique, c’est de baigner toute une composition infinie comme celle-ci, immense, de la même clarté atténuée et chaude et de donner à l’œil l’impression vivante que toutes ces poitrines respirent véritablement, mais là comme vous et moi, l’air doré qui les inonde. Au fond, j’en suis sûr, ce sont les dessous, l’âme secrète des dessous, qui, tenant tout lié, donnent cette force et cette légèreté à l’ensemble. Il faut commencer neutre. Après, il pouvait s’en donner à cœur joie, comprenez-vous ? Sacristi ! le chic parfait, le chic exquis, l’audacieux de tous les ramages, des étoffes qui se répondent, des arabesques qui s’enlacent, des gestes qui se continuent. Est-ce assez ça ? non, mais est-ce assez ça ? Vous pouvez détailler. Tout le reste du tableau vous suivra toujours, sera toujours là présent. Vous sentirez sa rumeur autour de la tête, du morceau que vous étudierez. Vous ne pouvez rien arracher à l’ensemble… Ce n’étaient pas des peintres de morceaux, ceux là, comme nous… Vous me demandez toujours ce qui nous empêche, après tout, d’aimer même un Courbet ou un Manet comme un Rubens ou un Rembrandt, ce qu’il y a de plus dans cette vieille peinture… il faut que nous en ayons le cœur net, que nous le trouvions aujourd’hui. Évidemment, l’Enterrement à Ornans, c’est une fichue page, et l’Entrée des Croisés et le Plafond d’Apollon, mais devant ça ou devant le Paradis du Tintoret, quelque chose chez les modernes flanche. Quoi ?… Dites, quoi ?.. Nous allons voir. Nous allons voir… Tenez, prenez à gauche, là, partez de cette colonne, est-elle de marbre, sacrédié ! et lentement, des yeux, faites tout le tour de la table… Est-ce beau ? Est-ce vivant ?… Et en même temps, est-ce transfiguré, triomphant, miraculeux, dans un monde autre et cependant tout réel. Le miracle y est, l’eau changée en vin, le monde changé en peinture. On nage dans la vérité de la peinture. On est saoul. On est heureux. Moi, c’est comme un vent de couleurs qui m’emporte, une musique que je reçois au visage, tout mon métier qui me coule dans le sang… Ah ! ils en avaient un sacré métier, ces bougres-là. Nous ne sommes rien, écoutez un peu, de vieilles bêtes, rien. Nous ne sommes même plus fichus de comprendre… Dire que j’ai voulu brûler ça, dans le temps. Par manie d’originalité, d’inventer… Quand on ne sait pas, on croit que ce sont ceux qui savent qui vous obstruent… Alors qu’au contraire, si on les fréquente, au lieu de vous encombrer, ils vous prennent par la main, et vous font gentiment, à côté d’eux, balbutier votre petite histoire. Ah ! faire d’après les grands maîtres décoratifs Véronèse et Rubens des études, mais comme on ferait d’après nature… La peinture, voyez-vous, a été perdue, lorsqu’elle a voulu être sage, faire léché, avec David. C’est ma grande horreur. Il est le dernier peut-être qui ait su son métier, mais qu’en a-t-il fait bon Dieu ? Les boutons de culotte de sa Remise des aigles. Alors qu’en grande pompe il eût dû nous donner, à la Titien, la psychologie de tous ces palefreniers et de tous ces goujats autour de leur crapule couronnée. Sale jacobin, sale classique… Vous savez, dans les Origines, ce que raconte Taine de l’esprit classique ! Ah ! David en est bien le terrible exemple. Ce vertueux !.. Il est arrivé à châtrer, dans son art, même ce paillard d’Ingres, qui adorait la femelle pourtant… On doit apprendre son métier. Seulement, on doit l’apprendre ici, par soi-même, dans la fréquentation des maîtres. Je ne parle pas des recettes, de l’apprentissage, hélas ! perdu, de tout ce qui est matériel et qui n’a rien à voir ici, le bon compagnonnage tué par ce révolutionnaire et qui faisait gagner tant de temps. Cela, les bons ateliers le donnaient. Il faudra qu’on y revienne… Mais je parle des maîtres. Quel que soit celui que vous préférez, ce ne doit être pour vous qu’une orientation. Sans cela, vous ne seriez qu’un pasticheur. Avec un sentiment de la nature, quel qu’il soit, et quelques dons heureux, vous devez arriver à vous dégager ; les conseils, la méthode d’un autre ne doivent pas vous faire changer votre manière de sentir. Subiriez-vous momentanément l’influence d’un plus ancien que vous, croyez bien que, du moment que vous ressentez, votre émotion propre finira toujours par émerger et conquérir sa place au soleil, prendre le dessus. Confiance. C’est une bonne méthode de construction qu’il faut arriver à posséder. Le dessin n’est que la configuration de ce que vous voyez. Michel-Ange est un constructeur, et Raphaël un artiste, qui, si grand qu’il soit, est toujours bridé par le modèle Quand il veut devenir réfléchisseur il tombe au-dessous de son grand rival. C’est celui-là qu’il faut être, à sa manière, et c’est de celui-là qu’éloignent les professeurs. Rien n’est plus mauvais que la férule des professeurs qui vous entrent de force dans la caboche leur ignorance, leur vision à eux. Ah ! il faut bien se choisir ses maîtres, ou plutôt ne pas les choisir, les avoir tous, les comparer. Comme l’homme d’un seul livre, je craindrais l’élève d’un seul peintre. Jean-Dominique est fort, très fort ! Eh bien ! il est très dangereux. Voyez Flandrin, voyez-les tous, jusqu’à Degas…
Moi :
― Degas ?
Cézanne :
― Degas n’est pas assez peintre, il n’a pas assez de ça !… Avec un petit tempérament on peut être très peintre. Il suffit d’avoir un sens d’art, et c’est sans doute l’horreur du bourgeois, ce sens-là. C’est pourquoi les instituts, les pensions, les honneurs ne peuvent être faits que pour les crétins, les farceurs et les drôles. Mais ce n’est pas de ces gens-là que je parle. Qu’ils aillent à l’École, qu’ils aient des professeurs à la pelle. Je m’en fous. Ce que je déplore, c’est que tous ces jeunes auxquels vous croyez, dont vous me parlez, ne courent pas l’Italie, ne passent pas leur journée ici. Quitte à se jeter en pleine nature, après. Tout est, en art surtout, théorie développée et appliquée au contact de la nature. Je ne voudrais pas qu’il leur arrive ce qui m’est arrivé, à moi. Je sais, je sais, si les salons officiels restent si inférieurs, la raison en est claire, ils ne mettent en œuvre que des procédés plus ou moins étendus. La sensation est à la base de tout, pour un peintre. Je le répéterai sans cesse. Ce ne sont pas les procédés que je préconise. Il vaudrait mieux apporter plus d’émotion personnelle, d’observation et de caractère. Mais voilà le chiendent ! Les théories sont toujours faciles. Il n’y a que la preuve à faire de ce qu’on pense qui présente de sérieux obstacles. Ici, au fond, je crois que le peintre apprend à penser. Sur nature, il apprend à voir. C’est grotesque d’imaginer qu’on pousse comme un champignon, quand on a toutes les générations derrière soi. Pourquoi ne pas profiter de tout ce travail, négliger cet apport formidable ? Oui, le Louvre est le livre où nous apprenons à lire. Nous ne devons pas cependant nous contenter de retenir les belles formules de nos illustres devanciers. Nous avons vu un dictionnaire, comme disait Delacroix, où nous trouverons tous nos mots. Sortons. Étudions la belle nature, tâchons d’en dégager l’esprit, cherchons à nous exprimer selon notre tempérament personnel. Le temps et la réflexion d’ailleurs modifient peu à peu la vision, et, enfin, la compréhension nous vient. Nous serons, si Dieu veut, vos amis seront capables de ficher debout une machine comme celle-ci… et à cet arc-en-ciel d’opposer l’harmonie argentée de celle-là.
En face des Noces de Cana, il me montrait le Jésus chez le Pharisien.
Ça, par exemple, c’est peut-être encore plus épatant… Cette gamme d’argent… Tout le prisme qui se fond dans ce blanc… Et ce que j’aime, vous savez, dans tous ces tableaux de Véronèse, c’est qu’il n’y a pas à tartiner sur eux. On les aime, si on aime la peinture. On ne les aime pas, si on cherche de la littérature à côté, si on s’excite sur l’anecdote, le sujet… Un tableau ne représente rien, ne doit rien représenter d’abord que des couleurs… Moi, je déteste ça, toutes ces histoires, cette psychologie, ces péladaneries autour. Parbleu, ça y est dans la toile, les peintres ne sont pas des imbéciles, mais il faut le voir avec les yeux, avec les yeux, vous m’entendez bien. Le peintre n’a pas voulu autre chose. Sa psychologie, c’est la rencontre de ses deux tons. Son émotion est là. C’est ça, son histoire, sa vérité, sa profondeur, à lui. Puisqu’il est peintre, voyons ! Et ni poète ni philosophe. Michel-Ange ne mettait pas plus ses sonnets dans la Sixtine que Giotto ses canzone dans sa Vie de saint François. Vous voyez d’ici la gueule des moines. Et quand Delacroix a voulu de force ficher son Shakespeare dans ses toiles, il a eu tort, il s’y est cassé le nez. Et c’est pourquoi je vous opposais, en venant, tout cet art, si émouvant soit-il, du moyen âge, à mon art, à celui de la Renaissance. Vous comprenez, cette espèce de symbolisme liturgique du moyen âge est tout abstrait. Il faut y penser. Celui, païen, de la Renaissance est tout naturel. L’un détourne la nature de son sens pour signifier nous ne savons quelle vérité théologique, l’autre, vous le sentez bien, ramène l’abstraction à la réalité, et la réalité est toujours naturelle, a une signification sensuelle, universelle, si j’ose dire… J’adore que la pomme, symbolique dans les mains de la Vierge des primitifs, devienne un jouet pour l’enfant dans celle de la Renaissance. Vous qui avez écrit Dionysos, vous devez vous rappeler ce que raconte Jacques de Voragine, que la nuit de la naissance du Sauveur les vignes fleurirent dans toute la Palestine. Ah ! c’est déjà de la Renaissance, cela ! Nous, peintres, nous devons plutôt peindre la floraison de ces vignes que les tourbillons d’anges qui trompettent le Messie. Ne peignons que ce que nous avons vu, ou que ce que nous pourrions voir… Comme ce Giorgione, tenez…
Nous sommes devant le Concert champêtre.
Embellissons, ennoblissons d’un grand rêve charnel toutes nos imaginations… Mais baignons-les dans la nature. Ne tirons pas la nature à elles. Tant pis, si nous ne pouvons pas. Vous comprenez, il aurait fallu, dans le Déjeuner sur l’herbe, que Manet ajoute, je ne sais pas, moi, un frisson de cette noblesse, on ne sait quoi qui, ici, emparadise tous les sens. Voyez la coulée d’or de la grande femme, le dos de l’autre… Elles sont vivantes, et elles sont divines. Tout le paysage dans sa rousseur est comme une églogue surnaturelle, un moment balancé de l’univers dans son éternité perçue, dans sa joie plus humaine. Et on y participe, on ne méprise rien de sa vie. C’est comme là-bas, venez, je vous montrerai cette Cuisine des Anges... Il y a là une nature morte prodigieuse.
Nous arrivons devant le tableau.
Murillo a dû peindre des anges, mais quels éphèbes, voyez, comme leurs pieds nerveux posent bien sur la dalle. Vraiment ils sont dignes d’éplucher ces beaux légumes, ces carottes et ces choux, de se mirer dans ces chaudrons… Le tableau lui était commandé, n’est-ce pas ?… Il s’est laissé aller, pour une fois. Il a vu la scène… Il a vu des êtres radieux entrer dans cette cuisine de couvent, de jeunes charretiers célestes, la beauté de la jeunesse, la santé éclatante, chez tous ces mystiques, ces épuisés, ces tourmentés. Voyez comme il oppose la maigreur jaunâtre, l’extase hystérique du saint en prière aux gestes calmes, à la certitude rayonnante de tous ces beaux ouvriers. Et le tas de légumes ! On peut passer des navets et des assiettes aux ailes sans changer d’air. Tout est réel… Et en face, cette esquisse du Paradis…
Il m’y entraîne.
Je n’ai pas vu le grand Paradis de Venise. J’ai très peu vu Tintoret, mais, comme le Greco, plus puissamment, parce qu’il est plus sain, il m’attire. Ce Greco, toujours on m’en parle, et je ne le connais pas. Je voudrais en voir… Oui, Tintoret, Rubens, voilà le peintre. Comme Beethoven est le musicien, Platon le philosophe.
Moi :
― Vous savez ce qu’a dit Ruskin, qu’au point de vue de la peinture son Adam et Ève est la première œuvre du monde ?
Cézanne :
― Je ne l’ai vu qu’en photographie… J’ai feuilleté tout ce que j’ai pu trouver de son œuvre. Elle est gigantesque. Tout y est, de la nature morte à Dieu. C’est l’arche immense. Toutes les formes d’existence, et dans un pathétique, une passion, une invention incroyables. Si j’étais allé à Venise, c’eût été pour lui. Il paraît qu’on ne le connaît que là… Je me souviens, dans une Tentation du Christ, qui est à San Rocco, je crois, d’un ange aux seins gonflés, avec des bracelets, un démon pédéraste et qui tend avec une concupiscence lesbienne, oui, des pierres à Jésus, on n’a rien peint de plus pervers. Je ne sais pas, mais chez vous, quand vous m’avez passé la photo, ça m’a produit l’effet d’un Verlaine gigantesque, d’un Arétin qui aurait eu le génie de Rabelais. Chaste et sensuel, brutal et cérébral, volontaire autant qu’inspiré, sauf la sentimentalité, je crois qu’il a tout connu, ce Tintoret, de ce qui fait la joie et le tourment des hommes… Écoutez un peu, je ne puis pas en parler sans trembler… Ses portraits, terribles, me l’ont rendu familier… Celui que Manet a copié aux Offices et qui est au musée de Dijon…
Moi :
― On dirait un Cézanne.
Cézanne :
― Ah ! je voudrais bien… Vous savez, il me semble que je l’ai connu. Je le vois, rompu de travail, harassé de couleurs, dans cette chambre tendue de pourpre de son petit palais, comme moi dans mon cafouchon du Jas-de-Bouffan, mais, lui, toujours, même en plein jour, éclairé d’une lampe fumeuse, avec l’espèce de théâtre à marionnettes où il préparait ses grandes compositions… Hein… ce guignol épique !… Quand il quittait ses chevalets, paraît-il, il arrivait là, il tombait, épuisé, toujours farouche, c’était un grognon, dévoré de désirs sacrilèges… oui, oui… il y a un drame terrible dans sa vie…. Je n’ose pas le dire… Suant à grosses gouttes, il se faisait endormir par sa fille, il se faisait jouer du violoncelle par sa fille, des heures. Seul avec elle, dans tous ces reflets rouges… Il s’enfonçait dans ce monde enflammé, où la fumée du nôtre s’évanouit… Je le vois… Je le vois… La lumière se dépouillait du mal… Et vers la fin de sa vie, lui, dont la palette rivalisait avec l’arc-en-ciel, il disait ne plus chérir que le noir et le blanc… Sa fille était morte… Le noir et le blanc !… Parce que les couleurs sont méchantes, torturent, comprenez-vous… Je connais cette nostalgie… Est-ce qu’on sait ? On cherche une paix définitive… Ce paradis. Allez, pour peindre cette rose de joie, tourbillonnante, il faut avoir beaucoup souffert… beaucoup souffert, je vous en fiche mon billet. Nous sommes à l’autre pôle, ici. Là-bas, ce beau prince de Véronèse. Ici, ce forçat de Tintoret. Cet espèce de misérable qui a tout aimé, mais dont un feu, une fièvre, consumait tous les désirs aussitôt qu’ils naissaient. Voyez son ciel… Ses bons dieux tournent, tournent. Ils n’ont pas le paradis calme. C’est une tempête, ce repos. Ils continuent l’élan qui, comme lui, les a dévorés, toute leur vie. Ils en jouissent maintenant, après en avoir tant souffert. J’aime ça…
Il se rapproche de la toile.
Et voyez ce pied blanc, ici, à gauche. Les dessous encore… il préparait ses chairs en blanc. Puis d’un glacis rouge, vlan, voyez à côté, il leur donnait la vie. Blanc et noir, je ne veux plus peindre qu’en blanc et noir, criait-il à la fin. Comment aurait-il fait ? Comment se serait-il passé de son supplice ? On peut tout attendre d’un tel bonhomme. Dans sa jeunesse, il avait eu le culot d’affirmer : la couleur du Titien dans le dessin de Michel-Ange. Et il y est arrivé. Titien l’avait flanqué à la porte…
Moi :
― Il est plus grand que Titien.
Cézanne :
― Oui, j’approuve votre admiration pour le plus vaillant des Vénitiens. Célébrons Tintoret. Amenez vos amis là-devant. Le besoin de trouver un point d’appui moral, intellectuel, dans des œuvres qu’on ne surpassera pas assurément, vous met sur le perpétuel qui-vive, sur la recherche incessante des moyens d’interprétation. Dites-le leur bien Ces moyens d’interprétation les conduiront sûrement à sentir sur nature leurs moyens d’expression, et le jour où ils les tiendront, ils peuvent en être convaincus, ils retrouveront sans effort et sur nature les moyens employés par les quatre ou cinq grands de Venise…
Il fait quelques pas, sans rien voir.
Ah ! avoir des élèves ! Passer toute mon expérience à quelqu’un. Je ne suis rien ; je n’ai rien fait, mais j’ai appris. Passer ça à quelqu’un… Renouer avec tous ces grands bougres par-dessus les deux derniers siècles. Dans les cahots modernes, le point fixe retrouvé… En vain. En vain peut-être.
Il serre les poings. Il roule des yeux furieux autour de lui.
Et tous ces crétins !… Une tradition. Une tradition pourrait repartir de moi, qui ne suis rien. Travailler avec des élèves, mais des élèves qu’on enseigne, comprenez-vous, qui ne prétendent pas vous enseigner. J’ai connu ça…
Il se retourne. Il m’entraîne, je pense, vers la salle des États, ce qu’il appelle le salon carré des modernes.
Je ne veux pas avoir raison théoriquement, mais sur nature. Ingres, malgré son « estyle », comme on dit à Aix, et ses admirateurs, n’est qu’un très petit peintre. Les plus grands, vous les connaissez : les Vénitiens et les Espagnols.
Il va à une fenêtre, regarde l’enfilade ensoleillée.
Ça, ce n’est pas bête du tout… Au fond, celui qui rendrait ça, simplement, la Seine, Paris, un jour de Paris, pourrait entrer ici, la tête haute… Il faut être un bon ouvrier. N’être qu’un peintre. Avoir une formule. Réaliser.
Il me regarde, triste et sublime.
L’idéal du bonheur terrestre… avoir une belle formule.
Et, brusque, il m’entraîne à pas rapides vers le salon carré des modernes. Il s arrête devant le Triomphe d’Homère. Il fait une moue.
Oui… L’orangé pour dire la colère d’Achille et les flammes de Troie, le vert pour dire les voyages d’Ulysse et les remous de l’Océan…. Mais ce n’est pas ça, la formule !… Oui, oui, la formule qui vous étreint… tandis que moi ! N’empêche, il a beau vous tourner sur le cœur avec sa peinture glaireuse, Jean-Dominique ! Je le disais à Vollard pour l’épater, il est très fort ! C’est tout de même un sacré bonhomme… C’est le plus moderne des modernes. Savez-vous pourquoi je lui tire mon chapeau ? C’est que son dessin de tonnerre de Dieu, il l’a fait avaler de force aux idiots qui croient aujourd’hui le comprendre. Mais ici, ils ne sont que deux : Delacroix et Courbet. Le reste, c’est de la fripouille…. Et quelqu’un manque… Manet. Il y viendra, avec Monet et Renoir.
Moi :
― Et vous.
Cézanne :
― Oh ! moi… Je serais peut-être d’un mauvais exemple, savez-vous ? Ce qu’on apporte, lorsqu’on a la gloire d’apporter quelque chose, déforme ce qu’on apprend. Et c’est terrible. Je n’ai encore rien fait qui se tienne à côté des autres, là-bas, écoutez un peu…
Moi :
― Votre Vieille au chapelet [R 808] les grandes Sainte-Victoire…
Cézanne :
― Ta, ta, ta…. Il restera peut-être le souvenir d’un brave homme qui a délivré la peinture d’une fausse tradition, tant indépendante, qu’académique, et qui a eu le vague rêve d’une renaissance de son art…. Et encore !…
Il s approche des Femmes d’Alger.
Nous y sommes tous dans ce Delacroix. Quand je vous parle de la joie des couleurs pour les couleurs, tenez, c’est cela que je veux dire… Ces roses pâles, ces coussins bourrus, cette babouche, toute cette limpidité, je ne sais pas moi, vous entre dans l’œil comme un verre de vin dans le gosier, et on en est tout de suite ivre. On ne sait comment, mais on se sent plus léger. Ces nuances allègent et purifient. Si j’avais commis une mauvaise action, il me semble que je viendrais là-devant pour me remettre d’aplomb… Et c’est bourré. Les tons entrent les uns dans les autres, comme des soies. Tout est cousu, travaillé d’ensemble. Et c’est pour ça que ça tourne. C’est la première fois qu’on a peint un volume, depuis les grands. Et chez Delacroix, il n’y a pas à dire, il y a quelque chose, une fièvre qui n’est pas chez les anciens. C’est la fièvre heureuse de la convalescence, je crois. Avec lui, la peinture sort du marasme, de la maladie des Bolonais. Il bouscule David. Il peint par irisation. Il lui suffit de voir un Constable pour deviner tout ce qu’on peut tirer du paysage, et lui aussi plante son chevalet devant la mer. Ses aquarelles sont des merveilles de tragique ou de charme. On ne peut les comparer qu’à celles de Barye, vous savez, les lions du musée de Montpellier. Et les natures mortes, rappelez-vous celle du chasseur, du carnier et du gibier en pleins champs ; toute la campagne y participe. Je ne vous parle pas des grandes compositions, tout à l’heure nous irons voir son plafond… Et puis, il est convaincu que le soleil existe et qu’on peut y tremper ses pinceaux, y faire sa lessive. Il sait différencier. Ce n’est plus comme chez Ingres, là-bas, et tous ceux qui sont ici… Une soie est un tissu et un visage de la chair. Le même soleil, la même émotion caresse, mais se diversifie. Il sait sur le flanc de cette négresse accrocher une étoffe qui n a pas la même odeur que la culotte parfumée de cette géorgienne, et c’est dans ses tons qu’il sait ça et qu’il le met. Il contraste Toutes ces nuances poivrées, voyez, avec toute leur violence, la claire harmonie qu’elles donnent. Et il a un sens de l’être humain, de la vie en mouvement, de la tiédeur. Tout bouge, tout chatoie. La lumière !… Dans son intérieur il y a plus de lumière chaude que dans tous ces paysages de Corot et ces batailles d’à-côté. Regardez… Son ombre est colorée. Il nacre ses dégradés, ce qui assouplit tout… Et quand il attaque le plein air ! Son Entrée des Croisés, c’est terrible… autant dire que vous ne la voyez pas. Nous ne la voyons plus. J’ai vu, moi qui vous parle, mourir, pâlir, s’en aller ce tableau. C’est à pleurer. De dix en dix ans, il s’en va…. Il n’en restera, un jour, plus rien… Si vous aviez vu la mer verte, le ciel vert. Intenses. Et comme les fumées étaient plus dramatiques alors, les navires qui brûlent, et comme tout le groupe des cavaliers se présentait. Quand il l’exposa, on cria que le cheval, ce cheval, était rose. C’était magnifique. Une rutilance. Mais ces sacrés romantiques, avec leur dédain, usaient d’atroces matières. Les droguistes les ont volés comme dans un bois. C’est comme le Naufrage de Géricault, une page superbe, on ne voit plus rien. Ici, il reste encore la mélancolie rongée des visages, la tristesse de ces éperonnes, mais tout cela, nous nous en souvenons, c’était dans les teintes de Delacroix, et les fonds s’étant éteints, son effet, son âme n’y est plus. Je les ai encore vus, moi, ces couronnés livides. Ils ne s’avancent plus dans le flamboiement, dans cet air d’Orient, cette terre de légendes. Constantinople est comme un Paris, comme les façades de la cité, tenez, derrière la barricade, là-bas. Je l’ai vue, là, comme Delacroix, comme Gautier, comme Flaubert la voyaient, et dans la seule magie des couleurs. Voilà, tenez, ce qui prouve mieux que tout que Delacroix est un vrai peintre, un bougre de grand peintre. Ce n’est pas l’anecdote des croisés, ils étaient anthropophages, dit-on, ce n’est pas leur humanité apparente, c’était le tragique de ses tons. qui faisait son tableau et qui exprimait toute l’âme pourrie de ces mornes vainqueurs. Alors la belle grecque mourante, la femme de soie abandonnée dans ses riches atours, la barbe du vieillard, les chevaux caparaçonnés et les hampes lugubres, dans les fusions chantantes, prenaient tout leur sens. Ça mourait, pleurait et reniflait. Dans les couleurs. Maintenant il ne reste plus qu’une image. Il n’y a que les couleurs de vraies pour un peintre… C’est comme si on vous traduisait une tragédie de Racine en prose… Les Femmes d’Alger, elles, n’ont pas bougé. L’Entrée était peinte aussi éclatante. Avez-vous vu, à Rouen, la Justice de Trajan ― elle fout le camp aussi, elle s’écaille, elle se ronge ― et à Lyon, la Mort de Marc Aurèle ? Quel vert il y a là… Le manteau vert ! Voilà Delacroix. Et le plafond d’Apollon, et Saint-Sulpice ! Allez, on a beau dire, beau faire, il est de la grande lignée. On peut parler de lui, sans qu’il ait à rougir, même après Tintoret et Rubens… Delacroix, c’est le romantisme peut-être. Il s’est trop gorgé de Shakespeare et de Dante, il a trop feuilleté Faust. Il reste la plus belle palette de France, et personne, sous notre ciel, écoutez un peu, n’a eu plus que lui le charme et le pathétique à la fois, la vibration de la couleur. Nous peignons tous en lui, comme vous écrivez tous en Hugo.
Moi :
― Et Courbet ?
Cézanne :
― Un bâtisseur. Un rude gâcheur de plâtre. Un broyeur de tons. Il maçonnait comme un romain. Et lui aussi, un vrai peintre. Il n’y en a pas un autre dans ce siècle qui le dégote. Et il a beau retrousser ses manches, se coller le feutre sur l’oreille, déboulonner la colonne, sa facture est d’un classique !, sous ses grands airs fendants… Il est profond, serein, velouté. Il y a de lui des nus, dorés comme une moisson, dont je raffole. Sa palette sent le blé… Oui, oui, Proudhon lui a tourné la tête, avec son réalisme, mais au fond, ce fameux réalisme, c’est comme le romantisme de Delacroix, il ne le faisait, vaille que vaille, rentrer à grands coups de brosses que dans quelques toiles, ses plus tapageuses, les moins belles sûrement. Et encore, il était plus dans le sujet, son réalisme, allez, que dans le métier. Il voit toujours composé. Sa vision est restée celle des vieux. C’est comme du couteau, il ne s’en servait que dans le paysage. C’est un raffiné, un fignoleur. Vous savez le mot de Decamps. Courbet est un malin… Il fait de la peinture grossière, mais il met le fin par-dessus. Et moi, je dis que c’est la force, le génie, qu’il mettait par-dessous. Et puis allez demander à Monet ce que Whistler lui doit à Courbet, lorsqu’ils étaient ensemble à Deauville, lorsqu’il lui a peint sa maîtresse… Il a beau faire large, il est subtil. Il est à sa place dans les musées. Sa Vanneuse du musée de Nantes, d’un blond si touffu, avec le grand drap roussâtre, la poussière du blé, le chignon tordu vers la nuque comme les plus beaux Véronèse, et le bras, ce bras de lait au soleil, ce bras tendu de paysanne, poli comme une pierre de lavoir… C’était sa sœur pourtant qui la lui avait posée… On peut la coller à côté de Velasquez, elle tiendra, je vous en donne ma parole… Est-ce charnu, dru, grenu ? Est-ce vivant ? Ça s’impose. On le voit.
Moi :
― Oui, je m’en souviens… Courbet est le grand peintre du peuple.
Cézanne :
― Et de la nature. Son grand apport, c’est l’entrée lyrique de la nature, de l’odeur des feuilles mouillées, des parois moussues de la forêt, dans la peinture du dix-neuvième siècle, le murmure des pluies, l’ombre des bois, la marche du soleil sous les arbres. La mer. Et la neige, il a peint la neige comme personne ! J’ai vu, chez votre ami Mariéton, la diligence dans les neiges, ce grand paysage blanc, plat, sous le crépuscule grisâtre, sans une aspérité, tout ouaté… C’était formidable, un silence d’hiver. Comme l’Hallali du musée de Besançon, où les personnages sont peut-être un peu théâtraux, mais qui me rappellent, sans être écrasés, avec leurs vestons de chasse, les chiens, la neige, le valet, qui me rappellent la manière pompeuse, l’héroïsme, le faire des maîtres, qu’est-ce que vous voulez ? Et le couchant du Cerf à Marseille, la bande sanguinolente, la mare, l’arbre qui fuit avec la bête, dans les yeux de la bête… Tous ces lacs savoyards avec le clapotement de l’eau, la brume qui monte des rives, enveloppe les montagnes… les grandes Vagues, celle de Berlin, prodigieuse, une des trouvailles du siècle, bien plus palpitante, plus gonflée, d’un vert plus baveux, d’un orange plus sale, que celle d’ici, avec son échevellement écumeux, sa marée qui vient du fond des âges, tout son ciel loqueteux et son âpreté livide. On la reçoit en pleine poitrine. On recule. Toute la salle sent l’embrun….
Il regarde, au-dessus du Triomphe d’Homère, le grand sous-bois du Combat des cerfs.
On ne voit rien… Comme c’est mal placé… Quand est-ce qu’on foutra un peintre, un vrai, à la direction du Louvre ?… Et quand est-ce qu’on apportera les Demoiselles de la Seine ici ? Où sont-elles ?
Il ferme à demi les yeux. Il les voit.
Là, écoutez un peu, on peut dire Titien…. Non… Non… C’est Courbet… Ne mêlons pas… Ces demoiselles ! Une fougue, une largeur, un accablement heureux, un vautrement, que Manet n’a pas donné dans son Déjeuner… Les mitaines, les dentelles, la soie cassée de la jupe, et les rousseurs… Le renflement des nuques, le potelé des chairs. La nature s’est faite garce autour d’elles. Et le ciel bas, coupé, le paysage suant, toute la perspective inclinée, qui fait qu’on les fouille… La moiteur, les perles chaudes… Et c’est enlevé ! aussi gras que l’Olympia est maigre, gracile, cérébrale… Les deux tableaux du siècle peut-être…. Baudelaire et Banville. Le métier opulent, la facture aiguë… Dans l’Olympia, oui, il y a quelque chose de plus, un air, une intelligence… mais Courbet est épais, sain, vivant. On a la bouche pleine de couleurs. On en bave…
Écoutez un peu, c’est une infamie que cette toile ne soit pas ici, et que l’Enterrement soit sacrifié, enterré dans cet espèce de couloir, là-bas… On ne peut pas le voir… Il devrait éclater, ici, à la cimaise, en face des Croisés, à la place de ce pompier d’Homère… Oui, oui, c’est très beau, ces pieds, ce calme, ce triomphe, mais c’est une reconstitution, à la fin. ! Tandis que l’Enterrement… Venez.
Il me prend sous le bras. Il m’entraîne avec une passion de jeunesse. Il parle tout en marchant.
On a dit qu’il a peint ça après la mort de sa mère. Il s’était enfermé un an à Ornans. Ce sont les gens du village qui lui posaient, sans poser. Il les avait dans l’œil… Dans une espèce de grenier… Ils venaient se reconnaître… Il mêlait ces grotesques à sa douleur… Flaubert… Mais on a dit ça… La légende est plus forte que l’histoire. Sa mère n’était pas morte. Elle a posé, elle est dans un coin… Mais c’est pour vous dire combien la machine est émue. Elle recrée, elle réimagine la vie.
Nous passons sous le plafond de Delacroix.
Nous allons revenir voir ça… Un coup d’œil ! Regardez. C’est la tempête lyrique, l’envolée, l’aube de notre renaissance… Un Michel-Ange en pierreries… Vous savez, le Michel-Ange des coins de la Sixtine, de la Judith… Et quels jeux ! Une ode de Pindare… Le tigre et la femme couchée, dont le sable boit les cheveux… Toute la mer jetée sur une plage… On sent le mouvement… La montée, l’élan du monde dans le soleil, la chute de l’envie dans la pesanteur, ces monstres. Et quelle fantaisie ! J’entends des coups de clairon…. À coups de marteau, voyez, ces bras forgent de la lumière… À coups de pinceau Delacroix a peint notre avenir… Et ça plafonne !… Nous reviendrons.
Il m entraîne.
Oui, comme Flaubert a tiré le roman de Balzac, Courbet, peut-être, de l’emportement romantique, de la véracité expressive de Delacroix, a tiré… Vous rappelez-vous dans ce voyage qu’il fait, le père Flaubert, dans Par les champs et par les grèves, cet enterrement qu’il raconte et cette vieille qui pleure comme il pleut… Chaque fois que je le relis, je pense à Courbet… La même émotion, dans le même art… Voyez.
Nous arrivons. Il est empourpré. Il rayonne. Son pardessus qu’il tient par une manche derrière lui balaie le parquet. Il redresse sa haute taille. Il exulte. Je ne l’ai jamais vu ainsi. Lui, si timide d’habitude, jette à droite et à gauche des regards de triomphe. Le Louvre est à lui… Dans un coin, il avise une échelle de copiste. Il bondit.
Enfin !.. Nous allons le voir.
Il traîne l’échelle. Il y grimpe.
Venez. Venez… Sacrédié !.. Que c’est beau…
Les gardiens accourent, l’interpellent.
Foutez-moi la paix… Je regarde Courbet… Placez-moi ça dans son jour, et on ne vous embêtera plus…
Il trépigne sur sa petite plate-forme.
Mais non, voyez ce chien…. Velasquez ! Velasquez ! Le chien de Philippe est moins chien, tout chien de roi qu’il était… Vous l’avez vu… Et l’enfant de chœur, ce rouge joufflu… Renoir peut y venir…
Il se monte, il se grise.
Gasquet, Gasquet… Il n’y a que Courbet qui sache plaquer un noir, sans trouer la toile… Il n’y a que lui… Ici, comme dans ses rochers et ses troncs, là-bas. Il pouvait, d’une coulée, descendre tout un pan de vie, l’existence minable d’un de ces gueux, voyez, et il revenait ensuite, avec pitié, par bonhomie de doux géant qui comprend tout… La caricature se trempe de larmes… Ah ! laissez-moi tranquille, vous là-bas. Allez chercher votre directeur… Je lui alignerai deux mots, à cet homme…
On s’attroupe. Il fait une véritable harangue.
C’est une infamie, nom de Dieu !… Non, à la fin, mais c’est vrai… Nous nous laissons toujours faire… C’est un vol… L’État, c’est nous… La peinture… c’est moi… Qui est-ce qui comprend Courbet ?… On le fout en prison dans cette cave… Je proteste… J’irai trouver les journaux, Vallès…
Il crie de plus en plus fort.
Gasquet, vous serez quelqu’un un jour… Promettez-moi, que vous ferez porter cette toile à sa place, dans le salon carré… Nom de Dieu, dans le salon des modernes… dans la lumière… Qu’on la voie….
Les gardiens ramassent son pardessus, son melon.
Foutez-moi la paix, vous autres… Je descends… Nous avons en France une machine pareille, et nous la cachons… Qu’on foute le feu au Louvre, alors… tout de suite… Si on a peur de ce qui est beau… Au salon des modernes, Gasquet, au salon des modernes… Vous me le promettez…
Il dégringole de l’échelle. Il promené un regard de maîtrise sur tout l’attroupement qui nous entoure…
Je suis Cézanne.
Il devient encore plus rouge… Il se fouille. Il fourre des louis dans la main des gardiens… Il s’enfuit, en m’entraînant… Il pleure. »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 187-208 :
« L’ATELIER
« Je me suis juré de mourir en peignant. »Cézanne achevait le portrait de mon père. J’assistais aux séances. L’atelier était vide. Seuls, le chevalet, la petite table à couleurs, la chaise où s’asseyait mon père, et le poêle le meublaient. Cézanne travaillait debout… Des toiles, en tas, contre le soubassement, dans un coin. Une douce lumière égale et que bleutait le reflet des murs. Sur une étagère de bois blanc, deux ou trois plâtres et des livres. Lorsque j’arrivais, Cézanne allait chercher un vieux fauteuil déjà à moitié dépaillé qui traînait dans la chambre à côté. Mon père fumait sa pipe. Nous causions.
La plupart du temps, quoiqu’il eût ses brosses et sa palette en main, Cézanne regardait le visage de mon père, le scrutait. Il ne peignait pas. De loin en loin, un coup tremblotant de pinceau, une mince touche appuyée, un vif trait bleu qui cernait une expression, dégageait, affirmait un coin fugitif de caractère… C’était le lendemain que je retrouvais, sur la toile, le travail de pénétration accompli la veille.
Ce jour-là, un après-midi de fin d’hiver, l’air sentait le printemps autour du Jas. Le ciel mielleux s’appuyait aux vitrages. Cézanne ouvrit un des châssis.
Cézanne :
― Tu n’auras pas froid, Henri ?… Le restouble sent l’amandier… Il fait bon… Mais, sacrédié ! il faut que je referme… Ces sacrés reflets… Un rien, savez-vous…
La peinture à l’huile
C’est bien difficile,
Mais c’est bien plus beau
Que la peinture à l’eau…
Mon père :
― Tu chantes ?.. C’est que ça marche bien aujourd’hui…
Cézanne :
― Pas mal… Ça ne te rase pas, à la fin, de poser… Écoute, ce n’est pas pour dire, mais tu me rends un fier service… Tu as une assiette…
Mon père, plaisantant :
― Extraordinaire.
Cézanne, se tournant vers moi :
― Une assiette morale, que je lui envie… Il ne se fait pas de bile, votre père… Jamais… Je voudrais rendre ça, trouver les tons, la justesse de ton qui rende ça…. Un point d’appui moral ! C’est moi qui ai cherché ça dans ma vie.
Mon père : ― Plains-toi.
Cézanne :
― Ah ! Chacun sait ce qui bout dans sa marmite… Moi, je te connais, parce que je te peins… Écoute un peu, Henri. Toi, tu as la certitude. C’est ma principale espérance. La certitude ! Chaque fois que j’attaque une toile, je suis sûr, je crois que ça va y être… Mais, tout de suite, je me souviens que j’ai toujours raté, les autres fois. Alors je me mange le sang… Toi, tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, dans la vie, et tu vas ton chemin…. Moi, je ne sais jamais où je vais, où je voudrais aller avec ce sacré métier. Toutes les théories vous foutent dedans… Est-ce parce que je suis un timide dans la vie ? Au fond, quand on a du caractère, on a du talent… Je ne dis pas que le caractère suffise, qu’il suffise d’être un brave homme pour bien peindre… Ce serait trop facile… Mais je ne crois pas qu’une crapule puisse avoir du génie.
Moi :
― Wagner.
Cézanne :
― Je ne suis pas musicien… Et puis, entendons-nous, une crapule, ce n’est pas avoir un tempérament du diable, et avec ce tempérament, se débrouiller pour rester toujours quelqu’un…. Un ami… N’est-ce pas, Henri ?… Garder les mains propres, quoi. Les artistes, parbleu, tous plus ou moins, nous godaillons toujours un peu, à droite et à gauche… Il y en a qui, pour arriver… oui, mais ceux-là, justement ce sont ceux, je crois, qui n’ont pas de talent. Il faut être incorruptible, sur son art, et pour l’être dans son art, il faut s’entraîner à l’être dans sa vie… Hein, Gasquet, le vieux Boileau ?
Le vers se sent toujours des bassesses du cœur.
En somme, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Quand on sait faire, on n’a pas besoin de faire savoir. Ça se sait toujours.
Mon père :
― Mais le petit me dit que tu n’as pas la place que tu devrais avoir.
Cézanne :
― Laisse-le dire… Moi, je dois rester chez moi, ne voir personne, travailler… Ma place, ma place !… Ce serait d’être content de moi. Et je ne le suis pas. Je ne le serai jamais. Je ne puis l’être. Jusqu’à la guerre, tu le sais, j’ai vécu dans les emmerdements, j’ai perdu ma vie. Ce n’est qu’à l’Estaque, en réfléchissant, quand j’ai bien compris Pissarro, un peintre comme moi, que ton petit connaît… C’était un acharné. L’amour enragé du travail m’a pris. Ce n’est pas que je n’aie pas travaillé avant, j’ai toujours travaillé. Mais ce qui m’a toujours manqué, tiens, c’est un copain comme toi, avec qui je n’aurais jamais parlé de peinture, mais avec qui on se serait compris sans rien se dire… Ah ! Henri ! Quand je te peins, quand je te vois là… c’est l’évocation pour moi de plus de quarante ans passés. Puis-je dire qu’une Providence m’a fait te connaître ? Si j’étais plus jeune, je dirais que c’est pour moi un point d’appui et un réconfort. Un stable dans ses principes et son opinion, c’est épatant… Je sens tout ça en te voyant tirer sur ta pipette.
Mon père, ému et gêné :
― Et quoi encore ?
Cézanne :
― Quoi encore ? Je m’associe de plein cœur au mouvement d’art que ton fils détermine et qu’il doit caractériser. Tu n’as pas idée comme c’est vivifiant, pour un vieil abandonné comme moi, de trouver autour de soi une jeunesse qui consente à ne pas vous enterrer immédiatement.
Il se tourne vers moi.
Oui, oui, groupez-vous. Lancez votre revue, vos Mois dorés, votre Pays de France, affirmez les droits séculaires de notre pays. Appelez à vous toutes les initiatives qui ont fait leur preuve. Il n’est pas possible, écoutez un peu, que l’homme qui se sent vivre et qui a gravi, consciemment ou non, le sommet de l’existence, entrave la marche de ceux qui viennent à la vie. Tous ceux qui vous précèdent sont des garants. Dans tous les ordres. Le chemin qu’ils ont parcouru est un indice pour la voie à suivre, et non pas une barrière à vos pas. Ils ont vécu, par ce seul fait, ils ont l’expérience. Ce n’est pas se diminuer que reconnaître ce qui est… Vous êtes jeune, vous êtes bien heureux, vous avez la vitalité… Ah ! Henri… quand nous avions cet âge !.. Ta mère m’en parle. Elle est dans ta maison la mère de la sagesse que tu représentes. Je sais qu’elle se souvient de cette rue Suffren qui fut notre berceau. Il est impossible que l’émotion ne me vienne en pensant à tout ce beau temps écoulé, sans s’en douter, et qui est sans doute la cause de l’état d’esprit actuel dans lequel nous nous trouvons. Ah ! si j’avais une belle formule, c’est ça que je peindrais dans ton visage, c’est ça qui se verrait sous ma couleur, c’est ça qui resterait de ton portrait… Reprends la pose. Travaillons.
Nous nous taisons. Mon père tire sur sa pipe. Les mains de Cézanne tremblent. Il pose quelques touches. Il va, il vient, à travers l’atelier. Il est de nouveau immobile devant sa toile. Mon père :
― Tu as vu cette exposition de Ziem ?
Cézanne :
― En voilà encore un qui n’est né nulle part… Tous ces bougres qui s’en vont en Orient, à Venise, en Algérie, chercher le soleil, est-ce qu’ils n’ont pas un bastidon sur le champ de leurs pères ? Si tu veux me parler d’un provençal, parle-moi de Puget. En voilà un qui sent l’ail, et Marseille, et Toulon, même à Versailles, sous le soleil de cuivre de Louis XIV. Il y a du mistral dans Puget, c’est lui qui agite le marbre. Et puis c’est de la sculpture décorative, comme la sculpture doit être…. Vous rappelez-vous, au Louvre, tout ce que nous avons dit devant le Persée et Andromède, le petit corps potelé de vierge blotti dans le giron du grand guerrier, à la Bossuet, et ces trous d’ombre qui peignent en saillie, mettent tout en relief, en couleurs, comme dans ces dessins de Rembrandt où la seule qualité des noirs donne tous les vertiges du prisme. C’est Puget qui a trouvé ça. La sculpture avant lui se présentait d’aplomb, tout d’un bloc de lumière cristallisée. Lui, il a peint, il a ombré. Il s’est servi de l’ombre ambiante comme ses contemporains des dessous. Allez voir l’effet qu’il en tire, à Toulon, sous le balcon des Cariatides. Sur les photographies, les dessins du Saint Sébastien et du grand évêque de Gènes, c’est renversant, c’est parlant. Le classique ne l’a pas éteint, lui.
Moi :
― Mais au fond, qu’entendez-vous par classique ?
Cézanne :
― Je ne sais pas… Tout et rien.
Moi :
― Je vous ai entendu dire que vous étiez classique, que vous vouliez l’être.
Il réfléchit un moment.
Cézanne :
― Imaginez Poussin refait entièrement sur nature, voilà le classique que j’entends.
Il se remet à peindre. Le portrait est très avancé, sur la joue et sur le front demeurent deux carrés blancs. Les yeux vivent. Deux fins traits bleus prolongent le dessin du chapeau presque jusqu’au bord de la toile. Il a commencé à couvrir, à fondre l’un de ces traits en attaquant les fonds. Un oiseau se butte aux vitrages.
Mon père :
― Entrez.
Cézanne, qui suit sa pensée :
― Ce que je n’admets pas, c’est un classique qui vous borne… Je veux la fréquentation d’un maître qui me rende à moi-même… Toutes les fois que je sors de chez Poussin, je sais mieux ce que je suis…
Il s arrête de peindre et de regarder son modèle. Il ramasse sa pensée.
Il est un morceau de la terre française tout entière réalisée, un Discours de la méthode en acte, un espace de vingt, cinquante ans de notre vie toute entière portée sur la toile, avec la plénitude de la raison et de la vérité… Et de plus, et avant tout, c’est de la peinture… Il est allé à Rome, n’est-ce pas ? Il y a tout vu. Tout aimé, tout compris. Eh bien ! il a rendu ça, cette antiquité, française, sans rien perdre de sa verdeur, de sa nature à lui. Il a tranquillement continué les autres, tout ce qu’il a trouvé beau avant lui… Moi, je voudrais de même le continuer, lui… le rendre de son temps, sans le gâcher, sans gâcher ni lui, ni moi, si j’étais classique, si je pouvais devenir classique…. Mais on ne sait jamais. L’étude modifie notre vision à tel point que l’humble et colossal Pissarro, tenez, se trouve justifié de ses théories anarchistes. Moi, je procède très lentement, vous avez pu le remarquer. La nature s’offre à moi si complexe. Les progrès à faire sont incessants, sans que j’aille y mêler encore un rêve de raison. Parbleu ! Un Poussin de Provence, ça m’irait comme un gant… Vingt fois j’ai voulu refaire sur le motif Ruth et Booz… Je voudrais, comme dans le Triomphe de Flore [Poussin], marier des courbes de femmes à des épaules de collines, comme dans 1’Automne donner à une cueilleuse de fruits la gracilité d’une plante olympienne et l’aisance céleste d’un vers de Virgile… Ce que Puvis lui doit à cet Automne… Je voudrais mêler la mélancolie au soleil… Il y a une tristesse de la Provence que personne n’a dite et que Poussin aurait accoudée à quelque tombeau, sous les peupliers des Alyscamps… Je voudrais, comme Poussin, mettre de la raison dans l’herbe et des pleurs dans le ciel… Mais il faut savoir se contenter… Il faut bien voir son modèle et sentir très juste, et si alors je m’exprime avec distinction et force, voilà mon Poussin, voilà mon classique à moi… Il y a le goût. Le goût est le meilleur juge. Il est rare.
Moi :
― Comme tout ce qui est beau.
Cézanne :
― Oh ! ce que je veux dire, c’est que l’artiste ne s’adresse qu’à un nombre excessivement restreint d’individus. Et il en connaît toujours trop, au fond, de son vivant. Il doit vivre dans son coin, avec ses motifs, ses réflexions, ses modèles. Caractériser… Et surtout, entendez-moi bien, il doit dédaigner l’opinion qui ne repose pas sur l’observation intelligente des caractères. Il doit redouter l’esprit littérateur… Ton petit me comprend, Henri… Cet esprit qui fait si souvent s’écarter le peintre de sa vraie voie, l’étude concrète de la nature, pour se perdre trop longtemps dans des spéculations intangibles. Nous l’avons dit cent fois… Ah ! les critiques ! Ces Huysmans !… J’ai toujours envie de leur écrire, à tous ceux qui me tournent autour : Il y a trois choses qui constituent le fond du métier, que vous n’aurez jamais et vers lesquelles je m’efforce depuis trente-cinq ans, trois : scrupule, sincérité, soumission. Scrupule devant les idées, sincérité devant soi-même, soumission devant l’objet… Soumission absolue à l’objet, c’est Sainte-Beuve qui a trouvé ça dans un Lundi sur Gautier… Tu es l’objet, Henri, pour le quart d’heure… Maître du modèle et des moyens d’expression, il n’y a qu’à peindre ce qu’on a sous les yeux et persévérer logiquement. Travailler sans croire à personne, devenir fort. Le reste, c’est de la foutaise…
Il a repris sa palette. Il jette de vifs coups d’œil sur le visage de mon père.
Je voudrais les y voir, tiens, devant ta gueule, tous ceux qui écrivent sur nous, avec mes tubes et mes pinceaux dans les pattes… À mille lieues…
Au diable, s’ils se doutent comment en mariant un vert nuancé à un rouge on attriste une bouche ou on fait sourire une joue. Vous sentez, vous, que chaque coup de pinceau que je donne c’est un peu de mon sang mêlé à un peu de sang de votre père, dans le soleil, dans la lumière, dans la couleur, et qu’il y a un échange mystérieux qui va de son âme qu’il ignore à mon œil qui le recrée, et où il se reconnaîtra… si j’étais un peintre, un grand peintre !… Chaque touche doit correspondre, là, sur ma toile, à une respiration du monde, de la clarté, là-bas, sur ses favoris, sur sa joue. Nous devons vivre d’accord, mon modèle, mes couleurs et moi, nuancer ensemble la même minute qui passe. Si vous croyez que c’est simple de faire un portrait… Écoutez un peu, il faut le modèle d’abord… L’âme !… Geffroy m’avait décidé à attaquer le portrait de Clemenceau. Je commence. Tout marche bien d’abord. Il arrivait, la badine aux doigts, fendant, comme un jeune homme, la cravate flottante, le mou gris sur l’oreille… La France était à lui. Je m’appliquais, il parlait. De tout. Éblouissant, et mauvais comme une teigne, avec ça. Des coups de bistouri… Tout marchait. À la troisième séance, je me bute. Un mur. Vous comprenez, le modèle m’avait travaillé, en dedans. Je voyais. J’ai beau imaginer un bleu amer, des jaunes acérés. À la maison crisper des lignes. Rien. Un mur. Je voyais. Je voyais… Alors, un beau matin, j’ai tout foutu en plan, la toile, le chevalet, Clemenceau, Geffroy… Cet homme ne croyait pas en Dieu… Comprenez-vous, j’en avais le cœur net. Allez faire un portrait, avec ça…
Mon père :
― Dis donc, j’y crois, moi… Tu ne me laisseras pas en plan ?
Cézanne :
― Oh ! toi… Ah ! non, par exemple… Toi, tu me fais trouver des choses. Je te copie, doucement, lentement. J’ai les couleurs de l’amitié…
Il se tourne vers moi.
Vous me dites qu’Élie Faure a écrit un livre d’amitié sur Carrière… [en 1908] Quand Carrière enveloppe toutes ses familles de la même brume tendre, c’est qu’il a le sens obscur de cette émotion des couleurs… Vous avez vu sa première communiante au musée de Toulon, les deux bons vieux, et cette espèce d’aube douce qui mange tout… Mais il ne va pas plus loin que son sentiment… Ça fait les dessous, ça… Il faut aller au-delà de son sentiment, dépasser, avoir le culot de l’objectiver, de vouloir rendre carrément ce qu’on voit en sacrifiant ce qu’on sent, en ayant sacrifié ce qu’on sent… Vous comprenez, il suffit de sentir… Ça ne se perd jamais, son sentiment… Ce n’est pas que je le condamne. Au contraire, je le dis souvent, hier encore, tenez, à un jeune homme, un soldat, Girier, Girieud, qu’on m’a présenté au « Clément ». Un art qui n’a pas l’émotion pour principe n’est pas un art… Mais l’émotion, c’est le principe, le commencement et la fin ; le métier, l’objectif, la pratique est au milieu… Entre toi, Henri, et moi, je veux dire entre ce qui fait ta personnalité et la mienne, il y a le monde, le soleil… ce qui passe… ce que nous voyons en commun…. Nos habits, nos chairs, les reflets… C’est là-dedans qu’il faut que je pioche… C’est là où le moindre coup de pinceau à côté fait tout dévier. Si je ne suis qu’ému là-dedans, je te flanque l’œil de travers… Si je tisse autour de ton regard tout l’infini réseau des petits bleus, des marrons qui y sont, qui s’y conjuguent, je te ferai regarder comme tu regardes, sur ma toile… Une touche après l’autre, une touche après l’autre… Et si je suis froid, si je dessine, si je peins, comme à l’école… je ne verrai plus rien. Une bouche, un nez, de convention, toujours les mêmes… sans âme, sans mystère, sans passion… Chaque fois que je me mets devant mon chevalet, je suis un autre homme, moi, et toujours Cézanne… Comment peuvent-ils s’imaginer, les autres, qu’avec des fils à plomb, des académies, des mensurations toutes faites, établies une fois pour toutes, on peut s’emparer de la changeante, de la chatoyante matière… Ils se crétinisent, se stupéfient, se solidifient… Un bloc dans la cervelle, une vitre, une géométrie… Ils feraient mieux de faire l’anatomie qui brusquement nous donne l’intuition du jeu des muscles, des mouvements de la peau, si nous voulons composer, dresser un bonhomme debout, sans modèle… Delacroix se levait à quatre heures du matin, pour aller, aux abattoirs, voir écorcher des chevaux… Aussi, voyez ronfler ceux de son plafond… L’anatomie !… Ils ne voient plus rien. Ils n’ont jamais rien vu… La règle, les règles, le dessin, leur dessin. Tout est là pour eux… Mais la diversité infinie, c’est le chef-d’œuvre de la nature…
Tenez, Gasquet, votre père… Il est assis, n’est-ce pas ? il fume sa pipe… Il n’écoute que d’une oreille… Il pense, à quoi ? Une bouffée de sensations lui vient, d’ailleurs… Son œil n’est pas le même… Une infinitésimale proportion, un atome de lumière a changé, du dedans, et s’est rencontré avec la nappe toujours la même, ou presque toujours la même, qui tombe du vitrage.
Alors vous voyez, ce petit, petit ton, ce minuscule ton qui ombre, sous la paupière, s’est déplacé… Bon…. Je corrige. Mais alors mon vert léger, à côté, je le vois, il sort trop. J’assourdis… Et je suis dans un de mes bons jours, aujourd’hui. Je me raidis. J’ai ma volonté en main… Je continue, par touches insensibles, tout autour. L’œil regarde mieux… Mais l’autre, alors. Pour moi, il louche. Il regarde, il me regarde, moi. Tandis que celui-ci regarde sa vie, son passé, vous, je ne sais pas, quelque chose qui n’est pas moi, qui n’est pas nous…
Mon père :
― Je pensais à l’atout que j’ai gardé hier jusqu’a ma troisième levée…
Cézanne :
― Vous voyez… Eh bien ! Rembrandt, Rubens, Titien savaient d’un coup, dans un compromis sublime, fondre toute leur personnalité à eux dans toute cette chair qu’ils avaient sous les yeux, l’animer de leur passion, et avec la ressemblance des autres, glorifier leur rêve ou leur tristesse… Exactement… Je ne puis pas, moi…
Moi :
― C’est que vous aimez trop les autres…
Cézanne :
― C’est que je veux être vrai… Comme Flaubert… Arracher la vérité de tout… Me soumettre.
Moi :
― C’est peut-être impossible.
Cézanne :
― C’est très difficile… En me substituant, en partie, à votre père, j’aurais mon ensemble… Et je me servirais des indications d’ombres et de lumières… Je me rapprocherais de la réalité. Je la veux toute entière… Autrement, à ma manière, je ferais ce que je reproche aux Beaux-Arts. J’aurais, dans la cervelle, mon type préconçu et je calquerais la vérité sur lui… Tandis que c’est moi que je veux calquer sur elle. Qu’est-ce que je suis, moi ?… L’atteindre dans son âme, la rendre comme elle est. Et si je m’y casse les reins, tant pis. J’aurai essayé. J’aurai frayé une voie. D’autres viendront plus solides, plus subtils… qui feront avec la figure ce que Monet a fait avec le paysage… Ils photographieront… comprenez-moi bien, mais ils photographieront des âmes, des caractères, un homme… Et d’autres alors de ces impressions tireront un grand art, une psychologie colorée, une philosophie de l’Homme…
Rubens a tenté ça avec sa femme et ses enfants, vous savez, la prodigieuse Hélène Fourment du Louvre, toute rousse, en chapeau, avec l’enfançon nu… et Titien, avec son Paul III entre ses deux neveux, du musée de Naples, une page de Shakespeare… Moi :
― Et Velasquez ?
Cézanne :
― Ah ! Velasquez, c’est une autre histoire. Il s’est vengé… Vous comprenez, cet homme, il peignait dans son coin, il se préparait à nous descendre des forges de Vulcain et des triomphes de Bacchus, de quoi couvrir tous les palais d’Espagne… Un imbécile, pour lui être agréable, en parle, le traîne chez le roi… On n’avait pas inventé la photo à cette époque… Faites-moi mon portrait, à pied, à cheval, ma femme, ma fille, ce fou, ce mendiant, celui-ci, celui-là… Velasquez devint le photographe du roi… le joujou de ce détraqué… Alors, il a tout ravalé en lui, son œuvre, sa grande âme… Il était en prison…. Impossible de fuir. Il s’est terriblement vengé. Il les a peints avec toutes leurs tares, leurs vices, leur décadence… Sa haine et son objectivité n’ont fait qu’un… Comme Flaubert son Homais et son Bournisien, il a peint son roi et ses bouffons… Il ne ressemble pas, lui, aux portraits qu’il peint, tandis que, remarquez, Rubens, Rembrandt, c’est toujours eux, on les reconnaît sous tous les visages… Et il y a aussi un autre précurseur, Goya… Sa Maja vestida et sa Maja desnuda… C’est l’amour, lui, qui a fait le miracle… Il était si effrayant, si laid. Vous l’avez vu dans son portrait, avec son tube énorme. Nous réussissons toujours nos portraits, parce que là nous ne faisons qu’un, comprenez-vous, avec le modèle… Il était terrible, Goya. Quand il a eu cette duchesse, cette mince aristocrate, ce corps brun entre les bras… Il n’a rien eu à inventer. Il a été amoureux. Il a peint la femme. Une femme… Et partout ensuite, on la retrouve. La minute de grâce n’a pas duré. Son imagination dévorante l’a de nouveau emporté. La duchesse d’Albe est partout, en ange, en courtisane, en cigarière, dans son œuvre. Elle est devenue son poncif. Comme Hélène Fourment pour Rubens ou sa fille pour le vieux Tïntoret… Ce sont d’immenses imaginatifs, des Shakespeare, des Beethoven. Je voudrais être…
Moi :
― Quoi ?
Il balbutie.
Cézanne :
― Rien…. Cézanne… Et tenez.., La pose est finie, Henri. C’est assez pour aujourd’hui. Merci… Tenez…
Il va au tas de toiles, cherche.., Il sort trois natures mortes, il les étale contre le mur, à terre. Elles éclatent, chaudes, profondes, vivantes, comme un pan de mur surnaturel, et toutes enracinées pourtant dans la plus quotidienne réalité. Dans l’une, sur une nappe, un compotier, avec quatre pommes, un raisin, un verre à pied, élancé, évasé comme un calice, à demi plein de vin, un tas de pommes, un couteau. Elle se détache sur une tapisserie à fleurs. À gauche, dans le coin, elle est à moitié signée… L’autre, sur une table de bois grossièrement équarrie, offre une prodigieuse corbeille, un panier de fruits à moitié enveloppés d’un linge, des poires sur la nappe, un service à café, la cafetière, le sucrier, et une sorte de pot, d’alcaraza à losanges. À droite, sur un coin entrevu de cheminée, une palette, un flacon à essence. Tout contre, des châssis de toiles. Au fond, sur le plancher fuyant, une chaise, le bas d’une chaise rustique dont le bord de la toile coupe la paille… Et la troisième c’est, élégante, savoureuse, lucide, une œuvre toute de France, décorative et pourtant aiguë ― se détachant à demi sur une riche étoffe drapée à larges plis, à sourds ramages, un Amour de plâtre, les bras coupés, à sa droite une assiette de poires, à sa gauche un tas de prunes. Au fond, imprévue, bourgeoise, mais d’un métier si gras, d’un faire si étourdissant, une cheminée à la prussienne, comme on en use encore dans les bastides de Provence.
Tenez, ce que je n’ai pas encore pu atteindre, ce que je sens que je n’atteindrai jamais dans la figure, dans le portrait, je l’ai peut-être touché là… dans ces natures mortes… Je me suis scrupuleusement conformé à l’objet… J’ai copié… Écoutez un peu, quel sort vous paraît le plus à plaindre ? Être dénué, n’est-ce pas ? Eh bien ! je me suis un peu donné là. Je ne serai pas tout à fait dénué, dans le temps, si, comme vous voulez bien me l’affirmer, après ma mort, on s’occupe encore un peu de moi… Voilà… Regardez ça… Dites-moi franchement votre avis… Et toi aussi, Henri.
Moi :
― Mais c’est plus grand que tout ce qu’on a peint depuis les Vénitiens… Il y a des fruits verts du Tintoret, à San Rocco, un morceau de sa Crucifixion replié et miraculeusement conservé dans toute sa fraîcheur, des pommes qui ressemblent à ça… Mais que c’est beau ! que c’est beau ! Il y a plus de vie, dans ces fruits, que dans bien des visages…
Cézanne :
― Voilà que vous vous emballez… Je ne me monte pas le coup, allez… Cette corbeille-là, je l’ai offerte à mon cocher, en souvenir de moi, pour plus tard, vous comprenez, il soigne bien maman, cet homme… Eh bien ! il a été content, il m’a bien dit merci… Mais il m’a laissé la toile… Il a oublié de l’emporter… Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?… Autant peindre, puisque c’est mon destin.
Moi :
― Maître…
Il a un grand geste calme de bras sceptiques qui retombent, de face désespérée, d’ironiques regards, mais de volonté indomptable.
Cézanne :
― Je me suis juré de mourir en peignant, plutôt que de sombrer dans le gâtisme avilissant qui menace les vieillards qui se laissent dominer par des passions abrutissantes pour leurs sens… Dieu m’en tiendra compte.
Moi :
― Et même, si vous n’avez pas, comme nous, la certitude que vous êtes un des plus grands peintres qui aient jamais…
Cézanne :
― Taisez-vous.
Moi :
― Vous avez du moins la consolation du travail.
Cézanne :
― Je n’aime que lui. Et la peinture… C’est si bon et si terrible de s’installer devant une toile vide. Celle-là, tenez, il y a des mois de travail dessus. Des pleurs, des rires, des grincements de dents. Nous parlions des portraits. On croit qu’un sucrier ça n’a pas une physionomie, une âme. Mais ça change tous les jours aussi. Il faut savoir les prendre, les amadouer, ces messieurs-là… Ces verres, ces assiettes, ça se parle entre eux. Des confidences interminables… Les fleurs, j’y ai renoncé. Elles se fanent tout de suite. Les fruits sont plus fidèles. Ils aiment qu’on fasse leur portrait. Ils sont là comme à vous demander pardon de se décolorer. Leur idée s’exhale avec leurs parfums. Ils viennent à vous dans toutes leurs odeurs, vous parlent des champs qu’ils ont quittés, de la pluie qui les a nourris, des aurores qu’ils épiaient. En cernant de touches pulpeuses la peau d’une belle pêche, la mélancolie d’une vieille pomme, j’entrevois dans les reflets qu’elles échangent la même ombre tiède de renoncement, le même amour du soleil, le même souvenir de rosée, une fraîcheur… Pourquoi divisons-nous le monde ? Est-ce notre égoïsme qui se reflète ? Nous voulons tout à notre usage. Il y a des jours où il me paraît que l’univers n’est plus qu’une même coulée, un fleuve aérien de reflets, de dansants reflets autour des idées de l’homme… Le prisme, c’est notre première approche de Dieu, nos sept béatitudes, la géographie céleste du grand blanc éternel, les zones diamantées de Dieu… Je te parais un peu maboul, Henri ?…
Mon père :
― Non, non. Le petit te comprend.
Cézanne :
― Les objets se pénètrent entre eux… Ils ne cessent pas de vivre, comprenez-vous… Ils se répandent insensiblement autour d’eux par d’intimes reflets, comme nous par nos regards et par nos paroles… C’est Chardin, le premier, qui a entrevu ça, a nuancé l’atmosphère des choses… Il était à l’affût, constamment… Vous vous rappelez son beau pastel, où il s’est représenté armé d’une paire de besicles, une visière faisant auvent… C’est un roublard, ce peintre… Remarquez qu’en faisant chevaucher sur votre nez un léger plan transversal d’arête, les valeurs s’établissent mieux à la vue… Eh bien ! il l’avait remarqué avant nous… Il ne négligeait rien. Aussi a-t-il surpris toute cette rencontre, dans l’ambiance, des particules les plus ténues, cette poussière d’émotion qui enveloppe les objets… Mais il est un peu sec… C’est peut-être encore un peu trop serti… Dessinez, dessinez, oui, parbleu, dessinez, mais c’est le reflet qui est enveloppant, la lumière, par le reflet général, c’est l’enveloppe… Voilà ce que je cherche… Et voilà pourquoi ces trois natures mortes, au fond, tenez, depuis que je vous parle, je ne les aime plus.
Moi :
― Comment, maître ?… Plus vous parlez, au contraire, mieux je les vois, plus je les aime, plus je les comprends… Elles sont comme vivifiées encore par tout ce que vous dites.
Cézanne :
― Écoutez un peu, quand on se met à bêcher Chardin, comme je viens de le faire, il faut apporter d’autres résultats.
Moi :
― Mais Chardin n’a pas cette clarté, il paraîtrait tout assourdi à côté de ce panier bleuâtre, de cet Amour… Il y a du chromo dans Chardin, à côté…
Cézanne :
―Taisez-vous… Vous me feriez croire que vous ne comprenez rien à ce que je tente… Moi, je ne trouve pas ça vivant, enveloppé…
Il me montre l’Amour de plâtre dans sa nature morte.
Ici, tenez, ces cheveux, cette joue, c’est dessiné, c’est habile, là, ces yeux, ce nez, c’est peint… Et dans un bon tableau, comme je le rêve, il y a une unité. Le dessin et la couleur ne sont plus distincts ; au fur et à mesure que l’on peint, on dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise. Voilà ce que je sais, d’expérience. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Le contraste et les rapports des tons, voilà le secret du dessin et du modelé… Tout le reste, c’est de la poésie. Qu’il faut avoir dans la cervelle, peut-être, mais qu’il ne faut jamais, sous peine de littérature, essayer de mettre dans sa toile. Elle y vient toute seule.
Il va prendre un livre sur l’étagère, son vieux Balzac. Il feuillette la Peau de chagrin.
Oui, vous avez vos métaphores, vos comparaisons. Quoiqu’il me semble que de constamment multiplier les « comme », c’est comme nous, quand notre dessin se voit trop. Il ne faut pas tirer les gens par la manche… Mais nous, nous n’avons que nos tons, la visibilité… Tenez, tenez… Il parle d’une table servie, il fait sa nature morte, Balzac, mais à la Véronèse… Une nappe…
Il lit :
«… blanche comme une couche de neige fraîchement tombée et sur laquelle s’élevaient symétriquement les couverts couronnés de petits pains blonds. »
Toute ma jeunesse, j’ai voulu peindre ça, cette nappe de neige fraîche… Je sais maintenant qu’il ne faut vouloir peindre que « s’élevaient symétriquement les couverts » et « de petits pains blonds ». Si je peins « couronnés » je suis foutu… Comprenez-vous ? Et si vraiment j’équilibre et je nuance mes couverts et mes pains comme sur nature, soyez sûr que les couronnes, la neige, et tout le tremblement y seront… Dans le peintre, il y a deux choses : l’œil et le cerveau, tous deux doivent s’entraider ; il faut travailler à leur développement mutuel, mais en peintre : à l’œil, par la vision sur nature ; au cerveau, par la logique des sensations organisées qui donne les moyens d’expression. Je ne sors plus de là. Je vous l’ai dit, un jour, je crois, devant le motif. Je vous le répète encore. Dans une pomme, une tête, il y a un point culminant, et ce point est toujours ― malgré l’effet, le terrible effet : ombre ou lumière, sensations colorantes ― le plus rapproché de notre œil. Les bords des objets fuient vers un autre placé à votre horizon. C’est mon grand principe, ma certitude, ma découverte. L’œil doit concentrer, englober, le cerveau formulera…. Et puis, j’ai encore noté ça, sur les marges du Chef-d’œuvre inconnu, un fameux livre, soit dit entre nous, autrement empoignant, autrement profond que L’Œuvre, et que tous les peintres devraient relire au moins une fois par an…. J’ai noté ça… Voici sans conteste possible, je suis très affirmatif…
Il lit.
« Une sensation optique se produit dans notre organe visuel qui nous fait classer par lumière, demi-ton ou quart de ton les plans représentés par des sensations colorantes… »
Il ricane.
La lumière n’existe donc pas pour le peintre.
Il reprend.
« Tant que, forcément, vous allez du noir au blanc, la première de ces abstractions étant comme un point d’appui autant pour l’œil que pour le cerveau, nous pataugeons, nous n’arrivons pas à avoir notre maîtrise, à nous posséder. Pendant cette période, nous allons vers les admirables œuvres que nous ont transmises les âges, où nous trouvons un réconfort, un soutien, comme le fait la planche pour le baigneur… »
Il jette le livre.
Mais dès que nous sommes peintres, nous nageons en pleine eau, en pleine couleur, en pleine réalité. Nous nous colletons directement avec les objets. Ils nous soulèvent. Un sucrier nous en apprend autant sur nous et sur notre art qu’un Chardin ou un Monticelli. Il est plus coloré. Ce sont nos tableaux qui deviennent des natures mortes. Tout est plus irisé que nos toiles, et je n’ai qu’à ouvrir ma fenêtre pour avoir les plus beaux Poussin et les plus beaux Monet du monde…. L’ombre tassée, l’ombre peinte, la lumière assassinée, horreur ! la clarté morte… On marche dans un pays d’aveugles… Par quels sens, avec quels sens percevez-vous donc le soleil ? Nos tableaux, c’est de la nuit qui rôde, de la nuit qui tâtonne… Les musées sont des cavernes de Platon. Sur la porte je ferai graver : « Défense aux peintres d’entrer. Il y a le soleil dehors ». Un peintre commence à peindre, ce qui s’appelle peindre, à quarante ans, un peintre de nos jours. Les autres, à cet âge, lorsqu’il n’y avait pas de musée, avaient presque achevé leur œuvre. Un peintre aujourd’hui ne sait rien. Jusqu’a quarante ans, oui, qu’il fréquente les musées, je le lui ordonne. Après qu’il retourne dans ces cimetières simplement pour s’y reposer et y méditer sur son impuissance et sur sa mort… Les musées sont des lieux odieux. Ils puent la démocratie et le collège. Je peins mes natures mortes, ces natures mortes, pour mon cocher qui n’en veut pas, je les peins pour que les enfants sur les genoux de leurs grands-pères les regardent en mangeant leur soupe et en babillant. Je ne les peins pas pour l’orgueil de l’empereur d’Allemagne et la vanité des marchands de pétrole de Chicago. On donne dix mille francs d’une de ces cochonneries ; on ferait mieux de me donner un mur d’église, une salle d’hôpital ou de mairie, et de me dire : « Foutez-vous là… Peignez-nous un mariage, une convalescence, une belle moisson…. » Alors, peut-être, je sortirais ce que j’ai dans le ventre, ce que je porte là depuis que je suis né, et ce serait de la peinture… Mais je rêve, je me saoule, je m’exalte… À quoi ça mène ? À m’empêcher de travailler mieux… Travailler !… Il n’y a que ça… La peinture, va, Henri, c’est bougrement difficile… On croit toujours la tenir, on n’y est jamais… Ton portrait, c’est un morceau, et tu comprends ce qu’il faut s’échiner sur un visage, des yeux qui regardent, une bouche qui parle… Eh bien ! ce n’est encore rien. Pour faire des tableaux, il faudrait presque pouvoir descendre un morceau comme ça par jour… Tintoret le faisait, et Rubens… Et il n’y a pas que la figure… Ces natures mortes, c’est la même chose. Elles sont aussi denses, aussi multiples. Il y a un métier par objet. On ne sait jamais son métier… Je peindrais cent ans, mille ans sans m’arrêter, qu’il me semble que je ne saurais rien….
Les anciens, eux, nom de Dieu, je ne sais pas comment ils s’y prenaient pour abattre des kilomètres de besogne… Moi je me dévore, je me tue, à couvrir cinquante centimètres de toile… N’importe… C’est la vie… Je veux mourir en peignant…
Il tombe brusquement dans une de ces rêveries qui lui étaient coutumières. Il regarde son poing fermé. Il y suit les passages des lumières aux ombres.
Ce n’est pas tout ça… Tout cela, écoutez un peu, c’est de la blague… Ce que je veux, c’est faire avec de la couleur, ce qu’on fait en blanc et en noir avec le tortillon…
Un grand silence encore. Puis, il me regarde, et je sens ses yeux qui, jusqu’au fond de moi, par-delà moi, jusqu’au fond de l’avenir, m’éblouissent. Il a un grand sourire résigné.
Un autre fera ce que je n’ai pu faire… Je ne suis, peut-être, que le primitif d’un art nouveau.
Puis, une sorte de révolte effarée le traverse.
C’est effrayant, la vie !
Et comme une prière, dans le soir qui tombe, je l’entends qui, plusieurs fois, murmure :
Je veux mourir en peignant…
mourir en peignant… »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 71 :
« Le volume des Études philosophiques où se trouvent la Peau de chagrin, Jésus-Christ en Flandre, Melmoth réconcilié, le Chef-d’œuvre inconnu, la Recherche de l’absolu, tout fripé, sali et décousu, était un de ses livres de chevet. »
26 juin
Vollard achète le tableau de Cezanne Compotier et assiette de biscuits (FWN741-R325) à Victor Vignon, pour 500 francs. Il le revendra à Alexandre Rosenberg, le 16 décembre de la même année, pour 1 800 francs.
Livre de comptes de Vollard, Archives Vollard.
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 954 numéros, notice 325, p. 221.
Début de l’été
Maurice Le Blond et Joachim Gasquet rendent visite à Cezanne dans son « pied à terre » parisien :
« Nulle part, on ne voyait de toile. » « — Ici, je n’ai jamais rien. À peine ai-je achevé une toile que je ne la vois plus, mon fils a mis la main dessus, elle est déjà chez Vollard. »
Le Blond-Zola Maurice, « Zola et Cezanne », L’Ordre, 7 avril 1939, p. 125-126 à voir ; cité par Ratcliffe Robert William, « Cezanne’s Working Methods and their Theorical Background », thèse de doctorat, Londres, University of London, Courtauld Institute of Art, 1960, 448 pages, p. 25 et note 126 p. 426.
NB. Maurice Le Blond avait fortement soutenu Zola lors de l’affaire Dreyfus. Il épousera en octobre 1908 sa fille Denise, d’où le changement de patronyme.
Été (?)
Cezanne est à Montgeroult et à Marines dans la région parisienne (actuel Val-d’Oise). Il peint les paysages suivants :
– La Route tournante à Montgeroult (FWN321-R828)
– L’Allée de Marines (FWN325-R829)
– Ferme à Montgeroult (FWN320-R833).
Il travaille parfois en compagnie du peintre Louis Le Bail (1866-1929), mais il se fâche avec lui.
« Montgeroult, lundi soir [1898].
Cher Monsieur,
Je viens de me réveiller, et je me rappelle que dans une circonstance analogue à celle qui s’est présentée à moi ces jours derniers 2, j’avais rendu la visite qu’on avait bien voulu me faire. Je suis très contrarié de la fausse position dans laquelle je me suis mis. Quoique je n’aie pas l’honneur de vous être connu depuis longtemps, j’ose vous prier de me venir en aide pour réparer ma bévue. Que dois-je faire, dites-le moi, je vous en serai bien reconnaissant.
Agréez l’expression de mes meilleurs sentiments.
P. Cezanne »
- Louis Le Bail, jeune peintre, habitant alors à Marines, avait appris par Camille Pissarro que Cezanne travaillait non loin de là. Il s’était déjà rendu plusieurs fois auprès de lui, et Cezanne s’était lié avec son jeune confrère.
- Le baron Denys Cochin, amateur d’art, venait de rencontrer lors d’une de ses promenades à cheval, Cezanne peignant à Montgeroult. Le peintre, ignorant que c’était un admirateur de son talent, l’avait plutôt mal reçu.
Lettres de Cezanne à Louis Le Bail, s. d. [1898] ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 264-265 .
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 110-112.
Louis Le Bail lui signala un peu plus tard l’identité du collectionneur, possesseur de plusieurs œuvres de Cezanne.
Autre lettre de Cezanne à Louis Le Bail :
« Marines [1898].
Monsieur,
La façon un peu trop cavalière avec laquelle vous vous permettez de vous présenter chez moi, n’est pas pour me plaire. Vous voudrez bien vous faire annoncer à l’avenir 1.
Veuillez remettre à la personne qui se présentera chez vous le verre et la toile demeurés dans votre atelier. Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées.
Paul Cezanne »
- Voici ce qu’il s’était passé : Cezanne ayant prié Louis Le Bail de le réveiller tous les jours après sa sieste, vers trois heures ; celui-ci, fidèle à la consigne et l’ayant trouvé endormi, était entré dans la chambre de Cezanne, après avoir frappé plusieurs fois à la porte, pour le réveiller.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 265.
Rewald John, Cezanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 194, 201 ; repris en partie de Rewald John, Cezanne, sa vie, son œuvre, son amitié pour Zola, Paris, Albin Michel éditeur, 1939, 460 pages, n. 1 p. 387-388 :
« Pissarro, qui respectait lui aussi le désir de solitude de Cezanne, encouragea néanmoins le jeune peintre Louis Le Bail à aller le voir quand il travaillait à Montgeroult, près de Pontoise, en 1898. Les deux hommes se lièrent d’amitié et un jour Cezanne demanda à son jeune collègue la permission de travailler à ses côtés sur un motif que Le Bail avait découvert. Alors que la toile du jeune homme était déjà bien avancée, Cezanne se mit à ébaucher fougueusement un grand tableau. Une jeune fille qui passait par là s’arrêta pour examiner les peintures et ne put s’empêcher de dire, en désignant le tableau de Le Bail : « C’est celui-là qui est beau. » Cezanne fut bouleversé par cette réflexion candide. Le lendemain, quand Le Bail lui demanda pourquoi il semblait chercher à l’éviter, Cezanne répondit : « Vous devriez avoir pitié de moi ; la vérité sort de la bouche des enfants. »
Cezanne confia à Louis Le Bail qu’il aurait été heureux de gagner six mille francs par an avec sa peinture. Volard n’était pas très généreux, mais Cezanne était flatté qu’il lui prenne toutes ses œuvres, même si elles étaient inachevées ou si la toile était crevée. Ainsi il vendait assez régulièrement ses peintures par l’intermédiaire de son fils à qui il donnait une commission sur les ventes. Vollard de son côté offrait également une commission au jeune Cezanne ; son père était parfaitement au courant de cet arrangement. « Le petit est plus fort que moi, disait-il d’un ton admiratif ; je n’ai aucun sens pratique. » »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 77 :
« Le peintre Le Bail qui, plus tard, fut son voisin aux environs de Paris et pour qui Cezanne se prit d’affection, m’a raconté avec quels soins il préparait les valeurs de ses natures mortes, glissant par exemple, sous des pêches, des tons un à un jusqu’à ce que les fruits se présentent dans la lumière, avec les tons, qu’il cherchait. « La composition de la couleur, disait-il, la composition de la couleur !… Tout est là. Voyez au Louvre, c’est ainsi que Véronèse compose. » »
Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 168 :
« Le jeune peintre Louis Le Bail assista ainsi un jour de pluie à la composition d’une nature morte : une serviette, un verre contenant un peu de vin rouge et des pêches. Il en a conservé ce souvenir : « la « serviette a été drapée à peine sur la table, avec un goût inné, puis Cezanne a placé les pêches, en opposant les tons les uns aux autres, faisant vibrer les complémentaires, les verts aux rouges, les jaunes aux bleus, penchant, inclinant, équilibrant les fruits comme il voulait que ce soit, se servant pour cela de pièces d’un sou et de deux sous. Il y apportait un très grand soin et beaucoup de précautions, on devinait que c’était pour lui un régal de l’œil » (7).
(7) Renseignement communiqué par M. Louis Le Bail dans une lettre à l’auteur. »
Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 170 :
« Quand il commençait, par exemple, une nouvelle toile, « il dessinait au pinceau avec l’outremer dilué dans beaucoup d’essence de térébenthine, mettant en place avec fougue, sans hésitation » (3).
(3) Renseignement communiqué par M. Louis Le Bail. »
Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 172 :
« à Montgeroult, près de Pontoise, où il se lia avec le jeune peintre Louis Le Bail (2).
(2) Sa femme et son fils ne venaient le voir que le dimanche et l’attendaient à la sortie de la messe. »
de Beucken Jean, Un portrait de Cezanne, Paris, « nrf », Gallimard, 1955, 341 pages, p. 270 :
« Sa femme et son fils venaient le dimanche, et l’attendaient à la sortie de la messe. Il parlait à le Bail de son fils avec une admiration un peu naïve : « Le petit est plus fort que moi, je n’ai aucun sens pratique. »
29 juillet
Un certain Montfort rend visite à Cezanne, mais celui-ci est absent de Paris. Il travaille à la campagne (Fontainebleau, Montigny-sur-Loing).
Une adresse de Cezanne à Fontainebleau, 11, rue Saint-Louis, est consignée dans un livre d’adresses de Vollard.
Lettre inédite de Paul Cezanne fils à J. Gasquet, 29 juillet 1898 ; Aix-en-Provence, bibliothèque Méjanes ; archives Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux.
Lettre de Gauguin à Monfreid, octobre 1898 ; Joly-Segalen Anne, Lettres de Paul Gauguin à Daniel de Monfreid, Paris, 1918, éd. révisée 1950, p. 109.
Octobre
Gauguin, à cours d’argent et malade à Papeete, a fait vendre par Chaudet l’un de ses tableaux de Cezanne.
« Chaudet, quel drôle de garçon ! Il m’annonçait pour le mois suivant 600 fr. provenant de mon Cezanne, puis pas de lettre. Attendons — »
Lettre de Gauguin à Daniel de Monfreid, octobre [18]98 ; Lettres de Gauguin à Daniel de Monfreid, précédées d’un hommage à Gauguin par Victor Segalen, édition établie et annotée par Mme Joly-Segalen, Paris, Georges Falaize, 1950, 251 pages, lettre XLVII p. 130.
6 novembre
Lettre de Cezanne à Eugène Montfort .
« Paris, 11 juin 1898,
Cher Monsieur,
Je suis en Possession de l’œuvre littéraire, que vous avez bien voulu me faire parvenir par l’intermédiaire de Joachim Gasquet. J’aurai le plus grand plaisir à en prendre connaissance et, lorsque l’occasion se présentera, vous voudrez bien me permettre de parler avec vous des choses de l’Art, qui nous intéressent tant.
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments,
Paul Cezanne »
Paul Cézanne, Soixante-trois lettres, transcrites et annotées par Jean-Claude Lebensztejn, Paris, L’Échoppe, à paraître.
Eugène Jules Montfort, écrivain français (7 février 1877 12 décembre 1936), fonde en 1895 avec Maurice Le Blond (gendre de Zola)et Saint-Georges de Bouhélier le mouvement littéraire appelé « naturisme ». On peut supposer que l’oeuvre littéraire dont il et question est Sylvie ou les émois passionnés, paru en 1896.
Novembre
Deuxième exposition de la Société des amis des arts d’Aix. Cezanne n’y participe pas.
Noir Claude, « La deuxième Exposition de la Société des amis des arts, notes de critique », Le Mémorial d’Aix, politique et littéraire, 61e année, n° 91, jeudi 10 novembre 1898, p. 1 :
« La deuxième Exposition
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
Notes de critique.J’ai une vieille amie qui aime l’art passionnément. Elle a beaucoup voyagé. Elle a vu de nombreux musées. Chez elle on feuillette de beaux albums où, photographiés par Braun, sont réunis les chefs-d’œuvre des maîtres. Par dessus tout elle chérit la noble lignée de peintres classiques qui partant du Poussin arrive à Puvis de Chavannes en passant par Ingres ; en cela elle est bien française. D’autre part, j’ai fait, l’autre jour, la connaissance d’un jeune peintre, admirateur fervent de Claude Monet. Il est venu contempler dans les derniers beaux jours de notre automne les chauds paysages que lui avait déjà révélés, aux galeries Vollard, la récente exposition que l’on vient de faire des œuvres de Paul Cézanne.
Le hasard bienveillant m’a fait rencontrer, ce matin, ma vieille amie et le jeune artiste devant les tableaux exposés à l’avenue Victor-Hugo. « Eh ! bien, ai-je dit au peintre, vous m’avez l’air bien affairé.
― Ah ! m’a-t-il répondu, vous allez me conduire devant les Cézanne. Je ne suis venu que pour eux. Je ne puis les trouver…
― Et vous ne les trouverez pas.
―Pourquoi ? N’y en aurait-il point ? Cela est vraiment extraordinaire. Ce grand peintre, dont le Musée impérial de Berlin a acheté un magnifique paysage, dont j’ai longuement contemplé avant de quitter Paris les deux vibrantes toiles dont s’honore le Luxembourg, cet artiste conscient dont Huysmans, Geffroy, Mirbeau, Mauclair et tous nos critiques viennent de s’occuper…
― … n’est pas prophète en son pays. C’est toujours la même histoire.
― Ah ! c’est vrai, je ne pensais plus que nous sommes en province. Mais alors… […] »
Noir Claude, « La deuxième Exposition de la Société des amis des arts, notes de critique », Le Mémorial d’Aix, politique et littéraire, 61e année, n° 96, dimanche 27 novembre 1898, p. 1 :
« La deuxième Exposition
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
Notes de critique.[…] Pour que cette fête artistique fût complète, il eût fallu, sur la cimaise, à la place d’honneur, quelque paysage de Paul Cezanne. Mais rien n’est parfait en ce monde. »
23 décembre
Cezanne renouvelle son amitié à Henri Gasquet et à son fils Joachim, apportant son soutien au mouvement artistique régionaliste lancé par ce dernier.
« Paris, 23 décembre 1898.
Mon cher Henri,
Je viens de recevoir le bon souvenir que tu as bien voulu m’adresser. Je ne puis que te remercier vivement. C’est l’évocation pour moi de plus de quarante ans passés. Puis-je dire qu’une providence m’a fait te connaître ? Si j’étais plus jeune, je dirais que c’est pour moi un point d’appui et un réconfort. Un stable dans ses principes et son opinion, c’est épatant. Je te prie de remercier aussi ton fils, dont le ciel m’a fait faire la connaissance et dont l’amitié m’est bien précieuse.
J’espère que je le reverrai bientôt, soit que je descende dans le Midi ou que ses études et ses intérêts littéraires le ramènent ici. Lui, Madame Gasquet et ses amis ont l’avenir pour eux. Je m’associe de plein cœur au mouvement d’art qu’ils déterminent et qu’ils doivent caractériser. Tu n’as pas idée comme c’est vivifiant de trouver autour de soi une jeunesse qui consente à ne pas vous enterrer immédiatement, aussi ne puis-je faire que les vœux les plus sincères pour leur triomphe.
Je ne m’étendrai pas ici plus longtemps ; il vaut mieux parler directement ― on s’explique et on s’entend toujours mieux.
En terminant, tu voudras bien me rappeler au souvenir de ta mère qui, dans la maison, est la mère de la sagesse que tu représentes. Je sais qu’elle veut bien se souvenir de cette rue Suffren qui fut notre berceau. Il est impossible que l’émotion ne nous vienne en pensant à tout ce beau temps écoulé, à cette atmosphère qu’on a respirée sans s’en douter et qui est sans doute la cause de l’état d’esprit actuel dans lequel nous nous trouvons.
Mon cher Henri, en te priant de faire agréer mes meilleurs sentiments à ta famille, permets-moi de t’embrasser de tout cœur,
ton vieux camarade,
Paul Cezanne »Lettre de Cezanne à Henri Gasquet, 23 décembre 1898 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 266-267.
Le père du poète et ancien condisciple de Cezanne, un bourgeois prospère, tenait à Aix une boulangerie héritée de sa famille.
23 décembre
Vollard propose à Signac de lui racheter ses Cezanne, lequel refuse de vendre sa plus grande toile (R434), qu’il avait achetée chez le père Tanguy en 1884, mais il échange une petite nature morte contre une tête de femme de Renoir, deux aquarelles de Jongkind et un Seurat :
« Vollard vient pour m’acheter mes Cézannes. Je refuse de lui vendre le plus grand [FWN147-R434], mais je consens à lui acheter la petite nature morte et c’est avec joie que je rapporte un joli petit Renoir — un rien, une tête de femme, un rose, un bleu, un jaune, mais c’est tout Renoir et son charme — deux aquarelles de Jongkind, et un Seurat du début de la division, qui était à la traine depuis des mois dans la boutique de Vollard. »
Rewald John, « Extraits du journal inédit de Paul Signac, III, 1898-1899 », Gazette des beaux-arts, 6e période, tome XLII, 95e année, 1014-1015e livraison, juillet-août 1953 ; p. 27-57, citation p. 37.
25 décembre
Signac décline de nouvelles propositions d’achat de son Cezanne :
« 25 décembre 1898.
Visite de trois juifs, de gros, qui viennent, envoyés par Moline, pour acheter le Degas. Ils le trouvent un peu cher, mais veulent absolument emporter pour 1.500 francs le Cezanne et le Guillaumin. — Devant leur insistance de millionnaire, je dois leur répondre sèchement que je ne suis pas marchand de tableaux. Ce sont bien là des gens faits pour racheter très cher les œuvres d’art acquises pour rien, quinze ans plus tôt, par les véritables amateurs. Ils ne regardent chez moi que les tableaux aux noms cotés et passent indifférents devant les Seurat, les Luce et les Cross qu’ils pourraient avoir pour quelques cents francs. »
Rewald John, « Extraits du journal inédit de Paul Signac, III, 1898-1899 », Gazette des beaux-arts, 6e période, tome XLII, 95e année, 1014-1015e livraison, juillet-août 1953 ; p. 27-57, p. 37.
Maurice Denis note dans son journal :
« Vuillard me rapporte que Cezanne parle avec la plus vive admiration de Véronèse, qu’il semble préférer à tout. Vuillard remarque qu’il a en effet les mêmes sujets que Véronèse : rapports, entente des arrangements. »
Denis Maurice, Journal, tome I « (1884-1904) », Paris, La Colombe, éditions du Vieux Colombier, 1957, 227 pages, p. 149.
Courant de l’année
Le collectionneur Havemeyer achète deux tableaux de Cezanne à Vollard.
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 157-158 :
« Le peintre américain Mary Cassatt, qui a tant fait pour l’art français, m’avait dit :
— J’ai parlé de vous, à M. Havemeyer. Mettez donc de côté pour lui ce que vous avez de mieux. Vous savez qui c’est, Havemeyer ?
Si je le savais ! Havemeyer, le roi du sucre ! Quelque temps auparavant, j’avais précisément lu, dans les journaux, qu’une importante baisse des sucres s’étant produite sur le marché américain pendant un voyage qu’effectuait M. Havemeyer, celui-ci avait regagné New York et son retour avait suffi pour faire reprendre aux valeurs sucrières toute leur fermeté. Le roi du sucre ! Tout en choisissant les tableaux que je jugeais dignes de lui être soumis, je pensais en moi-même : « Si j’avais la puissance dont disposent les milliardaires, ce n’est pas par ma magnificence que j’éblouirais le monde, mais, au contraire, par la simplicité de ma vie. Ainsi, je n’aurais pas de yacht. Je ne ferais pas former pour moi de trains spéciaux. Je ne retiendrais pas un palace entier. Je ne m’encombrerais pas d’une suite nombreuse, comme les magnats du pétrole, du cacao, du papier ou du chewing gum… » J’en étais là de mes réflexions, quand un méchant fiacre (c’était en 1898) s’arrête devant mon magasin. Il en descend un monsieur, très simplement mis, qui entre chez moi. Je pestai contre l’intrus. Si M. Havemeyer arrivait tout à coup et que je dusse le faire attendre pendant que je vendrais, peut-être, une gravure !… Mais non… C’était des Cezanne que voulait voir l’inconnu. Il en choisit deux. Puis il me remit sa carte et rejoignit son fiacre… C’était M. Havemeyer ! »
En 1898 ou 1899
Joachim Gasquet et le poète Saint-Georges de Bouhélier (Rueil, 19 mai 1876 – Montreux, 20 décembre 1947) rendent visite à Cezanne dans son atelier de Paris : « Cezanne avait alors soixante ans environs […] Il expliqua […] qu’il était venu à Paris pour les musées, qu’il allait chaque matin au Louvre où il s’amusait à copier des Velasquez. »
Saint-Georges de Bouhélier, « Pages d’histoire contemporaine. Simplicité de Cezanne », L’Écho de Paris, 52e année, n° 20695, lundi 15 juin 1936, p. 1-2 :
« La plus grande leçon d’humilité qui m’ait été donnée dans ma vie, je l’ai reçue de Cézanne. La jeunesse est volontiers subversive en art et, à l’égard des talents officiels qui sont généralement gorgés de bénéfices et d’honneurs, elle use de sarcasmes d’autant plus rudes qu’elle se sent plus d’admiration pour leurs rivaux foudroyés. Il y a là un sentiment commun à beaucoup de jeunes, surtout à ceux qui ont l’appétit du nouveau et le goût de la justice.
À mes débuts dans la carrière des Lettres j’ai donc fait comme ceux de mon âge et, tandis que je repoussais des gloires opulemment rentées et bien pourvues, je raffolais de malchanceux comme Verlaine ou Paul Cézanne. Ils n’avaient pas quitté ce monde dont ils étaient soit ignorés, soit cruellement outragés, et personne n’eût pu soupçonner qu’ils y prendraient plus tard une telle revanche. Verlaine passait pour un poète « abscons » et Cézanne pour un dément. Je ne crois pas qu’ils se soient fréquentés. Ils vivaient chacun dans son coin, travaillaient en dépit du sort et grandissaient la France à son insu.
Un jour que je me promenais avec Joachim Gasquet, un de mes camarades du naturisme, un Aixois de haute éloquence dont, à l’Orangerie, en ce moment même, on peut voir un très beau portrait dû au pinceau de Cézanne, nous remontions tous deux la rue de Rome, le long de la ligne du chemin de fer. Des trains filaient, trouant l’air de leurs plaintes, et nous devisions comme font les jeunes hommes (peut-être avais-je 22 ou 23 ans, et Gasquet 26 ou 27 au plus), c’est-à-dire avec l’enthousiasme de notre âge, envisageant pour mieux les jeter bas toutes les théories en vogue et en en bâtissant dans les nuées de plus adéquates à notre idéal, quand je vis Gasquet s’arrêter soudain, en levant les bras au ciel, tandis qu’à dix mètres de là un passant qui venait vers nous lui répondit par un geste semblable.
— Cézanne ! avait crié Gasquet.
Et, à présent, il s’élançait vers l’arrivant et, lui ayant serré les mains, avec un air de profonde émotion, il l’amenait bientôt vers moi qui, à ce spectacle imprévu, étais demeuré à l’écart, légèrement intimidé. Car, ainsi que je l’ai marqué et bien que Cézanne fût tenu pour un véritable raté de la peinture, il égalait à nos regards, à nous les jeunes de ce temps éloigné, les plus grands peintres du monde, qu’ils fussent au British Muséum ou aux Offices, ou dans le Louvre même.
La première impression que l’on reçoit d’un être a quelque chose de très révélateur. Pour avoir entendu Gasquet parler souvent du « Maître d’Aix, son compatriote de la ville des cent fontaines, je m’étais figuré une espèce de sauvage à la physionomie rébarbative et à l’humeur acariâtre. La légende voulait en effet qu’à Aix Cézanne fut isolé. Il y possédait une maison où il ne recevait presque personne. Il y passait des journées en reclus, acharné à peindre des pommes et des objets de ménage, ou à faire son propre portrait ou le portrait de sa femme, sans qu’ils fussent bien ressemblants. On ne pouvait pas l’arracher à son travail. Les gens qui se risquaient chez lui y étaient reçus à coups de fusil. Enfin, on ne connaissait pas personnage plus insociable. Il est notoire qu’il était hypocondre. Il se jetait sur ses tableaux et il en lacérait la toile.
Contrairement à cette singulière présentation qui m’avait été fournie par Gasquet, voilà que j’avais devant moi un vieil homme des plus affables. Avec beaucoup de gentillesse il m’avait tiré un coup de chapeau et je le voyais le crâne découvert, dans Una attitude d’extrême politesse. Comme la plupart des hommes qui ont à se débattre au milieu d’un monde qui refuse de les comprendre, Cézanne n’avait donc d’âpreté qu’en réaction de défense. Mais quand il se sentait en sympathie, il était plein de douceur.
Cézanne avait alors soixante ans environ et il paraissait plus vieux que son âge. Correctement vêtu de noir et coiffé d’un chapeau melon
Du meilleur style provincial, il eût passé inaperçu partout si, pour attirer l’attention du psychologue, il n’y avait eu ses yeux. Ceux-ci étaient petits mais profondément noirs et singulièrement brûlants. Ils éclataient dans une figure au teint de brique et qu’agrémentait une barbe grisâtre. Ils annonçaient un génie volcanique et en reflétaient les flammes.
— Vous êtes à Paris pour longtemps ? demanda Gasquet à Cézanne qui avait pris son ami par le bras et semblait s’attacher à sa personne.
Il expliqua qu’il repartait deux jours plus tard, qu’il était venu à Paris pour les musées, qu’il allait chaque matin au Louvre où il s’amusait à copier des Vélasquez. Je regardais ce soi-disant « barbare » (c’était d’épithètes de ce genre que la critique d’alors criblait Cézanne) ! Presque au déclin de son automne, il se mettait donc à l’École des Maîtres. Mais lui-même il comptait déjà parmi ceux-ci et les peintres du jeune mouvement, qui comptait des hommes comme Bonnard, Maurice Denis et Vuillard, le considéraient comme leur chef de file et se disaient ses élèves. Quelle modestie était la sienne d’aller interroger les tableaux des musées ! Tandis qu’on le traitait d’orgueilleux ignorant et qu’on lui prêtait des idées d’un entrepreneur de démolitions, il allait donc étudier les anciens et, de cette main qui, sur la toile, avait transporté les couleurs des paysages et les reflets des figures, il s’essayait comme un simple écolier à reproduire ses devanciers et à pénétrer leur science ! Il y avait là quelque chose d’excessivement émouvant.
— Comprenez, me disait Cézanne, aujourd’hui on n’entend plus rien aux grandes questions. Les hommes d’autrefois ont su travailler. Nous ne possédons que des bribes de leurs secrets. Nous ne disposons que des clés grossières, celles des maîtres sont perdues !
Ces paroles, Cézanne les disait d’un air tranquille, de sa voix de Méridional qui semblait traîner des cailloux comme un ruisseau de montagne. Moi, j’écoutais, tout étonné, songeant à cette foule de critiques pour qui le vieux mage que nous vénérions n’était qu’un « barbouilleur » ivre de rêves !
— La question, continuait Cézanne, ce n’est pas de peindre des sensations (il faisait allusion au groupe d’impressionnistes auquel, bien à tort, on l’apparentait et qu’en réalité il n’aimait point), la question c’est de retrouver l’ordre classique. Faire du Poussin sur le vif !
Gasquet et moi nous étions de son avis. Tout en accompagnant Cézanne, nous songions aux difficultés avec lesquelles il s’était vu aux prises. Son opposition aux idées du jour s’était soldée à ses dépens par une multitude de persécution et par une masse de misères. Mais n’est-ce pas le lot habituel de tous les hommes vraiment indépendants, à quelque ordre d’ailleurs qu’ils appartiennent et de quelque métier qu’ils se réclament !
La simplicité de Cézanne, je devais l’entrevoir encore et en discerner la grandeur à un petit fait que je vais vous conter. En effet, étant ce jour-là décidément en veine de confidence, il nous avait dit de venir jusque chez lui. Il nous y montrerait sa peinture. Nous ne nous l’étions pas fait dire deux fois, car c’était bien là une aubaine inespérée.
Chez lui (c’était dans une de ces rues qui avoisinent la place Blanche [rue Hégésippe-Moreau], mais le nom s’en est effacé de ma mémoire), il nous avait peu après introduits, et là, il nous avait fait voir une quantité de toiles qui étaient toutes rangées contre le mur dans un pêle-mêle de bazar. On était à la fin du jour et il faisait presque noir. Cézanne avait allumé une bougie et il tirait un tableau, au hasard, l’exposait une minute à nos regards, et le remettait par terre. On eût dit qu’il n’y accordait aucune espèce d’importance. Toutes les peintures qu’il gardait là, elles devaient plus tard enrichir des collections d’amateurs ou bien des salles de musées, mais, lui, il ne les jugeait pas comme d’un grand prix. Elles représentaient des études qu’il avait faites. Il s’était placé « devant le motif », avec sa palette et son chevalet, et il avait tâché d’exprimer sur la toile sa conception de la nature et son sentiment de l’homme. Que le résultat répondît à son attente, c’était toute son ambition. Il n’était devant l’univers qu’un apprenti. Il savait bien que, de sa vie entière, il ne lui serait jamais réservé de réaliser son rêve. Du reste, à quel homme sur cette terre une telle espérance était-elle permise ! Les œuvres de l’homme ne sont rien que des ébauches, des tâtonnements dans la nuit !
SAINT-GEORGES DE BOUHELIER. »
1898-1899
Cezanne peint une femme nue d’après un modèle (FWN694-R897 et RW387), Marie-Louise ?
Rivière Georges, Le Maître Paul Cezanne, Paris, H. Floury éditeur, 1923, 242 pages, p. 222-223 :
« 1898
Étude de Nu Marie-Louise, rare modèle féminin utilisé par Cezanne. Coll. Pellerin.
1899
Portrait de femme Plusieurs études ont été faites d’après la même personne : debout, assise, de dos. »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 130 ; repris par Vollard Ambroise, « L’atelier de Cezanne », Mercure de France, 25e année, tome CVIII, n° 402, 16 mars 1914, p. 286-295, citation p. 289 :
« Son rêve eût été de faire poser ses modèles nus en plein air ; mais c’était irréalisable pour beaucoup de raisons, dont la plus importante était que la femme, même habillée, l’intimidait. Il ne faisait d’exception que pour une servante qu’il avait eue autrefois au Jas de Bouffan, vieille créature au visage taillé à coups de serpe, et dont il disait avec admiration à Zola : « Regarde, est-ce beau ? On dirait un homme ! »
Aussi, quelle ne fut pas ma surprise quand il m’annonça, un jour, qu’il voulait faire poser une femme nue ! « Comment, monsieur Cezanne, ne pus-je m’empêcher de m’écrier, une femme nue ? » — « Oh ! monsieur Vollard, je prendrai une très vieille carne ! [FWN694-R897 et RW387] » Il la trouva d’ailleurs à souhait, et, après s’en être servi pour une étude de nu, il fit d’après le même modèle, mais cette fois vêtu, deux portraits qui font penser à ces parentes pauvres que l’on rencontre dans les récits de Balzac (3).
Cezanne m’avoua qu’il trouvait avec ce « chameau » beaucoup moins de satisfaction qu’avec moi, pour la pose. « Cela devient, m’expliquait-il, très difficile de travailler avec le modèle femme ! Et pourtant je paie cher la séance : ça va dans les quatre francs, vingt sous de plus qu’avant 1870. Ah ! si je pouvais réaliser votre portrait ! » »
Rewald John, Cezanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 201 ; repris en partie de Rewald John, Cezanne, sa vie, son œuvre, son amitié pour Zola, Paris, Albin Michel éditeur, 1939, 460 pages, p. 388 :
« Le jeune Paul Cezanne essaya même d’intervenir dans le choix des sujets de son père, lui reprochant par exemple de ne peindre que des hommes alors que les femmes faisaient « beaucoup plus de ventes ». Mais les femmes inspiraient à Cezanne des craintes qui n’avaient fait que s’aggraver avec l’âge. Il proposa bien à Louis Le Bail de venir travailler avec lui dans un atelier parisien où il pourrait avoir des modèles féminins, mais il ne donna pas suite à ce projet. »





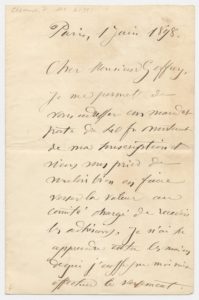
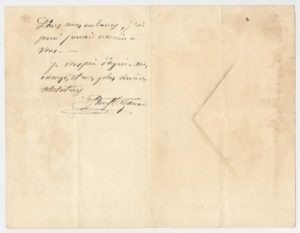
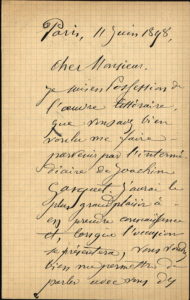
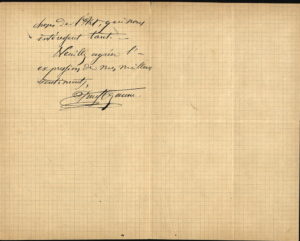


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.