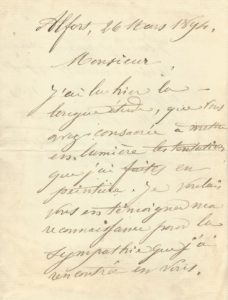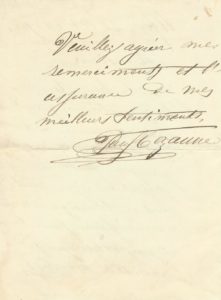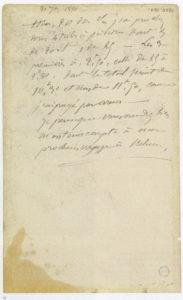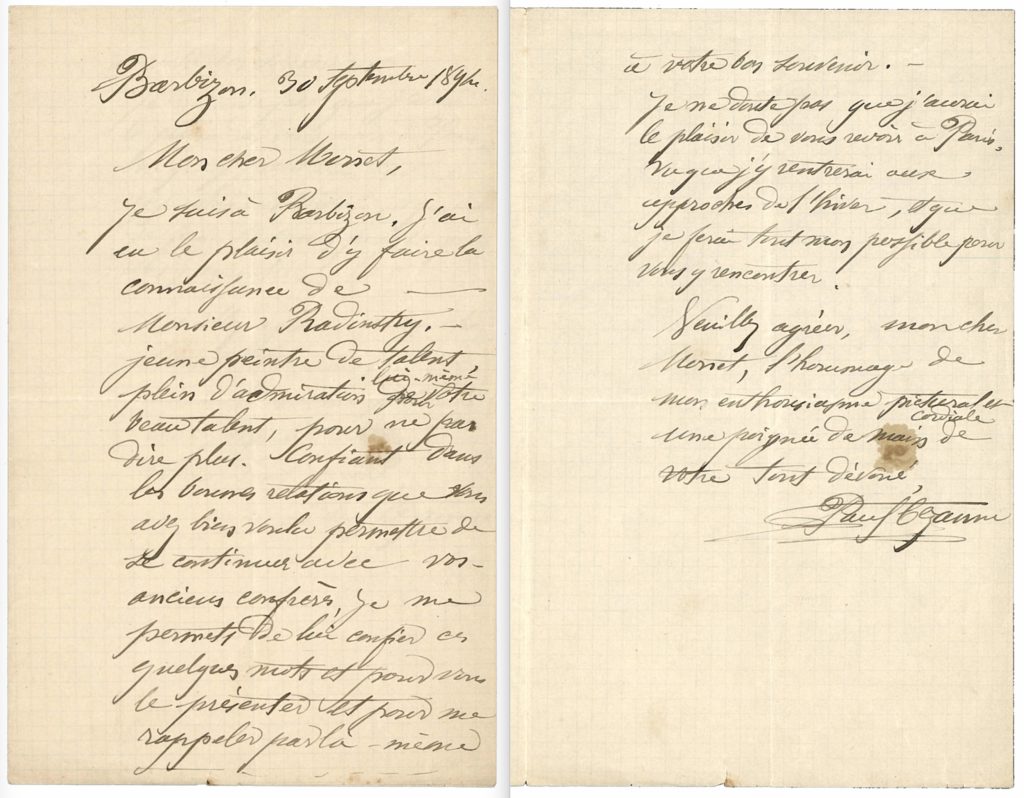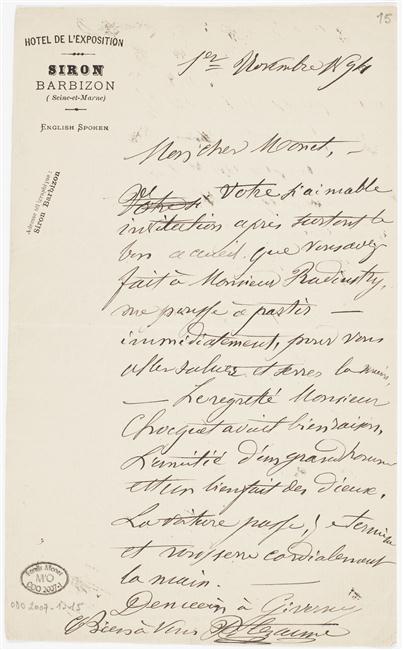Vers 1894
Gustave Geffroy demande à Monet des renseignements sur Cezanne :
« Pouvez-vous prendre le temps de m’écrire un peu longuement tout ce que vous savez et pensez de Cezanne. C’est un vrai travail que je vous demande, mais je suis bien embarrassé pour une notice urgente. Et si vous pouviez me dire où voir des Cezanne ? »
Lettre de Gustave Geffroy à Claude Monet ; vente Archives de Claude Monet, collection Cornebois, Paris, Artcurial, 11 décembre 2006, n° 112.
Janvier
Fondation de la Société des amis des arts d’Aix, 2 bis, avenue Victor-Hugo.
« Nouvelles locales », Le Mémorial d’Aix, journal politique, 57e année, n° 8, dimanche 29 janvier 1894, p. 2 :
« Une Société des Amis des Arts, vient de se constituer pour le développement des arts dans la ville d’Aix et la protection des artistes aixois.
Ont été nommés président, M. Louis Gautier [Aix, 10 octobre 1855 – Aix, 20 décembre 1947] ; vices-présidents, MM. de Montigny et Payan ; secrétaires, MM. Ducros [Édouard Ducros, Aix, 30 a oût 1856 – Aix, 27 octobre 1936] et de La Calade ; trésorier, M. Tardif ; membres de la commission, MM. Pontier, Heirieis, Maisonneuve, de Courtois et Brun. »
« Nouvelles locales. Une société artistique », Le National, journal républicain d’Aix, 24e année, n° 1183, dimanche 4 février 1894, p. 2-3 :
« Une société artistique
a été formée à Aix sous la présidence de M. Gautier, peintre.
Cette société, destinée à propager le goût des arts, a droit à tous nos encouragements. »
5 février
Gauguin écrit à sa femme.
« Vois donc s’il est possible de changer le Cezanne avec des toits rouges [FWN149-R437] pour une de mes toiles. Tu m’as dit dans le temps que Brandès te les avait achetées avec les conditions de les recéder au prix d’achat. Dans ce cas j’aimerai mieux les racheter avec l’intérêt de l’argent. J’aimerai énormément avoir ce tableau. Dans ce cas tu me l’enverrais ainsi que la paire d’épées dont je peux avoir besoin un jour ou l’autre.
J’attends une réponse sur toutes ces questions. »Lettre de Gauguin, Paris, à sa femme, sans date [5 février 1894] ; Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis, recueillies et préfacées par Maurice Malingue, Paris, éditions Bernard Grasset, 1946, 348 pages, lettre n° CXLVIII p. 255.
6 février
Le père Tanguy (Plédran, 28 juin 1825 – Paris, 6 février 1894) meurt d’un cancer de l’estomac, à soixante- huit ans.
Acte de décès n° 187, de Julien François Tanguy ; Archives de Paris, Paris 9e. Mirbeau Octave, « Le père Tanguy », L’Écho de Paris, 11e année, n° 3550, 13 février 1894, p. 1 :
« L’an mil huit cent quatre vingt quatorze, le six février, à une heure du soir, acte de décès de : Julien Tanguy, agé de soixante huit ans, fabricant de couleurs, né à Plédran (Côtes du Nord), décédé en son domicile, rue Clauzel 9, ce matin, à sept heures, fils de Louis Tanguy et de Jeanne Goulvestre, époux décédés. Époux de Renée Julienne Briend, âgée de soixante treize ans, sans profession. Dressé par nous, Louis François Henri Chain, adjoint au maire, officier de l’état civil du neuvième arrondissement de Paris, officier d’académie, sur la déclaration de Onésime Chenu, agé de quarante ans, sellier, rue Norvins, 9, gendre du défunt, et de Émile Degaut, agé de trente deux ans, fabricant de semelles, rue Clauzel, 9, qui ont signé avec nous, après lecture.
[signatures] Chenu Degaut Chain »
« Échos. À travers Paris », Le Figaro, 40e année, 3e série, n° 39, jeudi 8 février 1894, p. 1 :
« On vient de porter en terre un véritable type de Balzac. Ils sont devenus trop rares pour qu’on ne les signale pas au départ.
C’était le père Tanguy, un marchand de tableaux qui a joué un rôle des plus curieux aux temps héroïques de l’impressionnisme. Mais un marchand de tableaux comme on n’en verra plus de longtemps : en tablier bleu et gilet de tricot, et, dans toute saison, chaussé de gros sabots.
De temps immémorial, le père Tanguy occupait rue Clauzel une boutique de très humble apparence. Là pourtant dé- filèrent des artistes aujourd’hui célèbres, Claude Monet, Pissarro, Cezanne.
Le marchand leur donnait des couleurs, des toiles neuves, en échange d’études, de pochades aujourd’hui classées dans des collections connues.
Pourtant, le père Tanguy n’avait pas fait fortune : il avait une qualité… déplorable, pour un marchand, la foi.
La protection qu’il avait accordée aux maîtres d’aujourd’hui, il la continuait aux jeunes, à d’obscurs débutants. Non sans finesse sous son apparence paysanne, il avait toutefois une esthétique particulière. De celui-ci il disait :
— C’est un jeune homme instruit, qui a fait toutes ses classes. Il ira loin…
De cet autre :
— Un bon petit garçon, qui ne va jamais au café ; un avenir.
Et ce qu’il y a de curieux, c’est que certains de ces jugements se sont réalisés ou sont en train. D’ailleurs, le père Tanguy était extrêmement rigoureux dans ses préférences ; il allait surtout aux choses tranchées, violentes et caractérisées. »
Émile Bernard mentionne une unique rencontre entre Cezanne et van Gogh, qui aurait eu lieu chez Tanguy :
« JULIEN TANGUY
DIT LE « PÈRE TANGUY »
Et exaltavit humiles.
(Magnificat.)
Je voudrais ressusciter une image très belle et très rare celle d’un homme simple, dénué d’intérêts, au milieu d’une corruption mercantile intense, et d’une bonté à faire couler les larmes. Je l’ai connu dans la plus grande misère, je l’ai vu rayonner de longues années dans cette misère, et j’ai su — éloigné de lui par le destin — qu’il avait terminé sa vie sans accuser le monde de ses souffrances, avec la sérénité d’un saint laïque qui n’espère pas d’autre ciel que la paix éternelle de son cœur.
Il est mort dans la petite boutique qu’il avait, rue Clauzel, parmi les toiles des artistes qu’il fut le premier à discerner d’entre la foule des peintres de son temps, laissant en tas le grain des semailles futures, sans songer un instant que c’était là un trésor qu’il ne monnayerait pas, satisfait de l’avoir amassé pour la gloire.
§
Il était né à Plédran, dans le département des Côtes-du-Nord, le vingt-huit du mois de juin 1825 et exerça jusqu’à 29 ans la profession de plâtrier, puis, étant venu se fixer à Saint- Brieuc, il y avait épousé Renée-Julienne Briend, âgée de 34 ans et née à Hillion, dans le même département ; elle était charcutière et demeurait également dans le chef-lieu des Côtes-du-Nord. Les témoins de leur mariage avaient été un capitaine au cabotage, un cordonnier et un garde-champêtre. Comme ceci le démontre, la mer et la terre avaient leurs représentants à cette union.
Il faut croire que les nouveaux époux tentèrent de rester dans leur province, car ils ne vinrent pas de suite à Paris. Que firent-ils alors ? Essayèrent-ils de s’établir dans quelque petit commerce, de continuer leurs respectives occupations ou Julien Tanguy entra-t-il de suite, en vue d’augmenter le bien-être de la maison, à la Compagnie de l’Ouest ? Sur cette période de leur vie nul document n’est entre mes mains et personne n’a pu me renseigner. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’ils vinrent à Paris en 1860, et qu’il était à ce moment employé des lignes de Bretagne ; mais soit par dégoût, soit qu’il fût déjà guidé par le sort vers son invincible destin, il quitta bientôt ce poste pour entrer comme broyeur à la maison Édouard. Cette maison fournissait des couleurs aux principaux artistes de ce temps ; elle était réputée une des meilleures de Paris et se situait rue Clauzel. Ce fut pour cette raison que Julien Tanguy se fixa aussi dans cette rue.
Pour ceux qui venaient d’une grande ville tranquille et aérée, Paris, et en particulier cette voie étroite et triste où vivent dans de noires boutiques de misérables débitants et dans des garnis des courtisanes fanées, fut comme un deuil. En outre, les journées du broyeur étaient maigres, et sans doute un enfant était déjà sur le point de naître. La nécessité et la monotonie d’une existence mesquine ne furent donc pas sans leur souffler à l’oreille la tentation de chercher un coin meilleur. Une place de concierge leur fut offerte ; ils l’acceptèrent. C’était sur la Butte Montmartre, chez des particuliers, au 10 de la rue Cortot. Du même coup ils retrouvaient l’air, l’immensité, le feuillage, car cette rue est pleine de jardins. Ils allaient revoir le soleil, sentir le vent et pouvoir se promener sans contrainte, comme dans leur village natal ou dans les faubourgs de Saint-Brieuc.
Ce fut véritablement de cet instant que data leur vie réelle, celle qui devait produire son fruit.
On s’installa, et tout de suite on se trouva fort bien ; il fut convenu que la mère garderait la maison et que le père ferait sa couleur à son propre compte, pour la vendre aux alentours de Paris.
Le nomade que reste tout Breton ne pouvait trouver qu’un soulagement là où la plupart des hommes eussent vu une corvée ; promener ainsi sa marchandise, c’était l’indépendance, c’était la liberté. Il partait de bonne heure, traversant les rues tièdes d’aurore, son baluchon à son côté, joyeux comme l’oiseau qui sort du nid, sifflant son petit air de tête. Il lui semblait commencer le grand trimard, cette tournée de France que les ouvriers faisaient tous, à pied, autrefois. Les endroits hantés par les peintres étaient siens ; on le vit à Argenteuil, à Barbizon, à Écouen, à Sarcelle. Il semait ses tubes dans les boîtes des travailleurs, et sous ses yeux ses couleurs se transformaient en les sites jusqu’où il les apportait. La magie de la peinture l’initiait à son charme. Il s’en engouait sans le savoir. Ce fut dans ses voyages qu’il rencontra Pissarro, Monet, Renoir, Cezanne, qui étaient alors des jeunes gens, non pas comme ceux d’aujourd’hui, vains d’eux-mêmes et pleins de leur génie, mais des travailleurs avides d’apprendre, toujours sur le motif, et bien vivants de leurs admirations enthousiastes pour Courbet, pour Corot, pour Millet. Ils peignaient tant que la grande boîte de Tanguy se vidait dans les leurs sans y suffire. Le besoin de voir l’art s’épandre autour de lui, de contempler ces mastics colorés, qu’il triturait la nuit, devenir de la lumière, de l’air, du soleil, le poussa peut-être à devenir leur obligeant ami. D’ailleurs il n’était pas homme d’argent (pas plus qu’eux, comme on le verra par la suite).
La liberté jette dans toutes les têtes, et surtout dans celle d’un paysan venu habiter Paris, des ferments singuliers. Julien Tanguy, dont le caractère n’était que droiture, timidité, générosité, après avoir fait sept ans de service dans la garde nationale, entra subitement, en 1871, dans les bandes de fédérés de la Commune, à trente sous par jour. Ce n’est pas qu’il n’eût de très pures intentions, mais il était entraîné ; en outre, il n’y avait pas à choisir, et les opinions du fond de son cœur étaient pour l’indépendance promise et les droits du pauvre. Ayant fait partie de la Garde Nationale de la Défense, et entrant dans les rangs des fédérés, il devenait réfractaire. Mais il n’en avait aucun souci, agissant très inconsciemment et croyant au bien public. L’aventure qui en résulta fut pourtant des plus fâcheuses. Placé chez des maîtres hostiles à ses idées il fut immédiatement perdu dans leur opinion le jour où l’on sut qu’il se mêlait parmi les révoltés, et malgré l’estime que l’on faisait de son honnêteté, on fut tenté de le renvoyer. Il fallut l’extrême piété de sa femme et la situation difficile, presque insurmontable où elle se serait trouvée avec sa fille encore toute jeune, pour exciter la pitié de ses patrons. Un jour qu’il se promenait tranquillement sous les ombrages de la rue Saint-Vincent, son fusil à la main et rêvant plutôt à la douceur de la nature qu’aux horreurs et aux imprévus de la guerre, il fut dérangé de sa rêverie par une bande de Versaillais qui tentaient « d’accaparer les positions ». Dans l’impossibilité où il était de se défendre et peut-être dans le dégoût de tirer sur son semblable, il jeta son fusil et s’enfuit dans une maison voisine. Mais il avait été vu et on le prit avec quelques autres. Conduit à Versailles, puis déporté, il connut les pontons, la promiscuité, le manque d’air et de nourriture, il vit près de lui la maladie, la mort même.
Cependant il avait à Paris un ami, M. Jobé-Duval, qui parvint, en 1873, à le faire gracier, après deux ans de souffrances imméritées et sans nombre. Quand il sortit du ponton de Brest, des ordres sévères, des mesures de prudence presque tyranniques ne lui permirent pas de revoir de suite Paris, où sa femme et sa fille étaient restées. Il dut encore séjourner l’espace de deux années, par ordre du gouvernement, dans une ville de province. Il se réfugia alors à Saint-Brieuc, près de son frère.
À la suite de ces graves événements, ses maîtres, qui avaient toujours gardé à leur service sa femme chargée de son enfant, ne voulurent plus le reprendre. Ce fut pour lui un grand chagrin ; il lui en coûtait d’abandonner sa chère Butte Montmartre, ses jardins, ses vieux murs qui lui étaient devenus comme des amis et qu’il avait revus souvent en pensée là-bas, en exil. Il loua, rue Cortot, 12, une maisonnette située au fond d’un parc, qui vient d’être abattue récemment, et qui donnait sur la rue Saint-Vincent. Ses broyages recommencèrent, il reprit ses tournées ; mais tout avait changé : les paysages dévastés par l’invasion allemande n’attiraient plus les peintres. Certains, comme Cezanne, s’étaient enfuis ; d’autres avaient abandonné l’art, d’autres enfin avaient péri dans les rangs militaires. Il fallait donc chercher à nouveau une clientèle, et, pour cela, quitter décidément la Butte pour redescendre vers Paris. Justement la Maison Édouard abandonnait la rue Clauzel. Tanguy jugea bon de s’installer dans cette rue.
Vignon et Cezanne étaient les plus assidus, mais ils avaient tous deux le malheur de n’être point riches et, en outre, fallait faire des crédits illimités, gênants même ; les années s’écoulèrent. Guillaumin Pissarro, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Oller, Mesureur, Anquetin, Signac, De Lautrec et bien d’autres encore franchirent tour à tour le seuil de la petite boutique noire du numéro quatorze et y arborèrent leur œuvre simultanément.
Les mauvais traitements subis sur les pontons avaient achevé ce que l’instinct naturel et la raison éparse de la ville semaient dans l’esprit bon et rude de Julien Tanguy ; il était devenu une sorte de sage très révolté dans sa sagesse et très pondéré dans sa révolte ; la rencontre d’un art correspondant à ses éveils n’était pas de nature à le terrifier ; il s’associa à lui par affinité. D’ailleurs il aimait à causer de peinture, il détestait « les jus de chique », et il s’attendrissait à la fraîcheur et à la lumière des paysages nouveaux, unique joie de sa sombre échoppe ; puis il était le seul à Paris à posséder des toiles de Cezanne. Ce monopole lui valut presque une gloire dans la jeune école. On allait chez lui comme au musée pour voir les quelques études de l’artiste inconnu qui vivait à Aix, mécontent de son œuvre et du monde, et qui détruisait lui-même ces recherches, objet de l’admiration. Les magnifiques qualités de ce peintre véritable accentuaient encore leur originalité du caractère légendaire de leur auteur. Les membres de l’Institut, les critiques influents et les critiques réformateurs visitaient le modeste magasin de la rue Clauzel, devenu, à son insu, la fable de Paris et la conversation des ateliers. C’est que rien ne déconcertait comme ces toiles où les dons les plus éminents s’engloutissaient dans les naïvetés les plus enfantines ; les jeunes gens y sentaient le génie, les vieillards la folie du paradoxe ; les jaloux criaient à l’impuissance. Ainsi les opinions se partageaient et l’on allait de la discussion profonde à la raillerie amère, des injures aux hyperboles : Gauguin devant leur aspect de croûte lançait cette phrase : « Rien ne ressemble à une croûte comme un chef-d’œuvre. » Élémir Bourges s’écriait : « C’est de la peinture de vidangeur. » Alfred Stevens ne pouvait s’arrêter de rire, Vincent Van Gogh ne comprenait rien, Anquetin admirait, Jacques Blanche achetait.
§
Désormais la grande période de la vie de Julien Tanguy est commencée ; on brûle dans sa petite boutique les idoles de l’École des Beaux-Arts et des succès salonniers. Une secte péripatéticienne naît dans la peinture, et son Lycée est la rue Clauzel sans cesse retentissante de discussions ; ses membres arrivent par groupes, gesticulants ; on va voir ce musée « des horreurs » pour les uns, « de l’avenir » pour les autres. Dès la porte on était salué par le bon sourire socratique du prêtre du lieu, tandis que, muette et branlant sa tête incrédule d’oiseau déplumé, la mère Tanguy, qui songeait amèrement qu’il n’y avait rien pour la table et que l’on devait trois termes, semblait mépriser du haut de sa philosophie pratique tout ce monde « d’écervelés et de beaux parleurs ». Sur la demande des visiteurs, qui avaient d’abord parcouru du regard les nombreuses et incendiaires toiles tapissant les parois de l’endroit, le père Tanguy allait chercher les Cézannes. On le voyait disparaître dans une pièce obscure, derrière un galandage, pour revenir un instant après porteur d’un paquet de dimension restreinte et soigneusement ficelé ; sur ses lèvres épaisses flottait un mystérieux sourire, au fond de ses yeux brillait une émotion humide. Il ôtait fébrilement les ligatures, après avoir disposé le dos d’une chaise en chevalet, puis exhibait les œuvres, les unes après les autres, dans un religieux silence. Les visiteurs s’attardaient en remarques, découpaient du doigt des morceaux, s’extasiaient sur le ton, sur la matière, sur le style ; puis quand ils avaient fini, Tanguy reprenait la conversation et parlait de l’auteur.
« Le papa Cezanne, disait-il, n’est jamais content de ce qu’il fait, il lâche toujours avant que d’avoir terminé. Quand il déménage, il a soin d’oublier ses toiles dans la maison qu’il quitte ; quand il peint dehors, il les abandonne dans la campagne. » Puis il ajoutait : « Cezanne travaille très lentement, la moindre chose lui coûte beaucoup d’efforts, il n’y a pas de hasard dans ce qu’il fait. » Naturellement la curiosité des visiteurs le pressait de question. Alors Tanguy, prenant un air recueilli, disait : « Cezanne va au Louvre tous les matins. » Cela semblait paradoxal, mais c’était absolument vrai.
Outre les toiles de Cezanne, Tanguy en avait beaucoup de Vincent van Gogh. Ce dernier, dont il venait de faire la connaissance (1886), était l’hôte le plus assidu de sa boutique ; il y vivait presque. D’abord il avait vidé les casiers à couleurs de leurs tubes ; car il avait une méthode de travail fort dispendieuse, peignant avec le tube même, qu’il pressait à mesure qu’il se vidait, au lieu de se servir de brosses ; puis il s’était pris d’amitié pour ce brave homme du peuple qui se prêtait de si bonne foi à toutes les innovations, et qui avait le cœur, comme on le dit vulgairement mais si justement, sur la main. Aussi en peu de temps devinrent-ils de grands amis. Van Gogh, qui en tout était un apôtre (car il l’avait été d’abord du protestantisme), l’entraîna dans son propre mouvement, et lui définit nombre d’idées qui n’étaient dans son esprit qu’à l’état de confusion ou d’instinct ; puis il y avait le socialisme… Julien Tanguy, qui lisait assidûment le Cri du Peuple et l’Intransigeant, ayant pour doctrine l’unique amour des pauvres, concentrait son idéal sur un avenir de bonté et d’amour qui pencherait tous les êtres les uns vers les autres et détruirait les luttes individuelles de l’ambition, toujours si amères et si sanglantes. Vincent ne différait de cet idéal que par sa nature d’artiste, qui voulait faire de cette harmonie sociale une sorte de religion et d’esthétique. On trouvera dans ses lettres, publiées autrefois dans le Mercure, un grand nombre d’éclaircissements à ce sujet. Julien Tanguy fut séduit, j’en suis certain, beaucoup plus par le socialisme de Vincent que par sa peinture, qu’il vénérait cependant comme une sorte de manifestation sensible des espérances conçues. En attendant cette ère de félicité, tous deux étaient très pauvres, et tous deux donnaient ce qu’ils avaient, le peintre ses toiles, le marchand ses couleurs, son argent et sa table ; tantôt à des amis, tantôt à des ouvriers ; tantôt à des filles publiques, lesquelles, quant aux tableaux, allaient les vendre pour rien à des brocanteurs. Et tout cela était fait sans nul intérêt, pour des gens qu’ils ne connaissaient même pas. Ce fut vers cette époque que Vincent fréquenta une taverne qui avait nom « le Tambourin » et que tenait une fort belle Italienne, ancien modèle, étalant dans un comptoir bien à elle ses charmes sains et imposants. Il conduisait Tanguy dans cet établissement, ce qui donnait beaucoup d’inquiétudes à la brave mère Tanguy, qui ne pouvait s’imaginer les raisons innocentes et même enfantines de ses… escapades. Vincent, selon un contrat de quelques toiles par semaine, mangeait au « Tambourin » ; il avait fini par couvrir les grands murs du lieu de ses études. C’étaient, pour la plupart, des fleurs, dont il y avait d’excellentes. Cela dura quelques mois, puis l’établissement périclita, fut vendu, et toutes ces peintures, mises en tas, furent adjugées pour une somme dérisoire. Ce qu’il y a de certain, c’est que jamais personne ne connut comme Vincent la réprobation et la gêne, si ce n’est Tanguy ; mais chez ce dernier il n’y avait pas de sa faute, alors que Vincent, quoique soutenu par son frère, se dénuait volontairement.
Aussi lorsque les toiles s’accumulaient trop (et elles s’accumulaient rapidement, puisque Van Gogh en faisait jusqu’à trois par jour), fallait-il aller les vendre. Le peintre, les prenant sous son bras, les portait au premier brocanteur à des prix qui ne payaient même pas les matériaux employés. Un après-midi que Cezanne était venu chez Tanguy, Vincent, qui y était à déjeuner, le rencontra. Ils conversèrent ensemble et après avoir parlé de l’art en général, ils en arrivèrent à leurs idées particulières. Ce dernier ne crut pouvoir mieux expliquer les siennes qu’en montrant ses toiles à Cezanne et en lui demandant son avis. Il en fit voir de plusieurs sortes, des portraits, des natures mortes, des paysages. Cezanne, dont le caractère était timide, mais violent, après une inspection du tout, lui dit « Sincèrement, vous faites une peinture de fou ! »
C’étaient, au demeurant, deux natures absolument contraires, et en ce cas l’homme du Nord, le Hollandais, était aussi enthousiaste et ardent que l’homme du Midi, le provençal, était calme et pondéré. Dès lors, ils sentirent qu’ils ne s’entendraient jamais et ils ne se revirent point. Il faut que je dise ici que Vincent ne comprenait aucunement la manière de Cezanne et qu’il ne pouvait admettre qu’on la pût admirer ; il avait beau regarder ses toiles, il ne trouvait rien de ce qu’il voulait dans leurs tâtonnements.
C’est qu’à la vérité Cezanne était un technicien, épris seulement des qualités abstraites de la peinture, à la poursuite du mécanisme harmonieux de la couleur, et un styliste qui n’ambitionnait que certaines formules élégantes ; alors que Vincent l’envisageait comme un moyen d’expression spirituelle, comme une sorte de littérature écrivant par les couleurs et les lignes. Je ne crois pas utile d’ouvrir ici une longue parenthèse pour prouver qu’ils avaient tort tous deux, et que, pour être un maître, un artiste complet, il suffit de réunir ces deux choses qu’ils cherchaient à part.
La vie de Tanguy se serait écoulée fort paisiblement au milieu des visites de peintres, de critiques et d’amateurs, s’il avait vendu de temps à autre quelques-unes de ces œuvres qui excitaient la curiosité ; mais les admirateurs les plus passionnés étaient souvent les plus pauvres ; dès lors la misère continuait. La plupart des jeunes peintres qui se fournissaient chez lui le faisaient à crédit, et il fallait attendre la vente de quelqu’une de leurs études pour rentrer dans des avances illimitées. La clientèle payante était rare ; elle se composait pour la plupart d’amateurs fortunés qui jouaient à la peinture, utilisant leurs loisirs à la campagne ; aussi les termes dus s’accumulaient- ils, et les inquiétudes noircissaient-elles l’horizon ! En ces instants de crise, Tanguy, vieillissant et affecté d’une hernie, se mettait en campagne, quelques Cézannes sous le bras, et faisait à pied une vaste tournée chez ses amateurs, lesquels pour peu de chose achetaient ce que tant de jeunes gens auraient tout donné pour avoir, mais ceux-ci n’avaient que des dettes. Lassé, malade d’avoir trop marché, le brave homme revenait dans sa petite boutique et remettait à sa femme le maigre gain de la journée. Il avait vendu pour deux cents francs une œuvre qui se paie aujourd’hui près de vingt mille.
Mais il faut que je parle de la plus grande bonté de Tanguy, de celle qui était sa marque distinctive, et qui ne connaissait pas de bornes ; celle-ci, rien ne pouvait l’arrêter, ni la raison, ni la misère, et elle lui faisait trouver le moyen d’aider ceux qui manquaient de l’essentiel. Sa table était toujours ouverte à quiconque le venait voir, et il se serait cru humilié si on avait négligé de la partager ; s’il voyait un artiste qui, par timidité ou délicatesse, se gênait pour lui demander de la couleur, il lui ouvrait ses tiroirs et le priait de prendre tout ce qui lui plairait. J’en connais plus d’un à qui il fit même l’offre de ce qu’il avait dans sa poche. Un de mes amis, qui s’adonnait à la peinture malgré sa famille et qui était obligé de venir à pied à Paris, m’a raconté qu’il ne manquait jamais de le reconduire à la gare et de le remettre dans le train afin qu’il ne se fatiguât pas à retourner comme il était venu. Tanguy songeait si peu à lui-même qu’il donnait ainsi les quelques sous qu’il avait pour son propre usage. J’ai su de ses enfants qu’une fois, alors qu’il n’avait rien mangé de la veille et que son propriétaire le poursuivait par huissier, qu’il disait à un riche amateur acquéreur de quelques tubes qu’il voulait lui payer de suite : « Cela ne fait rien, ne vous dérangez pas, ce sera pour une autre fois. » Sa dignité n’acceptait pas un instant qu’on le supposât privé, et il se gardait bien d’en rien dire.
Ceux qui allaient chez lui n’en auraient, certes, jamais eu l’idée, si sa femme, qui avait la responsabilité de la table et de la maison, n’eût laissé couler devant eux quelques larmes et accusé le complet dénûment où ils se trouvaient. Ainsi disait-elle : « il ne se doute pas, voyez-vous, Monsieur, que demain nous allons être saisis ; il l’a oublié. Ah ! c’est une pauvre tête, allez, Monsieur, que le père Tanguy ! » Elle ne comprenait que les choses de l’instant et tout ce grand rêve de son mari lui importait peu.
Elle savait qu’il n’y a que deux choses certaines pour les pauvres gens : c’est qu’il faut payer sa nourriture et satisfaire à temps son propriétaire. Cependant, sitôt que Tanguy rentrait, elle se taisait, de crainte de lui faire de la peine, et de crainte aussi peut-être de le tirer de ces utopies qui lui ôtaient la vision malheureuse du présent et par anticipation lui procuraient la jouissance idéale des choses qui n’auront jamais lieu. Il y avait dans la boutique de Tanguy à cette époque (nous sommes toujours entre 1886 et 1888) une grande toile fort encombrante de Cezanne, qui représentait un de ses amis Achille Empéreire. Cette toile avait été envoyée au Salon, puis refusée. Cezanne, désireux de ne plus la revoir, l’avait abandonnée. Ce ne fut qu’après dix années que Tanguy put obtenir de lui la permission de la retirer du Garde- Meuble où elle avait été déposée d’urgence, m’avait logée dans sa demeure exiguë pour la soustraire à la curiosité ; mais il ne la cacha pas si étroitement qu’un de mes amis ne la pût découvrir et ne la tirât au jour. C’était là une manière de Cezanne absolument inconnue, qui ne ressemblait en rien aux petits tableaux que Tanguy montrait généralement ; c’était le Cezanne d’autrefois, procédant, largement et en pleine pâte, avec des épaisseurs semblables à du bas-relief et un clair-obscur violent à l’instar des Espagnols. L’outrance des formes, leur grossissement faisaient penser à Daumier, sans toutefois que l’on pût en rien inférer d’une influence.
Tanguy, dans un moment de détresse, fut obligé de se défaire de cette œuvre importante dont j’ai plus longuement parlé dans mes « Souvenirs sur Paul Cezanne ».
Mais des changements eurent lieu. Julien Tanguy quitta sa boutique du 14 pour traverser la rue et s’établir en face, un peu plus grandement et un peu plus clairement. Un des jeunes peintres qui fréquentaient chez lui jugea bon de la distinguer de ses voisines en la peignant lui-même en bleu d’outremer et en écrivant en jaune sur les vitres de la porte :
TANGUY
À vrai dire ce domicile ne valait guère mieux que le précédent, à part le magasin, qui était d’un meilleur éclairage ; l’obscurité régnait, comme dans l’autre, dans toute l’arrière-boutique où il y avait encore moins de place pour se loger. La chambre de Tanguy était en même temps son atelier ; son lit était auprès de sa pierre à broyer et de ses molettes ; les flacons contenant les poudres juchaient sur une planche, au-dessus, ainsi que les toiles blanches et celles peintes par Cezanne. Ce long boyau formait un corridor, que rétrécissait le lit et qu’éclairait d’un jour triste de cave une fenêtre percée sur la cour. D’autres inconvénients concouraient à rendre le lieu incommode et étroit ; on avait dû couper la boutique en deux par une cloison, afin de se ménager un emplacement où l’on pût manger, et cette cloison, munie de vitres, ne pouvait laisser passer la lumière, tant elle était couverte de toiles. C’était dans ce logis que Tanguy devait finir son existence incertaine.
Vincent était parti pour Arles, et Tanguy se trouvait seul, visité seulement de temps à autre par les mêmes clients. La belle Italienne du « Tambourin » tomba dans une grande gêne, alors on la recueillit, ce qui donna lieu à bien des médisances, quoiqu’il n’y eût là qu’un mouvement très généreux. Souvent à l’heure du repas un inconnu, pauvre diable en haillons, mendiant ou inventeur malheureux, surgissait de l’arrière-boutique ; et sa mine farouche ne semblait pas du tout dans sa patrie parmi ces toiles singulières qu’il regardait avec méfiance. Parfois c’était un pauvre qui avait entr’ouvert la porte pour demander la charité ou un voisin pris au dépourvu. L’inquiétude de Tanguy pour ces infortunés devenait un véritable cauchemar, il en parlait les larmes aux yeux et ne savait que machiner pour les mettre de suite à l’abri des nécessités ; ce qu’il y avait de plus étrange, c’est que jamais il ne songeait à sa propre misère. Il vivait pour ainsi dire heureux dans sa générosité ; il était comme transfiguré par ses élans cordiaux et fraternels ; son visage s’éclairait d’une bonté presque surnaturelle, qui donnait de la beauté à sa grosse figure de philosophe plébéien.
Certes il fut trompé plus d’une fois ; beaucoup de gens auxquels il donna sa confiance ne le payèrent jamais de retour. Pour certains esprits ces bontés-là ne sont que des faiblesses et ces générosités des naïvetés à exploiter. Tanguy supporta stoïquement les méfaits de cette race malhonnête et méchante, il ne s’en plaignit pas, jamais même il n’accusa qui que ce fût d’ingratitude ; il abondait au contraire en excuses toutes faites. Je ne lui ai jamais entendu dire de mal de personne.
Les années s’écoulaient monotones, n’amenant pas un grand changement dans la vie de Julien Tanguy, qui vieillissait, cela était certain, c’était même ce qu’il y avait de plus certain. Par moment on savait par les journaux que les impressionnistes, ceux que l’on avait connus autrefois, et que l’on ne voyait plus guère depuis que Durand Ruel les menait à la gloire, montaient. Monet atteignait à la réputation, Renoir le suivait, puis c’étaient Sisley, Pissarro, Berthe Morizot, etc. Que de satisfactions, qui donnaient des raisons de croire ! Seul Cezanne restait obstinément dans l’ombre, mécontent de son œuvre, oublié par ses anciens amis, négligé des marchands. Quant à Vincent, on ne cessait de travailler pour lui dans la petite boutique de la rue Clauzel. Les commandes arrivaient très pressées : il fallait de suite de la toile, des mètres de toile, des tubes en quantité. Séduit par le midi, il travaillait furieusement « en plein mistral », comme il l’écrivait lui-même. Son frère Théodore accourait à tout instant chercher les choses demandées, les expédiait, ou apportait de fabuleux rouleaux nouvellement reçus qu’il fallait étendre sans retard sur châssis. Ah c’était une rude pratique que Van Gogh ! D’ailleurs il n’était pas exigeant, il voulait que la couleur fût à peine broyée — presque en grains, — que la préparation des toiles fût légère et leur qualité plutôt grossière. On se réjouissait de tant de fertilité et de tant d’envois qui apportaient jusqu’au fond d’une obscure boutique de Paris le soleil méridional, lorsque, subitement, on apprit que Vincent était devenu fou. Il avait eu un accès violent dans lequel il s’était coupé l’oreille et avait failli mourir d’hémorragie. Tout ce drame avait ramené à Paris Paul Gauguin qui vivait alors en communauté avec Van Gogh à Arles. Tanguy fut fort affecté de cette nouvelle, car il portait une sincère amitié à Vincent. On sut peu à peu qu’il se remettait, et que, malgré son internat à Saint-Rémy, dans une maison de santé, il demandait des couleurs et des toiles.
On fit de nouveaux envois, et le dortoir où on le tenait encore et les portraits de ses compagnons et, plus tard, le jardin où on le laissa se promener renseignèrent sur sa nouvelle existence. Enfin il revint ; mais un nuage sinistre planait sur son front. Il s’installa aux environs de Paris, à Auvers. Après quelques mois de séjour, par une belle après-midi d’été, il alla se tuer derrière le château du pays. Mort mystérieuse qui mit en deuil tous les amis connus et inconnus de Vincent et qui restera toujours dans leur esprit comme une surprise des plus douloureuses.
Tanguy courut à Auvers veiller Vincent avec son frère Théodore et le docteur Gachet (un ami du peintre), qui habitait le village et qui avait été requis après l’accident ; mais la mort, inévitable, n’était qu’une question d’heures. Le coup de révolver que Van Gogh s’était tiré n’avait pas pris la direction du cœur, mais avait tourné sur une côte pour aller perdre sa balle dans le ventre, en un endroit où toute extraction était impossible. Tanguy pleura. Ceux qui arrivèrent les premiers pour l’enterrement trouvèrent l’humble marchand et un ami fidèle du mort entourant sa bière des toiles récemment peintes. Le deuil s’installa rue Clauzel. Théodore Van Gogh fut à son tour frappé, et on dut bientôt l’emmener en Hollande. Les visites des deux frères manquaient et l’on tombait à cette monotonie du silence qui semble sortir des tombeaux. Enfin, on apprit la mort de Théodore et le départ de sa femme pour la Hollande. Désormais la solitude s’agrandissait, faisant sentir aux Tanguy les amertumes de la vieillesse et de l’abandon. Malgré le succès des artistes connus autrefois, la gêne s’acharnait sur ces deux époux qui étaient devenus deux bons vieux. Octave Mirbeau, qui fit paraître au Journal, en février 1894, un émouvant article sur « le père Tanguy », lors de son décès, disait : « Les plus fortes joies de son existence furent le succès de ses peintres familiers ; à mesure que chacun d’eux s’élevait, on eût dit que c’était sa fortune à lui qui se bâtissait. Et pourtant il savait bien que les grands marchands avec lesquels il ne pouvait lutter allaient accaparer leurs œuvres qui peu à peu disparaîtraient de son humble devanture. Mais le père Tanguy ne connut jamais l’égoïsme, jamais l’idée d’un lucre quelconque ne souilla la fidélité de son enthousiasme et la bonté de son cœur en qui le dévouement devenait inaltérable ! » Voilà qui est bien dit, je ne regrette que la première phrase, qui effleure Tanguy d’un soupçon que celui qui l’a bien connu ne pourra jamais accepter. Ce que Tanguy aimait dans les artistes et dans leurs succès, ce n’était pas la gloire, la gloriole comme il disait, mais eux-mêmes et l’affection qu’il leur avait consacrée. Au demeurant, il estimait bien plus en eux les qualités du caractère que le talent ; mais comme, par une coïncidence naturelle, la plupart des hommes supérieurs dans l’art ou quelque autre branche des connaissances humaines se recommandent par la droiture de leurs sentiments et la générosité de leurs manières, il se produisit, ainsi, qu’en s’entourant de ceux vers lesquels se portait naturellement sa sympathie Tanguy se trouva être le point central d’un noyau de gens de valeur. J’emprunte à Octave Mirbeau, qui fut l’historien des derniers instants de Tanguy, sa fin stoïque et brave :
« Depuis quelque temps, il souffrait d’un cancer à l’estomac. Il fut obligé de s’aliter. La douleur, parfois, lui arrachait des cris : il ne pouvait dormir. Sa pauvre femme s’évertuait à le soulager, passait ses nuits à le consoler, à inventer mille remèdes pour calmer son mal…
« — Ma femme, dit-il un jour… ça ne peut pas durer comme ça !… Tu te fatigues trop… Il vaudrait mieux que j’aille à l’hôpital.
« — T’en aller d’ici !… Jamais !… Je ne veux pas !… Je veux te soigner.
« — Non, non, tu te fatigues trop… Et je vois bien que tu tomberas malade à ton tour.
« Il insista tellement qu’on fut bien forcé de le conduire à l’hôpital.
« Mais le pauvre père Tanguy s’y trouva bien vite dépaysé, sans une affection près de lui. Les médecins passaient devant son lit, indifférents, ils savaient que son mal était incurable et qu’il n’y avait pas lieu de faire, pour lui, des expériences amusantes. Et il pleurait, de se voir dans ces grandes salles tristes.
« Un jour il dit : « Je m’ennuie trop… ici… Je ne veux pas mourir ici… Je veux mourir chez moi, près de ma femme, au milieu de mes toiles… »
« On le ramena, sur un brancard, dans sa petite maison, et il expira près de ses molettes et de sa pierre à broyer. Le lendemain on apprenait par les journaux qu’un marchand de couleurs demeurant rue Clauzel et connu familièrement sous le nom de « père Tanguy » était mort.
« L’histoire de son humble et honnête vie est inséparable de l’histoire du groupe impressionniste, disait Octave Mirbeau (1), et lorsque cette histoire se fera le père Tanguy aura sa place. »
(1) Ce fut aussi Octave Mirbeau qui eut la généreuse idée de venir en aide à la veuve en organisant une vente à l’Hôtel Drouot. Cette vente rapporta quinze mille francs, qui furent, tous frais enlevés. réduits à dix mille, et avec lesquels vécut la mère Tanguy. Elle se retira, seule dans une petite chambre, au dix, rue Cortot, en cette même maison qu’elle avait habitée en arrivant à Paris. Ce fut là qu’elle mourut.
Voici les noms des quelques artistes qui répondirent par l’envoi d’une œuvre à l’initiative d’Octave Mirbeau : Cazin, Guillemet, Gyp, Lauth, Luce, Maufra, Monet, Nozal, Barillet, Peduzi, Petitjean, Pissarro (Félix, Lucien et Georges), Rochegrosse, Signac, Sisley, Vauthier, Carrier-Belleuse, Dagnaux, Léandre, Berthe Morisot, Renoir, Benner, Bergerat, Béthune, Dauphine (Jane et Madeleine), de Lambert, Jongkind (offert par M. Portier), Prouvé, Raffaelli, Schuller, Angrand, Detaille. Filiger, Grevidois, Moutte, Puvis de Chavannes, Roll, Mary Cassatt, Duez, Helleu, Jeanniot, Séguin, Rodin. Comme on le voit, sans aucune distinction d’école, un général hommage de sympathie fut décerné à Julien Tanguy. (J’omets les détails de l’enterrement, où se coudoyèrent des gens du monde, des arts et de la littérature.)
La vente eut le tort de comprendre, outre les dons, les œuvres d’artistes trop jeunes ou encore inconnus, qui étaient restées dans la boutique de la rue Clauzel ; elles ne furent pas vendues mais données ; un Dubois-Pillet fit 14 francs, un d’Espagnat 12 fr., un Seurat 50 fr., un Vignon 22 fr., un Vincent 30 fr. Les œuvres de Cezanne furent dans le même cas. Voici les prix :
Les Dunes 95 fr., Cour de village 215 fr., Pont 170 fr., Ferme 45 fr., Village 103 fr., Village 175 fr. Il y avait six toiles de Gauguin dont aucune ne dépassa 100 fr. Quatre de Guillaumin qui flottèrent entre 80 et 160. Seul Monet (3.000 fr.), et Cazin (2.900 fr.) se vendirent honorablement. Deux Sisley firent 370 fr. les deux.
Quelque temps après, à la vente Blot, les Cézannes atteignaient 6.000 fr., et les Sisley ;4.000. On sait à quel taux montèrent depuis beaucoup d’autres toiles. Tels sont les jeux de la banque picturale et de la réputation !
Je ne crois pas que ce soit dans le groupe impressionniste qu’il doive figurer, mais dans celui du symbolisme. On a dit de cette catégorie de peintres qu’elle avait formé l’École de Pont- Aven, c’est possible, puisque le hasard les a souvent réunis sur ce point de la France ; mais par les leçons qu’ils y prirent, la petite boutique de la rue Clauzel me semble le vrai lieu de leur naissance. La preuve la plus évidente est celle-ci : tous se réclament de Cezanne (Gauguin lui-même n’en fut-il pas l’élève ?) et Cezanne n’était alors visible que là.
C’est Tanguy qui a eu l’honneur de produire au jour et de faire connaître Cezanne, car de tous les impressionnistes il était le plus oublié et le plus désireux de l’être. Contre les couleurs qu’il lui fournissait, Tanguy se payait en natures-mortes et en paysages. Combien n’a-t-il pas sauvé de toiles ainsi qui eussent péri dans les colères de l’artiste contre lui-même ! Si l’on doit regretter quelque chose, c’est qu’il ait apporté trop de discrétion à en prendre autant qu’il eût fallu pour garantir leur destruction. Ainsi c’est dans l’école dite de Pont-Aven que je veux faire figurer Tanguy, parce que cette école se doit toute à la contemplation des toiles de Cezanne, et-que de Gauguin à Sérusier il n’y a pas un seul symboliste qui n’ait fait son pèlerinage rue Clauzel. On vit à cette devanture pendant assez longtemps le dessin d’un danois (Willumsen) représentant une femme enceinte avec je ne sais quelle inscription dessous qui signifiait que bientôt naîtrait de ce ventre enflé un enfant dont beaucoup seraient surpris. Il me semble que cette femme n’est autre que la modeste boutique du bon et franc père Tanguy.
§
Vincent a fait un portrait de Tanguy vers 1886. Il l’a représenté assis dans une salle tapissée de crépons japonais, coiffé d’un grand chapeau de planteur et symétriquement de face comme un Bouddha. Je ne sais si je suis bien renseigné, mais cette toile, qui a figuré à une exposition récente chez Bernheim, serait la propriété de Rodin. Van Gogh y a fort bien exprimé la placidité, le stoïcisme, la sûreté cordiale que la droiture du caractère de Tanguy lui assurait ; car quoiqu’il eût gardé en apparence de la rudesse de son granit natal, il n’était que délicatesse et que douceur. Le nez, comme celui de Socrate, était très épaté. Les yeux, petits et sans malice, étaient pleins d’émotion. Le crâne avait une tendance vers en haut ; le bas du visage était court et rond. Il avait une taille moyenne et les membres forts d’un travailleur. Quand il vous parlait, il se courbait un peu sur lui-même et se frottait les mains. Sa démarche était précautionneuse et un peu craintive, comme celle d’un homme qui ne se meut que dans une région intérieure. Il réalisait l’humilité dans ce que les saints ont pu lui demander de perfectionnements pour l’homme, et quiconque lui parlait lui semblait toujours plus grand que lui-même. Celui qui l’eût rencontré aurait pensé de suite qu’il devait être un brave homme, car cela était écrit dans toute sa personne, mais les abîmes de son cœur étaient ce qu’il avait de plus inconnu et de plus profond.
Son œuvre, qui fut importante en ce qu’elle a souvent consisté à mettre avec douceur, et presque sans qu’ils s’en aperçussent, sous la main des artistes (dont il fut un peu le père), les matériaux de leur production, se résume tout entière en un mouvement de bonté infinie, et nous voyons que cette bonté trouva en elle-même sa récompense en s’ouvrant inconsciemment le chemin de la gloire.
ÉMILE BERNARD.
Octobre 1908 » »
Bernard Émile, « Julien Tanguy dit le « père Tanguy » », Mercure de France, volume LXXVI, n° 276, 16 décembre 1908, p. 600-616.
R. G. [Rémy de Gourmont], « Choses d’art », Mercure de France, tome X, n° 51, mars 1894, p. 287 :
« Au commencement de ce mois est mort un marchand de tableaux dont le nom restera lié à l’histoire de l’école impressionniste – symboliste ; on l’appelait familièrement le père Tanguy. C’est dans sa petite boutique de la rue Clauzel que se vendirent d’abord Claude Monet, Pissarro, Cezanne, van Gogh, Gauguin, Filiger, et bien d’autres, qui sont ou seront illustres. C’était un marchand intelligent, ― mais trop honnête pour faire fortune. Comme il aimait « ses peintres » ! Il pleurait en parlant de Vincent van Gogh. Le père Tanguy est regretté de tous ceux qui l’ont connu.
R. G. »
Bernard Émile, « Notes sur l’école dite de Pont-Aven », Mercure de France, tome XLVIII, n° 167, novembre 1903, p. 675-682, p. 676-678 :
« PAUL CÉZANNE
En 1887, nous perfectionnons le cloisonnisme sous l’influence de Paul Cezanne ; nous avions rencontré la vraie peinture. Anquetin remonta vers les grands maîtres. Je restai fidèle à Cezanne. […]
LA BOUTIQUE DU PÈRE TANGUY
Le lieu où nous allions voir les Cezanne était situé rue Clauzel (l’école dite de Pont-Aven serait plus justement nommée l’école de la rue Clauzel), un vieux Breton, marchand de couleurs, le tenait : il se nommait Julien Tanguy, ou, plus familièrement, le père Tanguy (sa bonté pour les jeunes était paternelle en effet). Cette modeste boutique exerça un bien grand empire sur la génération actuelle. Appelé à rendre service au bon vieillard armoricain, je l’avais peinte en bleu pour la discerner de ses voisines mercantiles. C’est dans son antre obscur que, près de vingt ans durant, incendièrent, à feu couvert, les Cezanne, et que le tout-Paris des artistes et des amateurs alla les voir. Dresser la liste de ses visiteurs serait écrire l’histoire de l’art présent. C’est là que je me liai avec Van Gogh, qui avait demandé à me connaître, et avec Maurice Denis. »
Rewald John, Cezanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 205 :
« Un critique américain, qui y accompagna quelques peintres en 1892, raconta ensuite : « Le père Tanguy est un homme d’un certain âge, petit et trapu, à la barbe grisonnante et aux grands yeux bleu foncé rayonnants. Il a une drôle de façon de regarder d’abord ses tableaux avec toute la tendresse affectueuse d’une mère, puis de vous regarder par-dessus ses lunettes comme pour vous supplier d’admirer ses enfants chéris […]. Je n’ai pu m’empêcher de penser, indépendamment de toutes mes opinions personnelles, qu’un mouvement artistique capable d’inspirer une telle vénération devait avoir une signification plus profonde que le simple engouement d’une coterie. » »
Denis Maurice, « L’époque du symbolisme », Gazette des beaux-arts, 76e année, 6e période, tome XI, mars 1934, p. 165-179, citation p. 166-168 :
« Un autre souvenir resté vivant c’est, à la veille d’une exposition des Indépendants, la calme rue Clauzel et la boutique peinte en bleu du père Tanguy. On entend des blanchisseuses qui roucoulent la Chanson des Blés d’Or :
Ah ! quand le rossignol viendra chanter encore,
et le martellement grêle des sabots des chevaux de fiacre, peu nombreux, dans le silence de ce quartier mal fréquenté. Nos toiles attendent sur le trottoir la charrette à bras qui les portera au Pavillon de la Ville de Paris, sur le Cours la Reine. Mais le vieillard que Van Gogh a peint, avec son air bon et buté, sous le chapeau de paille, montre à l’intérieur de son petit magasin les soleils de Vincent, les grandes natures mortes de Cezanne, ses paysages, son portrait d’Emperère, et la Femme du Vidangeur, aujourd’hui perdue. Il y a encore de nombreux Bernard, et Vollard y va venir acheter un de mes premiers tableaux. C’est ici le Salon Carré du maître d’Aix, le seul lieu de Paris, puisque Durand-Ruel n’en « tient pas », où l’on puisse voir ses œuvres absurdes et splendides. Absurdes encore pour nous, car elles sont trop riches pour être aisément intelligibles. Le prodigieux original travaille dans la solitude : il est en train de révolutionner l’art de son temps et l’art universel. Tanguy parlait de M. Cezanne avec mystère. Gauguin et Bernard le connaissaient. Mais il fuyait Paris. Existait-il vraiment ? N’était-ce pas un mythe ? Tanguy savait, lui, que Cezanne était le grand maître, l’homme de génie de la nouvelle peinture. Aussi attribuait-il une grosse valeur à ses toiles : il en demandait jusqu’à 300 francs ! »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 35-36 :
« Avant lui, un vieux marchand de couleurs, le père Tanguy s’était intéressé à la peinture nouvelle, au point de faire crédit aux peintres qui peignaient « clair ».
Ce brave homme arrêté, par erreur, comme insurgé au cours des dernières journées de la Commune, au risque d’être fusillé, avait fini de très bonne foi par se croire un révolutionnaire. Épargné, il ne savait pourquoi, et devenu plus tard marchand de couleurs, il protégeait les peintres novateurs dans lesquels il se plaisait à voir des révoltés comme lui. J’ajouterai qu’il faisait également crédit à ceux qui peignaient noir, à la condition toutefois qu’ils se fissent remarquer par la régularité de leur vie, comme, par exemple, ne pas aller au café et ne pas jouer aux courses. Car ce communard par persuasion était le plus bourgeois des hommes, et rien n’aurait pu lui enlever cette idée qu’avec de la conduite, un peintre devait fatalement « arriver ». Et si, à son métier, le père Tanguy ne s’enrichissait guère, du moins il s’était acquis l’estime des artistes. Émile Bernard lui révéla, Cezanne, et Van Gogh. Celui-ci fit plusieurs portraits de Tanguy, dont un, presque grandeur nature, où il est représenté assis. Cette toile est aujourd’hui au musée Rodin. Quand on la lui marchandait, le père Tanguy en demandait froidement cinq cents francs et, si on se récriait devant 1’« énormité » du prix, il ajoutait : « C’est que je ne tiens pas à vendre mon portrait. » Et, en effet, la toile demeura chez lui jusqu’à la fin de sa vie ; après sa mort, Rodin en fit l’acquisition. »
Jourdain Francis, « À propos de Vincent Van Gogh », Arts de France, revue mensuelle des arts plastiques, 1947, n° 11, p. 7-18, p. 8, 10 :
« Le père Tanguy — gros traits, gros pif, doux yeux clairs — était d’une laideur attendrissante. Il était bon. Il était pauvre : le boulanger n’est pas si sot que d’accepter, en échange de son pain doré, des croûtes signées Cezanne, Gauguin, Van Gogh. Ah ! s’il n’avait pas été si pressé d’aller manger les pissenlits par la racine, s’il avait attendu quelques années encore que fussent enfin découverts « ces messieurs » — comme il disait avec une vénération bien trop affectueuse pour qu’on y puisse déceler la moindre trace de servilité — Tanguy eût fini dans la peau d’un millionnaire. Encore n’est-ce pas bien sûr. […]
J’ai été parmi les plus assidus des habitués de la rue Clauzel et assurément — avec Fargue — le plus jeune. Un jour, c’est à l’hôpital que j’allai voir mon vieil ami. Qu’il était jaune et que sa bonne figure était creuse ! Il se remit, cependant, revint broyer un peu de couleurs, très peu, et en vendre moins encore. Quelques mois durant, il put continuer à contempler silencieusement le trésor qui faisait sa fierté et sa misère, les mains dans les poches de son tablier bleu de jardinier, ne se plaignant pas, attendant sagement la mort. Elle arriva. Nous n’étions pas dix à l’enterrement. Quelques jours plus tard, je retournai rue Clauzel et la fille de celui qui venait de partir si discrètement cousait dans la petite boutique déserte. Nous parlâmes de l’absent ; elle en vint vite à évoquer la misère humaine et l’injustice divine. Il y avait dans ses propos beaucoup de tristesse et un peu d’amertume. Elle ne pensait que tout fût pour le mieux dans le meilleur des mondes habités… « Ah ! s’il y avait là-haut quelqu’un d’un peu capable… » Elle levait les yeux vers le plafond. Mais c’est le ciel vide qu’elle me montrait. »
8 février
Mme veuve Tanguy informe Dries Bonger du décès de son mari :
« Paris le 8 Fevrier 1894
Mon cher Mr. Bonger,
Je vous écrit cette lettre pour vous apprendre le malheur qui vient de marriver car je viens de perdre mon pauvre mari nous lavons mis en terre mercredi 7 Courant Je vous dirai quil etaient rentré a l’hopital de la riboisière le 9 janvier et il en est sortie le 5 février Pour venir rendre son dernier soupir chez lui la meme maladie que l’annee dernière cétaient déclaré et notre medecin ne pouvant pas ce charger de le soigner Comme l’année dernière vue que cétaient la faire de la chirurgie il le fit transporter a l’hopital en lui disant quil fallait probablement subir une opérations et que ce netait pas chez nous que lon pourrai lui faire mais lon ne nous disaient pas ce quil avait, ils nous lont gardé juste 4 semaine il ne lui ont rien fait dutout lennuie la gagné et il a voulu absolument revenir a la maison et c’est au bout de ce temps que le chirurgien en chef en lui disant que mon mari voulait absolument revenir qui nous a dit vous pouvez lemmener chez vous il ny a rien a faire il avait une tumeur dans laine et sa gagne le ventre il était trop agé pour subir une opérations il a éte six semaine sans manger rien du tout il ne prenait quun peu de bouillon et de lait ah le pauvre père tanguy il a bien souffert il étaient devenu a rien du tout mais mon cher Monsieur Bonger nous somme heureux tous les trois de la voir vue mourir chez nous il nous disaient qui ne voulait pas mourir a l’hopital. Quant au reste Monsieur Bonger vous connaissez ma situations depuis longtemps tant qua vos tableaux ils sont a la maison jusqu’au mois d’octobre Si mes enfants ne continue pas le commerce Je vous dirai que nous navons pas vandu d’autre tableaux. Nous esperons avoir votre visite au beaux temps prochain cher monsieur veuillez avoir l’obligeance de présenter tout nos respect a votre Dame de notre part ainsi qua Madame Vanghog.
Monsieur je sais que vous avez la liste de vos tableaux chez vous tant qua nous je ne sais si nous avons le double je ne m’en suis pas encore occupé.
Recevez Monsieur mes sincere Salutations
femme Vve Tanguy
mes enfants se joignent amoi pour vous offrir toute leur reconnaissance et amitié. »Lettre de Mme Vve Tanguy à Dries Bonger, 8 février 1894 ; Amsterdam, Van Gogh Museum, inventaire n° b1447V/1973 ; Tralbaut Mark Edo, « André Bonger, l’ami des frères van Gogh », (Anvers), Van Goghiana, I, sans date (1973 ?), p. 5-54, cité p. 34-35.
Quand la veuve parle de « ses » enfants, il s’agit de sa fille unique Mathilde Chenu et son mari Onésime Chenu.
Vers le 10-12 février
Dans une lettre à Maxime Maufra, Mirbeau trouve excellente l’idée d’une vente au bénéfice de la veuve Tanguy, d’autant que lui-même l’avait eue aussi :
« Cher Monsieur,
Votre idée est excellente, et je la trouve d’autant plus excellente que je l’avais eue aussi, et que ma femme an a parlé à la mère Tanguy.
Je crois qu’il vaudrait mieux que cette vente eût lieu chez Georges Petit, qui est tout disposé à la faire, car il a une clientèle plus nombreuse et plus riche, et il s’agit n’est-ce pas, de trouver le plus d’argent possible.
Du reste, nous en reparlerons. Il n’y a pas péril en la demeure. Il faut même, en ce moment, ne pas parler du tout de cette vente, avant qu’une question qui embête beaucoup la mère Tanguy, une question de propriétaire, soit réglée. J’écris d’ailleurs à ce propriétaire une lettre qui, je l’espère, va le faire réfléchir et l’amener là où nous voulons qu’il vienne.
À bientôt, donc, cher Monsieur, et croyez à ma vive sympathie.
Octave Mirbeau »Lettre d’Octave Mirbeau à Maxime Maufra, vers le 10-12 février 1894 ; Archives Yves Maufra ; Octave Mirbeau. Correspondance générale, édition établie, présentée et annotée par Pierre Michel avec l’aide de Jean-François Nivet, Lausanne, L’Âge d’homme, 2005, tome II, 969 pages, lettre n° 1221, p. 831.
13 février
Article de Mirbeau, dans L’Écho de Paris, qui rend hommage à Tanguy.
« […] Je me rappelle cette scène, chez le père Tanguy, quelques jours après la mort si tragique, si douloureuse, de Van Gogh [29 juillet 1890], que le bonhomme appelait familièrement Vincent, comme l’appelaient ses amis. Et je revois, avec un serrement de cœur, sous le béret bleu qui l’abritait, la figure si fine, si enthousiaste, si brave, de ce vieillard, qui fut, je crois bien, le plus brave homme de ce temps.
Pauvre père Tanguy ! Lui aussi vient de mourir ! Que ces quelques lignes soient sur sa tombe comme une fleur de souvenir !
L’histoire de son humble et honnête vie est inséparable de l’histoire du groupe impressionniste, lequel a donné les plus beaux peintres, les plus admirables artistes à l’art contemporain et, lorsque cette histoire se fera, le père Tanguy y aura sa place.
Il était établi marchand de couleurs rue Clauzel, dans une toute petite boutique que connaissaient bien les flâneurs en quête de curiosités parisiennes. À la devanture on voyait des Cezanne, des Van Gogh, des Gauguin ; autrefois, il y a déjà longtemps, des Claude Monet, des Pissarro, des Renoir.
Il vendait des couleurs aux artistes, ou plutôt il les échangeait contre des toiles. Il n’en était pas toujours le bon marchand, car il était difficile, aux époques dont je parle, de se débarrasser d’une toile qu’on couvre d’or aujourd’hui. Mais le père Tanguy n’était pas exigeant ; sa vie était d’une sobriété exemplaire. Il avait réduit ses besoins et ceux de son ménage, au minimum du nécessaire.
Sa joie était de vivre parmi ces toiles, et il s’exaltait à les regarder. Il aimait ses peintres comme ses enfants et l’on eût été mal venu à contester leur talent. Il en voulut beaucoup à Zola de n’avoir pas été juste pour eux dans son roman de L’Œuvre.
― Ce n’est pas bien ! ce n’est pas bien ! disait-il souvent. Jamais je n’aurais cru ça de M. Zola, qui est un si brave homme et qui était l’ami de ces messieurs ! Il ne les a pas compris ! Et c’est un grand malheur !
Rien n’existait pour le père Tanguy en dehors de « ces messieurs ». Jamais l’idée de regarder d’autres tableaux que les leurs ne lui fût venue. Il vivait dans un rêve d’enthousiasme perpétuel. […] »Mirbeau Octave, L’Écho de Paris, journal politique et littéraire du matin, 11e année, n° 3550, mardi 13 février 1894, p. 1.
17 février
Gauguin demande à son beau-frère Edvard Brandes de lui racheter les Pissarro et les Cezanne que sa femme Mette lui avait vendus :
« 17 fev. 94
Cher Monsieur
Ce que je vais vous demander va vous paraître bien étrange, mais vous connaissez quels sont les caprices des Artistes.
Aujourd’hui que je puis le faire quelques je désire avoir encore une fois quelques tableaux que vous avez acheté à Mette. Os, comme vous l’avez fait pour lui rendre service j’espère que ma demande vous paraîtra naturelle. Il est juste pourtant que vous y trouviez bénéfice.
Voici donc ce que je vous propose.
De la collection je voudrais avoir les Pissarro et les Cezanne. Je vous les racheterais aux prix que vous les avez payés, plus naturellement l’interêt couru. Il vous resterait donc Degas Manet, Guillaumin, Lewis Brown etc. et sur ceux là vous êtes aujourd’hui largement couvert de vos frais et en benefice ―
Veuillez donc être assez aimable pour me répondre en me fixant le prix total avec la nomenclature de ce que vous pouvez me recéder. Soyez assuré que je vous enverrai immédiatement les fonds ―
Avec mes remerciements anticipés, agréer Monsieur l’expression de mes meilleurs sentiments.
Paul Gauguin 6 Rue Vercingétorix »Bodelsen Merete, Gauguin og impressionisterne, Kunstforeningen, 1968, Copenhague, 196 pages, reproduit p. 56-57.
Brandes répondra :
« Monsieur,
J’ai pendant les dix dernières années acheté à Mette des tableaux pour une somme d’environ 10.000 f. Ça forme maintenant une toute petite collection, que j’aime. Je n’ai pas la moindre envie de me débarrasser de quelques pièces. Je comprends très bien votre caprice d’artiste mais vous aussi comprendrez que vous me demandez vraiment trop
Brandes »Lettre de Brandes à Gauguin, non datée ; Paris, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie ; Bodelsen Merete, Gauguin og impressionisterne, Kunstforeningen, 1968, Copenhague, 196 pages, p. 58.
Gauguin répondra :
« Monsieur,
Veuillez excuser l’inopportunité de ma demande. J’avais pensé à tort (maintenant je le conviens) que par simple bienveillance pour rendre service à Mette, vous aviez acheté des toiles fort embarrassantes et à l’époque très discréditées toutes œuvres folles prêtes à être rendues quand les temps meilleurs arriveraient. Je vous le répète, mon intention était bonne celle de vous débarrasser. Il n’en est rien, vous aimez votre collection, vous en sentez toute la valeur — intellectuelle. Je ne puis que vous en féliciter en artiste et vous prie Monsieur d’agréer etc. »Lettre de Gauguin à Brandes, non datée ; Paris, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie ; Bodelsen Merete, Gauguin og impressionisterne, Kunstforeningen, 1968, Copenhague, 196 pages, p. 58.
20 février
Lettre d’Émile Bernard à Dries Bonger :
« Depuis cette dernière lettre que vous avez reçue de moi, le plus abominable malheur nous est arrivé : nous avons perdu Tanguy. Vous connaissiez toute l’étendue de mon affection envers lui, et vous saviez sa bonté pour moi et toute la reconnaissance que je lui devais. Sans Tanguy que serai-je devenu il y a dix ans lorsque je me trouvais vis a vis de mon père furieux contre moi, de mon désir d’art et l’impuissance de ma mère à m’aider en ce désir. J’étais sans couleurs, sans argent, souvent sans avoir même à manger lorsque j’allais à Paris voir les chefs-d’œuvre du Louvre. Je faisais ces longs pèlerinages à pied et plein de toutes les merveilles que j’allais voir et du soleil de la route. Tout était bien beau alors dans mon âme malgré les révoltes que m’inspirait l’inaction forcée en laquelle on me tenait. Tanguy s’est trouvé sur mon chemin et c’est grâce à lui que cette carrière s’est ouverte à moi sans épines. Puis il fit même ma première éducation. Les Cezanne me furent montrés et expliqués par lui ; les misères de cette vie de peinture ne me furent révélés encore que par lui, au récit des noms que j’admirais ; souffrant et privé même de ce qu’il faut pour produire, comme je l’étais alors, ces tableaux m’enflammèrent d’enthousiasme. J’étais heureux d’avoir à souffrir comme les autres et d’aimer l’art au point de tout supporter. Ainsi ma vocation s’éveilla plus vivace, plus ferme, plus sûre d’elle-même, sans un doute, mais vinrent les heures découragées et c’est alors que la beauté et la résignation de ce presque Père — de ce père de ma peinture et de ma carrière me furent utiles à voir. Lui privé de tout, pauvre, n’ayant souvent même pas une hanche de pain, connait, espérait, aimait. Sublime spectacle, bien fait pour m’améliorer et me donner aussi la foi. Maintenant il n’est plus, et il nous reste à prier et à pleurer, souvent. J’y penserai comme à Vincent, comme à d’autres, aux morts inconnus et inconnus à jamais. Il s’inquiéta fort de moi et dit à ma mère qui l’allait voir que j’étais sauvé pour ma peinture. Cette préoccupation à l’heure de la mort d’un ami est tout ce qu’il y a de plus touchant. « Dites à Émile que je suis son ami sincère et qu’il a toutes mes sympathies » voilà ses dernières paroles à la dernière visite qui lui fut faite par ma mère et qu’elle m’a religieusement transcrites. Ainsi mourut ce brave. J’ai essayé selon ma foi de le ramener à Dieu ; mais cela fut inutile, il ne m’en a pas tenu rancune sachant bien que je n’agissais qu’avec la plus grande amitié et conviction. […]
Il serait nécessaire il me semble que quelqu’un s’occupe des toiles de Vincent qui sont à Paris. Si vous le voulez, je puis le faire prendre par ma mère chez moi ou les faire porter chez Boutteville qui est un homme en lequel, je crois, l’on peut avoir confiance. Tanguy est mort si pauvre que tout cela pourrait être saisi. Surtout sa femme étant porté au vin et ses enfants ne valant pas grand-chose. Ma mère m’écrivait encore qu’un côté de Tanguy nous était resté inconnu, que cet homme d’une bonté sublime et d’une âme noble vivait dans un milieu qui lui était fort inférieur et le tyrannisait atrocement. Sa patience a donc été encore plus grande qu’on le croit. Vincent en parle dans les lettres que je transcris en ce moment et qui sont des plus intéressantes. […] Tanguy étant mort il va sans dire qu’il est inutile de faire parvenir cent autres francs chez lui ; ils me sont en ce moment trop nécessaire pour que je les puisse donner à sa femme laquelle les partagera et mangera en peu de temps avec les marchands de vin et ses enfants avides et paresseux. […] »
Lettre d’Émile Bernard, Port-Saïd, à Dries Bonger, 20 février 1894 ; Tralbaut Mark Edo, « André Bonger, l’ami des frères van Gogh », (Anvers), Van Goghiana, I, sans date (1973 ?), p. 5-54, cité p. 36-37.
21 février
Mort de Caillebotte, âgé de quarante-cinq ans, à Gennevilliers.
Acte de décès de Gustave Caillebotte n° 22, mairie de Gennevilliers ; Marie Berhaut, Gustave Caillebotte, catalogue raisonné des peintures et des pastels, (nouvelle édition revue et augmentée, avec le concours de Sophie Pietri), Paris, Wildenstein Institute, La Bibliothèque des Arts, 1994, 315 pages, 565 numéros, fac-similé de l’acte de décès p. 281. Geffroy Gustave, « L’art d’aujourd’hui. Gustave Caillebotte », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 516, dimanche 25 février 1894, p. 1-2.
Geffroy Gustave, « L’art d’aujourd’hui. Gustave Caillebotte », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 516, dimanche 25 février 1894, p. 1-2 :
« L’ART D’AUJOURD’HUI
GUSTAVE CAILLEBOTTE
On annonce la triste nouvelle de la mort, à quarante-six ans, du peintre Gustave Caillebotte, qui fit partie, il y a quelque vingt années, du groupement impressionniste.
Parmi ces hommes ardents, animés de foi artiste, il s’inscrit et manifesta ses sympathies. Désireux de participer à ces belles luttes, il vint aider, de tout le secours de son activité et de sa bonne humeur, ceux qui étaient alors fort maltraités, comme l’on sait. Louer des salles, organiser les expositions, les ventes, donner sans cesse de sa personne et de sa bourse, ce fut le rôle qu’il prit et que nul de ses amis n’a oublié. En même temps, amateur qui devenait artiste, il travaillait avec une vaillance que rien ne lassait. On se souvient de ses débuts, de ces Raboteurs de parquets qui excitèrent les railleries par leur perspective osée, mais où il fallut bien reconnaître les qualités d’un observateur dans le modelé des torses et la vérité des mouvements.
Depuis, Caillebotte s’était appliqué à l’étude des mêmes perspectives dans des intérieurs de chambres, et il avait obtenu de curieux et parfois bizarres effets de raccourcis et de proportions. Seulement, où l’on croyait à une tactique et à un désir d’étonner, il y avait ingénuité et désir de vrai. Pour moi, le sens dans lequel le peintre a le mieux marqué son effort, c’est dans la série de paysages des rues de Paris, parfois vus d’un balcon : des avenues larges, des voies droites, de hautes maisons alignées, des maisons qui forment caps aux carrefours et qui ont vraiment, dans l’atmosphère de la ville, la beauté massive de hautes falaises.
Là, il y eut non seulement recherche, mais trouvaille et originalité, et le commencement de quelque chose qui pourra bien être continué.
J’ai connu Caillebotte aux dîners mensuels impressionnistes. Il y était la cordialité même, avec une verve rustique, et de bons emballe- ments d’honnête homme. Voilà le pauvre dîner bien désorganisé. Il y a à peine un mois, c’était M. Georges de Bellio, cet esprit distingué, d’une si haute bonté, qui s’en allait. Aujourd’hui, c’est celui-ci.
Depuis longtemps, Caillebotte avait délaissé la peinture pour se donner aux bateaux et au jardinage dont il raffolait. Pourtant, on l’avait décidé à faire une exposition de ses œuvres chez Durand-Ruel. On espérait le ramener à l’art ; on voulait le réconforter, lui inspirer un peu plus de confiance en lui.
Il ne faut pas renoncer à cette idée, il faut faire cette exposition qui sera maintenant un renseignement tardif pour beaucoup, une exposition posthume.
GUSTAVE GEFFROY. »
« Nos échos », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 517, lundi 26 février 1894, p. 1-2 :
« Les obsèques du regretté artiste Gustave Caillebotte auront lieu aujourd’hui, lundi, à midi précis, à l’église Notre-Dame-de-Lorette. »
Février
La succursale new yorkaise de Durand-Ruel achète deux natures mortes de Cezanne (Boîte à lait et pommes, FWN771-R426, et Boîte à lait, carafe et bol, FWN770-R427) à Sarah Hallowell, une amie de New York de Mary Cassatt. Elle les revendra en décembre 1895 à l’établissement parisien.
Archives Durand-Ruel, New York, livre de stock, nos 1164 et 1165 ; Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne : A Catalogue raisonné, volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, 1996, 592 pages, notice 426, p. 285.
Matisse Henri, « De la couleur », Verve, volume IV, n° 13, 1945, p. 9 :
« Chez Durand-Ruel, j’ai vu deux très belles natures mortes de Cezanne, biscuits [FWN744-R329] et boîtes à lait et fruits d’un bleu meurtri [FWN771-R426 ou FWN770-R427]. Elles me furent indiquées par le père Durand auquel je montrai des natures mortes que j’avais peintes. Voyez ces Cezanne, disait-il, que je ne puis vendre. Peignez plutôt des intérieurs avec figures tel que celui-ci et celui-là. »
Vers le 28 février
Lettre de Mme veuve Tanguy à Dries Bonger :
« Mon cher Monsieur Bonger
Je vous envoie votre recu comme vous le voyez et je vous remercie bien car sa me fait bien plaisir en ce moment ayant voulu faire un enterrement convenable a mon mari je me suis un peu épuisée mais comme il le méritaient bien je n’aie fait que mon Devoir je vous assure quil y avait beaucoup de monde et sa ma donne bien de la satisfaction Monsieur Bonger je vous dirai quil me reste encore des Cezanne et comme vous les les aimez quand vous viendrez au mois davril sil y en a qui vous conviennent nous pourons nous arranger avec les honnete gens il ny a rien a craindre et je sais l amitie dont mon mari vous portaient et de méme que vous. Je ne suis pas très forte je suis soufrante et se je navais pas mes enfants je ne sais pas ce que je deviendrai je vous dirai aussi que je suis en pour parler à mon proprietaire jespere que celui ci va aderer a ce que je quitte au mois doctobre mais pour avoir mes six mois d avance il faudra que je lui paye le terme davril Monsieur chouffenecker est venu mevoir et il desirerai avoir un tableaux de Mr Vincent c’est le soleil et je lai fait six cent franc le prix que mon mari le fesaient et il a du vous écrire a se sujet je nagirai que d après vos ordres jusqua présent nous cherchons la liste des tableaux qui reste et ne pouvant la trouver quand vous vienderai vous verrez ceux qui restent nous avons bien trouve la liste ce ceux qui ont été vandu cher Monsieur je termine ma lettre en vous priant de recevoir mes respect bien sincère ainsi qua Madame Bonger
Veuve Tanguy
mes enfants se joignent a moi pour vous dire bien des choses »Lettre de Mme Vve Tanguy à Dries Bonger, vers le 28 février 1894 ; Amsterdam, Van Gogh Museum, inventaire n° b1446V/1973.
Quand la veuve parle de « ses » enfants, il s’agit de sa fille unique Mathilde Chenu et son mari Onésime Chenu.
11 mars
Renoir, exécuteur testamentaire de Caillebotte, informe par une lettre le directeur des Beaux-arts, Henri Roujon, que Gustave Caillebotte, décédé le 21 février 1894, a légué à l’État sa collection (suivant ses testaments du 3 novembre 1876, du 20 novembre 1883 et le codicille du 5 novembre 1889).
« Monsieur le Directeur,
Exécuteur testamentaire de la succession de Gustave Caillebotte, artiste peintre décédé le 21 février 1894, j’ai l’honneur de vous informer que M. Caillebotte, par ses dernières volonté, fait une donation au Musée du Luxembourg et au Louvre ou au Musée du Luxembourg seulement, d’une collection de soixante œuvres environ, de messieurs Degas, Cezanne, Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Millet, un dessin de Gavarni.
Cette collection est encore au Petit Gennevilliers, je vais la faire revenir à Paris, alors j’aurai l’honneur de vous demander une audience pour vous faire part moi-même des détails de cette donation.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de sentiments respectueux.
Renoir
13, rue Girardon. »Lettre de Renoir à Henri Roujon ; Archives du musée du Louvre, P8 ; Vaisse Pierre, « Le legs Caillebotte d’après les documents. Annexe : documents », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, séance du 3 décembre 1983, Paris, 1985 ; p. 223-233, lettre p. 223.
Le dessin de Gavarni ne figurera sur aucune des listes de la collection conservées aux Archives du Louvre et dans les archives privées.
Cinq œuvres de Cezanne font partie de la collection (FWN637-R244, FWN926-R261, FWN722-R265, FWN129-R389, FWN119-R390), dix-huit de Pissarro, sept de Degas, quatre de Manet, seize de Monet, neuf de Renoir, neuf de Sisley, soit un total de soixante-huit œuvres impressionnistes, d’après la liste établie par Martial Caillebotte des œuvres léguées par son frère (Archives familiales), confirmée par la liste dressée par Gustave Geffroy de soixante-deux peintures et pastels, auxquels s’ajoutent six œuvres retrouvées ultérieurement par Renoir dans un atelier annexe, cinq de Pissarro et une de Sisley (cf. catalogue d’exposition Caillebotte de 1994, cf. Pierre Vaisse).
Geffroy Gustave, « L’art d’aujourd’hui. La collection Caillebotte », Le Journal, quotidien littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 538, lundi 19 mars 1894, p. 3-4 :
« L’ART D’AUJOURD’HUI
La Collection CaillebotteC’est aujourd’hui lundi que la collection de tableaux modernes, rassemblée par Gustave Caillebotte et qu’il a léguée par testament, au musée du Luxembourg, sera présentée par Renoir, l’exécuteur testamentaire de Caillebotte, à ia commission officielle chargée de examen et de la réception.
Les informations, sur ce sujet, ont été brèves. On a dit les noms des peintres et désigné quelques-unes des œuvres réunies. Je me fais un plaisir, par les renseignements complémentaires qui suivent, d’apprendre au public qui a la curiosité et la passion des choses d’art la composition exacte et l’importance capitale de cette collection offerte a tous par le généreux artiste.
***
Il m’a été donné, en effet, hier, de faire le rapide voyage d’Argenteuil et d’entrer dans cette maison de Caillebotte, où tout dit encore la présence vivante de la veille, à croire que le maître du logis va rentrer, parcourir les pièces, s’asseoir, causer, reprendre ce livre à la page de la lecture commencée, travailler à cette toile encore fraîche sur le chevalet.
Mais ce n’est que l’illusion tenace et mensongère de la vie continuée. La Mort silencieuse et invisible a fait son œuvre, a arrêté subitement les pas, la voix, le geste, clos l’existence de l’homme. Tout est aujourd’hui semblable à ce qui était hier, hormis que l’habitant n’est plus là. Il est entré, il est sorti, et rien n’est changé du décor de son existence. La maison a la même gaieté, entre les champs et la Seine, en face d’Argenteuil. Les bateaux se balancent sur l’eau soyeuse. Tout est doré par le soleil du nouveau printemps. Dans le jardin, au long des plates-bandes. dans les clairières du bois minuscule, dans les interstices des pierres qui forment un piédestal rocheux à la serre, partout, la verdure déplie ses bourgeons, les fleurettes brillent comme des yeux enfantins, des pousses vivaces trouent la terre. Tout ce petit monde végétal étiqueté, choyé, adoré par Caillebotte, est exact au rendez-vous qui lui avait été donné. « Vous verrez mon jardin au printemps », disait-il à ses amis, au dernier dîner des Impressionnistes. Le printemps est venu, le jardin se pare pour l’éternelle fête. Un chien triste parcourt les allées.
C’est la monotone et banale histoire de l’homme. « Quand la maison est bâtie, la Mort entre », dit le proverbe arabe. L’homme qui regarde cela et constate la loi du sort peut prendre la mesure exacte de ses préoccupations, de ses ambitions, de sa frénésie de succès, de sa course à la fortune ou à la gloire. Voilà le but : tous le connaissent et sont sûrs de le toucher. Si cette certitude, au moins pouvait nous apprendre a tous à bien vivre.
Caillebotte a bien vécu.
Il a aimé l’eau qui passe et qui bruit, les voiles blanches qui s’envolent aux tournants des rivières, qui palpitent sur la mer.
Il a aimé les fleurs qui colorent et par- fument l’atmosphère, il a été le sage amateur de jardins. Relisez le discours de Lamartine aux jardiniers, le poète parcourant les théogonies, les religions, la fable, l’histoire, cherchant quelle idée l’homme a pu se faire du bonheur et trouvant « que l’imagination humaine n’a pu rêver, dans tous les paradis qu’elle s’est créés, quelque chose de mieux qu’un jardin terrestre ou céleste, des eaux, des ombrages, des fleurs, des fruits, des gazons, des arbres, un ciel propice, des astres sereins, une terre fertile, une intelligence secrète, une amitié réciproque, pour ainsi parler, entre l’homme et le sol… » Caillebotte avait en lui cette sympathie pour la vie universelle, et c’est un des traits caractéristiques du groupe d’artistes auquel il appartenait.
Enfin, il a aimé l’art, — qui concentre les sensations de l’homme, qui crée une durée pour notre vie fugitive, qui perpétue notre joie de vision, l’enivrement de notre esprit. Non seulement par son apport personnel, — par des vues originales de paysages et d’intérieurs parisiens, par des observations curieuses de mouvements humains, tels que le travail des Raboteurs de parquets, fa flânerie des Peintres en bâtiment, — Caillebotte a fait partie du groupe des peintres impressionnistes : mais il a été encore, pour ces contestés, celui qui réunit, qui réconforte, qui aide. Aucun n’a oublié son bon vouloir, son activité, et le témoignage qu’ils lui rendent, c’est qu’il fut un compagnon vraiment rare, d’une ab- négation absolue, pensant aux autres avant de penser à lui, — s’il pensait a lui.
Sa mort est venue affirmer pour tous la véracité de ce témoignage, par ce testament qui rend sa collection publique, et ceci me ramène aux dernières volontés de l’artiste regretté et à cette magnifique série de toiles que j’ai vues, hier, dans l’atelier vide, et qui appartiendront, demain, à l’État.
Les toiles. d’abord. Elles sont au nombre de soixante-cinq. Les voici exactement énumérées, simplement cataloguées :
Quatre Manet :
Le Balcon, que l’on a pu voir autrefois au Salon, trois personnages dans la clarté, en avant d’une chambre obscure, un homme et deux femmes, des toilettes d’été, des manches transparentes, l’harmonie d’une beauté brune, d’une robe blanche, du balcon et des contrevents verts ;
Le portrait de femme à l’éventail noir, un visage énergique, anguleux, bossué, de la période de Manet retour d’Espagne ;
Le Jeu de croquet peint à Sainte-Adresse, délicieuse peinture ferme, tranquille, sept personnages, une atmosphère traversée de coups de vent rendus visibles par les gestes, les voiles, les oriflammes ;
Une petite esquisse de chevaux de courses.
Seize Monet :
Une grande toile : le Déjeuner, une table desservie, des prunes, des pécher du pain, une cafetière, un jardin fleuri, un enfant au premier plan, deux femmes dans le fond ;
Trois vues de gares, les ponts, les maisons, les locomotives, la fumée, la trépidation du sol, la fragilité sonore des verrières ;
Une chambre bleuie par la lumière du dehors, des plantes, des tentures, un enfant ;
Trois vues de Vetheuil : la Seine sous Le givre, — une colline rose, — l’église sous la neige ;
Une vue d’Argenteuil ;
Des Pommiers ;
Le mont Riboudet, à Rouen ;
Des chrysantèmes rouges ;
Trois esquisses : des arbres en fleurs, — des arbres dépouillés en avant d’un côteau, — une vue des Tuileries, délicieux paysage de Paris, doré et rose ;
Enfin, les Côtes de la mer sauvage, le plus grandiose, le plus beau de la série peinte à Belle-Isle-en-Mer, toute la mélancolie somptueuse, la grandeur de solitude de l’Océan.
Huit Renoir :
L’admirable Moulin de la Galette, la poésie de Paris, l’ivresse de la danse, de l’amour, du soleil ;
Un torse de femme nue, une chair fine et saine, pétrie avec la lumière ;
La Balançoire, une jeune femme dressée dans l’espace, une apothéose de la jeunesse dans la verdure ;
Une tête de femme lisant ;
Quatre paysages : la Seine à Champrosay, — Montmartre, — le pont de Chatou, — la place Saint-Georges.
Treize Pissarro : Treize paysages datés de 1871 à 1879 : des arbres en fleurs, des maisons, des champs, des routes, des bois, des rivières, des passages d’êtres, des occupations paysannes. Toute la première partie de la carrière du maître paysagiste est présente par cette série où il y a des pages d’une douceur, d’une vérité et d’une poésie inoubliables.
Huit Degas, — huit pastels :
Une femme sortant du bain : sa bonne l’enveloppe d’un peignoir ;
Une femme à sa toilette ;
Un café où quatre femmes attendent les aventures, quatre demoiselles fatiguées, fanées, aux corps affaissés, et un dialogue en pantomime singulièrement expressif entre deux d’entre elles, l’une qui fait craquer l’ongle de son pouce contre sa dent : « Pas ça ! », l’autre qui regarde cette confidence d’un air hébété. C’est à la fois comique et lamentable, une page des mœurs de Paris marquée de superbe maîtrise. Au fond, en reflet, dans une glace, le paysage du boulevard ;
Une rangée de figurants en costumes du seizième siècle, collants, crevés, mi-parties, fausses barbes, bouches ouvertes, énormes mains étendues, jambes torses, le serment solennel de mourir pour la patrie, vociféré pour quarante sous ;
Un violoniste et une fillette de la danse ;
Un Buste de Danseuse, les cheveux et la taille agrémentés de rubans d’un bleu vert ;
Une Danseuse assise, penchée, une main tenant un pied ;
Une Danseuse qui bondit sur la scène, robuste et légère, éperdue comme un oiseau, épanouie comme une fleur, debout sur un pied, les bras en arabesque.
Huit Sisley :
Huit paysages, de 1877 à 1885 : des vues de Saint-Mammès, la Seine, des bateaux, des maisons, une cour de ferme, des régates anglaises, le décor joyeux de l’eau et du ciel.
Cinq Cezanne :
Les Baigneurs, une des toiles les plus célèbres de Cezanne, bleue et blanche, ferme et colorée comme une belle faïence, des figures nues, un paysage de rocs et de nuages ;
Une marine méridionale, une eau pesante et bleue, des collines rocheuses, la stupeur des choses sous la chaleur, paysage fortement construit, d’une attention et d’une franchise rares ;
Deux autres paysages : une société de personnages assis ou couchés au bord de l’eau, — une maison a toit rouge ;
Un vase blanc et bleu empli de fleurs.
Un crayon et une notation d’aquarelle de J.-F. Millet.
Enfin, jointe à cela, en toute justice, une toile de Caillebotte qui sera probablement les Raboteurs de parquet.
Pour les dispositions testamentaires de Caillebotte, elles sont nettes, sans phrases, comme il fut lui-même. Libellées en 1876, à l’époque de bataille ardente, aux jours difficiles, elles prévoyaient un mauvais accueil et spécifiaient bien que ces toiles n’étaient pas pour être roulées, mises dans les greniers des musées nationaux ou dispersées en province : si le don n’était pas reçu comme il devait l’être, il n’y avait qu’à attendre des jours meilleurs. Ces dispositions sont restées les mêmes, affirmées dans un codicille. Mais le temps de 1876 est passé : depuis dix-huit ans, l’art injurié a été mis en honneur, et c’est avec reconnaissance que le legs de Caillebotte sera reçu. Il donne au Luxembourg ce qui lui manquait, il inscrit aux murailles mal pourvues du musée un sérieux commencement d’histoire, il fait succéder logiquement la période de ces vingt-cinq dernières années a la période de 1830 a 1860. Le Luxembourg, où quelques toiles significatives sont entrées depuis quelques années, va achever, par Caillebotte, de mériter son enseigne de musée des artistes vivants.
GUSTAVE GEFFROY. »
L. B., « La collection Caillebotte et l’école impressionniste », dans Bénédite Léonce, « Le musée du Luxembourg », Les Musées de France, n° 2, 1894, Paris, librairie d’art, Ludovic Baschet, éditeur, n. p.
« LA COLLECTION CA1LLEBOTTE
ET
L’ÉCOLE IMPRESSIONNISTEPar un testament en date du 3 novembre 1876, le peintre Gustave Caillebotte, qui vient de mourir, léguait à l’État une collection de peintures de quelques artistes réunis sous la qualification, alors nouvelle, de peintres impressionnistes. C’était pour eux le plein moment d’une lutte ardente contre l’opinion. Ils n’étaient accueillis que par des rires et des huées, et, il faut bien le dire, le public et la critique ne manquèrent pas de donner le triste spectacle de la passion sotte et odieuse avec laquelle sont toujours accueillis les ouvrages de l’esprit qui sortent des sentiers battus.
Le pauvre Caillebotte sentait si bien que l’heure n’était pas encore venue pour ses amis qu’il avait pris des précautions prudentes afin d’assurer l’exécution de son legs, comptant beaucoup sur le Temps, ce grand apaiseur de querelles. C’est ainsi que la disposition spéciale qui attribuait sa collection aux Musées nationaux portait, avec la condition qu’elle ne serait cachée ni dans les Musées de province, ni dans les greniers du Luxembourg ou du Louvre, qu’elle ne serait exécutoire qu’au bout d’une période de vingt années, jugée par lui suffisante pour que l’opinion publique revînt de ses préventions.
Caillebotte avait eu l’œil juste en mesurant la distance nécessaire à l’acceptation régulière et normale de ces œuvres, car il a bien fallu près de vingt ans pour que l’état général des esprit fût modifié de telle sorte qu’il accueillît non seulement sans passion hostile, mais même avec gratitude, cet ensemble d’œuvres d’un enseignement particulièrement intéressant.
C’est, en effet, avec reconnaissance que le Musée du Luxembourg a accepté le legs Caillebotte, qui vient si à propos combler dans ses galeries une lacune dont on avait commencé à sentir l’importance et qu’on s’était déjà efforcé de diminuer peu à peu.
Ce legs donne à l’Etat soixante-six ouvrages des premiers fondateurs du groupe impressionniste. Leur signification et leur qualité sont, forcément inégales ; car, à côté de morceaux définitifs que le Luxembourg aurait eu le droit d’envier longtemps sans cette heureuse éventualité, une partie des toiles de ce lot est formée d’études, de morceaux inachevés, qui n’ont d’intérêt qu’à l’atelier. Aussi, d’accord avec les héritiers et l’exécuteur testamentaire et dans un esprit de prudence et d’équité, un choix a-t-il été fait par l’Administration, de manière que chacun des artistes fût représenté dignement, mais sans dépasser le maximum qui est jusqu’ici accordé aux autres artistes exposés au Luxembourg. Les autres ouvrages, pour se conformer aux vœux du testateur, seront conservés dans les annexes des Musées nationaux qui ne sauraient être qualifiées ni de greniers ni de Musées de province.
Ce vocable d’impressionniste a besoin d’être défini, car l’acception primitive en est dénaturée et appliquée couramment aujourd’hui à toute peinture qui semble plus ou moins inattendue. Les fondateurs du groupe primordial l’ont étendu eux-mêmes à un certain nombre de confrères, sympathiques à leurs idées, mais de mœurs moins intransigeantes, dont quelques-uns ont toujours été acceptés du public et parfois récompensés officiellement. C’est ainsi que les noms de Bracquemont, Boudin, Desboutin, Cals, Jongkind, Legros, Lépine, De Nittis, Raffaëlli se trouvent à la fois sur les livrets des Expositions impressionnistes de 1874 à 1889 et sur les catalogues des Salons et même du Luxembourg.
La collection Caillebotte est formée exclusivement d’œuvres des principaux fondateurs du groupe : MM. Claude Monet, Renoir, Sisley, qui s’étaient connus à l’atelier de Gleyre, et M. Pissaro, auxquels se joignirent par sympathie Manet et M. Degas, et ensuite M. Cezanne. Il n’y manque que Mme Berthe Morizot, lacune comblée, d’ailleurs, par l’Administration, à la vente de la collection Duret.
Il s’agit donc, pour expliquer leur nom, de définir le but poursuivi par les impressionnistes et les moyens employés pour l’atteindre.
[…] La collection Caillebotte ne contient rien de Manet qui puisse efficacement balancer au Luxembourg la mauvaise réputation d’Olympia. Angelina est une étude forte et brutale dans le goût du Greco. Le Balcon est une œuvre pleine de choses charmantes, mais incomplète et qui n’a pas la saveur fraîche et originale des beaux morceaux célèbres exposés à la galerie Durand-Ruel. En revanche, les amis plus directs de Caillebotte s’y rencontrent avec un choix d’œuvres exceptionnelles. M. Claude Monet, ce puissant et audacieux paysagiste qui a abordé si franchement l’étude de la nature face à face avec elle, est représenté par plus de dix peintures, à plusieurs desquelles le public ne marchandera pas son admiration : les Rochers de Belle-Isle, l’Église de Vétheuil par un effet de neige, la Gare Saint-Lazare, avec ses fumées et son bruit, qui a toute la beauté et la poésie moderne d’un Turner, le Givre, le Déjeuner, des vergers de poiriers en fleur ou de pommiers aux fruits rouges, etc. M. A. Renoir figure avec plusieurs de ses plus célèbres morceaux où il a noté si amoureusement la vie courante sous le jeu délicat des rayons vivants et des ombres mouvantes. Le Moulin de la Galette, la Balançoire sont bien connus ; il faut y ajouter de fortes et belles études de paysage. M. Pissaro a quatorze paysages, et M. Sisley huit ; ceux qui seront exposés sont bien faits pour surprendre les gens friands de scandales, non point par leur excentricité ou leur bizarrerie, mais par leur bonne tenue, leur sincérité et souvent même par un charme poétique qui n’est pas cherché.
Sept pastels présentent M. Degas sous plusieurs aspects connus de son talent de coloriste raffiné, de dessinateur sûr et concis, d’observateur sagace, mordant et profondément moderne. Ce sont des visions troublantes de ce monde étrange qu’il a ouvert à l’art : tantôt des danseuses d’Opéra tourbillonnant dans la blancheur frissonnante de leurs courtes jupes évasées, sous le jour mystérieux de la scène, ou saisies curieusement dans leurs poses accoutumées, leurs gestes professionnels ; des coins de coulisses où s’alignent en beuglant des choristes grotesques ; des filles abêties humant l’absinthe dans les cafés du boulevard Montmartre ; tantôt de ces études de nu, de « femmes se baignant, s’essuyant ou se peignant » qui vous froissent par l’ironie froide et implacable d’une observation aiguë, et vous séduisent en même temps par le charme des harmonies rares et délicates.
Par une modestie peu commune, Caillebotte avait pris soin de s’oublier lui-même dans ce legs important qui allait donner à ses compagnons la consécration très enviée du Luxembourg. La générosité des héritiers a heureusement réparé cet oubli en offrant au Musée les Raboteurs de parquet, cette toile qui avait tant surpris le public de 1875 et qui semble si sage aujourd’hui, et une vue de toits par un effet de neige qui donne une note franche et sincère de ce genre de paysages originaux des boulevards et des rues de Paris vus cavalièrement, où les hautes masses de maisons surgissent comme des îles escarpées. Ces deux toiles montrent bien, comme on a pu s’en convaincre à son Exposition posthume, que Caillebotte avait le droit d’avoir sa petite place personnelle près des maîtres qui l’entouraient et auxquels il s’était entièrement dévoué.
Grâce à cet artiste, le Musée du Luxembourg peut donc fournir un enseignement complet et impartial sur l’histoire de la peinture contemporaine dans toutes ses inspirations, ses mouvements et ses réactions. Aujourd’hui que toutes les querelles sont apaisées, que l’on peut jeter un coup d’œil d’ensemble sur l’évolution de l’École impressionniste et établir le bilan de ce qu’elle a apporté de nouveau dans le domaine de l’art, au public à décider la vraie place qui lui appartient dans l’histoire.
L. B. »
Marie Berhaut a déterminé les dates d’acquisition de certaines œuvres, mais la partie de sa thèse sur ce sujet reste inédite.
Berhaut Marie, « Le legs Caillebotte, vérités et contre-vérités », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, 1983, publié en 1985, note n° 10 p. 219. Liste des oeuvres p. 238-239.
Sur le legs Caillebotte, voir aussi :
G. L. [Gaston Lesaulx], « Pour le Luxembourg » (entretien avec G. Geffroy), Le Mémorial artistique, 24 mars 1894
A. Leroy, Histoire de la peinture française, 1800-1933, Paris, 1934, p 165-168
G. Mack, Paul Cezanne, New York, 1935, p 331-337 ; G. Bazin, French Impressionists in the Louvre, New York, 1958, p 44-48 [qui contient une tentative d’exonérer Bénédite].
A revoir. Il lègue à l’État 65 tableaux de sa collection d’autres peintres que lui, dont plusieurs seront refusés par l’administration et rendus aux héritiers. Dans l’inventaire après décès des tableaux légués à l’État se trouvent quatre Cezanne (« Baigneurs », « Pêcheurs », un paysage, un bouquet de fleurs), mais Geffroy en dénombre cinq dans la collection, avec un paysage supplémentaire. Un second choix sera établi comprenant deux tableaux de Cezanne (deux paysages : Cour de ferme à Auvers FWN129-R389, et L’Estaque FWN119-R390) qui seront retenus et estimés à un prix très bas, 750 francs chacun. D’après Vollard, trois tableaux auraient été écartés : Baigneurs, Bouquet de fleurs, Scène champêtre [Pêcheurs]) ; qui sont, respectivement : Baigneurs au repos, III (FWN926-R261), Le Vase rococo (FWN722-R265), Au bord de l’étang (FWN637-R244). À l’issue de cette « affaire », le marchand décidera d’organiser une exposition consacrée à Cezanne.
« La collection Caillebotte au Luxembourg », Répertoire des ventes publiques cataloguées de livres, autographes, vignettes, estampes et tableaux, 1re année, tome I, n° 8, mardi 3 avril 1894, p. 120-121.
« La collection Caillebotte au Luxembourg.
— Voici la liste des tableaux que Gustave Caillebotte a légués au musée du Luxembourg.
[…] Cinq Cezanne : les Baigneurs ; une Marine ; Personnages au bord de l’eau ; une Maison à toit rouge ; un vase de fleurs.
[…] En tout, 65 œuvres. »
Archives du musée du Louvre, P8, 1895-1896 ; Gustave Caillebotte, catalogue d’exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 12 septembre 1994 – 9 janvier 1995 ; Chicago, The Art Institute of Chicago, 15 février – 28 mai 1995, p. 31-32 (catalogue établi et rédigé par A. Distel, D. Druick, G. Groom, R. Rapetti)
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 55-56 ; « Au jour le jour. La collection Caillebotte », Le Temps, 34e année, n° 11990, dimanche 25 mars 1894 ; p. 3.
Vollard Ambroise, Renoir, Les Éditions G. Crès & Cie, Paris, 1920, 286 pages, p. 152-154 :
« — Moi [Vollard]. En votre qualité d’exécuteur testamentaire de Caillebotte, vous avez dû avoir plus d’une querelle avec Roujon quand il s’est agi de faire entrer au Luxembourg les « impressionnistes » ?
— Renoir. A vrai dire, je ne me suis jamais entendu avec Roujon sur rien, non qu’il manque d’esprit, ni qu’il ne soit pas d’un commerce agréable ; mais, pour m’entendre avec lui, il ne fallait pas que fût prononcé par moi un seul nom des peintres que j’aimais.
Vous pouvez imaginer quelles furent nos discussions devant la collection Caillebotte. Roujon acceptait bien les Degas, et aussi les Manet ; pas tous cependant, il en rejeta un ou deux… Ma peinture, par contre, était, pour lui, un sujet d’inquiétude, qu’il ne cherchait pas à dissimuler.
La seule toile de moi qu’il admît de confiance, était le Moulin de la Galette, parce que Gervex y figurait. Il regardait la présence de ce maître, parmi mes modèles, comme une sorte de garantie morale. Il était, d’autre part, assez disposé à goûter, sans trop d’exagération pourtant, Monet, Sisley et Pissarro, qui commençaient à être acceptés par les « amateurs ». Mais quand il arriva devant les Cezanne ! Ces Paysages qui s’équilibrent comme des Poussin, ces tableaux de Baigneurs dont les couleurs semblent avoir été ravies aux anciens faïenciers, enfin tout cet art suprêmement sage… J’entends encore Roujon :
— « Celui-là, par exemple, s’il sait jamais ce que c’est que la peinture ! » »
Renoir Jean, Renoir, Paris, Hachette, 1962, 457 pages, p. 260-261 :
« Caillebotte réunit la collection la plus importante du moment des œuvres de ses amis. Ces achats enthousiastes arrivèrent souvent à pic. Que de « fins de mois » furent allégées par sa généreuse clairvoyance. « Il avait sa petite idée… il était une sorte de Jeanne d’Arc de la peinture !… »
Caillebotte mourut en 1894 après avoir fait de Renoir son exécuteur testamentaire. C’était une tâche difficile, car il laissait sa collection au musée du Louvre, dans l’espoir que l’État n’oserait pas la refuser et que cette acceptation marquerait la fin de l’ostracisme officiel qui frappait encore l’école moderne française. C’était cela « la petite idée » !
Mon père se trouva devant un certain M. R… [Roujon], haut fonctionnaire des Beaux-Arts. Un brave homme, bien embêté d’avoir à prendre une décision. Il marchait de long en large dans son bureau du Louvre ; Renoir regardait les portes sculptées, et finalement ne résista pas au plaisir de passer la main sur la moulure. « Belle porte. » D’une voix plaintive, M. R… lui demanda :
« Pourquoi diable votre ami a-t-il décidé de nous envoyer cet éléphant blanc ? Mettez- vous à notre place. Si nous acceptons, nous avons tout l’Institut sur le dos. Si nous refusons ce sont les gens « dans le mouvement » qui nous tombent dessus. Comprenez-moi bien, monsieur Renoir, je ne suis pas contre la peinture moderne… je crois au progrès… Je suis socialiste, c’est tout vous dire !… » Renoir lui suggéra de passer de la théorie aux faits et d’aller regarder les tableaux. Les Manets et les Degas, sauf deux ou trois, semblèrent acceptables à M. R… Il admettait Le Moulin de la Galette parce que c’était une scène populaire. « J’aime le peuple, moi. » Mais quand il arriva devant les Cézannes il poussa de hauts cris. « Ne me dites pas que Cezanne est un peintre. Il a de l’argent, son papa était banquier et il peint pour passer le temps… Et je ne serais pas même surpris s’il peignait pour se payer notre tête ! » On connaît l’histoire. Les deux tiers de cette collection unique au monde furent refusés. Le tiers accepté ne franchit pas les portes du Louvre et fut entreposé au Luxembourg. A la mort de Charlotte Caillebotte les œuvres refusées passèrent à de vagues héritiers qui s’en défirent tout de suite. »
Rewald John, Cezanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 205 :
« Les tableaux furent entreposés dans l’atelier parisien de Caillebotte, au 11 boulevard de Clichy, tandis que Renoir conservait les cadres dans son atelier de Montmartre, 13 rue Girardon. Entre-temps, Renoir dut s’absenter de Paris pour des raisons de santé et passer quelque temps dans le midi de la France. Mais il était de retour le 2 mai, pour une entrevue avec Roujon et le frère de Gustave Caillebotte, Martial, où il fut décidé que les héritiers garderaient par-devers eux, tout en les tenant à la disposition de l’État, les œuvres de la collection qui ne seraient pas exposées. Autrement dit, dès les premiers stades des négociations, on envisageait de passer outre à la volonté expresse de Caillebotte, dont le testament stipulait que la collection devait être acceptée dans son intégralité. »
Revue de presse chronologique du legs Caillebotte :
« Chronique », L’Artiste, 64e année, tome VIIe, 40e livraison, mars 1894, p. 232-240, p. 235 :
« Le peintre Caillebotte, qui vient de mourir, lègue à l’État une fort belle collection de tableaux des maîtres de l’école impressionniste, Degas, Cezanne, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, ainsi que deux beaux dessins de J.-F. Millet. Cette collection est évaluée à une somme d’au moins 400.000 francs. »
« Informations », Le Figaro, 40e année, 3e série, n° 72, mardi 13 mars 1894, p. 2 :
« Dans les Musées. — Le peintre Caillebotte, dont nous avons annoncé la mort il y a quelques jours, a légué à l’État une collection importante de tableaux qui se compose de soixante toile des maîtres de l’École impressionniste qui n’étaient pas encore représentés au Luxembourg.
Cette collection, estimée 400,000 francs, se compose de six grandes toiles par Degas, de huit tableaux par Claude Monet, d’œuvres nombreuses par Pissarro, Renoir, Sisley, Paul Césanne et de deux beaux dessins de J.-F. Millet. »
Alexandre Arsène, « Chroniques d’aujourd’hui », Le Paris. 14 mars 1894 :
« Cette collection donne au Luxembourg justement tout ce qui lui manquait. Ce musée pourra enfin mériter le nom de musée des artistes vivants. Nous supposons qu’on va être content.
Ce qui serait un comble maintenant, ce serait qu’on fît la petite bouche et que l’on dise « nous n’avons pas de place ; nous n’osons pas : pour ceci, pour cela ». Ah, ce jour-là par exemple il y aurait une jolie volée de sifflets et un joli charivari dans la presse à l’adresse de l’administration des Beaux-Arts. De la place, rien qu’en enlevant un Cormon l’on pourrait loger un sixième de la collection ! D’ailleurs quand on vous apporte sur un plat d’argent une collection qui vaut un demi-million, on peut bien faire construire un hangar d’une vingtaine de mille francs pour la loger […] l’argent pour faire construire cette annexe ? « Juste celui qu’on se proposait de dépenser pour acheter des Monet, des Degas, des Sisley, des Pissarro et qu’on n’a plus besoin d’acheter puisqu’on vous les donne.
Quant au « nous n’osons pas », ce serait l’excès du ridicule dans un temps où personne ne conteste plus la valeur de ces artistes et où l’on reconnaît au contraire, jusque dans les milieux les plus timorés, l’intérêt de leur apport à l’art de ce siècle et la place qu’ils ont conquise dans l’histoire après l’école de Fontainebleau et de Barbizon. Mais nous faisons là une supposition impossible… nous n’avons qu’à attendre les riches joies artistiques qui nous sont préparées pour le jour où la salle Caillebotte s’ouvrira. ».
« A. de L. [Alfred de Lostalot, pseudonyme d’Alfred Jean Jacques Lostalot de Bachoué], La Chronique des arts et de la curiosité, supplément de la Gazette des beaux-arts, n° 11, 17 mars 1894, p. 85 :
« La Collection Caillebotte
Le peintre Caillebotte, dont nous avons annoncé la mort il y a quelques jours, a légué à l’Etat une collection importante de tableaux. Il s’agit de soixante toiles des peintres de l’école dite impressionniste, qui n’étaient pas encore représentés au Luxembourg.
Cette collection se compose de six grandes toiles par Degas, de huit tableaux par Claude Monet, d’œuvres nombreuses par Pissaro, Renoir, Sisley, Paul Cezanne et de deux beaux dessins de J.-F. Millet.
On sait que l’État cherchait à acquérir une œuvre quelconque de Degas. Cette collection est estimée 400.000 fr.
Quoi que l’on pense de la valeur de certains des peintres mentionnés ci-dessus, il faut considérer le legs Caillebotte comme une aubaine pour nos collections publiques, aussi espérons-nous que l’Administration voudra bien l’accepter en bloc et ne pas entraver la prise de possession par d’inutiles réticences. On sait ce qu’ont coûté à nos Musées les partis-pris et les pudeurs des conservateurs d’autrefois : nous nous plaisons à constater, d’ailleurs, que ceux d’aujourd’hui ne leur ressemblent guère.
A. de L. »
« Actualités. La collection Caillebotte », Journal des débats politiques et littéraires, 106e année, jeudi matin 22 mars 1894, p. 3.
« La collection Caillebotte.
« Nous avons annoncé récemment que le peintre Caillebotte, décédé il y a quelques semaines, avait laissé à l’État sa collection de tableaux composée en grande partie d’œuvres d’artistes de l’école impressionniste. Le bruit avait couru un moment que la direction des beaux-arts ne croyait pas devoir accepter ce legs, mais la nouvelle était inexacte : le directeur des beaux-arts et les principaux fonctionnaires de son département ont été convoqués lundi par le peintre Renoir, l’exécuteur testamentaire de Caillebotte, pour examiner les toiles laissées par son ami et la collection a été acceptée. Comme plusieurs œuvres étaient d’un intérêt médiocre, il a été convenu d’un commun accord que, seules, les principales seraient exposées au Luxembourg, où, aussitôt que le Conseil d’Etat aura autorisé la direction des musées a accepter le legs, on les réunira dans une même salle : il y a deux œuvres de Manet, dont le Balcon, du Salon de 1869, deux de Renoir, dont l’Escarpolette, plusieurs Claude Monet, des Sisley, un Cezanne, ce qui, avec les quelques tableaux que le musée possède déjà et le Portrait, par Mlle Morizot, acheté lundi par l’Etat à la vente Duret, composera une collection à peu près complète des artistes impressionnistes. »
« Nouvelles. La collection Caillebotte », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 12, 24 mars 1894, p. 92 :
« Nous avons annoncé, dans notre dernier numéro, que le peintre Caillebotte, décédé il y a quelques semaines, avait laissé à l’État sa collection de tableaux composée en grande partie d’œuvres d’artistes de l’école impressionniste. On avait craint un moment que la direction des Beaux-Arts ne crût pas devoir accepter ce legs, mais, cette fois, ces craintes ne se sont pas trouvées justifiées. Le Directeur des Beaux-Arts et les principaux fonctionnaires de son département ont été convoqués lundi par le peintre Renoir, l’exécuteur testamentaire de Caillebotte, pour examiner les toiles laissées par son ami, et la collection a été acceptée. Comme plusieurs œuvres étaient d’un intérêt médiocre, il a été convenu d’un commun accord que, seules, les principales seraient exposées au Luxembourg, où, aussitôt que le Conseil d’État aura autorisé la direction des Musées à accepter le legs, on les réunira dans une même salle : il y a deux œuvres de Manet, dont le Balcon, du Salon de 1869, deux de Renoir, dont l’Escarpolette, plusieurs Degas, Cl. Monet, Sisley, un Cezanne, ce qui, avec les quelques tableaux que le Musée possède déjà et le Portrait, par Mme Morizot, acheté lundi par l’État à la vente Duret, composera une collection à peu près complète des artistes impressionnistes. »
Le Journal des arts, 24 mars 1894, p. 2 :
« La collection de tableaux léguée à nos musées nationaux par M. Caillebotte et présentée par M. Renoir, exécuteur testamentaire, est acceptée en principe par la commission des musées ; mais il a été convenu que seules les principales œuvres seraient exposées au musée du Luxembourg, où elles seront réunies dans une même salle. Toutefois, cette décision ne sera valable qu’après que le Conseil d’État aura autorisé la direction des musées à accepter le legs. »
« Au jour le jour. La collection Caillebotte », Le Temps, 34e année, n° 11990, dimanche 25 mars 1894 ; p. 3 ; repris dans « Mouvement des bibliothèques, des archives, collections et musées. La collection Caillebotte », Les Nouvelles de l’intermédiaire, n° 9, 30 mars 1894, p. 65-66 :
« AU JOUR LE JOUR
La collection CaillebotteAinsi que nous l’avons annoncé, le peintre Caillebotte a légué à l’État sa collection de tableaux, œuvres des maîtres impressionnistes. Nous croyons savoir que cette collection, présentée par M. Renoir, « exécuteur testamentaire, a été acceptée en principe par la commission des musées ; mais il a été convenu que seules les principales œuvres seraient exposées au musée du Luxembourg, où elles seront réunies dans une même salle. Toutefois, cette décision ne sera valable qu’après que le Conseil d’État aura autorisé la direction des musées à accepter le legs. Voici l’énumération des toiles que possédait Caillebotte et qui vont devenir la propriété de l’État :
[…] Cinq Cezanne :
Les « Baigneurs », toile bleue et blanche [FWN926-R261] ; une marine méridionale [FWN119-R390] ; deux autres paysages, une société de personnages assis ou couchés au bord de l’eau [FWN637-R244], et une maison à toit rouge [FWN129-R389] ; un vase blanc et bien rempli de fleurs [FWN722-R265]. »
« Nouvelles diverses. Faits du jour », Le Gaulois, 28e année, 3e série, n° 5127, lundi 26 mars 1894, p. 2 :
« ― Le peintre Caillebotte, dont nous avons récemment annoncé la mort, a, ainsi que nous l’avons dit, légué à l’Etat sa collection de tableaux, œuvres des maîtres impressionnistes.
Cette collection, présentée par l’exécuteur testamentaire, M. Renoir, a été acceptée en principe par la commission des musées, mais elle donnera lieu à une sélection ; les principales œuvres seules seront exposées au Luxembourg, dans une salle unique, à laquelle on donnera, sans doute, le nom du généreux donateur.
Les toiles offertes par Caillebotte se composent de quatre Manet, seize Monet, huit Renoir, treize Pissaro, huit Degas, huit Sisley, cinq Cezanne, un crayon et une notation d’aquarelle de J.-F. Millet et une toile de Caillebotte. »
J. de M., « Notes d’art, La Grande Dame, revue de l’élégance et des arts, 2e année, n° 7, 1er avril 1894, p. 10.
« Les mêmes noms se trouvent réunis sur le catalogue du legs, réellement royal, que vient de faire à l’État cet honnête et consciencieux artiste qui eut nom Caillebotte. Lui aussi, à l’époque des débuts, encouragea et admira les impressionnistes. Cœur généreux, esprit ouvert et clairvoyant, Caillebotte fut l’ami et l’on peut même dire le frère de Manet, de Courbet, de Pissaro, de Cezanne et de ce Renoir qu’il nomma son exécuteur testamentaire et qu’il chargea de porter à l’Etat ce cadeau d’incomparable magnificence. Le musée du Luxembourg possédera donc des Degas, des Cezanne, et même — bien qu’il fût un timide et que l’admiration qu’il professait pour ses amis empêchât Caillebotte de mettre en évidence un réel talent, — quelques paysages du donateur. »
Javel Firmin, « Les nouvelles artistiques. La collection Caillebotte », Gil Blas, 16e année, n° 5249, lundi 2 avril 1904, p. 2 :
« NOUVELLES ARTISTIQUES
La collection Caillebotte
Un journal — je crois bien que c’est le Gil Blas — exprimait dernièrement le vœu que le peintre Caillebotte eût légué au musée du Luxembourg sa collection de tableaux de l’école impressionniste.
Ce vœu s’est réalisé. L’Etat est dès aujourd’hui possesseur de 60 toiles importantes qui formaient la galerie particulière de l’artiste regretté. La commission du musée a accepté ce legs, et c’est ainsi que le musée des artistes vivants va pouvoir combler une lacune énorme : M. Degas, notamment, c’est-à-dire un des plus admirables maîtres contemporains, n’y était pas représenté, en dépit des efforts de M. Bénédite, le très informé conservateur.
La collection Caillebotte renferme six grandes toiles du peintre des danseuses et des chevaux de courses, qui est en même temps un paysagiste incomparable.
Du même coup, les musées nationaux s’enrichissent de cette adorable et si parisienne idylle de M. Renoir le Moulin de la Galette, de huit paysages de M. Monet, de nombreuses pages de MM. Camille Pissarro, Sisley, Paul Cezanne, etc., et enfin de deux très beaux dessins de Jean-François Millet.
On n’estime pas à moins de 400,000 fr. la valeur de la collection Caillebotte, qui va permettre à notre musée de la rive gauche de refléter encore-plus fidèlement, plus immédiatement le mouvement artistique moderne. »
« Échos du matin », Le Matin, 11e année, n° 3687, mercredi 4 avril 1894, p. 2 :
« On vient de décider à la direction des Beaux-Arts que la collection des tableaux léguée à l’État par M. Caillebotte serait exposée au musée du Luxembourg.
Cette résolution, qu’on nous a donnée comme certaine malgré l’absence de M. Roujon, entraîne des conséquences dont on n’a pas, nous semble-t-il, assez apprécié la gravité.
La première est qu’on va être obligé de construire, pour loger ces œuvres, un salon extérieur sur la terrasse du musée, qui en sera un peu plus laid. C’est là un mal relatif, mais ce qui est plus important, c’est que cette nouvelle, galerie, depuis, longtemps demandée pour dégager la salle de sculptures, où les statues s’entassent de la façon la plus désastreuse, va être, de ce fait, envahie par des peintures. Où mettra-t-on les marbres qu’on va acheter aux Salons prochains ! C’est un problème dont nous ne voyons plus la solution.
D’autre part, la résolution extraordinaire qu’on a prise pour la collection de M. Caillebotte crée, à notre avis, un redoutable précédent. Nous savons bien que, sur les soixante tableaux qui composent cette série, le comité consultatif des musées nationaux veut en écarter quelques-uns dont l’exécution, d’une inhabileté peu sincère, n’enthousiasme qu’un très petit nombre de gens ; mais l’avis de ce prudent comité sera-t-il écouté ? L’expérience nous permet, malheureusement, de craindre le contraire. »
Nous savons bien qu’au Luxembourg on fait chaque année entrer silencieusement pas mal d’ouvrages refusés unani[me]ment par le comité consultatif ; tel le tableau de Renoir qu’on a, contre toutes règles, commandé pour le Luxembourg, et que le peintre a recommencé trois fois en ne réussissant qu’à fatiguer sa toile. On n’était jamais allé jusqu’à accepter en bloc une collection entière. Que deux ou trois amateurs d’art veuillent suivre l’exemple de M. Caillebotte et l’on se trouvera obligé, pour ne pas mécontenter leurs admirateurs, de bâtir deux ou trois ailes nouvelles à notre musée national d’art moderne. À moins qu’on ne prenne le parti de déménager quelques douzaines de maîtres dont le vieux jeu a cessé de plaire, et qu’on enverra en province distraire les bonnes gens qui ont conservé les goûts naïfs. »
G.[ustave] G.[effroy], « Conversations de Paris. Le legs Bareiller », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 615, lundi 4 juin 1894, p. 1. :
« P.-S. — Récemment, au lendemain de la mort de Gustave Caillebotte, j’ai dit ici le désir d’art, les réalisations, la faculté de dévouement du regretté artiste et le don de sa collection de tableaux au musée du Luxembourg. Aujourd’hui, il reste à annoncer l’ouverture, galerie Durand-Ruel, d’une exposition de ses œuvres, organisée par sa famille et ses amis. On connaîtra là une. intéressante personnalité moderne, un amour de l’eau et de la lumière, une observation narquoise des personnages.
G. G. »
19 mars
Vente de la collection de Théodore Duret à la galerie Georges Petit, comprenant quarante-deux tableaux, dont trois Cezanne : Nature morte (FWN778-R417), acheté 660 francs par l’abbé Octave Gaugain (1850-1904), Une Route dans un village (FWN163-R490), acheté 800 francs par Paul Helleu, et La Moisson (FWN651-R301), acheté 650 francs par Emmanuel Chabrier.
« Ventes prochaines », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément de la Gazette des beaux-arts, n° 11, 17 mars 1894, p. 87 :
« VENTES PROCHAINES
Une collection de tableaux modernes très intéressants va être vendue, lundi 19 mars, à la galerie Georges Petit, par MM. Paul Chevallier, Durand-Ruel et G. Petit. Elle a été formée par un amateur de grand goût et d’instinct sûr qui fut un des premiers à pressentir l’importance de la révolution esthétique accomplie par Manet, Degas, Whistler et, plus tard, l’école impressionniste.
M. Théodore Duret possède […] et diverses pointures des impressionnistes Pissarro, Cezanne, etc.
C’est donc une vente très curieuse : nous avons tenu à la signaler à nos lecteurs. »
Julie Manet, la fille de Berthe Morisot et d’Eugène Manet, qui va avoir seize ans, visite l’exposition avant la vente et y découvre les toiles de Cezanne :
« Un peintre qui me plaît beaucoup d’après ce qui se trouve de lui réuni à ces toiles ; c’est Cezanne ; ce sont surtout des pommes très peintes que je trouve jolies (je ne connais que ces trois tableaux de lui). »
Manet Julie, Journal de Julie Manet, préface de Jean Griot, Paris, Klincksieck, 1979 ; réédition Scala, 1987, [17 mars 1894], p. 52.
Catalogue des Tableaux et pastels composant la Collection de M. Théodore Duret dont la vente aura lieu Galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, le lundi 19 mars 1894 à 3 heures, commissaire-priseur : Me Paul Chevallier, experts : M. Durand-Ruel, M. Georges Petit, 32 pages, 42 numéros, Cezanne p. 10-11 (Lugt 52368) (procès-verbal de la vente, Archives de Paris, D 48 E3 art 79) :
« CÉZANNE
3 — Une Route dans un village.
Une route tournante en pleine lumière, pénètre au milieu des arbres et des maisons d’un village. Au fond, une colline boisée, à laquelle le village est adossé.
Œuvre importante el très réussie de cet artiste puissant et éminemment original.
Toile.
Haut., 59 cent. ; larg., 71 cent.CÉZANNE
4 — Nature morte.
Des pommes vertes, rouges et jaunes sont placées sur une table ; par derrière, une serviette est jetée.
Toile.
Haut., 17 cent. ; larg., 59 cent.CÉZANNE
5 — La Moisson.
Un moissonneur fauche un champ de blé ; d’autres dorment ou se reposent sous les arbres. Dans le fond, une colline escarpée avec des édifices et maisons.
Toile.
Haut., 43 cent. ; larg., 54 cent. »
« La vente Duret », Répertoire des ventes publiques cataloguées de livres, autographes, vignettes, estampes et tableaux, 1re année, tome I, n° 8, mardi 3 avril 1894, p. 114-115 :
« LA VENTE DURET
Le lundi 19 mars a été dispersée, Galerie Georges Petit, par le ministère de Me Chevalier, devant un public très nombreux et des plus choisis, la collection réunie par Théodore Duret. Cette vente, qui ne comprenait que 42 tableaux ou pastels, était intéressante par le nom des artistes, par l’importance dans leur œuvre des toiles vendues, par la personnalité du collectionneur, qui, dans la notice annonçant la vente, se réclame lui-même du titre de champion et presque de précurseur de l’école impressionniste — dite moderne.
3 Cezanne, 8 Dugas [sic], 6 Manet, 6 Claude Monet, 4 Pissaro, 3 Renoir, 3 Sisley, 1 Whistler ont défilé, en une heure et demie, sous le marteau. C’est beaucoup pour une fois, mais la mode n’a pas de maître. Que nous sommes loin du temps du premier essai de vente d’impressionnistes à l’Hôtel Drouot, où Me Tual fut forcé de faire évacuer la salle sans pouvoir vendre, les coups de cannes et de poings venant appuyer de part et d’autre les appréciations, du temps même où Daubigny achetait 300 fr. le canal en Hollande de Claude Monet qui, à sa mort, il y a à peine 15 ans, se revendait 150 fr. et que nous revoyons aujourd’hui à 5,500 fr. L’État a acquis pour le Luxembourg le tableau de « Jeune femme au bal », par Berthe Morizot, 4.500 fr. Avec la collection Caillebotte, voilà donc les musées nationaux pourvus en représentants de la nouvelle école.
La vente a produit 158,885 fr. Un amateur près de nous disait que l’on s’attendait à un total supérieur ? Voici toutefois les principales enchères qui, mieux que des mots, diront quel accueil les amateurs ont fait aux œuvres des maîtres jadis si discutés.
Cezanne, « Une route dans un village, » 800 francs. »
Natanson Thadée, « Expositions. Théodore Duret », La Revue blanche, n° 30, avril 1894, p. 376-379, Cezanne p. 377-378 :
« Si l’on admet encore que Pissaro et Sisley n’ont pas tant créé une formule et une technique qu’ils ont heureusement développé celles à qui s’apparentaient le mieux leurs très grands talents, demeurent surtout Monet, Manet. Degas et Cezanne. […]
Pour Cezanne — si petite que soit ici sa place, matériellement — il garde toute l’âpreté et la saveur de sa nouveauté. En dépit des imitations et même des déductions, il reste le seul théoricien presque sans disciples, le seul créateur déjà ancien d’une formule qu’aucun peintre n’aurait encore glorieusement appliquée.
Car si peu achevée que paraisse l’œuvre, c’est l’idée d’un absolu bouleversement de l’art de peindre qu’elle apporte. »
J. de M., « Notes d’art, La Grande Dame, revue de l’élégance et des arts, 2e année, n° 7, 1er avril 1894, p. 8, 10.
« Quel est l’artiste, ou la personne inquiète des choses de l’art, qui ne connaisse le nom de M. Théodore Duret ? Critique, collectionneur, analyste, lettré et surtout, et avant tout, artiste, au sens le plus élevé et le plus subtil du terme, M. Théodore Duret a eu ce beau courage et cette belle conscience d’aimer, d’apprécier, d’estimer la magnifique pléiade des Indépendants, à une époque où les noms seuls de Manet ou de Degas suscitaient le rire stupide et provoquaient le mépris.
Aujourd’hui que Whistler, Pissaro, Claude Monet, Renoir, Sisley, Mme Berthe Morizot, Jongkind, Courbet, Cezanne, Degas, Manet se sont définitivement imposés au respect et à l’admiration de tous, ce n’est pas le moindre mérite de M. Théodore Duret d’avoir deviné le glorieux avenir de ces peintres et d’avoir, à l’heure première, prodigué sa sympathie effective à ceux-là qui marquent, en ce moment, une des plus magnifiques étapes de l’art pictural en France et dans le monde entier. La collection de M. Duret, composée exclusivement de ces noms aimés, s’est dispersée au feu des enchères, et le succès de cette vente a démontré éloquemment, et mieux que ne pouvait le faire tout commentaire, avec quels soins intelligents, quelle patience et quel parfait discernement M. Duret avait su réunir sa collection. La Grande Dame reproduira une partie de ces œuvres remarquables ; c’est le moyen le plus efficace de vulgariser, en des milieux jusqu’ici réfractaires, une formule et une vision artistiques inconnues jusqu’à ce jour. »
Mauclair Camille, « Notes sur la vente Duret », Journal des artistes, 1er avril 1894, p. 521-522. À voir.
« Cezanne, on en voit si rarement ! Gauguin et les autres en ont profité ; quand Gauguin peint de l’herbe sur un talus ou un if, c’est dans un tableau de Cezanne que l’herbe et l’if avaient poussé. »
Mauclair Camille, « Choses d’art », Mercure de France, tome X, n° 52, avril 1894, p. 379 :
« Le bulletin d’art est toujours vivace ; et je reviendrai sur la vente Théodore Duret : Degas, Cezanne, Manet, Monet, Whistler. »
Mauclair Camille, « Choses d’art – Vente Théodore Duret galerie Georges Petit », Mercure de France, tome XI, n° 53, mai 1894, p. 92-95 :
« Nous avons salué la gloire de Manet, de Degas, de Renoir, de Cezanne. […]
Les trois Cezanne étaient parmi les plus beaux, »
« Vom Kunstmarket », Kunst für alle, 15 avril 1894.
Bodelsen Merete, « Early impressionist sales 1874-1894 in the light of some unpublished « procès-verbaux » », The Burlington Magazine, juin 1968, p. 344-346.
25 mars
Gustave Geffroy publie un article « Paul Cezanne », dans Le Journal.
« L’ART D’AUJOURD’HUI
PAUL CÉZANNE.Paul Cezanne a été d’actualité ces jours-ci : il y a des toiles de lui dans le legs Caillebotte, trois de ses tableaux ont été achetés à des prix honorables à la vente Duret, on en verra d’autres à la vente Tanguy. Le nom de l’artiste pourrait bien, désormais, rester en vedette, et il me paraît, en tous cas, que le moment peut être choisi pour parler de lui et de son œuvre au public, de plus en plus nombreux, désireux de renseignements sur l’art de ce temps.
***
Paul Cezanne aura eu, pendant longtemps, une singulière destinée artistique. On pourrait le définir comme un personnage à la fois inconnu et célèbre, n’ayant que de rares contacts avec le public et tenu comme une influence parmi les inquiets et les chercheurs de la peinture, connu de quelques-uns seulement, vivant dans un isolement farouche, reparaissant, disparaissant brusquement aux yeux de ses intimes. De tous les faits mal connus de sa biographie, de sa production quasi-secrète, de la rareté de ses toiles qui ne semblaient soumises à aucune des lois acceptées de la publicité, il lui vint une sorte de renom bizarre, déjà lointain, un mystère enveloppa son individu et son œuvre.
Ceux qui sont en quête d’inédit, qui aiment découvrir les choses non encore vues, parlaient des toiles de Cezanne avec des airs entendus, fournissaient des indications comme s’ils se donnaient des mots de passe. Ceux qui abordaient, curieux et ardents, la région, nouvelle pour eux, de l’art moderne, les champs en travail où l’on voit, au jour le jour, naître et croître les pousses, toutes les pousses, le blé et l’ivraie, ceux-là interrogeaient leurs aînés sur ce Cezanne fantomatique, qui vivait ainsi en marge de la vie, sans plus se soucier de rôle ou de figuration. Quel aspect avaient ses toiles ? Où pouvait-on en voir ? Il était répondu qu’il y avait un portrait chez Émile Zola, deux arbres chez Théodore Duret, quatre pommes chez Paul Alexis, ou bien que la semaine précédente une toile avait été vue chez le père Tanguy, le marchand de couleurs de la rue Clauzel, mais qu’il fallait se dépêcher pour la trouver, car il y avait toujours, pour les Cezanne, des amateurs rapides à fondre sur ces proies espacées. Il était parlé aussi de collections étendues, de toiles diverses en nombre considérable : il aurait fallu, pour les connaître, pénétrer chez M. Choquet à Paris, ou chez M. Murer, à Rouen, ou chez M. le docteur Gachet, à Auvers, près Pontoise.
***
De fait, les rencontres avec les peintures de Cezanne étaient rares dans la vie courante, puisque l’artiste renonça assez vite à se produire, prit seulement part à la première exposition du groupe indépendant de 1874. On entrevoyait donc, seulement, çà et là, un paysage ou une nature morte, une toile le plus souvent incomplète, avec des parties solides et belles, et l’on gardait comme une opinion en suspens. [Alinéa ajouté dans La Vie artistique]
***
Depuis, dans le milieu artiste, la réputation de Cezanne s’est affirmée davantage, a visiblement grandi. Cezanne est devenu une manière de précurseur duquel se sont réclamés les symbolistes, et il est bien certain, pour s’en tenir aux faits, qu’il y a une relation directe, une continuation nettement établie, entre la peinture de Cezanne et celle de Gauguin, Émile Bernard, etc. De même, avec l’art de Vincent van Gogh.
A ce seul point de vue, Paul Cezanne mérite que son nom soit remis à la place qui est la sienne.
Il est certain que, dans le groupe indépendant ou impressionniste, il affirmait auprès de ses compagnons un talent particulier, une nature originale, et qu’il y a eu bifurcation sur son œuvre, embranchement commencé par lui et continué par d’autres. Que cette route nouvelle continue, aboutisse à de magnifiques espaces, ou aille se perdant par les fondrières et les marécages, ce n’est pas ce qui est en question aujourd’hui. C’est le secret de l’avenir. Quoi qu’il arrive, Cezanne aura été là comme un indicateur, et c’est le point à ne pas oublier. L’histoire de l’art est faite d’un tracé de grandes voies et de ramifications, et Cezanne a tout au moins commandé une de ces dernières.
Autre chose serait de dire qu’il y a un lien d’esprit absolument marqué entre Cezanne et ses successeurs, et que Cezanne a eu les mêmes préoccupations théoriques et synthétiques, que les artistes symboliques. Aujourd’hui, pour peu qu’on le veuille, il est facile de se faire une idée de la suite d’efforts et de l’ensemble de l’œuvre de Cezanne. En quelques jours il m’a été donné de voir une vingtaine de peintures caractéristiques, par lesquelles peut se résumer aussi sûrement que possible la personnalité de l’artiste. Or, l’impression ressentie avec une force croissante, et qui reste dominante, c’est que Cezanne n’aborde pas la nature avec un programme d’art, avec l’intention despotique de soumettre cette nature à une loi qu’il a conçue, de l’assujettir à une formule d’idéal qui est en lui. Il n’est pas pour cela dépourvu de programme, de loi, et d’idéal, mais ils ne lui viennent pas de l’art, ils lui viennent de l’ardeur de sa curiosité, de son désir de posséder les choses qu’il voit et qu’il admire.
C’est un homme qui regarde autour de lui, près de lui, qui ressent une ivresse du spectacle déployé, et qui voudrait faire passer la sensation de cette ivresse sur l’espace restreint d’une toile. Il se met au travail, et il cherche le moyen d’accomplir cette transposition aussi véridiquement que possible.
***
Ce désir de vérité, visible sur toutes les toiles de Cezanne, est certifié par tous ceux qui ont été ses contemporains, ses amis.
D’abord, par Émile Zola, dans la dédicace de Mon Salon, brochure de 1866. Que l’on se reporte aux termes de cette dédicace, révélateurs de la plus tendre intimité d’esprit : « À mon ami Paul Cezanne. J’éprouve une joie profonde, mon ami, à m’entretenir seul à seul avec toi… » L’écrivain continue, rappelle les dix années d’affection, de causeries, et s’il en vient à aborder la question des idées remuées, des systèmes examinés, sa conclusion est que Cezanne, comme lui, a tout rejeté, ne croit qu’à la vie puissante et individuelle. C’est là un premier et bon témoignage. Zola et Cezanne, tous deux nés à Aix en Provence, courant la campagne ensemble, faisant leurs classes ensemble, venus tous deux à Paris avec la même ambition, avaient mis en commun leurs pensées et leurs rêves, et l’écrivain exprimait, avec ses idées, les idées du peintre.
Puis, ce sont les témoignages, aussi nets, de ceux qui ont été les camarades, les amis de peinture, de Cezanne, ceux qui ont été aux champs avec lui, Renoir, Monet, Pissarro, les témoins de son labeur, ceux qui le voyaient, comme eux, s’acharner à la recherche du vrai, à sa réalisation par l’art.
Sans cesse, comme aux jours de son adolescence, de sa jeunesse, où s’il s’en allait pendant des semaines, peindre dans les anfractuosités de collines et les clairières des bois, sans cesse Cezanne est parti à la conquête de ce qu’il voyait si beau : le sol richement paré de verdure, les routes mollement tournantes, les arbres vivants et forts, les pierres couvertes de mousses, les maisons intimement unies à la terre, le ciel lumineux et profond. Il aimait cela, et il m’aimait que cela, à oublier tout ce qui n’était pas cela, à rester pendant des heures et des heures, des jours et des jours, devant le même spectacle, acharné à le pénétrer, à le comprendre, à l’exprimer, — obstiné, chercheur, appliqué, à la façon des bergers qui ont trouvé, dans la solitude des champs, le commencement de l’art, de l’astronomie, de la poésie.
Ce n’est pas par un travail hâtif, par une mise en œuvre superficielle, qu’il couvrait ces toiles accueillies aux expositions et dans les ventes par les moqueries faciles. Où nombre de visiteurs, d’amateurs mal inspirés, ne voulaient voir que barbouillages quelconques, travail de hasard, i] y avait au contraire application soutenue, désir d’approcher la vérité le plus près possible. Telle toile de Cezanne, d’aspect simple et tranquille, est le résultat de luttes acharnées, d’une fièvre de travail et d’une patience de six mois. C’était un spectacle inoubliable, me dit Renoir, que Cezanne installé à son chevalet, peignant, regardant la campagne : il était véritablement seul au monde, ardent, concentré, attentif, respectueux. Il revenait le lendemain, et tous les jours, accumulait ses efforts, et parfois aussi s’en allait désespéré, revenait sans sa toile qu’il laissait abandonnée, sur une pierre ou sur l’herbe, en proie au vent, à la pluie, au soleil, absorbée par le sol, le paysage peint repris par la nature environnante.
***
Mais on ne saurait pas cela, que les œuvres de Cezanne le diraient hautement, affirmeraient la tension vers le réel, cette patience, cette longueur de temps, cette nature d’artiste probe, cette conscience si difficilement satisfaite. Il est de toute évidence que le peintre est fréquemment incomplet, qu’il n’a pu vaincre la difficulté, que l’obstacle à la réalisation s’affirme pour tous les yeux. C’est un peu, et sans procédé, la touchante recherche des Primitifs. Il y a des absences de l’atmosphère, de la fluidité par laquelle les plans doivent s’espacer et le lointain se voir à sa distance. Les formes gauchissent parfois, les objets se mêlent, les proportions ne sont pas établies toujours avec la rigueur suffisante.
Mais ces remarques n’ont pas leur emploi devant chaque toile de Cezanne. Il a tracé et matérialisé complètement des pages infiniment expressives. Alors il déploie de beaux ciels mouvementés, blancs et bleus, il dresse dans un éther limpide sa chère colline de Sainte-Victoire, les arbres droits qui entourent sa demeure provençale du Jas de Bouffan, un mamelonnement de feuillages colorés et dorés, aux environs d’Aix, une pesante entrée de mer dans une baie rocheuse où le paysage est écrasé sous une atmosphère de chaleur.
On ne remarque plus la distribution arbitraire de lumière et d’ombre qui a pu surprendre ailleurs. On est en présence d’une peinture d’ensemble qui paraît d’un seul morceau et qui est exécutée longuement, à couches minces, qui a fini par devenir compacte, dense, veloutée. La terre est solide, le tapis de l’herbe est épais, de ce vert nuancé de bleuâtre qui appartient si bien à Cezanne, qu’il distribue par taches justes dans la masse des feuillages, qu’il étale par grands pans herbus sur le sol, qu’il mêle à la douceur moussue des troncs d’arbres et des rocs. Sa peinture alors prend une sourde beauté de tapisserie, se revêt d’une forte trame harmonieuse. Ou bien, comme dans les Baigneurs, coagulée et lumineuse, elle prend l’aspect brillant et blanc bleuté d’une faïence grassement décorée.
Je sais encore de Cezanne un portrait de jardinier qui est chez Paul Alexis, une toile trop grande, le vêtement vide, mais une tête solide, bien appuyée sur la main, des yeux ardents qui regardent réellement [R 756]. Et enfin, ce sont les fameuses pommes, que le peintre a aimé à peindre et qu’il a si bien peintes. Les fonds parfois avancent, mais les nappes, les serviettes sont si souples, de blancs si nuancés, et les fruits sont de si naïves belles choses. Vertes, rouges, jaunes, en petits tas de deux sous, posées sur des assiettes, ou versées à pleins paniers, les pommes ont la rondeur, la fermeté, les vives couleurs de nature qui s’harmonisent. Elles sont saines, parlent de rusticité, elles suggèrent la bonne odeur de fruits.
***
Quelque sujet qu’il ait abordé, il y a la vraie sincérité chez Cezanne, la marque parfois charmante, parfois douloureuse d’un vouloir qui se satisfait ou échoue. Souvent aussi, une grandeur ingénue, comme dans le Jardinier et dans les Baigneurs, où les figures incorrectes ont si fière tournure : ce baigneur, par exemple, qui appuie un pied sur un tertre, et qui prend, avec son visage triste, ses membres longs et musclés, une sorte d’apparence michelangesque, non cherchée, certes.
Que Cezanne n’ait pas réalisé avec la force qu’il voulait le rêve qui l’envahissait devant la splendeur de la nature, cela est certain, et c’est sa vie et la vie de bien d’autres. Mais il est certain aussi que sa pensée s’est révélée, et que la réunion de ses peintures affirmerait une sensibilité profonde, une rare unité d’existence. Sûrement cet homme a vécu et vit un beau roman intérieur, et le démon de l’art habite en lui.
GUSTAVE GEFFROY. »
Geffroy Gustave, « L’art d’aujourd’hui. Paul Cezanne », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 544, dimanche 25 mars 1894, p. 1 ; repris par Geffroy Gustave, « Paul Cezanne », La Vie artistique, 3e série, Paris, E. Dentu, éditeur, 1894, 395 pages, p. 249-260 ; repris par Geffroy Gustave, La Vie parisienne, 3e série, 16 novembre 1895, ?
Destrem Jean, « Gustave Geffroy. La Vie artistique », Le Rappel, jeudi 18 mai 1894, 28 floréal an 102, n° 8833, p. 1-2, Cezanne p. 2, citation d’un extrait de La Vie artistique :
« CÉZANNE : « C’était un spectacle inoubliable me dit Renoir, que Cezanne installé à son chevalet, peignant, regardant la campagne ; il était véritablement seul. Il revenait le lendemain, et tous les jours, et parfois aussi s’en allait désespéré, revenait sans sa toile qu’il laissait abandonnée sur une pierre ou sur l’herbe. » »
[Mars]
Lettre de Geffroy à Monet, datée jeudi ; vente Archives de Claude Monet, collection Cornebois, Paris, hôtel Dassault, 13 décembre 2006, n° 129 :
« Ce que vous me dites pour Cezanne m’a fait plaisir. Je n’ai de lui aucune nouvelle, et ne sais s’il a lu mon article. Envoyez-le-lui donc si vous avez à lui écrire. Je serais heureux de lui avoir été agréable en disant ce que je pense ».
26 mars
Cezanne, qui est à Alfort (aujourd’hui Maisons-Alfort), remercie Gustave Geffroy de son article paru la veille.
« Alfort, 26 Mars 1894,
Monsieur,
j’ai lu hier la longue étude, que vous avez consacrée à mettre en lumière les tentatives que j’ai faites en peinture. Je voulais vous en témoigner ma reconnaissance pour la sympathie que j’ai rencontrée en vous.
Veuillez agréer mes remercîments et l’assurance de mes meilleurs sentiments,
Paul Cezanne »Lettre de Cezanne à Geffroy, datée « Alfort, 26 Mars 1894 » ; reproduction sur le site internet paulfrasercollectibles.com ; Geffroy Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Crès, 1922, 362 pages, p. 200 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 239. Vente du 25 mars 2020, Autograph Letters, Historical Documents & Manuscripts, International Autograph Action Europe, Malaga (Espagne),lot 327, est. 7 000-10 000 €
Dans cette période, il peint et dessine les bords de Marne, à Alfort, Saint-Maur, Créteil et Saint-Maurice (Le Moulin des Corbeaux, Saint-Maurice, C1143).
Rivière Georges, Le Maître Paul Cezanne, H. Floury éditeur, Paris, 1923, 243 pages, p. 204 :
« Le Pont Brûlé. [FWN635-R242] Bords de la Marne à Alfort. Les arches de pierre du pont seules subsistent ; derrière les ruines, on aperçoit un moulin. [FWN287-R765] »
Mars ou avril
Cezanne séjourne à Barbizon selon le témoignage de William Vogt.
Vogt William, « Cezanne et Zola », L’Éventail, Genève, n° 2, 15 décembre 1917, p. 47-58, voir ce texte plus bas, rubrique « Été ».
Avril
Sur le livret militaire de Paul junior, un visa de la gendarmerie indique comme adresse 2, rue des Lions-Saint-Paul (renseignement communiqué par Philippe Cezanne).
9 avril
Le peintre Jean-Léon Gérôme proteste vigoureusement contre l’acceptation du legs Caillebotte :
Gérôme :
« Monsieur, nous sommes dans un siècle de déchéance et d’imbécilité. Et je ne parle pas seulement au point de vue de l’Art, non… c’est la société entière dont le niveau s’abaisse… Caillebotte ? N’a-t-il pas fait de la peinture lui-même ? Je n’en sais rien — je ne connais pas ces messieurs, et de cette donation, je ne connais que le titre — il y a là-dedans de la peinture de M. Manet, n’est-ce pas ? — de M. Pissarro et d’autres ? — Je le répète, pour que l’État ait accepté de pareilles ordures, il faut une bien grande flétrissure morale… C’est l’anarchie partout et l’on ne fait rien pour la réprimer. Sur la foi d’Octave Mirbeau, je me suis risqué à l’exposition de Pissarro. Ma stupéfaction a été grande, rien, rien… Il y en a qui peignent comme ça, d’autres comme ça, en petits points, en triangles, que sais-je ; je vous le dis, tout ça, des anarchistes ! et des fous. Ces gens-là peignent chez le Dr Blanche… ils font de la peinture sous eux vous dis-je… »
Gabriel Ferrier :
« Je ne peux pas vous parler longuement de ces gens-là, parce que je ne les connais pas et ne veux pas les connaître. Quand j’aperçois quelque chose d’eux, je me sauve au plus vite. Si je passe rue Lafitte devant la boutique bleue, je traverse de l’autre côté…
En résumé, je ne crois pas à ces artistes. Je ne crois pas à la sincérité des gens qui les préconisent, c’est une question de boutique, c’est un coup de Bourse et mon avis est très carré, les uns et les autres, c’est à coups de pied au derrière qu’on doit les traiter… »
Machard :
« Certainement le mouvement qui comprend Courbet, Manet, Monet est intéressant. Ils ont protesté contre la peinture rance, ils ont apporté dans l’art une note de lumière. Mais je trouve exorbitante la prétention d’imposer une série de leurs toiles au Musée du Luxembourg. »
Bataille Henri, Le Journal des artistes, 9 avril 1894.
Leseaux Gaston, Le Moniteur, 24 mars 1894. À voir
Mai
Lucien Pissarro demande à son père qu’il essaie de lui « procurer des pinceaux courts, comme ceux dont se servait Cezanne ».
Lettre de Lucien Pissarro, Eragny House, Epping (Essex), mai 1894, à son père ; Thorold Anne (édité par), The Letters of Lucien to Camille Pissarro 1883-1903, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 796 pages, p. 362.
2 juin
Vente en faveur de la veuve de Tanguy, organisée par Mirbeau, à l’hôtel Drouot. La vente est composée de tableaux de la boutique du marchand : notamment un Seurat, un Signac, deux Pissarro, deux Sisley, deux Van Gogh, quatre Guillaumin, six Gauguin et six Cezanne, et d’œuvres offertes par des artistes tels que Cassatt, Morisot, Monet, Pissarro, Puvis de Chavannes, Renoir, Rodin. La vente atteint des prix dérisoires. Quatre des six tableaux de Cezanne sont achetés par Vollard, « un marchand de tableaux nouvellement établi rue Laffitte » :
n° 5 Ferme. 60 x 73 cm. [145 francs : Murat ; peut-être FWN138-R408]
n° 6 Village. Etude. 50 x 60 cm. [toile crevée ; 102 francs ; Malcoud, peut-être FWN79-TA-R199]
n° 7 Village. 46 x 55 cm. [175 francs ; Volat (sic, pour Vollard ) ; FWN168-R497]
n° 8 Les Dunes. 55 x 46 cm. [95 francs ; Volat (sic) ; probablement FWN111-R382]
n° 9 Coin de village. 45 x 54 cm. [215 francs ; Volat (sic) ; FWN174-R502]
n° 10 Le Pont. 60 x 73 cm. [170 francs ; Volat (sic) ; FWN173-R500]
Catalogue des tableaux modernes, pastels, aquarelles, dessins, gravures, sculpture, dont la vente aura lieu au profit de Mme Vve Tanguy, hôtel Drouot, salle n° 2, le samedi 2 juin, à 2 heures 1/2, Me Paul Chevallier, commissaire-priseur, M. Georges Petit, expert.
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne : A Catalogue raisonné, New York, Harry N. Abrams, 1996, notice 500.
Procès-verbal de la vente, Archives de Paris, D48 E3 art 79 n° 7994
Lettre de madame Tanguy à Dries Bonger ; 12 juin 1894, Bodelsen Merete, « Early impressionist sales 1874-1894 in the light of some unpublished « procès-verbaux » », The Burlington Magazine, juin 1968, p. 346.
« Échos. À travers Paris », Le Figaro, 40e année, 3e série, n° 152, vendredi 1er juin 1894, p. 1 :
« Aujourd’hui, à l’hôtel Drouot, exposition des tableaux et dessins qui seront vendus samedi, au bénéfice de la veuve du « père Tanguy ». »
« Informations. Vente de charité », Journal des débats politiques et littéraires, 106e année, dimanche matin 3 juin 1894, p. 2 :
« Vente de charité. On a vendu, hier, à. l’hôtel Drouot, un certain nombre de tableaux modernes, pastels, aquarelles, dessins et gravures au profit de la veuve d’un marchand de couleurs, le Père Tanguy, ainsi que l’appelaient familièrement tous les artistes qui eurent recours, en des jours malheureux, à ses bons offices. Le brave homme leur fournissait, en effet, à crédit, palettes, peintures, pinceaux et chevalets, et il était si peu exigeant pour les payements qu’il se ruina par amour de l’art.
Quelque temps avant de mourir il avait dit à sa vieille compagne : Sois tranquille, ces messieurs ne te laisseront pas mourir de faim… Le père Tanguy ne s’était pas trompé. Les artistes sont venus en aide à Mme Tanguy en organisant cette vente qui a produit, hier, 14,260 fr. Plus de cinquante artistes avaient envoyé une ou plusieurs œuvres.
Parmi les enchères, il faut citer Un paysage de Cazin, 2,900 fr. ; Coin de village, de Cezanne, 215 fr. ; Bordighiera, de Claude Monet, 3,000 fr. ; »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 69 :
« il avait fini par enfermer dans sa malle « ses Cezanne », qui, après sa mort, ne furent guère disputés à l’Hôtel Drouot (1).
(1) Cezanne. Ferme, hauteur 60 cm., largeur 73, 145 fr.
— Village, hauteur 46 cm., largeur 55, 175 fr.
— Coin de village, hauteur 45, largeur 54, 215 fr.
— Le Pont, hauteur 60 cm., largeur 73, 170 fr.
(Gazette de l’Hôtel Drouot, 19 juin 1894.) Un Cezanne [Les Dunes] ne fut pas mentionné par la Gazette de l’hôtel Drouot, celle-ci n’ayant pas rendu compte des ventes au-dessous de 100 francs (Note de l’auteur.). »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 36-37 :
« À la vente Tanguy, j’eus cinq [quatre, en fait] toiles de Cezanne pour environ neuf cents francs. Quand on régla les achats, le commissaire-priseur, M. Paul Chevallier, me félicita pour le cran que j’avais montré — il faut dire que les enchères avaient commencé à dix francs. Devant ce compliment, je n’en éprouvai que plus d’embarras à lui avouer que je ne possédais que trois cents francs. Je lui proposai de les lui verser à titre d’arrhes jusqu’au moment où je pourrais prendre livraison de mon achat. Il me regarda un instant. « Non ! emportez vos tableaux. Vous me réglerez d’un seul coup, dès que vous le pourrez. » Le brave homme que M. Chevallier ! Ce souvenir m’aide à m’expliquer qu’à sa mort on ait trouvé, dans son coffre-fort, tant de bordereaux en souffrance. »
Roger-Milès L., « Au jour le jour. La vente Tanguy », Le Figaro, 40e année, 3e série, n° 149, mardi 29 mai 1894, p. 1.
« Au Jour le Jour
LA VENTE TANGUYIl ne s’agit pas ici d’une collection réunie à grands frais, et à la veille d’être dispersée, après avoir procuré à son propriétaire une longue joie des yeux ; mais d’une collection improvisée en quelques jours par ce levier, autrement puissant que la fortune, la charité, toujours admirable d’élan, quand elle est aidée par les artistes.
Il y a quelques mois, à mi-côte de Montmartre, rue Clauzel, un vieux brave homme s’éteignait, « le père Tanguy », bien connu de ceux qui allaient lui acheter des couleurs à crédit et le payaient après de longs délais, avec des toiles alors d’un placement difficile. Tanguy ne se plaignait pas ; il avait la foi ardente des vocations à venir ; il croyait à toutes les audaces de pinceau, en apôtre rêveur, sans aucune pensée de lucre, et sur toute une génération de débutants il exerça, la lèvre souriante, la main loyalement tendue, le mécénat de la bouchée de pain, qui sauve des chutes désespérées, et de l’instrument de travail, qui préserve de la paresse. Mais à ce métier-là on ne fait pas fortune.
Le père Tanguy est mort, laissant dans un dénûment complet sa pauvre vieille. Cette misère, très digne et tenue cachée, fut devinée cependant par quelques amis. Des premiers, Octave Mirbeau s’en émut ; en vingt-quatre heures il eut vite fait de constituer un comité auquel adhéraient MM. Arsène Alexandre, Bergerat, Carrière, Cazin P. Chevallier, H. Fouquier, G. Geffroy, Ph. Gille, Roger Marx, C. Monet, Georges Petit, C. Pissarro, J.-F. Raffaëlli, Renoir, A. Rodin et d’autres encore.
M. Puvis de Chavannes, le maître aimé, accepta la présidence. En principe, il fut décidé qu’on organiserait une petite vente, sans bruit, comme Tanguy avait toujours vécu. Voici, à cet effet, la belle lettre que M. Puvis de Chavannes, en son nom et au nom du Comité, adressa, il y a quelques jours, aux artistes, sans distinction d’école ou de société :
Monsieur,
Encore un appel à votre inépuisable charité. Il s’agit de secourir une vieille de soixante-quatorze ans, la veuve d’un original, brave et digne homme, depuis cinquante ans fabricant de couleurs et de toiles, « le père Tanguy », bien connu de la plupart des peintres, dont les commencements difficiles ne permettaient pas toujours d’acheter au comptant. « Le père Tanguy », très pauvre lui-même, s’est souvent passé de souper, afin de pouvoir fournir la commande d’un de « ces messieurs », comme il disait. On le payait quand on pouvait ; aussi est-il mort misérable, en rassurant sa vieille compagne par ces paroles « Sois tranquille, ces messieurs ne te laisseront pas mourir de faim. »
Nous nous sommes réunis quelques-uns pour organiser une vente de tableaux, de dessins, de sculpture, et nous vous demandons, Monsieur, de bien vouloir nous aider à exaucer le vœu du « père Tanguy».
Agréez, etc.
Puvis de Chavannes.
Les réponses ne se sont pas fait attendre ; déjà, chez Georges Petit, où les œuvres sont centralisées, nous avons pu voir d’excellentes peintures signées de MM. Claude Monet, Rochegrosse, Maurice de Lambert, Augrand, Signac, Ed. Cross, Carrier-Belleuse, Delpy, Berthe Morisot, Wagner, Petitjean, Lauth, Barillot, Schuller, Cabrit, Chudant, Jean Benner, Rodolphe Ernst, Jeanniot, Sisley, Léandre, Camille, Georges et Lucien Pissarro, Dauphin, Dagnaux, Vauthier, Luce, Kaplein, Vignon, Prouvé, Guillemet, Nozal, Detaille, Renoir, Moutte, Raffaëlli, Eliot, Gyp, Duez, Béthune, d’autres encore dont je ne retrouve pas le nom dans mes notes.
Et ce n’est pas tout. Nombre d’artistes ont demandé au comité de reculer les délais d’adhésion, expliquant leur désir de collaborer à cette œuvre de bonne charité et l’impossibilité où ils sont de le faire en ce moment, avec la préparation de leurs envois ici et là, pour les expositions officielles, à Paris, Lyon, Anvers, etc. Or, le comité a fait droit à cette requête et retardé la vente jusqu’aux derniers jours de mai. Cette manifestation, dont l’admirable effort de la solidarité de tous les artistes fait une grande vente, aura donc lieu à l’époque où les amateurs de France et de l’étranger se pressent dans l’hôtel Drouot pour les enchères solennelles. Le marteau de P. Chevallier adjugera aux collectionneurs qui se les disputeront les fleurs d’art épanouies autour de la mémoire du père Tanguy :tous les concours se sont généreusement offerts pour cette tâche de gratitude et de charité. Qu’il nous soit permis d’adresser dès maintenant l’expression de nos remerciements sincères à tous les artistes qui, oubliant les querelles d’école et les divergences d’opinion, ont répondu avec tant de bonne grâce à l’appel du comité.
L. Roger-Milès. »
Geffroy Gustave, « Notre temps. La vente Tanguy », La Justice, 15e année, n° 5251, vendredi 1er juin 1894, p. 1 :
« NOTRE TEMPS
LA VENTE TANGUYDans quelques jours aura lieu, chez Georges Petit, la vente Tanguy.
Qu’est-ce que la vente Tanguy ? C’est un exemple nouveau de la solidarité des artistes. Octave Mirbeau dans l’Écho de Paris, puis Roger Milès, dans le Figaro, ont raconté comment un vieux marchand de couleurs de la rue Clauzel vers Montmartre, « le père Tanguy » mourait en laissant sa vieille femme dans un dénument absolu. Mirbeau donna sou éloquence, sa passion à cette humble cause. Il écrivit, comme il écrit, un article improvisé qui est une page, il montra le bonhomme dans sa boutique, le marchand devenu apôtre, croyant au génie et à l’avenir des peintres débutants qui achetaient chez lui leurs couleurs et le payaient quand ils pouvaient, et comme ils pouvaient, avec quelque toile qui faisait le plus souvent se cabrer l’amateur.
Il s’est trouvé que le père Tanguy eut raison pour plus d’un, que nombre de ses anciens clients sont devenus célèbres. Célébrité ne veut pas dire richesse, et d’ailleurs, la médiocre situation du vieux ménage était de celles qui n’apparaissent pas. Le bonhomme et la bonne femme continuaient paisiblement leur commerce, et voilà, tout. C’est lorsque la mort fit son entrée que la vérité fut connue.
Mirbeau fit. plus qu’un article. Il prit l’affaire à cœur, ne l’abandonna plus une fois commencée, réunit un comité dont Puvis de Chavannes accepta la présidence et qui fut composé de Rodin, Claude Monet, Renoir, Eugène Carrière, Raffaëlli Camille Pissarro, Georges Petit, Philippe Gille, Henry Fouquier, Cazin, Bergerat, P. Chevallier, Roger Milès, Roger Marx, Arsène Alexandre, etc. Puis la lettre suivante fut écrite à nombre d’artistes par le président au nom du comité :
Monsieur,
Encore un appel à votre inépuisable charité. Il s’agit de secourir une vieille de soixante-quatorze ans, la veuve d’un original, brave et digne homme, depuis cinquante ans fabricant de couleurs et de toiles, « le père Tanguy », bien connu de la plupart des peintres, dont les commencements difficiles ne permettaient pas toujours d’acheter au comptant. « Le père Tanguy » très pauvre lui-même, s’est souvent passé de souper, afin de pouvoir fournir la commande d’un de « ces messieurs », comme il disait. On le payait quand on pouvait ; aussi est-il mort misérablement, en rassurant sa vieille compagne par ces paroles : « Sois tranquille, ces messieurs né te laisseront pas mourir de faim. »
Nous nous sommes réunis quelques-uns pour organiser Une vente de tableaux, de dessins, de sculpture, et nous vous demandons, Monsieur, de bien vouloir nous aider à exaucer le vœu du « père Tanguy ».
Agréez, etc.
Puvis de Chavannes.
Le résultat fut tel qu’on pouvait le souhaiter. Hier, Roger Milès énumérait les peintures déjà réunies chez Georges Petit et citait les noms de Claude Monet, Rochegrosse, Maurice de Lambert, Angrand, Signac, Ed. Cross, Carrier-Belleuse, Delpy, Berthe Morisot, Wagner, Petitjean, Lauth, Barillot, Schuller, Cabrit, Chudant, Jean Benner, Rodolphe Ernst, Jeanniot, Sisley, Léandre, Camille, Georges et Lucien Pissarro, Dauphin, Dagnaux, Vauthier, Luce, Kaplan, Vignon, Prouvé, Guillemet, Nozal, Detaille, Renoir, Moutte, Raffaëlli, Eliot, Gyp, Duez, Béthune.
Il y aura d’autres noms, et probablement une autre liste pourra être publiée dans quelques jours. Le fonds de Mme Tanguy contient aussi des toiles infiniment curieuses maintenant recherchées, de Cezanne, de Gauguin… et enfin, le présent article, comme ceux de mes camarades, porte le fait à la connaissance des artistes qui l’ignoreraient, aux quelques-uns que je connais, comme à ceux que je ne connais pas. Qu’ils préviennent Georges Petit, on ira chercher leur toile, leur pastel, leur dessin, et, grâce à eux, la vieillesse sera réconfortée, l’exemple de bonne humanité aura été donné une fois encore.
Gustave Geffroy. »
12 juin
À la suite de la vente, Mme Vve Tanguy (Renée Julienne Tanguy-Briend, 1821-1897), écrit à Dries Bonger :
« Je répond à votre lettre Pour vous faire savoir que jaie bien reçu les deux cents franc. Je vous remercie bien Cher Monsieur Vous me demandez quelques détails de ma vente ; Je vous dirai quel a en effet eu lieu le 2 juin mais elle n’a pas Produir cequelle aurait due Produire si sa cétaient vandu chez george petit car il y aurait eu beaucoup plus damateur qua l’hotel drouot […] car je dois vous dire que javais de très belle chose a ma vente et malheureusement sa été donné pour rien. Car il ny avaient Pour ainsi dire que des marchand de tableaux et ils setaient donné le mot entre eux Pour ne pas faire monter les Prix avec tout ce quil y avait de monde mont dit que je Pouvais grandement faire de 20 a 25 mille francs et tandis que sa na montee que quatorze mille 191 franc et jaurai dans les deux mille 500 a 3000 franc de frais il est probable et je vous dirai que les toile de Cezanne et de guillaumin ont été vendu très bon marché C’est Monsieur Vollard marchand de tableaux nouvellement établi rue laffite qui a eue tout les Cezanne et si je n’avais pas eue 4 ou 5 maitre qui mavait donne une toile Je n’aurai rien fait de ma vente. 1 claude monet s’est vendu 3000 1 cazin 2900 les Pissarro 400 les gaugain ont ete vandu très bon marché les plus cher a 100 franc mais mon cher Mr Bonger quoi que cela je suis tout de meme bien heureuse davoir été protégé par Mr Mirbeau car je serai resté avec rien nous sommes toujours rue Clauzel jusque quand je puisse finir de liquider ma marchandise. je ne trouve personne pour acheter tout ce quil me reste il nous tarde bien a nous trois d’être débarasé de la boutique. Monsieur Bonger Je vous dirai que jaie toujours le Cezanne chez nous et nous somme très heureux de ne pas lavoir envoyé a la vente Car il est le plus beau de tous. Monsieur je termine ma lettre et vous prie d’agréer mes profond respects bien mes compliments a votre dame de ma part. mes enfants se joignent a moi Pour vous dire bien des choses Mme Van Gogh ne ma toujours pas répondu a ma lettre que je lui avait écrit quand vous êtes venu a paris Je vous envoie le recu des deux cent francs.
Vve Tanguy 9 rue Clauzel. »Lettre de Mme Vve Tanguy à Dries Bonger, 12 juin 1894 ; Tralbaut Mark Edo, « André Bonger, l’ami des frères van Gogh », Van Goghiana, I, sans date (1973 ?), p. 5-54, cité p. 45-46.
Les deux cents francs envoyés par Bonger à Mme Tanguy correspondent peut-être au paiement en partie d’une toile de Cezanne, « Petite ville de l’île de France » (FWN144-R414), qu’il lui a achetée en 1894, pour 300 francs. Cette toile est vue sur une photographie de 1904, accrochée à un mur de la maison de Bonger, 56, Stadhouderskade, à Amsterdam.
Leeman Fred, Odilon Redon and Émile Bernard. Masterpieces from the Andries Bonger Collection, Amsterdam, Van Gogh Museum, Zwolle, Waanders Publishers, 156 pages, p. 117 ; photo, Archives Bonger, Amsterdam, Rijksmuseum, illustration n° 96, p. 96.
20 juin
Ferdinand Dufau, propriétaire de la Galerie Vivienne, à Paris, achète à Vollard « 1 tableau de Cezanne Coin de Village », (Maisons et sapins, FWN174-R502) pour 800 francs, payé en échange de deux aquarelles de Félicien Rops de 300 francs et en argent. Vollard avait acheté une peinture portant ce titre à la vente Tanguy du 2 juin 1894 pour 215 francs.
Registre commercial de Vollard, 20 juin 1894 – 3 novembre 1897, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,2) f° 1.
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman, volume I « The Texts », 592 pages, 955 numéros, New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, notice 502, p. 335.
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 34-35 :
« Je me laissai aller à dire à M. Chéramy :
— Et quelque chose de Cezanne ? Est-ce que les « Amis du Luxembourg » ?…
Alors, M. Chéramy sévère :
— Cezanne ?… Pourquoi pas Van Gogh ? L’homme de la rue ne pensait pas différemment.
Quand, en 1894, je fis une exposition du Maître d’Aix, j’entendis, un jour, comme une altercation devant mon magasin. Une jeune femme était maintenue par une solide poigne d’homme devant un tableau de Baigneuses.
— Me forcer à voir ça, moi qui ai eu un prix de dessin à la pension !
— Eh bien, ma petite, repartit l’homme, ça t’apprendra, une autre fois, à être plus gentille avec moi.
Du moins, cette protestataire n’appartenait pas à la critique d’art. Or, un des écrivains dont celle-ci se réclame volontiers en raison de ses tendances modernes ne devait-il pas, à propos de cette même exposition, déplorer que « le maigre savoir de Cezanne le trahît » et le fît échouer « dans l’art d’espacer les plans, de donner l’illusion de l’étendue » ? [Lecomte Georges, « Paul Cezanne », Catalogue de tableaux, aquarelles, pastels et dessins composant la collection de M. E. Blot et dont la vente aura lieu à Paris hôtel Drouot les mercredi 9 et jeudi 10 mai 1900]
C’était encore pis pour Van Gogh ; les plus audacieux même n’arrivaient pas à « encaisser » sa peinture. Comment s’étonner de celle résistance du public, quand on voyait les plus affranchis des artistes, comme Renoir et Cezanne, l’un faire grief à Van Gogh de son « exotisme » et l’antre lui dire ; « Sincèrement, vous faites une peinture de fou ! » »
Juillet
Rewald John, Cezanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 205.
« En juillet, Renoir découvrit encore une dizaine de tableaux ayant appartenu à Caillebotte, dont six s’ajoutèrent au legs. Un peu plus tard, Martial Caillebotte trouva six toiles supplémentaires, de sorte que le nombre des œuvres de Pissarro passa de treize à dix-huit et le nombre des œuvres de Sisley de huit à neuf. »
Voir Marie Berhaut, « Le legs Caillebotte. Vérités et contre-vérités », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, année 1983 [1985].
Été
L’écrivain suisse William Vogt rencontre Cezanne dans une auberge près de Barbizon. Il le relatera bien plus tard.
Vogt William, « Cezanne et Zola », L’Éventail, Genève, n° 2, 15 décembre 1917, p. 47-58 :
« CÉZANNE ET ZOLA
Voilà bientôt vingt-cinq ans de cela, sinon plus.
C’était par une journée admirable de premier printemps où tout, dans la nature, faisait irruption, impétueusement. L’air était exquis de fraîcheur et sous le soleil déjà chaud, les arbustes, les plantes et les êtres animés frémissaient dans la secousse de l’éclosion à cette vie nouvelle. Au delà d’une clairière où bourdonnaient mouches et guêpes, où venaient se poser, pendant une seconde, les premiers papillons jaunes et bruns, je venais de voir bondir un cerf escorté de son sérail, lorsqu’au détour d’un sentier, je perçus au loin les premières maisonnettes de Barbizon. Ayant hâté le pas, j’arrivai, à l’heure du déjeuner, l’estomac dans les talons. L’auberge qui m’ouvrit ses portes était modeste, mais de bon aloi et de note gaie avec ses pampres, sa verdure et son écusson. A table, attaquant l’omelette, deux dames, la mère et la fille.
— Nous allons placer Monsieur à coté de M. Cezanne ? interrogea l’hôtesse en jetant un coup d’œil interrogateur à ses pensionnaires.
— Oh ! Monsieur peut sans craindre prendre la place de M. Cezanne, dit la jeune fille, une longue brune que sainte Catherine devait avoir déjà baisé au front.
— Vous savez bien, Madame Jacqueline, que M. Cezanne arrive toujours lorsque nous nous levons de table, observa d’une voix aigre Mme Mère.
— Quand il est au travail, il ne s’aperçoit pas de l’heure qui passe, expliqua l’hôtesse, en me priant de m’asseoir en face des deux dames.
— Ah ! le beau travail ! le beau travail ! s’écrièrent à la fois mère et fille, en éclatant d’un rire bruyant qui me blessa par sa vulgarité de nargue. Ah ! parlons-en de son travail, Madame Jacqueline !
Mais Mme Jacqueline, comme si elle avait connu le leitmotiv, venait de disparaître du côté de la cuisine.
— Vous parlez, Mesdames, d’un M. Cezanne. Serait-ce peut-être l’ami de Zola, ce peintre auquel le pamphlétaire dédia jadis « Mes Haines » et dont il parle ?…
— Cela se pourrait fort bien, Monsieur, me répondit la demoiselle, quoique M. Cezanne ne nous ait jamais parlé de Zola.
— Oh ! c’est lui, c’est sûrement lui, affirma péremptoirement la matrone.
Puis d’un ton dédaigneux, elle ajouta :
— Les deux font la paire !
— L’un commet en littérature ce que l’autre bousille sur la toile, aigrechonna la Princesse.
Je réprimai un sourire et j’allais peut-être répondre, même durement, car j’étais alors — et le suis resté — un admirateur de l’« Assommoir », de l’« Œuvre » et de « Germinal ». Mais allez donc placer un mot quand Mme Mère est lancée.
— Ma fille fait aussi de la peinture, monsieur. Seulement de la peinture, de la vraie peinture. Elle appartient à la classe de Monsieur…
Le cas est grave, la situation critique et je n’ose assumer de responsabilité. Madame Mère a-t-elle nommé Courtois, Cormon ou Gervex ? Mes souvenirs datent de trop loin et je tremble d’affirmer.
— Mignonne, tu voudras bien montrer ton sous-bois à Monsieur.
— Oui, maman, mais tu sais bien, la toile « gondole » ; le cadre…
— Cela ne fait rien, monsieur est peintre.
— Moi ? Mais non, madame…
— C’est délicieux ce sous-bois, monsieur, vous l’admirerez. Combien je me réjouis de rentrer à Paris pour le faire voir a nos amis qui sont, eux, des…
Un homme paraissant âgé d’une cinquantaine d’années entra, en saluant. D’un air un peu effaré, il alla déposer sa boîte à couleurs dans un coin, puis vint s’asseoir à mes côtés, en face de la dame qui continuait à parler, en dardant sur moi deux yeux dominateurs, comme pour me suggestionner de distraire mon attention du survenant et la fixer sur le sous-bois de sa fille.
— Oui, monsieur, nous avons des amis, ma fille et moi, qui sont des critiques éclairés, des amateurs qui savent ce que c’est que la vraie, la bonne peinture. Tiens ! mignonne, Lefébure, le marchand de glaces, au coin du boulevard Poissonnière, un vieil ami de la famille, établi là depuis plus de trente ans, car nous sommes de Paris, nous. Moi, je suis née rue Turbigo, feu mon mari place de la Sorbonne et Lefébure à Ménilmontant. Eh bien, Lefébure, il sera transporté en voyant ton sous-bois, fillette ! Voilà un homme de goût, un connaisseur et je suis bien sûre qu’il n’a jamais lu « Nana ». Et M. Thomasset, le marchand de papiers peints, porteur du ruban violet, lui aussi il est de Paris, lui aussi connaît et admire la bonne peinture…
L’intellect absorbé par sa portion de lapin sauté, Cezanne qui n’était pas né rue Turbigo et dont la boutonnière devait rester vierge jusqu’à la mort, Cezanne regardait son assiette, faisant le gros dos et laissant passer l’orage. Quant à moi, je tentais en vain, par quelques mots, placés au hasard, d’atténuer l’effet désagréable de cette sortie, où les allusions sifflaient. Quand, à bout de souffle, la mère s’interrompait, aussitôt la fille de reprendre, d’une voix moins aigre toutefois, mais avec tout autant de prétention féminine et bourgeoise. Pour elle, Albert Wolff, écrivant au « Figaro », était l’oracle.
A la fin, poussé à bout par leur tranchante malhonnêteté vis-à-vis de Cezanne, dans lequel je croyais deviner le pauvre honteux, l’incompris timide et réservé ; craignant aussi qu’elles n’arrivassent à le faire partir par leur mise en demeure que la politesse m’empêchait jusque là d’éluder, je finis par me mettre en colère, déclarant que Francisque, en fait d’art, n’était qu’une baderne et Albert une andouille. J’ajoutai que, cinq ans après leur mort, il ne resterait plus souvenir des critiques désespérément terre-à-terre de l’un et des verdicts absurdes de l’autre.
Je parlai avec véhémence, mais n’eus point l’heur de terminer ma démonstration : un regard foudroyant, un coup de coude à sa fille, un salut dédaigneux et les deux femmes disparurent du coté de la cuisine dans un bruissement irrité de jupes et de cotillons.
Cezanne leva alors les yeux vers moi et sourit doucement.
— Pardon, monsieur, fis-je sans autre préambule, seriez-vous peut-être le Cezanne de Zola ?
— Ah ! Zola. Vous-connaissez Émile ?
Il me demandait cela avec une sorte de violence attendrie.
— Mais oui, durant toute la jeunesse nous avons vécu comme deux frères, inséparables comme les deux doigts de la main, à Marseille, à Arles. Y a-t-il longtemps, monsieur, que vous ne l’avez vu ?
Je lui dis mon enthousiasme pour les articles de combat qui paraissaient alors dans le « Figaro », ma prédilection pour l’« Œuvre ».
Cezanne, je m’en souviens, se défendit d’avoir inspiré le personnage de Claude et ne pouvait se reconnaître en ce fiévreux idéalisé » Cependant, la tendresse admirative dont le peintre entourait l’écrivain m’avait ému. Quelle belle nature, confiante et timide, que cet ignoré qui, après sa mort, devait tant exciter la critique !
Après le café, sur ma demande, nous montâmes dans sa chambre pour voir ses études, mais causant toujours de Zola et de sa jeunesse. Je l’avoue, une fois là-haut, devant ces plâtras qui me parurent informes, représentant un paysan dans son sarreau bleu, en face d’une petite esquisse dont je ne compris même pas la signification, je ne pus dissimuler ma gêne, et cela malgré mon désir d’être agréable à l’auteur. Je n’y comprenais littéralement rien et pourtant je n’étais point tout à fait bouché à l’émeri en ce qui concernait les tendances nouvelles. J’appartenais, d’intuition et de cœur, à toutes les écoles révoltées, admirant Delacroix, exaltant Manet. Mais, là devant, je restais baba. Mon ahurissement que je ne parvenais pas à cacher, me causait une peine énorme ; je ne pouvais tirer un mot du gosier et ce fut pour moi un véritable crève-cœur, lorsque après un long moment, je vis Cezanne, respectueux de mon silence, tourner ses deux toiles contre le mur, laissant les autres, comme résigné à son sort douloureux de ne pas être compris, même par ceux qui lui témoignaient de l’affection. En descendant l’escalier, il me dit cette phrase qui me surprit au plus haut degré :
— Le paysan… pas l’esquisse… Le paysan, je voudrais bien l’exposer aux Champs-Élysées, En me faisant recommander à Bouguereau, à qui ma peinture peut plaire…
Textuel ! Cet homme était d’une telle candeur de grand artiste honnête, d’une innocence si loyale qu’il était à cent lieues de se douter que son envie de suspendre une toile aux Champs-Élysées et sous l’égide de Bouguereau, avait quelque chose de monstrueux. Voilà vraiment qui me semblait encore plus incompréhensible que sa peinture.
Une fois dans la rue, il leva la tête, vit le ciel bleu :
— Bah ! je ne travaillerai pas cette après-midi. Vous n’avez pas de projets, monsieur ? Si je vous montrais quelques beaux sites dans la forêt.
J’acceptai avec plaisir.
Tout en cheminant, il recommença à parler de Zola.
A sa voix, à son geste, à son effusion chaude, on sentait que, depuis longtemps, cet être affectueux vivait isolé, et qu’avant rencontré un jeune homme s’intéressant au mouvement artistique, il éprouvait grande joie à s’entretenir avec lui d’un ami qui lui tenait tant au cœur.
— Ah ! bien oui, Zola. Au collège, dans le Midi, tous les prix de composition lui étaient attribués et certains morceaux écrits par ce potache de quinze ans avaient étonné les professeurs les plus difficiles. Publiée aujourd’hui, telle description dont Cezanne avait gardé religieusement copie, ferait figure dans le plus beau livre du Maître.
Nous marchions ne donnant que maigre et distraite attention aux sites. Tout aux confidences de l’adorable brave homme, j’écoutais. Nous nous arrêtions bien, de temps à autre, lui m’indiquant l’arbre ou le rocher célèbres, mais après un : « Oui c’est curieux ! » ou un : «Tiens ! Flaubert en parle dans « l’Éducation sentimentale », nous reprenions notre marche.
Pendant plus de dix ans, je crois, les deux frères ne s’étaient pas quittés d’une semelle. La vie de l’un et celle de l’autre avaient été tellement mêlées depuis le collège que les deux existences faisaient partie l’une de l’autre. Zola dominait apparemment, car Cezanne ne semblait avoir vécu que par lui, à cette époque, admirant l’écrivain et dans ses actes et dans ses théories, transporté de gratitude aussi en voyant son idole s’intéresser a ses premiers essais de peinture réaliste. Ceci, Cezanne ne le disait peut-être point, mais l’empire de Zola sur son camarade, l’admiration absolue qu’il lui inspirait encore se devinaient dans le récit simple, attendri de ses souvenirs d’antan. Cezanne évoqua les promenades, les confidences, les projets d’avenir. Et tout cela était raconté d’une façon exquise avec, de temps en temps, des expressions de là-bas qui nous faisaient rire.
— Émile partit pour Paris. Oh ! moi qui étais resté à Aix, je lui écrivais presque toutes les semaines. Il répondait par des pages superbes, ponctuellement, en homme de devoir, car je ne crois pas qu’il ait jamais laissé dans sa vie une lettre sans réponse, celle-ci fût-elle insignifiante et écrite par un inconnu. Par la suite, comme il est naturel, notre correspondance s’espaça. Nous nous revîmes, an jour, à Marseille, où il se trouvait de passage. Quelle joie ! Quel bonheur, cher monsieur ! Le succès, la célébrité, s’annonçaient et il accepta d’être le parrain de mon garçon qui venait de naître.
Cezanne s’arrêta, puis il reprit avec une voix plus faible :
— Il y aura deux ans, bientôt. Un matin, je partis de Marseille pour Paris, avec ma femme. Nous arrivons vers les trois heures de l’après-midi, le lendemain. J’installe ma femme dans un hôtel des environs de la gare et je cours rue de Bruxelles. Dans l’antichambre, en bas, à gauche, se trouvaient des messieurs ; des journalistes, monsieur, des écrivains, rédacteurs dans les grands journaux de Paris.
Et la voix de Cezanne s’accentua d’une nuance de respect en signalant la présence de ces demi-dieux dans l’antichambre de Jupin.
Il reprit, après un arrêt :
— Lorsque le domestique — un gros à culottes courtes et aux bas blancs — me demanda ma carte, je le priai de dire mon nom, tout simplement « Cezanne ». Cela suffira. Et me figurant la surprise joyeuse de Zola à l’ouïe de mon nom, je souris, heureux, et restai debout, ne voulant pas m’asseoir.
Le domestique revint, après quelques minutes. Monsieur me priait d’attendre.
Quelqu’un descendit l’escalier. Le domestique sortit et revint pour faire signe à l’un de ces messieurs qui attendaient comme moi.
Au troisième, je pris une chaise. Que voulez-vous, monsieur, Émile est l’homme de la correction, du devoir. A chacun son tour…
— Cela ne fait rien, interrompis-je. Un vieil ami comme vous. Que diable ! On fait une exception…
—Oui, mais ces messieurs… C’étaient sûrement des hommes d’importance… Oui, je crois qu’il aurait pu… Eh bien ! monsieur, ils défilèrent tous devant moi. Je fus reçu le dernier, peu avant sept heures ! Moi qui m’étais imaginé qu’au seul énoncé de mon nom, Émile allait bondir, lâcher son interlocuteur, dégringoler l’escalier et tomber dans mes bras pour me présenter ensuite à ces messieurs, les journalistes !
Déconcerté, un peu triste, je montai l’escalier…
— Sous le nombril du bonze chinois, polychrome d’or, fis-je à mi-voix.
— Émile, continua Cezanne, était à sa table de travail. Son accueil fut aimable, chaleureux même. Il se déclarait enchanté de me voir, tout en rangeant ses papiers. Comme je lui annonçai que mon intention n’était pas de me fixer à Paris, il s’indigna. Pour arriver il fallait faire son trou à Paris, y manger de la vache enragée. Mais il s’excusa : sa femme l’attendait pour dîner en ville. On se reverrait un jour prochain, vendredi probablement, pour causer à l’aise.
En effet, le vendredi, je recevais un petit bleu m’invitant à dîner, moi et ma femme. Nous y allâmes. Je ne sais comment vous dire, monsieur : mais ce fut triste. Je crus bien pouvoir, entre deux silences, éveiller à l’aide d’un souvenir, l’affection d’antan, faire renaître une de ces bonnes paroles, une vibration fraternelle de jadis… En vain ! Émile se montra préoccupé tout le temps du repas, regardant Mme Zola, laquelle, s’adressant à son mari le plus souvent, parlait de gens et de choses qui ne pouvaient guère nous intéresser, ma femme et moi :
« Voilà qui est officiel de ce matin : le mariage de la petite Ham… est rompu ». Ou bien : « J’attends toujours ta réponse au sujet du cuir de Cordoue… »
Je n’étais vraiment pas venu chez Émile pour parler de la petite Ham…, de cuir de Cordoue, de la robe mauve de Mme Charp… et d’une dizaine d’autres sujets d’intérêt aussi mince pour deux vieux amis, deux artistes, qui se revoient, après tant d’années…
Ébaubi, je contemplais cet homme d’un autre âge.
Il ne soupçonnait point l’astucieuse méchanceté. Cezanne ne pouvait comprendre cette tactique de femme, ennuyée d’avoir à sa table le pauvre petit peintre, totalement inconnu, et la provinciale qui détonnerait aux mardis de Madame ; un couple « undesirable » auquel la maîtresse de maison, en femme impérieuse, signifiait par ce flux de paroles, hostiles dans leur banalité voulue, de n’avoir plus à revenir rue de Bruxelles pour « causer avec Émile ».
Cezanne continuait à déplorer et à ne pas comprendre.
Je n’eus garde d’éclairer la pensée de cet homme d’une candeur à vous renverser. Il était si beau, si brave, comme cela.
Après un moment, il reprit :
— Je l’ai bien vu, au café. Les femmes ne se plurent point… Alors, que vous dirai-je, monsieur ? Je n’ai plus revu Zola depuis lors… Je ne le reverrai peut-être plus, plus jamais…
L’amertume même de la plainte de Cezanne montrait assez quelle part y avait l’affection. Le peintre a souffert cruellement de ce détachement injuste, barbare.
Il soupira :
— J’aurais tant besoin de lui, aujourd’hui. Mon intention est de faire entrer mon fils à Polytechnique. Émile a de grandes relations…
Le regard fixé sur la mousse, les paroles du père trahissaient son anxiété. Il appréhendait de retourner rue de Bruxelles.
— Ah ! Si seulement Bouguereau voulait recevoir mon paysan qui n’a rien de révolutionnaire ! Lui, pourrait aussi bien que Zola, recommander mon fils…
Retenu, d’un côté, par un sentiment de dignité ; poussé de l’autre par son aveuglement paternel, l’honnête rêveur ingénu s’abandonnait, sans malice, à tous les mirages de son imagination et berçait ainsi d’un irréalisable espoir son impuissance de pauvre pécheur de la vie.
William Vogt. »
Vogt est accompagné par Armand Silvestre, qui dira :
« Il y avait, nous dit M. Silvestre, un millier de toiles dans l’atelier de Barbizon, parmi lesquelles dominaient les natures mortes ».
Geneux Paul, « Hommage à Paul Cezanne », Vie, art et cité, Genève, décembre 1939 à voir ; cité par Ratcliffe Robert William, « Cezanne’s Working Methods and their Theorical Background », thèse de doctorat, Londres, University of London, Courtauld Institute of Art, 1960, 448 pages, p. 20 et note 60 p. 388.
Noter que le text de Vogt parle d’une journée de « premier printemps » et non d’été, ce qui situerait ce séjour à Barbizon aux alentours de mars ou avril. Ceci ne contredit pas le fait qu’il y retourne en septembre.
C’est pourquoi, si on prend à la lettre ce qu’écrit Hortense Cezanne à Mme Chocquet le 3 janvier 1895, on peut penser que celle-ci, accompagnée de son mari, a passé deux mois en Suisse durant l’été 1894, et non à Barbizon :
« Nous resterons à Paris assez tard, je pense peut-être jusqu’à la fin juin, car nous devons aller dans le midi à l’automne, tout en passant comme l’année dernière deux mois en Suisse. »
Lettre d’Hortense Cezanne, « rue des Lions St Paul 2 », à madame Chocquet, datée « Paris 3 janvier 1895 » ; mise en vente en novembre 2015 par la librairie de l’Abbaye-Pinault, Paris, 27-36, rue Bonaparte.
Ils seraient alors tous deux à leur retour en France allés s’installer à Barbizon en septembre (voir plus bas).
Nous pensons cependant que ce voyage en Suisse a eu lieu plutôt en 1893.
8 août
Lettre de Mathilde Chenu, fille des Tanguy, à Dries Bonger :
« Paris le 8 aout 94
Cher Monsieur Bonger
Je menpresse de vous dire que nous avons recu les deux cent franc dont je vous remercie beaucoup et dont je vous envoie la quittance Je vous dirai que la maman Tanguy va partir un mois chez Mr Pissarro et elle fera votre comission elle est très heureuse et se plait beaucoup dans sa petite chambre (au 6 rue Cortot) mais elle a un peu juste pour vivre si elle ne veut pas toucher au capital mais nousavons convenu ensemble que nous l’aiderons en lui donnant tant tout les mois pour quelle puisse arriver et ne se priver de rien. Monsieur Bonger tant q’uau tableaux de Cezanne nous vous avons donné La préference et nous n’avons pas changé didée mais nous voudrions bien le garder un peut et tout le monde le trouve très golie malheureusement Pour nous se sont tout les marchand de tablaux qui se sont associé à la vente Pour les avoir à très bon marché et malheureusement J aie été prévenu trop tard car nous les aurions racheté et se nomme Vollard marchand de tableaux a l’heure quil est ne veut pas vandre un Cezanne à moins de fr 800 et une petite toile mais ne croyez pas que je vous dit cela pour ne pas vous la donner et aussitot que nous serons décidé je vous enverrai un mot Cher Monsieur ma mère se joint a moi pour vous dire bien des choses ainsi qua votre dame Récevez Monsieur des respect les plus distingué
Madame Chenu
9 rue Norvins montmartre. »Lettre de madame [Mathilde] Chenu, fille du père Tanguy, à Dries Bonger, 9 août 1894 ; Amsterdam, Van Gogh Museum, inventaire n° b1453V/1973.
Tralbaut Mark Edo, « André Bonger, l’ami des frères van Gogh », Van Goghiana, I, sans date (1973 ?), p. 5-54, cité p. 47.
Fin de l’été (?)
Cezanne emménage à Paris, 2, rue des Lions-Saint-Paul, au troisième étage à gauche dans un appartement comprenant entrée, salon, salle à manger, chambre à coucher, pièce à feu et cuisine.
Calepins cadastraux D1P4, 1876, Archives de Paris. Imbourg Pierre, « Cezanne et ses logis », Beaux-arts, n° 316, 20 janvier 1939, p. 3. Andersen Wayne V., « Cezanne’s carnet moiré », The Burlington Magazine, volume CVII, juin 1965, p. 313-314.
NB. Nous n’adhérons pas à cette hypothèse, cf notre commentaire de l’automne 1891.
Cezanne loue probablement un atelier, 3, passage Dulac. Sur une page du carnet de croquis dit « carnet violet moiré », il écrit :
« Passage
Dulac
3 = »« Carnet violet-moiré », imprimé en fac-similé par Daniel Jacomet, Paris, éditions Quatre Chemins, 1956, n. p., p. V.
Imbourg pense qu’il y habite :
« En 1894, le peintre émigre passage du Lac [Dulac], puis rue Bonaparte [à partir de la fin novembre 1894].
En 1896, il est à Montmartre, « à une portée de fusil du Sacré-Cœur »… Nous n’en avons pas trouvé davantage. »Imbourg Pierre, « Cezanne et ses logis… à Paris », Beaux-Arts, n° 316, 20 janvier 1939, p. 3.
Mais Andersen Wayne a montré qu’il s’agissait seulement d’un atelier :
Traduction :
« À la page IV verso [du carnet violet moiré, C 1074] (fig. 47) apparaît le nom de Delaherche, avec l’adresse, rue Halévy – boulevard Haussmann. Auguste Delaherche, grès artistique, le céramiste qui a cuit certains des pots de Gauguin en 1889-1890, a vécu au n° 1, rue Halévy, à l’angle du boulevard Haussmann, entre les années 1889 et 1897(3). Après 1889, il a possédé une fabrique au 153, rue Blomet (acquise, au cours de l’année, auprès d’Ernest Chaplet, qui avait autrefois cuit des céramiques de Gauguin(4)), à quelques rues du 3, passage Dulac, une adresse qui figure à la page V du carnet (fig. 45). Elle se rapporte à une petite rue ― d’un seul bloc en longueur ― du 15e arrondissement, la rue Dulac, appelée entre 1847 et 1909 le passage Dulac, « du nom de son fils créateur »(5). Pierre Imbourg, qui a publié en 1939 un article sur les logis de Cezanne, a écrit que Cezanne a vécu passage Dulac en 1894, avant de prendre un atelier rue Bonaparte(6). Aucune preuve à l’appui n’est citée ; la dernière adresse est documentée dans une lettre de Cezanne, d’Aix, à Francisco Oller en date du 17 juillet 1895 : « Vous pouvez faire prendre votre toile dans l’atelier de la rue Bonaparte, d’ici au quinze janvier prochain. » Au cours des années 1890-1896, le passage Dulac comprenait dix-huit numéros d’immeuble. Le numéro 3 n’apparaît dans le Didot-Bottin qu’en 1892, quand il a été occupé par un M. Tibut, peinture et vitrerie. Celui-ci a conservé cette adresse jusqu’en 1895, quand un M. Mirallès, peintre-artiste, lui a succédé. Nous avons pu constater, cependant, que pendant les années quatre-vingt-dix, il a pu y avoir un certain nombre de petits ateliers à cette même adresse ― le Didot-Bottin ne répertorie que les entreprises commerciales et peut-être que chaque artiste résident n’était pas pris en compte. Le numéro 3 du passage Dulac est désormais un tribunal flanqué de trois bâtiments : le plus ancien, un bâtiment en pierre de deux étages dans le style de l’annexe d’une ferme du xixe siècle ; les deux autres, construits vers 1900. Auparavant, le site était occupé par un certain nombre de petits pavillons, probablement d’artistes et artisans(7). Le passage était une rue populaire avec des ateliers : six artistes-peintres y sont enregistrés entre 1890 et 1896. Au n° 4, au moins deux artistes ont résidé pendant toute la période. Le fait que la maison principale ait été occupée continûment pendant chacune des années quatre-vingt-dix exclut l’éventualité que Cezanne y ait vécu avec sa famille. Il n’aurait pas plus utilisé un petit pavillon comme résidence alors qu’il n’avait pas de difficultés financières. On peut donc supposer que la date initiale du carnet de croquis correspond à celle de l’inscription de l’adresse de son atelier rue Bonaparte en 1894. Les informations d’Imbourg, fournies par la famille de Cezanne, ne correspondent pas à ce que nous savons désormais des mouvements de l’artiste au cours de ces années-là. Apparemment, il faisait souvent l’aller-retour entre Aix et Paris. Son arrivée à Paris eut lieu au début de l’année 1894. Il a rejoint sa femme et son enfant dans un appartement au 2, rue des Lions-Saint-Paul, entre l’île Saint-Louis et la place de la Bastille(8). Il a dû prendre un atelier passage Dulac pour une utilisation temporaire, comme Imbourg le suggère, car il y avait une distance considérable avec la Bastille. En prenant un atelier rue Bonaparte, Cezanne a presque réduit de moitié la distance.
Notre documentation sur les années 1890-1894 n’est guère abondante, aussi ne pouvons-nous pas exclure la possibilité que l’adresse du passage Dulac ait été utilisée après 1894. Dans la lettre de Cezanne à Oller du 17 juillet 1895, citée ci-dessus, il affirme que le 15 janvier 1896 est la date au plus tard de son occupation de l’atelier de la rue Bonaparte. Puisque la lettre a été écrite en plein été, nous pouvons supposer que Cezanne a utilisé cet atelier l’hiver précédent. Cela justifierait que l’ensemble de l’année 1895 soit une évaluation raisonnable de la période qu’il y a passée, ainsi que les derniers mois de 1894. Au cours de l’année 1893, si l’on en croit le récit de Vollard sur ses efforts pour réunir suffisamment de toiles de Cezanne afin d’organiser une exposition dans sa galerie, les allées et venues de Cezanne étaient inconnues même de Pissarro. Après avoir trouvé la trace de Cezanne à Fontainebleau, mais trop tard, Vollard a trouvé son domicile rue des Lions-Saint-Paul, à Paris, mais l’artiste était parti à Aix en juin(9). Durant la première moitié de l’année, donc, il n’est pas censé avoir travaillé à Paris. Au cours de la seconde moitié, il était dans le Midi, mais cela n’exclut pas la possibilité que Cezanne ait utilisé un atelier passage Dulac, peut-être seulement comme dépôt, ainsi qu’il l’a fait pour l’atelier de la rue Bonaparte en 1895. Il n’est pas impossible que le récit d’Imbourg signifie qu’au retour d’Aix en 1894 Cezanne ait d’abord pris un atelier passage Dulac, cet atelier étant un petit pavillon à côté de la rue de Vaugirard où il avait un logement. […]
(3) Voir ci-dessous, note 30.
(4) Sur le travail de Gauguin avec Delaherche et Chaplet, voir Christopher Gray : The Sculpture and Ceramics of Paul Gauguin, Baltimore, 1963, p. 25, et Merete Bodelsen : Gauguin’s Ceramics, London, 1964, p. 211. Pour une correction des dates données à la fois par Gray et Bodelsen, voir mon compte rendu dans The Art Bulletin, décembre 1964.
(5) Jacques Hillairet, Le Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, 1924].
(6) « Cezanne et ses logis », Beaux-Arts, 20 janvier 1939.
(7) Information communiquée par le propriétaire actuel du 3, rue Dulac, qui se rappelle la construction de deux immeubles vers 1900.
(8) Voir Henri Perruchot, Cezanne, traduit par H. Hare, New York, 1963, p. 240.
(9) Ambroise Vollard : Paul Cezanne, Paris, 1914, p. 62.
30) Une référence à Auguste Delaherche, 1, rue Halévy, à l’angle du boulevard Haussmann, grès artistique, fabrication rue Blomet, 153. Delaherche a eu l’adresse de la rue Halévy de 1890 à 1897 : Didot-Bottin, Annuaire du commerce, Paris, volumes 1890-1897. C’est à l’adresse de la rue Blomet que Gauguin avait été initié à la céramique par Ernest Chaplet en 1886. Chaplet a cédé sa fabrique en 1890, qui fut reprise par Delaherche. »Andersen Wayne V., « Cezanne’s Carnet violet-moiré », The Burlington Magazine, volume CVII, n° 747, juin 1965, p. 313-318, p. 313-314.
Concernant la rue Bonaparte, Rivière écrit :
« Portrait d’un Italien. Le personnage est représenté assis. Cette toile a été peinte dans un atelier que l’artiste avait loué et qui dépendait d’un hôtel meublé de la rue Bonaparte. »
Rivière Georges, Le Maître Paul Cezanne, H. Floury éditeur, Paris, 1923, 243 pages, p. 210.
Noter que Cezanne loue l’atelier de la rue Bonaparte à son retour de Giverny fin novembre ou début décembre 1894, voir plus bas.
Septembre
Il travaille à Melun ou aux environs, car il écrit à un marchand de couleurs à Melun :
« À Melun.
21 7bre 1894.
Hier, 20 du ct. j’ai pris chez vous quatre toiles à peindre dont 3 de 20 et 1 de 25 — Les 3 premières à 2f,50, celle de 25 à 2f,80, dont le total serait de 10f,30 et non de 11f,50, comme j’ai payé par erreur.
Je pense que vous voudrez bien m’en tenir compte à mon prochain voyage à Melun., »Brouillon d’une lettre écrit sur une page d’un carnet de dessins de Cezanne à un fournisseur de couleurs et ustensiles de peinture, 21 septembre 1894 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 239-240.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Bernard Grasset éditeur, 319 pages, p. 216-217, reproduit figure 36 ;
Chappuis Adrien, Les Dessins de Paul Cezanne au Cabinet des Estampes du musée des Beaux-arts de Bâle, Olten et Lausanne, Suisse, éditions Urs Graf-Verlag, 1962, tome I : « Texte », 126 pages, 96 numéros, tome II : « Planches », 156 pages, 211 reproductions, n° 167, p. 99 du tome I,reproduit p. 122 du tome II.
The hidden Cezanne – From sketchbook to to canvas, edited by Anita Haldeman, Kunstmuseum Basel,2017, p.241.
On peut penser qu’en réalité il était à Barbizon, où Hortense l’aura rejoint, comme en témoigne sa lettre du 3 janvier 1895 à Mme Chocquet :
« Je suis restée à Barbison (sic), plus longtemps que ce que je comptais y rester. Et à mon retour fin septembre (…) »
Lettre d’Hortense Cezanne, « rue des Lions St Paul 2 », à madame Chocquet, datée « Paris 3 janvier 1895 » ; mise en vente en novembre 2015 par la librairie de l’Abbaye-Pinault, Paris, 27-36, rue Bonaparte.
30 septembre
Cezanne écrit à Monet :
« Barbizon, 30 Septembre 1894.
Mon cher Monet,
Je suis à Barbizon. J’ai eu le plaisir d’y faire la connaissance de Monsieur Radinsky, ― jeune peintre de talent, plein d’admiration lui-même de pour votre beau talent, pour ne pas dire plus. Confiant dans les bonnes relations que vous avez bien voulu permettre de se continuer avec vos anciens confrères, je me permets de lui confier ces quelques mots et pour vous le présenter et pour me rappeler par là-même à votre bon souvenir. ―
Je ne doute pas que j’aurai le plaisir de vous revoir à Paris, vu que j’y rentrerai aux approches de l’hiver, et que je ferai tout mon possible pour vous y rencontrer.
Veuillez agréer, mon cher Monet, l’hommage de mon enthousiasme pictural et une poignée de main cordiale de votre tout dévoué,
Paul Cezanne »Lettre de Cezanne à Monet, datée « Barbizon, 30 Septembre 1894 » ; collection privée, Paris, musée des Lettres et Manuscrits.
Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cezanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 33.
Václav Radimský, impressionniste tchèque (1867-1946), séjourne à Giverny à partir d’octobre 1894, où Cezanne reste du 7 au 30 septembre, et à nouveau fin novembre.
1er novembre
A l’invitation de Monet, Cezanne, qui loge à l’hôtel de l’Exposition, quitte Siron-Barbizon pour aller voir le « grand homme » à Giverny.
« HOTEL DE L’EXPOSITION
SIRON
BARBIZON
(Seine-et-Marne)
English Spoken
Adresse télégraphique :
Siron Barbizon1er Novembre 1894
Mon cher Monet, ―
Votre si Votre si aimable invitation après surtout le bon accueil que vous avez fait à Monsieur Radinsky, me pousse à partir ― immédiatement, pour vous aller saluer et serrer la main. ― Le regretté Monsieur Chocquet avait bien raison, L’amitié d’un grand homme est un bienfait des dieux.
La voiture passe, je termine et vous serre cordialement la main. ―
Demain à Giverny
Bien à vous P. Cezanne »Lettre de Cezanne à Monet, datée « 1er novembre 1894 », écrite sur papier à en-tête de l’hôtel de l’Exposition, Siron, Barbizon ; vente Archives de Claude Monet, collection Cornebois, Paris, hôtel Dassault, 13 décembre 2006, n° 47, reproduit.
Le peintre Václav Radimský (Kolín (Bohême centrale), 6 octobre 1867 – Pašinka (Tchécoslovaquie), 1946), séjourne à l’hôtel Baudy à Giverny pendant environ trois mois à partir du 4 octobre 1894. Il a été reçu par Monet, auprès de qui Cezanne, rencontré à Barbizon, l’avait recommandé dans son courrier du 30 septembre.
Registre des voyageurs de l’hôtel Baudy, 1887-1899, n° 410, bibliothèque du Philadelphia Museum of Art ; Gerdts William H., Giverny, une colonie impressionniste, New York, Londres, Paris, Abbeville Press Publishers, 1993, traduit de l’anglais par Xavier Carrère, 256 pages, p. 118 et note n° 9 p. 235.
Elder Marc, À Giverny, chez Claude Monet, Paris, Bernheim-Jeune, 1924, p. 49 :
« A mon tour j’éprouvai l’ironie de Cezanne. Je lui avais écrit pour l’inviter à venir s’installer à Giverny où il m’avait envoyé un jeune peintre auquel il s’intéressait. « L’amitié d’un grand homme est un bienfait des dieux », me répondit-il. Et il accepta… Drôle de corps ! »
7-30 novembre
Il séjourne à l’hôtel Baudy à Giverny, où se trouve aussi une jeune peintre américaine, Matilda Lewis, ainsi que Václav Radimský. Sur le registre de l’hôtel Baudy est inscrit : « M. Cezanne P., 57 ans, Aix, 7-30 novembre 1894 ».
Registre des voyageurs de l’hôtel Baudy, 1887-1899, n° 410, bibliothèque du Philadelphia Museum of Art.
Matilda Lewis, dans une lettre à sa famille aux États-Unis, dessine de lui un portrait pris sur le vif :
« The circle has been increased by a celebrity in the person of the first Impressionist, Monsieur Cezanne — the inventor of Impressionism as Madame D. [probably a misreading of « B., » for Baudy] calls him. He is a friend of the Bohemian, and of Monet. Monsieur Cezanne is from Provence, and is like the man from the Midi whom Daudet describes. When I first saw him I thought he looked like a cutthroat with large red eyeballs standing out from his head in a most ferocious manner, a rather fierce looking pointed beard, quite gray, and an excited way of talking that positively made the dishes rattle. I found later on that I had misjudged his appearance, for far from being fierce or a cutthroat, he had the gentlest nature possible, « comme un enfant » as he would say. His manners at first rather startled me, he scrapes his soup plate, then lifts it and pours the remaining drops into the spoon ; he even takes his chops in his fingers and pulls the meat from the bone. He eats with his knife and accompanies every gesture, every movement of his hand with that implement, which he grasps firmly when he commences the meal and never puts down until he leaves the table ; yet in spite of the total disregard of the dictionary of manners he shows a politeness towards us which no’ other man here would have shown. He will not allow Louise to serve him before us in the usual order of succession at the table ; he is even deferential to that stupid maid, and he pulls off the old tam-o’shanter, which he wears to protect his bald head, when he enters the room. I am gradually learning that appearances are not to be relied upon over here ; the Bohemian, with his leather coat and corduroys which he wears to dinner, and in which he looks rather like a stable boy, speaks five languages, not [just] passibly [sic], but understanding all the idioms, all the shades of meaning ; he even remembers his Latin and Greek, has read much of the literature of several countries, traveled tremendously, and with all this is a hard working artist ; and I have despised him for wearing a leather coat to dinner!
The conversation at lunch and dinner is principally of art and cooking. The Bohemian talks about a dish which he calls « Soufflé des Anges, » which we discover to be a cream of garlic and oil. The Impressionist praises the oil of Provence, he says that the people of his country who have an income of eight hundred francs have an oil which Napoleon could not have bought. Cezanne is one of the most liberal artists I have ever seen, he prefaces every remark with « Pour moi » it is so and so, but he grants that every one may be as honest and as true to nature from their convictions, he doesn’t believe that every one should see alike. »
Traduction :
« Le cercle s’est agrandi par l’arrivée d’une célébrité, le premier des impressionnistes. Monsieur Cezanne — inventeur de l’impressionnisme selon les termes de Madame D. [erreur probable pour « B », Mme Baudy]. C’est un ami du Bohémien et de Monet. Monsieur Cezanne vient de Provence, il est comme ces gens du midi que décrit Daudet. La première fois que je l’ai vu, je lui ai trouvé l’air d’un assassin avec ses gros yeux écarquillés qui lui sortent de la tête d’une manière tout à fait féroce, sa barbe pointue assez menaçante, toute grise, et sa façon exaltée de parler qui fait trembler les plats. Mais je me suis rendu compte que je m’étais méprise sur les apparences, car bien loin d’être dur ou dangereux il est l’homme le plus doux du monde, « comme un enfant » dit-il. Au début ses manières m’ont interloquée : il racle l’assiette à potage, puis il la soulève et en vide les dernières gouttes dans la cuiller : il mange même ses côtelettes avec les doigts et arrache la viande de l’os. Il mange au couteau et ponctue le moindre geste, le moindre mouvement de la main avec cet instrument qu’il agrippe dès le début du repas, et ne lâche que quand il sort de table ; mais malgré son mépris total de l’étiquette, il est avec nous délicat comme personne d’autre ici. Il ne veut pas que Louise le serve avant nous, selon l’ordre du service à table ; il est même cérémonieux avec cette pauvre fille, et il ôte le vieux béret dont il protège sa tête chauve en entrant dans la pièce. J’apprends ainsi peu à peu qu’ici il ne faut pas se fier aux apparences ; le Bohémien avec son manteau de cuir et le pantalon en velours côtelé qu’il porte à table, qui le feraient passer pour un garçon d’écurie, ne parle pas moins de cinq langues dont il maîtrise toutes les expressions, toutes les subtilités ; il possède son grec et son latin, connaît la littérature de plusieurs pays étrangers, il a énormément voyagé et avec tout cela, il peint sans arrêt : dire que je le méprisais parce qu’il portait un manteau de cuir pour manger !
La conversation à table, le midi et le soir, roule principalement sur l’art et la cuisine. Le Bohémien parle d’un plat qu’il appelle le « soufflé des anges » ; nous nous sommes aperçus que c’était une crème à l’huile et à l’ail. L’impressionniste aime l’huile de sa Provence, il dit que les gens de son pays avec des revenus de huit cents francs, ont une huile que même Napoléon n’aurait pu s’offrir. Cezanne est l’un des artistes les plus ouverts que j’aie vus, il commence chaque remarque en disant « Pour moi » ceci, cela, il trouve que tout le monde devrait par honnêteté rester le plus près possible de ses convictions profondes, mais il ne croit pas que tout le monde doive forcément penser comme lui. »
Lettre de Matilda Lewis à sa famille, [novembre 1894] ; tapuscrit, Archives of the Yale University Art Gallery ; lettre citée par Gerdts William A., Monet’s Giverny. An Impressionist Colony, New York, Londres, Paris, Abbeville Press Publishers, 1993, p. 118-119 et note 6 p. 235 ; traduction en français de Xavier Carrère
Lettre attribuée auparavant à Mary Cassatt, par Breeskin Adelyn D., The Graphic Work of Mary Cassatt, New York, H. Bittner and Company, 1948, 91 pages.
Novembre
Lettres de Mirbeau à Monet :
« Je serai très heureux de connaître Cezanne ».
« Nous irons mercredi [28 novembre], c’est entendu. […] Mais sapristi que Cezanne n’oublie pas de venir, car j’ai un violent désir de le connaître ».Lettres de Mirbeau à Monet, Carrières-sous-Poissy, novembre 1894, vente Archives de Claude Monet, collection Cornebois, Paris, hôtel Dassault, 13 décembre 2006, n° 181.
23 novembre
Monet écrit à Geffroy :
« C’est entendu pour mercredi [28 novembre].
J’espère que Cezanne sera encore ici et qu’il sera des nôtres, mais il est si singulier, si craintif de voir de nouveaux visages, que j’ai peur qu’il nous fasse défaut, malgré tout le désir qu’il a de vous connaître. Quel malheur que cet homme n’ait pas eu plus d’appui dans son existence ! C’est un véritable artiste et qui en est arrivé à douter de lui par trop. Il a besoin d’être remonté : aussi a-t-il été bien sensible à votre article ! »Lettre de Monet à Geffroy. Giverny, 23 novembre 1894. Geffroy Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Les éditions G. Crès & Cie, 1922, 362 pages, p. 196-197, 199.
Mack Gerstle, La Vie de Paul Cezanne, Paris, Gallimard, « nrf », collection « Les contemporains vus de près », 2e série, n° 7, 1938, 362 pages, p. 248 :
« Madame Marie Gasquet, veuve de Joachim Gasquet, rapporte une anecdote qui illustre bien cette tendance. Monet et plusieurs autres impressionnistes, tous de bons amis de Cezanne, avaient imaginé une fois de donner un déjeuner en son honneur. Quand Cezanne arriva [chez Monet, à Giverny], les autres étaient déjà réunis autour de la table et Monet commença un petit discours de bienvenue où il exprimait l’admiration profonde et l’affection que tous les invités présents éprouvaient pour leur collègue. Cezanne écouta, la tête inclinée et les yeux pleins de larmes ; et quand Monet eut fini il dit : « Ah, Monet, vous aussi vous vous moquez de moi ! » A la consternation de tous et en dépit des protestations, il se précipita hors de la pièce. Il ne revint pas et ne voulut jamais se laisser convaincre que l’hommage des autres peintres avait été sincère. »
28 novembre
Monet organise une réception en l’honneur de Cezanne. Clemenceau, Rodin, Mirbeau et Geffroy y assistent. Il s’agit de la première rencontre du peintre avec ces personnes.
Lettre de Monet à Geffroy, 23 novembre 1894 ; Geffroy Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Les éditions G. Crès & Cie, 1922, 362 pages, p. 196-197, 199 ; réédition Paris, Macula, 1980, p. 325-326.
LeFigaro, n° 836, 4 mai 1962 <à voir>.Geffroy Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Les éditions G. Crès & Cie, 1922, 362 pages, p. 196-197, réédition Paris, Macula, 1980, p. 325-326 :
« En 1894, Monet a revu son ami Cezanne, et celui-ci est venu s’établir à l’auberge de Giverny. Monet a invité pour lui faire fête quelques amis, et il m’écrit le 23 novembre :
… C’est entendu pour mercredi.
J’espère que Cezanne sera encore ici et qu’il sera des nôtres, mais il est si singulier, si craintif de voir de nouveaux visages, que j’ai peur qu’il nous fasse défaut, malgré tout le désir qu’il a de vous connaître. Quel malheur que cet homme n’ait pas eu plus d’appui dans son existence !! C’est un véritable artiste et qui en est arrivé à douter de lui par trop. Il a besoin d’être remonté : aussi a-t-il été bien sensible à votre article !
Cezanne revint donc vers Monet, après des années de séparation. Installé à l’auberge, peignant dans les environs, acceptant de venir de temps à autre chez son compagnon retrouvé, ce fut ainsi qu’il se trouva un jour avec Rodin, Clemenceau, Mirbeau et moi. Il nous apparut immédiatement à tous comme un personnage singulier, timide et violent, émotif à un point extraordinaire. Entre autres propos, ne nous donna-t-il pas la mesure de son innocence ou de son désarroi en prenant à part Mirbeau et moi pour nous déclarer, les larmes aux yeux : « Il n’est pas fier, monsieur Rodin, il m’a serré la main ! Un homme décoré !!! » Mieux encore, après le déjeuner, ne se mit-il pas à genoux devant Rodin, au milieu d’une allée, pour le remercier encore de lui avoir serré la main ? A entendre de pareilles choses, on ne pouvait qu’éprouver de la sympathie pour l’âme primitive de Cezanne, qui était à ce moment aussi sociable qu’il pouvait l’être, et montrait qu’il se plaisait, par son rire et ses saillies, dans la compagnie qui l’entourait. Clemenceau, avec lequel il se retrouva ensuite, avait particulièrement le don de le faire s’épanouir d’aise, par les plaisanteries dont il le régalait. Il me dit bien un jour qu’il ne pouvait se rallier à Clemenceau, ce que je ne lui demandais d’ailleurs pas. Et il m’en donna cette raison étonnante : « C’est que je suis trop faible !… Et que Clemenceau ne pourrait pas me protéger !… Il n’y a que l’Église qui puisse me protéger ! »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 75 :
« À Giverny il rencontrait Claude Monet ; il le fréquentait peu, pas plus que Pissarro, Renoir et Sisley, les seuls dont il se souvint plus tard, « la bande impressionniste à qui il a manqué un maître, des idées », avouait-il parfois. Toute une saison pourtant il vécut côte à côte avec Renoir. Il n’aimait pas Degas. « Je préfère Lautrec », disait-il. À Paris, il mangea quelquefois, chez le même marchand de vins, avec Auguste Rodin dont, goguenardait-il, il admirait plus la roublardise paysanne que l’art symbolique et sûr.
« ― Il a du génie, faisait-il… et un bas, un bon bas de laine. Il venait, avec sa blouse plâtreuse, s’asseoir à côté des maçons… C’est un finaud, il leur rivait leur clou ; mais j’aime beaucoup ce qu’il fait. C’est un intense… On ne le comprend pas encore, ou tout à contresens. Il faut qu’il ait un rude tempérament pour résister à la pommade de tous ces petits Mauclairs… À sa place, j’aurais une rude frousse… Il a de la chance. Il réalise. »
Il voyait aussi Guillaumin et quelques bons camarades dans un café des Batignolles. Il exécrait Puvis de Chavannes, au point de vouloir expulser de chez moi la reproduction que j’en avais de l’hémicycle de la Sorbonne.
« ― Quelle mauvaise littérature ! » disait-il. »
Fels Florent, Propos d’artistes, Paris, La Renaissance du Livre, 1925, 215 pages, p. 174 :
Monet aurait dit à l’auteur :
« Cezanne est venu à Giverny, nous avons travaillé ensemble, devant le même motif. »
Peu après, Cezanne quitte brusquement Giverny, sans prévenir Monet, laissant plusieurs toiles à l’hôtel :
- Cezanne coiffé d’un chapeau mou (FWN511-R774)
- Paysage d’hiver (Giverny) (FWN299-R777)
- Giverny (FWN300-R778).
Selon un témoignage de Suzanne Bruno, fille de Mme Baudy, il a ensuite réclamé l’autoportrait à Vollard, qui apparemment est venu le chercher à l’hôtel, accompagné par Monet, mais il a laissé les deux paysages :
Traduction :
« Selon madame Suzanne Bruno, fille de madame Baudy, propriétaire de l’Hôtel Baudy à Giverny, Cezanne a laissé ces peintures quand il est parti pour Aix en novembre 1894.
Note : […] Rewald a rendu visité à la fille de Madame Baudy à Giverny et a découvert que, quand Cezanne est parti, il a abandonné non seulement les deux paysages FWN299-R777 et FWN300-R778, mais aussi un autoportrait (FWN511-R774). Selon les notes de Rewald, l’autoportrait a apparemment été récupéré par Vollard en présence de Monet, tandis qu’il laissait les deux paysages, considérant peut-être qu’ils n’étaient pas de Cezanne. Ils ont ensuite été vendus par Mme Baudy. »Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman, volume I « The Texts », 592 pages, 955 numéros, New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, p. 11 et notice 777, p. 470.
Fin novembre ou début décembre
Cezanne, qui habite avec sa famille 2, Rue des Lions-Saint-Paul, loue un atelier rue Bonaparte :
« Mon mari a loué un atelier près de l’école des Beaux-arts, rue Bonaparte. Il s’y est installé fin novembre. »
Lettre d’Hortense Cezanne, « rue des Lions St Paul 2 », à madame Chocquet, datée « Paris 3 janvier 1895 » ; mise en vente en novembre 2015 par la librairie de l’Abbaye-Pinault, Paris, 27-36, rue Bonaparte.
NB. : Le départ de Giverny se situant quelques jours après le 28 novembre, cette location a dû intervenir dans les premiers jours de décembre.
18 décembre
Charles Alexander Loeser (New York, 11 janvier 1864 – New York, 15 mars 1928) achète à Vollard « un tableau de Cezanne (maisons dans la campagne) – Vte Tanguy », pour 250 francs. Vollard l’avait acheté 175 francs lors de la vente Tanguy du 2 juin 1894 (Paysage, FWN168-R497).
Registre commercial de Vollard, 20 juin 1894 – 3 novembre 1897, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,2) f° 8.
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 497, p. 333.
Décembre
Émile Bernard publie un article sur Cezanne dans la revue Le Cœur.
Bernard Émile, « Paul Cezanne », Le Cœur, 2e année, décembre 1894, n° 9, p. 4-5 :
« Paul Cezanne
La foule admire les passions, l’écume ; elle ne voit pas le grand cœur qui résiste et qui, par sa résistance, protège tout derrière lui.
Louis Veuillot.
Aucun œuvre entre tous ceux que l’on eut la témérité d’analyser n’est comparable à celui de Paul Cezanne ; épars, étrange, inattendu, génial ; perdu dans le fond d’obscures boutiques, disséminé au hasard du besoin, selon l’homme de goût, ou selon l’ami ; déchiré dans les brutales colères du découragement, brûlé au poêle aux heures de dégoût.
Donc bien difficile sera d’en parler comme il sied.
Paul Cezanne est un peintre ignoré à force de s’ignorer lui-même (dit Paul Roinard avec beaucoup de sens), toujours insatisfait, toujours se meurtrissant à la poursuite d’un but jamais atteint.
Qui dira les souffrances et les crises de cet état !
Voyons l’œuvre : il contient l’homme.
Des toiles de jeunesse à celles de ces dix ans, que nous pûmes voir, une évolution s’est accomplie, suivant en progrès les recherches, les tendances de plus en plus nettes du groupe impressionniste dont il fit partie ; mais ce qui caractérise cet œuvre, c’est d’abord son apparence de mépris pour ce que le public nomme généralement « Idée ».
Natures mortes, paysages, figures, tout n’est ici que prétexte à bonne peinture.
Ce but uniquement poursuivi reste seul visible, et rien n’est distrait. De ceci pourrons-nous augurer le silence qui se fit alentour de ce lutteur infatigable et de ses efforts ?…
En général les littérateurs s’adonnent à la critique des tempéraments et des peintures leur offrant tissus et sujet, leur donnant leur cause à descriptions et figures et poétique. Ici rien de tout cela, l’œuvre étant formé d’autre chose.
On peut diviser en deux catégories très distinctes les peintres de tous les temps : d’un côté ce sont les penseurs, se servant d’un pinceau comme d’autres d’une plume ou d’un instrument quelconque pour fixer une idée, une vision, un rêve ; de l’autre les vrais peintres, c’est-à-dire les tempéraments rigoureusement épris des qualités matérielles de leur art et y apportant une science si subtile et si personnelle que leur genre s’impose tout autant que celui des premiers, sans pourtant atteindre la spiritualité. Cependant, nous oserons avancer cette opinion que sans avoir peut-être le même intérêt apparent, ces derniers ont tellement subtilisé, perfectionné les moyens de leur art qu’ils sont arrivés à quelque chose qui dépasse la réalité de l’objet copié et qui est pour ainsi dire imaginaire à force d’être cherché, supérieur à force d’être distingué, immatériel à force de quintessence et d’analyse. Vélasquez nous servira d’exemple. En réalité ce grand artiste n’eut d’autres préoccupations que les qualités de son art ; et pourtant il l’a tant raffiné et parfait, il en a tellement dégagé une harmonie singulière qu’il peut sembler aussi penseur que n’importe quel autre peintre ; Delacroix qui, au contraire, a sacrifié à l’idée, produit souvent des discordances et s’écarte souvent de la beauté calme et simple de la vraie peinture. L’expression d’une tête ne préoccupait pas Rembrandt ou Rubens outre mesure, et l’idée de peinture était avant tout en eux. Les vrais peintres ne sont donc pas inférieurs à ceux qui plus séduisants par le sujet, apportent à nos yeux des pages pleines d’imagination et de fougue.
En dehors de ce que l’on nomme vulgairement « Imagination », faculté qui consisterait à se représenter dans un désordre considérable toutes sortes de choses bizarres et déformées, il y a une « Imagination » plus méconnue qui est celle qui préside à l’ordonnance et établit la solidité de l’œuvre : travail logique de transposition qui ne demande pas moins d’effort que le précédent et d’où l’artiste surgit créateur et digne de ce nom. Ici ce n’est point une cohue étrange, mais une nature vue, toute refaite, toute transformée et toute vivante de vie de l’ordre et de la volonté. Ceci n’est point dit, certes, pour blâmer des hardiesses que nous avons admirées et admirons encore les tout premiers ; on peut faire de belles œuvres sous toutes conditions, à condition surtout d’être bien doué, mais il y aurait, il nous semble, injustice à ne point placer au-dessus des qualités particulières à chacun la spécialité qu’exigé un art dans ses moyens d’expression. La peinture qui doit être avant tout peinture et doit ainsi revêtir la chose à exprimer par son intermédiaire de tout le charme et de tout l’attrait des qualités pour ainsi dire matérielles (et immatérielles tout à la fois) qui élèvent à l’art, nous commande d’admirer les vrais peintres comme nos seuls maîtres et nos seuls modèles.
Il n’est pas rare d’ailleurs que certains artistes se rattachant aux deux catégories dont nous avons parlé plus haut. Ainsi Rembrandt, ainsi Goya ; tandis que Vélasquez, Rubens, Franz Hals, ne paraîtront jamais que des peintres purs.
Paul Cezanne est de ces derniers : charme, grâce, style, beauté de la ligne et de la couleur, grandeur de la composition, il a toutes les qualités de ces maîtres ; et il en a aussi la force.
Si devant nous étaient placées les toiles de cette longue carrière, nous serions tellement éblouis de leur diversité, de leur nouveauté et de leur égalité dans le génie que rien de comparable ne saurait être vu. Mais ce bonheur ne nous a point encore été donné, et si nous l’avions, nous sommes certains que notre espoir ne serait en rien déçu. Chaque fois qu’il nous a été permis de voir une nouvelle étude du maître, notre surprise, quelque précaution que nous ayons prise d’avance, restait toujours la même : l’étonnement, l’imprévu.
C’est là, il faut l’avouer, une des qualités les plus étranges de ce génie, qui, malgré tant de siècles de productions, tant de chefs-d’œuvre, tant de tentatives et trouvailles en tous genres, sans aucune discordance avec les maîtres de tous les temps, apporte un art tout viril et tout inattendu.
Ce serait folie de vouloir décrire le peu qu’il nous a été permis de voir cet œuvre, et que l’on voit si difficilement ; il faudrait faire un dictionnaire tout exprès pour exprimer la qualité intime de chaque ton, de chaque emportement, de chaque ombre, de chaque touche, tantôt d’une douceur pénétrante comme un morceau de Mozart, tantôt d’une gravité magistrale, tantôt rustique comme la flûte du pâtre. C’est donc une tâche impossible à accomplir que nous nous sommes assignée en mettant le nom de cet artiste en tête de ces lignes ; mais tout ce que nous pouvons affirmer, c’est que c’est là un puissant génie, un tempérament remarquable, un pur peintre de la lignée des maîtres graves de l’Espagne et de l’Italie.
Chez Tanguy, rue Clauzel, nous avons vu autrefois une femme nue couchée [FWN595-R140] que Daumier, qui est un bien grand dessinateur, n’aurait point su faire, et que Michel-Ange n’aurait point désavouée malgré sa laideur ; car cette laideur même est d’une grandeur incompréhensible, qui s’impose et qui faisait dire à Baudelaire : Les charmes de l’horreur n’enivrent que les Forts.
Étendue de tout son long, cette femme vraiment immense, ce qui fait songer à la « Géante » du même poète, se détache en lumière d’un fond de mur gris où une image naïve est encore collée. Au premier plan, une étoffe rouge est jetée sur une chaise grossière.
Si Manet dans « Olympia » a mis plus de grâce et d’étrangeté, il n’a pas peint ces draps larges et clairs, ces ombres vigoureuses, ces membres puissants et ce rouge clamant comme une fanfare, qui pend sur cette chaise de campagne ; c’est là un morceau unique, sain, surprenant, énorme et qui fait songer avec désespoir au temps que perdit Cezanne, tyrannisé par son père ; et à ce que nous avons perdu nous-mêmes en ne l’employant pas sur les murs de nos édifices. Second Michel-Ange, il eût fait un second jugement dernier non moins surprenant que le premier. Insistons-y. C’est là un bien grand crime que la méconnaissance et le silence qui se sont faits autour de ce génie ; et nous-mêmes en payons la conséquence à cette heure par nos regrets.
Paul Cezanne n’est point de ceux qui intriguent et qui postulent. L’artiste est fier et grand, et son dédain est fait d’orgueil ; orgueil légitime comme la conscience de soi-même est légitime, orgueil qui donne la force, et fait regarder le malheur avec force.
Cette toile de jeunesse a disparu.
Le portrait d’« Achille Empéreire » [FWN423-R139], peintre, nous a aussi été montré, il doit dater de la même époque ; il nous fut même dit que toutes deux furent envoyées au salon et refusées, et que l’artiste, les croyant mauvaises sur cela, les laissa dix ans dans les greniers. Enfin Tanguy parvint à les en sortir et à les rendre aux curieux d’art, ceux-ci les dédaignaient ; mais elles ont toutes deux trouvé leur acquéreur.
Eugène Boch possède « Achille Empéreire ».
C’est un être maladif, à vaste front, assis dans un fauteuil antique, couvert d’une pelisse à fleurs ; ses maigres jambes sortent d’une robe de chambre d’un gros bleu, elles sont moulées par un caleçon gris rouge, et ses pieds sans chaussures mais en chausses sont posés sur une chaufferette de bois. Mêmes qualités que pour la femme nue couchée. Vision large, effet puissant, la tête est immense et triste, le dos du fauteuil resplendit derrière comme une auréole ; en haut du tableau on lit (formé avec des lettres de tôle et imprimé au tampon) : Achille Empereire, peintre.
Il existe un très grand nombre de toiles, que nous ne connaissons pas, dans différentes collections. Le maître Renoir nous a parlé, à Pont-Aven, d’un tableau de « Baigneurs » [FWN926-R261] appartenant à M. Caillebotte, et nous a fort vanté l’excellence de ce morceau hardi. Les peintres Schuffenecker, Blanche, Rouart, ont aussi chez eux de ces rares perles ; pour nous, comme nous l’avons dit déjà, le reste de ce que nous avons vu nous paraît indescriptible. Ce sont des paysages, des portraits, des natures mortes, d’une manière moins larges, mais plus cherchée et plus subtile, d’une science unique et déconcertante. Titien, Rubens, semblent des coloristes enfantins près de ces déroulements de dégradés jusqu’à l’évanouissement, et les primitifs eux-mêmes perdent leur style près de ces préciosités, gracieuses tellement qu’elles semblent inconnues.
Je l’ai dit, cette étude est une lourde tâche, une tâche impossible ; les mots sont sourds et vains, toute critique est ici impuissante. Il faut accepter l’œuvre tout et tel qu’il est, ou le méconnaître absolument ; seul un artiste pourra apprécier la science de ces couleurs réparties avec mesure, de ces finesses, de ces sensibilités, de ce style frêle, ample ou sauvage, de ces hardiesses qui n’ont rien de brutal, de cette rudesse apparente qui n’est que raffinement et beauté.
Il est facile de faire « Beau » avec les recettes que l’on enseigne à cet effet, comme il est facile d’être aimable en se banalisant ; mais ce Beau-là, c’est le Joli, et le Joli, c’est la haine du Beau. D’où il provient que si peu connaissent le Beau, le confondant toujours avec sa contrefaçon, contrefaçon si désagréable et exécrable aux purs artistes. Paul Cezanne a un « Beau » qui n’est pas celui-là, mais qui est le vrai. Dans un arbre, il voit un monde de grâce ; dans les encorbellements d’un buisson, les mille tresses d’une haie, la chevelure d’un saule, il inscrit un poème nouveau sans choquer en rien le goût vrai. D’un paysage apparemment banal il extraira ainsi le plus délicieux prétexte à couleurs, à combinaisons, de teintes et de nuances ; et vous-même surpris constaterez que le peintre en tout cela, inaperçu auparavant, n’a fait que de copier à travers les qualités de sa logique et de son propre génie, et a composé ainsi comme une sorte de fugue. Cette qualité, qui permet de transformer la vie moderne si souvent aride en beau et en aimable nous paraît la plus magique. Ainsi tout peut se peindre, car d’une robe de soie surgiront autant de délicieuses couleurs que d’un conte de fée, d’une chevelure autant de reflets somptueux que d’un casque ou d’une armure, et ainsi une simple nature morte de pommes pourra atteindre à la grandeur décorative d’une tapisserie du meilleur siècle, et cela parce que tout sera exprimé en l’œuvre, en ce sens que rien n’y sera vu d’une façon commune ou apprise.
Paul Cezanne est donc le type du peintre absolument personnel ; type toujours vanté, jamais trouvé, méconnu sitôt trouvé ; des maîtres il a la force, la science, le génie d’arrangement, et il leur ressemble tellement qu’il ne leur ressemble plus ; c’est pourquoi on peut, sans que cela lui nuise, devant la moindre de ses peintures, songer indifféremment à toutes les écoles et à tous les « phares ».
Mais, ce qu’il faut surtout admirer, dans ce peintre, c’est la profonde honnêteté de son exécution. Ici, point de ces balayages, de ces sauces, de ces rondeurs, de ces indécisions si fréquentes, même chez les meilleurs artistes ; les touches se succèdent comme les notes d’un morceau, sans qu’aucune soit inutile, et n’apporte à l’ensemble son concours. Loin ces peintres, dont Monsieur Carrière est le type, qui dans un faux effacement noient leur paresse ou leur ignorance. Le rêve n’est point là, comme on le croit trop vite, mais bien ici, où tout est senti et éclairé de délicate manière. N’est-ce point de la sérénité et de la douceur, que le rêve est l’enfant, et le mystère a-t-il cette maladresse et cette trivialité de moyens !! N’est-ce point plutôt une chose pressentie derrière ce que l’on voit, qu’une chose vue effacée et imparfaite…
Cependant, que des critiques complaisants ou malhonnêtes écrivent toute leur poétique d’usage et vident leurs compliments sur les postulants du succès, il est triste de songer que nos vrais grands hommes s’éteignent, méconnus aujourd’hui comme hier, édifiant de leur génie le monument futur qui témoignera à des temps moins hideux de la lâcheté et de l’ignorance de leurs contemporains. »
Fin décembre, après le 24
Dans un brouillon de lettre écrite et largement biffée sur deux feuilles du carnet de dessins CPII (National Galley of Art, I recto et II recto), Cezanne remercie Mirbeau de la marque de sympathie qu’il lui témoigne dans son article « Le legs Caillebotte et l’État », paru dans Le Journal du 24 décembre, où il se moque de l’hésitation que les pouvoirs manifestent envers cette donation. Il lui demande de l’« aboucher avec un marchand de tableaux ». Chappuis estime que c’est pour remplacer Tanguy, récemment décédé.
« Samedi faites voir au
Je vous prierai de m’aboucher avec un marchand de tableaux.
Vous êtes intelligent — vous voyez —
Faites voir au lecteur ce que vous voyez. —
Ecrivez pour les intelligences moyennes
Je ne crois pas que vous soyez un Huysman.
Ne vous sentez jamais son lecteur
J’attendais le renouvellement de l’année pour me rappeler à votre excellent souvenir, mais devant cette récente marque de sympathie artistique que vous me donnez dans le Journal, je ne puis tarder plus longtemps de vous remercier.
Je compte que j’aurai l’honneur de vous rencontrer vous revoir et pouvoir manifester d’une façon moins éphémère que par de simples paroles, la gratitude quis’impose[mot non lus] et s’impose.
Je vous prierai de vouloir bien faire agréer à Madame Mirbeau mes hommages Respectueux et me croire bien cordialement à vous. P. Cezanne »Brouillon d’une lettre de Cezanne à Mirbeau trouvé dans un carnet de dessins, [fin décembre 1894] ; Chappuis Adrien, Album de Paul Cezanne, préface de Roseline Bacou, Paris, Berggruen & Cie, 1966, n° 374, tome 1 : 89 pages de texte, p. 17, tome 2 : fac-similé du carnet de dessins, feuilles numérotées de I à LIIII, p. II et III, reproduites.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 241-242, la transcription est moins complète.
J.-K. Huysmans (1848-1907) tantôt faisait des réserves sur l’art de Cezanne, tantôt le louait, dans ses écrits.
Mirbeau Octave, « Le legs Caillebotte et l’État », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 818, lundi 24 décembre 1894, p. 1 :
« Le legs Caillebotte et l’État
Et le legs Caillebotte ?
Telle est la question qui me fut, l’autre jour, brusquement adressée par un amateur de peinture, surpris de ne point voir, accrochées dans les salles du Luxembourg, les très belles toiles léguées à l’État par le généreux et regretté Gustave Caillebotte. Cet amateur, je ne le désignerai pas autrement que par ceci : il possède une des plus admirables collections de tableaux, anciens et modernes, qui soient dans le monde et que, avec une ardeur de générosité irréfléchie et de naïf patriotisme, il était dans l’intention de laisser à l’État.
— Le legs Caillebotte ! répondis-je. Ma foi, je pense que l’État l’aura définitivement refusé… Cela vous étonne ?
— Nullement ! fit l’amateur, en homme qui n’est pas de province, de cette province politique, ambitieuse, stupide et barbare, sous quoi Paris est, de plus en plus, submergé… fluctuat et mergitur.
Et il ajouta :
— Cela m’étonne d’autant moins que je pressentais cette solution, et que vous me voyez, après cette aventure et quelques autres de ce genre, parfaitement décidé à déchirer mon testament, c’est-à-dire a ne laisser à l’État, vraiment trop grincheux et trop décourageant leyguataire, rien des chefs-d’œuvre illustres que je lui destinais… J’ai des héritiers très gentils, pour qui je désire que ma mort soit une joie sans mélange. Je ne veux pas les exposer aux tracasseries ridicules, aux fatigantes démarches, aux inutiles dégoûts, à toutes les discussions écœurantes que comportent, fatalement, de tels dons posthumes… D’ailleurs, je sais quelques collectionneurs, possesseurs d’inestimables objets, qui sont férocement résolus a faire comme je fais. Et savez-vous à combien j’évalue les trésors d’art que l’irréductible imbécillité de l’État, ses partis pris de fiscalité tyrannique, et son formalisme idiot, auront fait perdre à la nation française ?… Trente millions, mon cher, et je ne connais pas tout !… Non, vraiment, ils décourageraient jusqu’au bon Dieu lui-même… Mieux que cela, jusqu’à Mossieu Chauchard, s’il ne mettait, pour leur ivresse future, du Meissonier en bouteille… Inexprimables crétins !
— Ah! vous pouvez le dire !… Et l’histoire du legs Caillebotte est une éclatante paraphrase de votre judicieuse exclamation… Voulez-vous que je vous la raconte succinctement, cette histoire.
Je vous écoute.
― Eh ! bien, voilà ! Caillebotte meurt en léguant à l’État une collection de tableaux composée des plus délicieuses œuvres de Manet, Degas, Monet, Renoir, Cezanne, Berthe Morisot, Pissarro. En homme qui connaît l’esthétique de l’État, il met à ce legs une prévoyante condition : c’est que l’État n’enterrera ces tableaux ni dans un grenier, avec les seuls rats pour public, ni dans un musée de province, et qu’il les accrochera, comme si c’étaient d’infâmes croûtes, au musée du Luxembourg. L’État fait d’abord la grimace. C’est une habitude, et il n’y a pas lieu de s’en inquiéter. Quand on lui lègue quelque chose, son premier mouvement est de se méfier et de se demander si on ne lui fait pas « une blague ». Enfin, après des hésitations nombreuses et prudentes, il entre en pourparlers avec les exécuteurs testamentaires de Caillebotte…
— Enchanté, messieurs… Vraiment, ce M. Caillebotte était un homme bien généreux, et vous-mêmes vous êtes des artistes incomparables.
Devant la collection réunie, l’État pousse des soupirs de découragement :
— Il y en a trop !… gémit-il. Il y en a trop !… D’abord, vous n’ignorez pas que, par un décret aussi sage que restrictif, nous ne pouvons admettre, pour le Luxembourg, que trois toiles d’un artiste vivant…
— C’est pourquoi, répondent les exécuteurs testamentaires, vous avez sept Meissonier au Luxembourg !…
— Ils sont si petits !
— Et si l’on vous en donnait cinquante mille, vous sauriez bien les accrocher tous. Au besoin, vous n’hésiteriez pas à faire construire un palais pour eux.
— Sans doute!… Mais Meissonier est Meissonier !
— On ne vous le reproche pas, et nous sommes plus tolérants. Nous trouvons ça très bien, au contraire. Il y a des gens qui aiment le Meissonier et à qui cela fait plaisir de venir le dimanche s’ébaubir devant ces images vénérées. C’est parfait ! Nous ne demandons pas tant ; nous voudrions seulement que les peintres officiels, dont vous représentez, en ce moment, l’omnipotente avidité et les éternelles rancunes, agissent comme nous… quoique, dans le fond, entre nous, n’est-ce pas, nous nous moquions absolument du Luxembourg !… Notre idéal n’est pas là, croyez-le… Mais nous sommes ici pour exécuter les volontés d’un mort qui fut notre ami… Acceptez-vous ?
— Vous nous mettez dans une situation terrible !… Quel dommage, vraiment, que M. Caillebotte ait eu la malencontreuse idée d’imposer une condition à son legs !… Pourquoi ne nous a-t-il pas légué ces tableaux sans condition ? Nous les eussions enterrés quelque part… Il n’en eût plus été question, et tout le monde serait tranquille aujourd’hui… Au lieu que nous sommes-là, à discuter… Vraiment, les morts, ont parfois des inventions bien bizarres.
— Enfin, oui, ou non… acceptez-vous ? Si le nombre des toiles vous gêne et que vous vouliez respecter un décret dont vous savez si bien vous passer en d’autres occasions… eh bien, choisissez dans le tas les tableaux qui vous plairont et laissez-nous le reste.
— Impossible !… Il nous faut tout prendre ou tout laisser !…
— Eh bien, prenez-vous ?
— C’est très délicat…
— Ou laissez-vous ?
— C’est bien tentant !
— Il faut pourtant vous résoudre à l’une quelconque de ces deux extrémités…
— Comme vous y allez !… Les choses, que diable, avec moi, n’ont jamais cette allure. Sapristi ! laissez-moi réfléchir…
Et les mois s’écoulent. L’État est toujours perplexe. Enfin, un beau jour, il convoque les exécuteurs testamentaires.
— J’accepte le legs, dit-il.
— Ah ! enfin !…
— Oui, je l’accepte. Seulement, je mettrai une partie des tableaux a Versailles, une partie à Compiègne, une autre a Fontainebleau… et rien au Luxembourg.
—Pardon ! répliquent les exécuteurs testamentaires, le testament est net, il est clair comme le jour. Les tableaux seront au Luxembourg ou ils ne seront pas…
— Mais ignorez-vous donc que Versailles, Compiègne et Fontainebleau ne sont que des succursales du Luxembourg !… Ce n’est pas de la province, que diable !. Et quels souvenirs historiques !… Louis XIV, Napoléon III, Casimir-Perier !…
— Le Luxembourg ou rien !
— Ah ! vous êtes intolérables, à la fin. Allez vous asseoir.
— Alors, c’est bien décidé… vous refusez ?
— Je refuse sans refuser… J’accepte sans accepter !… Nous reparlerons de cette affaire dans une quinzaine d’années, si vous le voulez bien…
L’amateur avait écouté ce récit, et voici comment il conclut :
— En ce qui me concerne, comme il m’est très désagréable de penser que mes tableaux, qui m’ont coûté tant de recherches, tant d’argent, puissent être, un jour, après ma mort, dispersés, par le hasard d’une vente ou d’un partage, je prends le parti de les léguer… à l’Angleterre, qui se fera une véritable joie de les accepter et de leur donner, à la National Gallery, les places d’honneur qu’ils méritent…
Parodiant un mot célèbre, il s’écria :
— Ingrate patrie, tu auras peut-être mes os, mais tu n’auras pas mes tableaux !
Puis il sortit noblement.
Je crois tout de même qu’il exagère.
OCTAVE MIRBEAU. »
D’autres articles de presse évoquent le legs Caillebotte au début de 1895 :
« Revue de la presse », Journal des débats politiques et littéraires, 107e année, vendredi soir 11 janvier 1895, p. 3.
« M. Arsène Alexandre consacre un article de l’Éclair au refus de la collection Caillebotte par l’État :
« L’État vient de refuser la collection Caillebotte. Du moins, il l’avait acceptée dans des conditions tellement ridicules et insultantes que cette acceptation était pire que le refus et que les exécuteurs testamentaires se conformaient au vœu du donateur, ont repris provisoirement ce magnifique cadeau.
Ils ont fait leur devoir, tout leur devoir. L’administration, une fois de plus, a manqué au sien.
Parmi ces tableaux, il y a le Balcon et la Femme à la mantille noire de Manet ; le Chœur des soldats et la Terrasse d’un café de Degas ; le Moulin de la Galette et la Balançoire de Renoir ; le Déjeuner, le Givre de Claude Monet ; les Racleurs de parquets et le Jeune Homme au piano de Caillebotte ; les Baigneurs[FWN926-R261] et des paysages de Cezanne [FWN129-R389, FWN119-R390] ; des toiles de choix, de Sisley, de Pissaro.
Caillebotte avait exprimé la. volonté que, si l’État n’acceptait point le legs dans son intégralité, et pour l’exposer au Luxembourg, ses exécuteurs testamentaires le reprendraient et en seraient quittes pour le proposer de nouveau le jour où se rencontrerait un gouvernement intelligent, ou une administration informée.
Le Conseil d’État a fait savoir que la collection ne pourrait être acceptée qu’à la condition que l’on pourra la transporter à Compiègne ou à Fontainebleau.
L’administration des beaux-arts s’est retranchée derrière cet avis ; en conséquence, les exécuteurs testamentaires de Caillebotte qui ne voulaient voir ses tableaux qu’au Luxembourg se sont conformés aux volontés du testateur et la famille garde les toiles. — On se souvient pourtant que, lors de la visite de M. Leygues au Luxembourg, il avait prévu, dans les agrandissements possibles du musée, la construction d’un pavillon spécial pour recevoir la collection Caillebotte. »
Demailly Ch., « Journaux d’hier. La collection Caillebotte », Le Gaulois, 29e année, 3e série, samedi 12 janvier 1895, p. 3 :
« La collection Caillebotte
M. Arsène Alexandre, dans l’Éclair, s’indigne du refus de l’administration des beaux-arts, d’admettre au Luxembourg la collection des impressionnistes léguée par M. Caillebotte :
Parmi ces tableaux il y a le « Balcon » et la « Femme à la mantille noire », de Manet ; le « Chœur des soldats » et la « Terrasse d’un café » M. de Degas ; le « Moulin de la Galette » et la « Balançoire », de Renoir ; le « Déjeuner », le « Givre », de Claude Monnet ; les « Racleurs de parquets » et le « Jeune homme au piano », de Caillebotte ; les « Baigneurs » [FWN926-R261] et des paysages de Cezanne [FWN129-R389, FWN119-R390], des toiles de choix de Sisley, de Pissarro. Cette collection, parfaitement homogène, et d’une grande valeur (les marchands de lorgnettes vous diraient qu’elle dépasse certainement deux ou trois cent mille francs, mais nous préférons ne pas parler en marchands de lorgnettes), cette collection, qui représente un ensemble comble une lacune dans les musées nationaux, est léguée par le possesseur à ses compatriotes. Il semble qu’il n’y ait qu’à accepter, à honorer la mémoire du donateur, puis à passer à d’autres affaires.
Or l’administration n’a voulu admettre cette collection qu’à Fontainebleau ou Compiègne, et par ce fait le legs est caduc.
En vérité, tout cela est bien triste et bien dérisoire. Pour les mêmes raisons ou des raisons semblables, nous n’avons au Louvre ni Corot, ni Daumier, ni Millet, c’est-à-dire qu’ils sont très mal ou très incomplètement représentés. Nous ne pouvons plus acheter de leur peinture, parce qu’elle coûte maintenant cinq cents fois trop cher pour nous. De même, voici un groupe qui, pendant vingt-cinq ans, a produit des œuvres remarquables, a exercé une considérable influence, qui a sa place dans l’histoire de l’art. On pouvait avoir cette fois pour rien un résumé parfait de ce groupe. Il ne sera pas plus représenté dans les galeries publiques que les naturistes de 1830. »
« Le legs Caillebotte. Le Luxembourg doit-il accepter la collection ? », Le Matin, 12e année, n° 3970, samedi 12 janvier 1895, p. 1 :
« LE LEGS CAILLEBOTTE
LE LUXEMBOURG DOIT-IL ACCEPTER LA COLLECTION ?
Une donation trop exclusive — Rue de Valois — Faute d’emplacement — Difficultés d’aménagement — Et les achats du Salon ? — Rien n’est compromis.On se rappelle le testament si généreux par lequel le peintre Caillebotte laissait à l’État sa collection de tableaux modernes, comprenant de fort belles toiles des maîtres impressionnistes les plus estimés : Manet, Claude Monet, Degas, Sisley, Pissarro, Cezanne, etc.
Il paraît que des difficultés viennent de surgir entre l’administration et les exécuteurs testamentaires pour l’acceptation de ce legs.
Comme des attaques fort aigres ont été dirigées à ce propos contre l’administration des Beaux-Arts, nous avons voulu connaître les véritables raisons des difficultés survenues.
Voici ce qu’on nous a répondu dans les bureaux de la rue de Valois :
— En lisant les articles violents qui ont paru à propos de la collection Caillebotte, on pourrait croire à la mauvaise foi de ceux qui les ont écrits.
Je ne vous citerai pas les nombreuses inexactitudes qu’ils contiennent. Cela serait trop long. Contentons-nous d’examiner les griefs que l’on met en avant.
On dit que l’État vient enfin de refuser la collection Caillebotte ? Rien n’est plus faux. Et pour cette seule raison que l’administration des Beaux-Arts continue les pourparlers engagés avec les exécuteurs testamentaires de l’artiste et espère arriver à une entente.Trop d’exigences.
Par son testament, Caillebotte a laissé sa très intéressante collection à l’État, mais il ne s’en est pas tenu là : il a stipulé en outre qu’il faisait ce legs à la condition absolue que toutes les toiles composant sa galerie seraient réunies dans une seule et même salle, au Luxembourg.
La direction des Beaux-Arts n’aurait pas mieux demandé que d’acquiescer à cette dernière volonté : mais, tout en rendant hommage à la générosité du donateur et en laissant pour un instant la question d’art de côté, il lui a bien fallu étudier la question, matérielle de l’organisation de la galerie.
Or, comme vous le savez, le musée du Luxembourg dispose d’un emplacement si restreint, qu’il est actuellement impossible d’y placer des œuvres d’une grande valeur qui attendent depuis longtemps un bout de panneau pour être exposées aux yeux du public.
Comment, dès lors, pourrait-on admettre que, du jour au lendemain, il soit possible de trouver dans ces pavillons archi remplis une salle entière pour y installer d’un seul bloc toutes les œuvres léguées par Caillebotte ?
Faudra-t-il, pour satisfaire au testament du regretté peintre, décrocher et exiler dans les greniers des toiles aimées du public et qui, certainement, valent celles qu’on nous propose ? Que diraient alors les amateurs ? De quels anathèmes l’administration ne serait-elle pas poursuivie ? De quel éreintement ne serait-on pas prodigue ?
Nous vous en laissons juge.Place aux jeunes.
Et puis ! que diront les artistes qui chaque année exposent au Salon des œuvres de mérite dans l’espoir de les voir acheter par l’État et exposer au Luxembourg ? Si nous n’avons plus la place d’exposer les toiles appartenant déjà à l’État, où placerons-nous celles que la moisson annuelle nous apporte ?
Nos artistes ne veulent pas entendre parler des. musées de province. Ils veulent, tous, les honneurs de la rue de Vaugirard. Qu’on nous donne des locaux et nous satisferons tout le monde.
Dans les attaques passionnées dirigées contre l’administration, on a fait intervenir le conseil d’État. Ce grand corps de l’État se transformant, a-t-on dit, en jury artistique, aurait refusé le legs.
Ceux qui parlent ainsi devraient savoir que le conseil d’État ne s’occupe jamais que du point de vue administratif et qu’il ne sort pas de ses attributions. Il a examiné le côté légal de la question, et rien de plus.
Du reste, à quoi bon répondre davantage ? La question reste pendante. Aucune parole aigre n’a été prononcée, aucune allusion à une rupture quelconque n’a été faite dans les entretiens qui ont eu lieu entre l’administration et les exécuteurs testamentaires. Attendons les résultats et tâchons de satisfaire les amateurs d’art. »
« Musée insuffisant. Entretien avec le conservateur du Luxembourg », Le Matin, 12e année, n° 3971, dimanche 13 janvier 1895, p. 1 :
« MUSÉE INSUFFISANT
ENTRETIEN AVEC LE CONSERVATEUR DU LUXEMBOURG
À propos du legs Caillebotte — Chez M. Bénédite — L’exiguïté des locaux — Impossibilité de s’agrandir — Déménagement qui s’impose.Nous avons exposé l’état. de la « question Caillebotte » et dit à quelles raisons spéciales est dû le retard fort naturel apporté à l’acceptation définitive, par la direction des Beaux-Arts, des collections du regretté peintre impressionniste.
Parmi les motifs invoqués à juste titre contre l’acceptation en bloc figure en première ligne l’insuffisance des locaux du musée appelé à entrer en possession des legs. Il était intéressant de faire connaître à cet égard l’opinion de M. Bénédite, le distingué conservateur du Luxembourg.
— Vous me demandez, nous dit-il, en quoi le musée est insuffisant ? En tout.
La section de sculpture est si encombrée que les statues sont à peu près coude à coude. L’espace indispensable à l’analyste, qui aime à se mouvoir aisément autour de son sujet, à s’en éloigner pour le mieux voir et l’apprécier, fait totalement défaut.
Faute de place, les bronzes ont dû être placés sur la terrasse. Pour la même raison, les animaux sont relégués dans la cour. Quant à la peinture, l’exiguïté des salles où elle est renfermée oblige à limiter à trois le nombre des œuvres exposées par un même artiste. Une. telle mesure n’est pas digne de notre premier musée d’art moderne. Aujourd’hui, il serait impossible de placer un tableau, à moins d’en retirer un autre.
Lorsque, il y a quelques années, on voulut procéder à l’adjonction d’une salle consacrée à la peinture étrangère, il fallut supprimer la salle des dessins. Ces derniers se trouvent actuellement, ainsi que les pastels et les aquarelles, en partie dans la salle 9, où ils sont horriblement à l’étroit, et en partie… chez le président du Sénat !
Passons maintenant à la très belle collection de médailles et de pierres gravées, de création récente, collection à laquelle il serait indispensable d’affecter une salle spéciale. Elle est à peu près introuvable, serrée, étouffée qu’elle est parmi les marbres de la galerie d’entrée.
Les objets d’art ne sont pas dans une meilleure situation. Placés dans des vitrines, au beau milieu du premier salon de peinture, ils ne sont guère vus et empêchent de voir.Et les estampes ?
La création d’une salle d’estampes serait aussi l’une des plus importantes à mettre à l’ordre du jour de la reconstruction ou da l’agrandissement du musée. En ce moment, cette collection est enterrée : dans une petite pièce d’une dizaine de mètres carrés, à laquelle les amateurs sont autorisés à accéder deux fois par semaine par l’escalier de l’administration.
Ce n’est pas tout ; il n’y a au Luxembourg ni atelier de moulage, ni atelier de photographie, ni magasin. Les statues ou les tableaux placés en réserve pour une raison ou pour une autre s’empilent tout simplement, comme vous voyez, dans mon cabinet. Parfois, quand l’encombrement devient trop grand et qu’il faut absolument faire de la place, j’en envoie un peu au Louvre, un peu au Palais de l’Industrie et même à l’Élysée ou au Palais-Bourbon ! Il va sans dire, que ces déplacements, outre qu’ils eurent des chances de détérioration, nécessitent aussi des frais de transport assez élevés.
Enfin, il est une autre lacune qu’il est urgent de combler : le conservateur du Luxembourg n’y est pas logé. Qu’il se produise, pendant la nuit ou un dimanche, en son absence, un incident ou un accident quelconque, et toute la responsabilité des mesures à prendre incomberait à un gardien-chef, serviteur intelligent et dévoué à la vérité, mais à qui manquerait évidemment l’autorité et la connaissance nécessaires pour agir vite et bien.
Nous demandons alors à M. Bénédite comment il estime qu’il soit possible d’étendre ou de surélever les bâtiments actuels.Allons ailleurs.
— En hauteur, l’adjonction d’un étage est impossible, vu le peu de solidité des murs et l’insuffisance des fondations. En largeur, l’addition de n’importe quel dégagement nécessiterait un empiétement soit sur les jardins de la présidence du Sénat, soit sur le jardin public du Luxembourg. A quelque parti qu’on se rangeât, il faudrait que l’empiétement fût autorisé par le Sénat, auquel une loi concède la jouissance absolue de tout le Luxembourg.
— Et que pensez-vous d’une reconstruction complète?
— J’en suis absolument partisan. D’abord parce que le musée actuel est exposé au midi, que la chaleur y est insupportable en été, et que le soleil y détériore peu à peu les œuvres exposées.
— Existe-t-il un projet de réédification du musée des artistes vivants, car, en cas de déplacement, il ne sera plus possible de continuer à l’appeler « musée du Luxembourg » ?
— Pas que je sache. Mais il faudra bien s’y résoudre. »
« Chronique parisienne. La collection Caillebotte », La Croix Supplément, n° 3588, dimanche 13, lundi 14 janvier 1895, p. 1 :
« La collection Caillebotte
L’État vient de refuser la collection Caillebotte.
Il l’avait acceptée….. dans des conditions tellement ridicules que cette acceptation était pire que le refus et que les exécuteurs testamentaires, se conformant au vœu du donateur, ont repris ce magnifique présent.
Parmi ces tableaux, il y a le Balcon et la Femme à la mantille noire, de Manet ; le Chœur des soldats et la Terrasse d’un café, de Degas ; le Moulin de la Galette et la Balançoire, de Renoir ; le Déjeuner, le Givre, de Claude Monet ; les Racleurs de parquets et le Jeune homme au piano, de Caillebotte ; des paysages de Cezanne ; des toiles de choix de Sisley, de Pissaro.
Caillebotte avait exprimé la volonté que, si l’État n’acceptait point le legs dans son intégralité, et pour l’exposer au Luxembourg, ses exécuteurs testamentaires le reprendraient et en seraient quittes pour le proposer de nouveau le jour où se rencontrerait un gouvernement plus soucieux des choses de l’art.
Le Conseil d’État a fait savoir que la collection ne pourrait être acceptée qu’à la condition que l’on pourra transporter à Compiègne ou à Fontainebleau.
L’administration des Beaux-Arts s’est retranchée derrière cet avis. Et les exécuteurs testamentaires de Caillebotte qui ne voulaient voir ses tableaux qu’au Luxembourg se sont conformés aux volontés du testateur et la famille garde les toiles. »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 73-75 /
« En 1895, l’État eut à se prononcer sur l’acceptation, pour le Musée du Luxembourg, du legs Caillebotte. Parmi les tableaux de ce legs, il y avait quelques Cezanne, notamment les Baigneurs [R 261], donnés jadis à Cabaner, et que Caillebotte, à la mort de celui-ci, avait acquis pour la somme de trois cents francs, prix énorme pour le temps. Mais Caillebotte ne regardait jamais au prix quand un tableau lui plaisait. Cezanne, en apprenant que ses Baigneurs iraient au Luxembourg, l’antichambre du Louvre, avait eu ce cri du cœur : « Maintenant j’emm..de Bouguereau ! » Le mot, répété, eut beaucoup de succès, sauf en haut lieu, où on le jugea d’une suprême inconvenance. On se vengea en décrétant que les Baigneurs n’entreraient pas au Luxembourg, résolution sur laquelle les Beaux-Arts comptaient secrètement pour se trouver délivrés du cauchemar de l’ensemble entier de la collection Caillebotte ; car celle-ci, aux termes du testament, devait être acceptée ou refusée dans sa totalité.
Mais on n’avait pas prévu le désintéressement des héritiers de Caillebotte. Ceux-ci, dans leur respect de l’« esprit » des intentions du donateur, acceptèrent la condition imposée sans s’attacher à la « lettre » du testament. De telle manière que l’Administration des Beaux-Arts se vit contrainte à laisser voir plus ouvertement son jeu. Alléguant le manque de place, et l’intérêt bien compris des peintres eux-mêmes, elle repoussa huit Monet, trois Sisley, onze Pissarro, un Manet, et deux autres Cezanne : un Bouquet de fleurs [FWN722-R265] et une Scène champêtre [FWN637-R244], au total vingt-cinq toiles. La collection Caillebotte se trouvait ainsi réduite de près de moitié. Ce n’était plus l’entrée triomphale des Impressionnistes au Luxembourg ; mais les amis de la « bonne peinture » demeuraient intransigeants : des professeurs de l’École des Beaux-Arts n’avaient-ils point parlé de démissionner ? »
Ludovici A.[Anthony], An Artist’s Life in London and Paris 1870-1925, New York, Minton, Balch & Company, 1926, 210 pages, p. 200 :
Traduction :
« Dans cette collection [de Caillebotte] figurait un tableau de Cezanne, « Les Baigneurs », acheté par Caillebotte pour 300 francs. Cezanne, apprenant que son tableau devait être accroché au Luxembourg, dans sa joie et son mépris des Bouguereau, eut ce cri du cœur : « Maintenant j’emm..de Bouguereau ! », mots qui furent répétés dans tous les ateliers de Paris. Cette déclaration fut jugée tellement inconvenante par les autorités des Beaux-Arts qu’elle les détermina à refuser ce tableau et vingt-quatre autres de Monet, Sisley, Pissarro, aussi bien que d’autres de Cezanne. La collection Caillebotte fut en conséquence réduite de moitié, bien que selon les termes du testament elle dût être acceptée ou refusée dans sa totalité. »
[Fin décembre ?]
Cezanne rédige au crayon, sur un carnet de dessins, des vers d’occasion composés sous l’incitation de son fils, probablement jeune homme.
« Mon fils me demande de lui faire des vers
Mais hélas, je crains bien de rimer de travers
Car Phébus Apollon à mon appel rebelle
Pour monter au Parnasse a retiré l’échelle.
Je me gratte le front, et plus dure qu’un rocher
Ma muse en mal d’enfance refuse d’accoucher.
A moins que mon enfant à ce jeu ne se pique
Je vais casser ma plume et rester sans réplique.
Malgré l’entêtement de ma muse infertile
Dans un site enchanteur ombragé d’arbres verts
Aux regards importuns de tous côtés couverts
Une claire fontaine à l’eau limpide et pure
S’écoule lentement avec un doux murmure.
C’est là que mon enfant a surpris l’autre jour
une jeune
Le saule
Le saule, le peuplier, audessus de ces eaux
balancent mollement leurs flexibles rameaux
et mon fils [mot biffé non lu, lu « amoureux » par Chappuis]
Quand un jour mon cher fils, cherchant la solitude
pour s’y livrer à l’aise aux douceurs de l’étude
y fait [mots biffés non lus] hazard
et portant un bouquin favori sous son bras
par un simple hazard y vint porter ses pas.
Tout à coup il s’arrête ; et [mot biffé non lu] en haleine
et gardant le silence,
il jouit d’un tableau, que sa seule présence,
soupçonnée en ces lieux s’il avait été [mot non lu], aurait pu déranger :
étranger
Le [mots biffés non lus]
En ces lieux ignorés, formant comme »Vers écrits par Cezanne sur deux pages d’un carnet de dessins, [fin décembre 1894] ; Chappuis Adrien, Album de Paul Cezanne, préface de Roseline Bacou, Paris, Berggruen & Cie, 1966, n° 374, tome 1 : 89 pages de texte, p. 87-88, tome 2 : fac-similé du carnet de dessins, feuilles numérotées de I à LIIII, p. LIIII verso et LIIIIX2 (sur la moitié droite de la dernière page et sur le second plat intérieur de la couverture), reproduites.