5 janvier
Lettre de Zola à Cezanne :
Lettre de Zola à Cezanne, 5 janvier 1860 ; Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 190-192.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 126-127.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 64-65.« Paris, 5 janvier 1860
Mon cher Cezanne,
J’ai reçu ta lettre. J’ai fumé une pipe — je possède depuis le jour de l’an une belle pipe en écume que je culotte magnifiquement — et j’ai vu voltiger dans la fumée du tabac mille pensées que je te communique sur-le-champ, croyant te distraire.
Tu me demandes de te parler de mes maîtresses, mes amours sont en rêve. Mes folies sont d’allumer mon feu, le matin, de fumer ma pipe et de penser à ce que j’ai fait et à ce que je ferai. Tu vois qu’elles ne sont pas bien coûteuses et que je n’y perdrai pas la santé. Je n’ai pas encore vu Villevieille ; à la première occasion je ferai la commission du passe-partout. Quant à Catherine, ma mère doit lui écrire très prochainement.
Tu as lu, dis-tu, mon feuilleton [« La Fée amoureuse », publié dans La Provence, les 29 décembre 1859 et 26 janvier 1860]. J’ai bien peur qu’on ne l’ait pas plus compris que Mon follet [publié dans La Provence, 4 août 1859]. La pauvre Sylphide amoureuse, comme on a dû lui arracher ses belles ailes et sa couronne ! On a dû n’y voir qu’une fée vulgaire, et je me l’étais représentée si belle et si riante. Pour moi, c’étaient les âmes des deux amants réunies en une seule et chantant cet hymne de l’Amour que la terre chante depuis six mille ans. Hélas ! j’ai bien peur qu’on ne l’ait pas comprise.
Tu dois savoir que je ne suis rien moins qu’un favori de la Fortune, et depuis quelque temps il me peine de me voir, moi, grand garçon de vingt ans, à la charge de ma famille. Aussi suis-je décidé à faire quelque chose, à gagner le pain que je mange. Je pense entrer dans quinze jours au plus dans l’administration des Docks 1. Toi qui me connais, qui sais combien j’aime ma liberté, tu comprendras que je dois bien me forcer pour m’y résoudre. Mais je croirais commettre une méchante action en n’agissant pas ainsi. J’aurai encore beaucoup de temps à moi et je pourrai me livrer alors aux occupations qui me plaisent. Je suis loin d’abandonner la littérature — on abandonne difficilement ses rêves — et je tâcherai de remplir le moins longtemps possible un emploi qui me pèsera sans nul doute. Je te l’ai déjà dit dans ma dernière lettre, la vie est une boule qui ne roule pas toujours où la main voudrait la pousser, et crois que je ne quitte pas avec plaisir mes livres et mes papiers pour aller m’asseoir sur une chaise et griffonner de méchantes copies. Mais je serai toujours le même, je serai toujours le poète qui divague, le Zola qui est ton ami. Après avoir secoué à ma porte la poussière du bureau, je reprendrai la plume pour continuer mon poème interrompu ou ta lettre commencée. C’est une nécessité, et je m’y conforme en y apportant mes petits changements.
Je lis cette phrase dans un des derniers feuilletons de Gaut : « Lorsque la chaleur des estomacs repus eut fait monter le vermillon de la satisfaction à tous les visages… » [« La bûche de Noël », Le Mémorial d’Aix, 25 décembre 1859] Qu’en dis-tu ? Jamais les précieuses n’ont inventé quelque chose de mieux. C’est faux, tiraillé, d’un goût atroce.
Tu vois, mon cher ami, que je t’ai répondu longuement. Et encore je n’ai pas tout dit, et assez bien dit ce que je voulais dire. N’importe, je désire que cela t’ait distrait un instant.
Je te serre la main. Ton ami,
É. Zola »
1. Zola devait quitter cet emploi dès le mois de mai, incapable de supporter la vie d’un bureaucrate.
La phrase de Gaut que cite Zola provient du feuilleton du Mémorial d’Aix, du 25 décembre 1859 : « Quand la chaleur des estomacs repus fit monter le vermillon de la satisfaction à tous les visages ».
Gaut J.-B. [Jean-Baptiste], « La bûche de Noël », Le Mémorial d’Aix, journal politique, littéraire, administratif, commercial, agricole, 23e année, n° 52, dimanche 25 décembre 1859, p. 1-2, p. 1.
9 janvier
Cezanne prend sa sixième inscription à la Faculté de droit d’Aix, pour le deuxième trimestre de l’année 1859-1860, mais il abandonnera ses études au cours de ce trimestre.
« Registre des inscriptions à la Faculté de droit d’Aix, contenant quatre cent trois feuilles recto et verso, commencé le 2 janvier 1858 à la page n° 1 clos le 18 à la page » ; Archives départementales des Bouches-du-Rhône, centre d’Aix-en-Provence, fonds de la Faculté de droit, 1T 1900 ; reproduit par Lioult Jean-Luc, Monsieur Paul Cezanne, rentier, artiste peintre. Un créateur au prisme des archives, Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Images en Manœuvres éditions, 2006, 299 pages, p. 59.
14 janvier
Zola écrit à Baille. Il lui joint un extrait d’une lettre qu’il compte envoyer prochainement à Cezanne, amoureux, d’un amour platonique.
Lettre de Zola à Baille, Paris, 14 janvier [1860] ; Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 1-4, daté 14 janvier 1859.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 128-130.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 43-45.« Paris, le 14 janvier
Mon cher Baille,
Je ne te ferai aucun reproche, cela est de fort mauvais ton et n’avance à rien. Tu t’accuseras toi-même, en pensant que nous sommes au 14 janvier et que tu ne m’as pas encore écrit, malgré ta promesse. Tu ne me feras jamais croire que le travail t’absorbe à ce point ; j’ai de sérieuses inquiétudes sur ta santé et sur ton intelligence ; rien ne donne plus de maux de tête, rien n’abrutit comme un travail prolongé, et tu me sembles t’en donner à cœur joie.
Cezanne, qui n’est pas aussi paresseux que toi — je devrais dire aussi travailleur, — m’a écrit une bien longue lettre [le 29 décembre]. Jamais je ne l’ai vu si poète, jamais je ne l’ai vu si amoureux ; si bien que, loin de le détourner de cet amour platonique, je l’ai engagé à persévérer. Il m’a dit qu’à Noël tu avais tâché de le ramener au réalisme en amour. Jadis, j’étais de cet avis, mais je crois maintenant que c’est un projet indigne de notre jeunesse, indigne de l’amitié que nous lui portons. Je lui ai répondu longuement, lui conseillant d’aimer toujours, et le lui persuadant par des raisons que je ne puis te dire ici. Si par hasard tu t’étais fait l’apôtre du réalisme, si le conseil que tu as donné à Cezanne n’était pas dicté par ton amitié pour lui, si tu désespérais toi aussi de l’amour, je t’engage à lire ma réponse à Cezanne quand tu le pourras, et je souhaite que cette lecture puisse rajeunir ton cœur noyé dans l’algèbre et la mécanique. Je vais même te transcrire quelques lignes que je pense adresser à Cezanne prochainement. C’est à lui que je parle, mais cela te convient aussi ; voici ces lignes :
« Dans une de tes dernières lettres, je trouve cette phrase : « L’amour de Michelet, l’amour pur, noble, peut exister, mais il est bien rare, avoue-le ». Pas si rare que tu pourrais le croire, et c’est un point sur lequel j’ai oublié de te parler dans ma dernière lettre. Il était un temps où, moi aussi, je disais cela, où je raillais, lorsque l’on me parlait de pureté et de fidélité, et ce temps-là n’est pas bien ancien. Mais j’ai réfléchi, et j’ai cru découvrir que notre siècle n’est pas aussi matériel qu’il veut le paraître. Nous faisons comme ces échappés de collège qui se disputent entre eux pour savoir celui qui aura commis le plus grand méfait ; nous nous racontons nos bonnes fortunes avec le plus d’égoïsme possible et nous nous noircissons à qui mieux mieux. Nous semblons faire fi des choses saintes ; mais, si nous jouons ainsi avec les vases de l’autel, si nous nous appliquons à démontrer à tous que nous ne valons rien, je crois que c’est plutôt par amour-propre que par méchanceté innée. Les jeunes gens surtout ont cet amour-propre, et comme l’amour est, si j’ose parler ainsi, une des plus belles qualités de la jeunesse, ils s’empressent de dire qu’ils n’aiment pas, qu’ils se traînent dans la fange du vice. Tu as passé par là et tu dois le savoir. Celui qui avouerait un amour platonique au collège — c’est-à-dire une chose sainte et poétique — n’y serait-il pas traité de fou ? Mais je le répète, l’amour-propre joue là-dedans un grand rôle ; de même qu’en religion un jeune homme n’avoue jamais qu’il prie, en fait d’amour un jeune homme n’avoue jamais qu’il aime. Crois que la nature ne perd pourtant jamais ses droits ; au temps des chevaliers, la mode était d’avouer son amour et on l’avouait, maintenant la mode a changé, mais l’homme est toujours l’homme, il ne peut se dispenser d’aimer. Je gagerais bien que l’on trouverait l’amour au fond du cœur de ceux qui veulent passer pour les plus grands scélérats : chacun a son heure, chacun doit y passer. Maintenant il est vrai qu’il y a des amants plus ou moins poètes, plus ou moins exaltés. Chacun aime à sa manière, et il serait absurde à toi, l’amant des fleurs et des rayons, de dire que l’on ne peut aimer sans faire des vers et sans aller se promener au clair de lune. Le berger grossier peut aimer sa bergère ; l’amour est chose bien élevée, bien sublime, mais il entre dans chaque âme, même la moins cultivée, en s’y modifiant selon l’éducation. Pour revenir, c’est donc à l’orgueil, un bien sot orgueil, qu’il faut s’en prendre, suivant moi ; c’est à la société, aux hommes réunis et non à l’homme en particulier. L’homme ne peut se passer d’aimer, ne serait-ce qu’une fleur, qu’un animal ; pourquoi donc alors ne voulez-vous pas qu’il aime la femme ? Je sais bien que la cause que je plaide ici est bien épineuse ; nous sommes enfants du siècle et l’on a eu soin de nous donner des idées arrêtées sur ce sujet. On nous a tant fait d’aimables plaisanteries sur la femme et sur l’amour que nous ne croyons plus à tout cela. Mais, si tu y réfléchis bien, si tu consultes bien ton cœur, tu seras forcé de convenir, en considérant que tu n’es pas d’une autre pâte que les autres hommes, qu’il est faux d’avouer que l’amour est mort, que notre temps n’est que matérialisme. Une tâche grande et belle, une tâche que Michelet a entreprise, une tâche que j’ose parfois envisager, est de faire revenir l’homme à la femme. On finirait peut-être par lui ouvrir les yeux ; la vie est courte, ce serait un moyen de l’embellir ; le monde est dans la voie du progrès, ce serait un moyen d’arriver plus vite. Et ne va pas croire que ce soit le poète qui parle. Qu’importe même l’exagération. Michelet fait un dieu de la femme dont l’homme est l’humble adorateur. Aux grands maux, il faut les grands remèdes, si l’on exécutait la moitié de ce qu’il demande, le monde à mon avis, irait parfaitement. »
Mes respects à tes parents. Je te serre la main.
Ton ami dévoué.
Émile Zola »
16 janvier
Lettre de Zola à Cezanne.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 192-195.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 130-132.« Paris, 16 janvier 1860
Mon cher Cezanne,
Me trouvant à la tête de l’énorme somme de vingt centimes, et ne sachant à quoi l’employer dignement, j’ai pensé que c’était tout juste ce qu’il fallait pour causer un peu avec toi. Je vais remplir mes quatre pages et comme Dieu, après avoir enfanté le monde, je me dirai : C’est bon !
Je lis Dante et voici la phrase que j’ai trouvée dans le chant V de l’Enfer : L’amour qui ne fait grâce d’aimer à nul être aimé, etc. Et je me suis dit que Dieu veuille que le grand poète ait raison. Je connais de par le monde un excellent garçon qui aime bien, et je voudrais que l’amour ne fasse pas grâce à la femme qu’il aime ; ce serait grande joie dans le cœur de ce cher ami ; et au moins, quand la Mort étendrait vers lui ses griffes sèches : « Je ne te crains pas, pourrait-il lui dire, j’ai connu l’amour, je puis mourir ». Et comme Victor Hugo, il s’écrierait :
Je puis maintenant dire aux rapides années :
— Passez, passez toujours ! je n’ai plus à vieillir !
Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;
J’ai dans l’âme une fleur que nul ne peut cueillir.Dernièrement, j’ai découvert chez une de mes connaissances une vieille gravure enfumée. Je la trouvais délicieuse et je ne m’étonnai pas de mon admiration lorsque je la vis signée du nom de Greuze. C’est une jeune paysanne, grande et de rare beauté de formes : on dirait une déesse de l’Olympe, mais d’une expression si simple et si gracieuse que sa beauté se change presque en gentillesse. On ne sait trop ce que l’on doit le plus admirer, ou de sa figure mutine, ou de ses bras magnifiques ; quand on les regarde, on se sent pris d’un sentiment de tendresse et d’admiration. Je me connais fort peu en dessin, je ne sais si la gravure est bonne, mais je sais qu’elle me plaît. D’ailleurs, Greuze a toujours été mon favori, et je suis resté longtemps devant cette eau-forte, me promettant d’aimer l’original, si un tel portrait, sans doute un rêve de l’auteur, peut en avoir un.
Connais-tu Ronsard ? non, sans doute. Eh bien, voici des vers de ce poète :
Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait desclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu, cette vesprée,
Les plis de sa robe pourprée
Et son teint au vôtre pareil.Et dire que monsieur Despréaux a eu l’audace de critiquer un homme capable d’écrire de telles choses. Boileau ! un eunuque ! un poète qui ne voit dans un vers qu’une césure et qu’une rime. Comme l’a dit si bien Alfred de Musset, l’auteur du Lutrin, au lieu du nectar des poètes du moyen âge, ne versait à ses lecteurs que de la tisane à la glace.
Paris est triste à l’œil comme une duègne rechignée, comme un tableau du divin Chaillan, l’immortel inventeur d’un immortel engrais. Le sol est couvert de boue, le ciel de nuages, les maisons d’un vilain badigeon, les femmes de fards de toutes les couleurs. Ici, avant le visage, il y a toujours un masque. Et lorsque vous avez démasqué un objet, il n’est pas sûr que ce que vous apercevez soit l’objet lui-même, c’est peut-être un second masque. — Bon Dieu, dans quelles phrases je m’embarque ! Je voulais te dire tout simplement qu’il fait mauvais temps, et me voici en plein carnaval.
Je suis triste comme le temps donc, en raisonnant comme un portrait du sublime Chaillan, le sublime auteur de ton sublime portrait. Las ! te souviens-tu de cette teinte jaune qui décolorait tes joues, de cette teinte grise qui passait sur ton front pareille au gris nuage que les romanciers, lorsqu’ils sont gris, mettent sur le front de leurs gris héros ? Las ! te souviens-tu de toutes ces belles choses qui ornaient la chambre dudit Chaillan et qui, roses, ont vécu ce que vivent les roses. Heureux coquin, il t’a fait ton portrait, ce grand artiste ; avec de bonnes couleurs encore… et sans payer !
Je suis donc triste, et je ris du bout des lèvres. Oh ! si Jupiter, Hésus, Dieu, le grand Tout, quel que soit son nom, me donnait un moment sa puissance ! Comme ce pauvre Monde serait joyeux ! Je rappellerais sur la terre l’ancienne gaieté gauloise. J’agrandirais les litres et les bouteilles, je ferais des cigares très longs et des pipes très profondes. Le tabac et le vermouth se donneraient pour rien, la jeunesse serait reine, et pour que tout ce monde soit roi, j’abolirais la vieillesse. Je dirais aux pauvres mortels : « Dansez, mes amis, la vie est courte et l’on ne danse plus dans le cercueil. Puisque la branche se penche vers vous, cueillez le fruit ; arrière les grandeurs, arrière les jaloux, arrière les prosaïques ; et buvons frais, morbleu ! » Et ces malheureux amants, comme je les caresserais, comme je les favoriserais ! J’agrandirais les bocages, le gazon pousserait plus vert, les arbres plus touffus. Celui qui n’aimerait pas serait condamné à mort, et une fleur serait portée par les plus fidèles. Chacun trouverait sa chacune ; et il naîtrait autant d’hommes que de femmes, et chaque couple futur naîtrait avec un même signe qui leur permettrait de se reconnaître dans la foule. Et je leur dirais, à nos chers amoureux, ce qu’Amoureuse disait à Odette. Je signalerais ma divinité par un acte de justice. Je me chercherais une compagne, puis j’abdiquerais pour aller nous perdre, les pieds dans les fleurs et le front au soleil.
Je te serre la main. Ton ami,
É. Zola.
Je ne sais trop ce que je viens d’écrire. — Écris-moi, et divague le plus possible. »
La phrase de L’Enfer de Dante que cite Zola permet d’identifier l’édition qu’il est en train de lire, parue chez Hachette, dont la phrase complète est :
« L’amour, qui ne fait grâce d’aimer à nul être aimé, m’enivra tellement du bonheur de mon amant, que, comme tu le vois, il ne peut pas m’abandonner ; l’amour nous a conduits à la même mort ! Le cercle de Caïn attend celui qui nous a ôté la vie. »
Alighieri Dante, La Divine Comédie, traduction nouvelle accompagnée de notes par Pier-Angelo Fiorentino, 1re édition, Paris, Ch. Lahure, 1958, 398 pages, 7e édition, Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862, 398 pages, p. 17-18.
9 février
Lettre de Zola à Cezanne.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 195-197.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 133-134.« Paris, 9 février 1860
Mon cher ami,
Je suis triste, bien triste, depuis quelques jours et je t’écris pour me distraire.
Je suis abattu incapable d’écrire deux mots, incapable même de marcher. Je pense à l’avenir et je le vois si noir, si noir, que je recule épouvanté. Pas de fortune, pas de métier, rien que du découragement. Personne sur qui m’appuyer, pas de femme, pas d’ami près de moi. Partout l’indifférence ou le mépris. Voilà ce qui se présente à mes yeux lorsque je les porte à l’horizon, voilà ce qui me rend si chagrin. Je doute de tout, de moi-même le premier. Il est des journées où je me crois sans intelligence, où je me demande ce que je vaux pour avoir fait des rêves si orgueilleux. Je n’ai pas achevé mes études, je ne sais même pas parler en bon français ; j’ignore tout. Mon éducation du collège ne peut me servir à rien : un peu de théorie, aucune pratique. Que faire alors ? et mon esprit balance, et me voilà triste jusqu’au soir. — La réalité me presse et cependant je rêve encore. Si je n’avais pas ma famille, si je possédais une modique somme à dépenser par jour, je me retirerais dans un bastidon, et j’y vivrais en ermite. Le monde n’est pas mon affaire ; j’y ferai triste figure, si j’y vais quelque jour. D’autre part, je ne deviendrai jamais millionnaire, l’argent n’est pas mon élément. Aussi je ne désire que la tranquillité et une modeste aisance. Mais c’est un rêve, je ne vois devant moi que luttes, ou plutôt je ne vois rien distinctement. Je ne sais où je vais et je ne pose mon pied qu’avec frayeur, sachant que la route que j’ai à parcourir est bordée de précipices. Et encore, je le répète, si j’avais quelque joie qui vint me donner du cœur ; si, lorsque je suis trop triste, je savais où aller m’égayer. Depuis que je suis à Paris, je n’ai pas eu une minute de bonheur ; je n’y vois personne et je reste au coin de mon feu avec mes tristes pensées et quelquefois avec mes beaux rêves. Parfois cependant je suis gai, c’est lorsque je pense à toi et à Baille. Je m’estime heureux d’avoir découvert dans la foule deux cœurs qui aient compris le mien. Je me dis que, quelles que soient nos positions, nous conserverons les mêmes sentiments ; et cela me soulage. Je me vois entouré d’êtres si insignifiants, si prosaïques, que j’ai plaisir à te connaître, toi qui n’es pas de notre siècle, toi qui inventerais l’amour, si ce n’était pas une bien vieille invention, non encore revue ni perfectionnée. J’ai comme une certaine gloire à t’avoir compris, à te juger ce que tu vaux. Laissons donc les méchants et les jaloux : la majorité des humains étant stupide, les rieurs ne seront pas de notre côté ; mais qu’importe ! si tu éprouves autant de plaisir à me serrer la main que moi à serrer la tienne. — Voici deux pages et demie de noircies et je ne t’ai encore rien dit de ce que je désirais, je ne t’ai pas expliqué pourquoi je suis triste. C’est ce que j’ignore moi-même, et je me contenterai d’ajouter que peut-être je me désespère ainsi parce que je n’ai personne pour me consoler.
Voici le carnaval qui finit, hâte-toi de faire des folies pour me les raconter. On ne s’amuse plus ; la reine Bacchanale a abdiqué en faveur du roi Ennui. On a retiré les battants des grelots et crevé les tambours de basque, hâte-toi de faire des folies. — Sans doute Baille viendra te voir le mardi gras. Tâchez de casser les pots, les bouteilles et les verres vides. Inventez quelque bon tour qui me fasse rire.
Écris-moi souvent et parle-moi souvent de toi. — Mes respects à tes parents.
Je te serre la main. — Ton ami,
Émile Zola. »
20 février
Lettre de Zola à Baille.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 82 édition les Cahiers rouges
« Paris, 20 février 1860
[…] Lorsque nous nous sommes rencontrés au début la vie et que, réunis par une force inconnue, nous nous sommes pris la main, jurant de ne jamais nous séparer, aucun de nous ne s’est enquis de la richesse ni de l’intérieur de ses nouveaux amis. Ce que nous cherchions, c’était la richesse du cœur et de l’esprit, c’était surtout cet avenir que notre jeunesse nous faisait entrevoir brillant. […] »
J’attends Cezanne et j’espère recouvrer un peu de gaîté d’autrefois dès qu’il sera ici 1. »
1. Cezanne avait alors l’intention d’abandonner ses études de droit se rendre à Paris pour s’y consacrer à la peinture. Quoique son père s’opposât énergiquement à ce projet, le jeune artiste avait néanmoins fait entrevoir à Zola la possibilité de son arrivée à Paris pour le commencement du mois d’avril.
3 mars
Lettre de Zola à Cezanne.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 83 édition les Cahiers rouges
« Paris, 3 mars 1860
Mon cher Paul,
Je ne sais, j’ai de mauvais pressentiments sur voyage, j’entends sur les dates plus ou moins prochaine ton arrivée. T’avoir auprès de moi, babiller tous à comme autrefois, la pipe aux dents et le verre à la main paraît une chose tellement merveilleuse, tellement impossible, qu’il est des moments où je me demande si je m’abuse pas, et si ce beau rêve doit bien se réaliser […]
J’ignore de quel côté soufflera l’ouragan, mais je sens comme une tempête sur ma tête.
Tu as combattu deux ans pour en arriver au point où tu en es ; il me semble qu’après tant d’efforts la victoire ne peut te rester complète sans quelques nouveaux combats. Ainsi voici le sieur Gibert qui tâte tes intentions, qui te conseille de rester à Aix ; maître qui voit sans doute avec regret un élève lui échapper. D’autre part, ton père parle de s’informer, de consulter le susdit Gibert 1, conciliabule d’où résulterait inévitablement le renvoi de ton voyage au mois d’août. Tout cela me donne des frissons, je tremble de recevoir une lettre de ta part où, avec maintes doléances, tu m’annonces un changement de date. Je suis tellement habitué à considérer la dernière semaine de mars comme la fin de mon ennui, qu’il me serait très pénible, n’ayant fait provision de patience que jusque-là, de me trouver seul à cette époque […]
Tu me fais une question singulière. Certainement qu’ici, comme partout ailleurs, on peut travailler, la volonté y étant. Paris t’offre, en outre, un avantage que tu ne saurais trouver autre part, celui des musées où tu peux étudier d’après les maîtres, depuis onze heures jusqu’à quatre heures. Voici comment tu pourras diviser ton temps. De six à onze tu iras dans un atelier peindre d’après le modèle vivant ; tu déjeuneras, puis, de midi à quatre, tu copieras, soit au Louvre, soit au Luxembourg 2 le chef-d’œuvre qui te plaira. Ce qui fera neuf heures de travail ; je crois que cela suffit et que tu ne peux tarder, avec un tel régime, de bien faire. Tu vois qu’il nous restera toute la soirée de libre et que nous pourrons l’employer comme bon nous semblera, et sans porter aucun préjudice à nos études. Puis, le dimanche, nous prendrons notre volée et nous irons à quelques lieues de Paris ; les sites sont charmants et, si le cœur t’en dit, tu jetteras sur un bout de toile les arbres sous lesquels nous aurons déjeuné. Je fais chaque jour des rêves charmants que je veux réaliser lorsque tu seras ici : le travail poétique, tel que nous l’aimons. Je suis paresseux pour les travaux de brute, pour les occupations qui n’occupent que le corps et étouffent l’intelligence. Mais l’art, qui occupe l’âme, me ravit, et c’est souvent lorsque je suis couché nonchalamment que je travaille le plus. Il y a une foule de gens qui ne comprennent pas cela, et ce n’est pas moi qui me chargerait de leur faire comprendre. — D’ailleurs, nous ne sommes plus gamins, il nous faut songer à l’avenir. Travaillons, travaillons : c’est l’unique moyen d’arriver.
Quant à la question pécuniaire, il est un fait que 125 francs par mois ne te permettront pas un grand luxe. Je veux te faire le calcul de ce que tu pourras dépenser. Une chambre de 20 francs par mois ; un déjeuner de 18 sous et un dîner de 22 sous, ce qui fait 2 francs par jour, ou 60 francs par mois ; en ajoutant les 20 francs de chambre, soit 80 francs par mois. Tu as ensuite ton atelier à payer ; celui de Suisse 3, un des moins chers, est, je crois, de 10 francs ; de plus, je mets 10 francs de toiles, pinceaux, couleurs ; cela fait 100 francs. Il te restera donc 25 francs pour ton blanchissage, la lumière, les mille petits besoins qui se présentent, ton tabac, tes menus plaisirs : tu vois que tu auras juste pour te suffire, et je t’assure que je n’exagère rien, qui je diminue plutôt. D’ailleurs, ce sera là une très bonne école pour toi ; tu apprendras ce que vaut l’argent et comme quoi un homme d’esprit doit toujours se tirer d’affaire. Je le répète, pour ne pas te décourager, tu peux suffire. — Je te conseille de faire à ton père le calcul ci-dessus ; peut-être la triste réalité des chiffres lui fera-t-elle un peu plus délier sa bourse. — D’autre part, tu pourras te créer ici quelques ressources par toi-même. Les études faites dans les ateliers, surtout les copies prises au Louvre 4 se vendent très bien ; et quand tu n’en ferais qu’une par mois, cela grossirait gentiment la somme pour les menus plaisirs. Le tout est de trouver un marchand, ce qui n’est qu’une question de recherche. — Viens hardiment, une fois le pain et le vin assurés, on peut, sans péril, se livrer aux arts.
[…] En tout cas, je compte que tu m’écriras la veille de ton départ, le jour et l’heure de ton arrivée. J’irai t’attendre à la gare et t’emmènerai sur-le-champ déjeuner en ma docte compagnie. — Je t’écrirai d’ici là. — Baille m’a écrit. Si tu le vois avant de partir, fais-lui promettre de venir nous retrouver au mois de septembre. »
1. Gibert, professeur de dessin à l’École d’art d’Aix, consulté par le père de Cezanne et ne voulant pas perdre un élève, s’était prononcé contre le départ de Paul. Le voyage à Paris fut donc définitivement ajourné jusqu’au moment où Cezanne aurait terminé ses études. Voir la lettre de Zola à Cezanne du 3 mars 1860.
2. Au musée du Luxembourg, qui n’existe plus, se trouvaient alors les œuvres des artistes contemporains qui n’entraient au Louvre qu’un certain temps après leur mort (à moins qu’elles ne fussent transférées dans des musées de province).
3. La prétendue « Académie » Suisse était une école libre, quai Orfèvres, dirigée par un ancien modèle nommé Suisse. Les artistes pouvaient y travailler pour un prix modique d’après des modèles et sans que leurs études soient corrigées. Cette « Académie » n’attirait pas seulement les débutants ; beaucoup de peintres y venaient pour profiter d’une occasion peu coûteuse de peindre ou dessiner des nus.
4. Selon les archives du Louvre, ce n’est qu’au début 1868 que Cezanne a demandé une carte d’étudiant l’autorisant à des visites gratuites. Il est possible que l’artiste ait tant tardé à faire cette demande parce qu’il ne travaillait sous aucun maître reconnu. Dans sa requête, Cezanne se désignera comme élève d’un certain Chesneau. La carte lui sera accordée le 13 février 1868, sous le n° 278.
17 mars
Lettre de Zola à Baille.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 86 édition les Cahiers rouges
« Paris, 17 mars 1860.
[…] Si, las de ma solitude, j’appelle la Muse, cette douce consolatrice, la Muse ne me répond plus […] La Muse m’a quitté pour un temps, ce n’est plus que moi qui versifie et je déchire de dégoût tous les vers que je fais […]
Si les derniers mois qui viennent de s’écouler, pleins de trouble et de désillusions, m’ont été nuisibles, ils ne sauraient avoir étouffé en moi toute poésie. Je la sens qui y tressaillit ; il ne faut qu’un beau jour, qu’un événement heureux pour quelle s’épanouisse de nouveau. Je compte beaucoup sur la venue de Cezanne.
J’ai reçu dernièrement une lettre de Cezanne, dans laquelle il me dit que sa petite sœur est malade et qu’il ne compte guère arriver à Paris que vers les premiers jours du mois prochain. Tu pourras donc le voir encore pendant tes vacances de Pâques. Buvez une dernière fois un bon coup, fumez une bonne pipe, et jure-lui de venir nous retrouver au mois de septembre prochain. Nous pourrons alors former une pléiade, aux rares et pâles étoiles, il est vrai, mais brillante à force d’union. Comme le dit notre vieux ; il n’y aura pas de rêves, pas de philosophie comparables aux nôtres… »
1. Ce « vieux » est Paul Cezanne.
25 mars
Lettre de Zola à Cezanne. Il lui a envoyé des gravures. Il lui parle longuement de son admiration pour Ary Scheffer. « C’est pour toi, que je dis cela, monsieur mon ami, monsieur le grand peintre futur. C’est pour te dire que l’art est un, que spiritualiste, réaliste ne sont que des mots, que la poésie est une grande chose et que hors de la poésie il n’y a pas de salut. »
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, p. 139-142.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 139-142.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 70-72. p. 87 édition les Cahiers rouges :« [Paris] 25 mars 1860
Mon cher ami,
Nous parlons souvent poésie dans nos lettres, mais les mots sculpture et peinture ne s’y montrent que rarement, pour ne pas dire jamais. C’est un grave oubli, presque un crime ; et je veux tâcher de le réparer aujourd’hui.
On vient de débarrasser de ses toiles la fontaine de Jean Goujon [la fontaine des Innocents], que l’on était en train de réparer. Elle est située sur l’emplacement qui s’appelait jadis la cour des Miracles, et entourée d’un délicieux petit jardin — ce qui, entre parenthèses, montre la versatilité des choses terrestres. Cette fontaine genre Renaissance affecte une forme carrée ; elle est surmontée d’un dôme et percée de quatre ouvertures à plein cintre, une pour chaque face. De chaque côté de ces ouvertures se trouve un bas-relief fort étroit et fort long, ce qui fait deux bas-reliefs par face, soit huit pour tout le monument. Chacun d’eux représente une naïade, ainsi que l’indique une plaque de marbre noir portant ces mots : Fontinx nymphus. Et je t’assure que ce sont de charmantes déesses, gracieuses, souriantes, tout comme j’en désirerais pour m’égayer dans mes moments d’ennui. D’ailleurs, tu connais le genre de Jean Goujon : tu dois te rappeler ces deux baigneuses qui sont dues à son ciseau et que je dessinais si maladroitement un jour chez Villevieille. De plus, au-dessus des pleins cintres sont encore des bas-reliefs, de petits Amours tenant des banderoles. Même grâce, même finesse de lignes, même charme dans l’ensemble. Enfin, l’eau tombe en nappe de bassin en bassin. — Je te parle de cette fontaine, parce que je me suis oublié une grande heure à la contempler ; qui plus est je me dérange souvent de ma route pour aller lui jeter un regard d’amour. C’est que je ne puis l’exprimer, dans ma froide description, toute son élégance, toute sa gracieuse simplicité ! Aussi une de nos premières courses, lorsque tu viendras ici, sera d’aller voir l’objet de mon admiration.
L’autre jour, en me promenant sur les quais, j’ai découvert des gravures de Rembrandt fort risquées. Comme dit Rabelais, j’y vis derrière je ne sais quel buisson, je ne sais quels gens, faisant je ne sais quoi, et, je ne sais comment, aiguisant je ne sais quels ferrements, qu’ils avaient je ne sais où, et je ne sais en quelle manière. — Les extrêmes se touchent ; tout à côté étaient suspendues des gravures d’après Ary Scheffer : Françoise de Rimini, la Beatrix du Dante, etc.
Je ne sais si tu connais Ary Scheffer, ce peintre de génie mort l’année dernière : à Paris, ce serait un crime de répondre non, mais en province, ce n’est qu’une grosse ignorance. Scheffer était un amant passionné de l’idéal. Tous ses types sont purs, aériens, presque diaphanes. Il était poète dans toute l’acception du mot, ne peignant presque pas le réel, abordant les sujets les plus sublimes, les plus délirants. Veux-tu rien de plus poétique, d’une poésie étrange et navrante, que sa Françoise de Rimini ? Tu connais l’épisode de la Divine Comédie : Françoise et son amant Paolo sont punis de leur luxure en Enfer par un vent terrible qui toujours les emporte, enlacés, qui toujours les fait tournoyer dans l’espace sombre. Quel magnifique sujet ! mais aussi quel écueil ! comment rendre cet embrassement suprême ? ces deux âmes qui restent même unies pour souffrir les peines éternelles ! quelle expression donner à ces physionomies où la douleur n’a pas effacé l’amour ? Tâche de te procurer la gravure et tu verras que le peintre est sorti victorieux de la lutte ; je renonce à te la décrire, j’y perdrais du papier sans seulement t’en donner une idée.
Scheffer, le spiritualiste, me fait penser aux réalistes. Je n’ai jamais bien compris ces messieurs. Je prends le sujet le plus réaliste du monde, une cour de ferme. Du fumier, des canards barbotant dans un ruisseau, un figuier à droite, etc., etc. Voilà bien un tableau qui semble dénué de toute poésie. Mais qu’il vienne un rayon de soleil qui fasse scintiller la paille jaune d’or, miroiter les flaques d’eau, qui glisse dans les feuilles de l’arbre, s’y brise, en ressorte en gerbes de lumière ; que, de plus, on fasse passer dans le fond une leste fillette, une de ces paysannes de Greuze, jetant du grain à tout son petit monde de volailles : dès ce moment, ce tableau n’aura-t-il pas, lui aussi, sa poésie ; ne s’arrêtera-t-on pas charmé, pensant à cette ferme où l’on a bu de si bon lait, un jour que la chaleur était accablante ? Que voulez-vous donc dire avec ce mot de réaliste ? Vous vous vantez de ne peindre que des sujets dénués de poésie ! Mais chaque chose a la sienne, le fumier comme les fleurs. Serait-ce parce que vous prétendez imiter la nature servilement ? mais alors, puisque vous criez tant après la poésie, c’est dire que la nature est prosaïque. Et vous en avez menti. — C’est pour toi, que je dis cela, monsieur mon ami, monsieur le grand peintre futur. C’est pour te dire que l’art est un, que spiritualiste, réaliste ne sont que des mots, que la poésie est une grande chose et que hors de la poésie il n’y a pas de salut.
J’ai fait un rêve, l’autre jour. — J’avais écrit un beau livre, un livre sublime que tu avais illustré de belles, de sublimes gravures. Nos deux noms en lettres d’or brillaient, unis sur le premier feuillet, et, dans cette fraternité de génie, passaient inséparables à la postérité. Ce n’est encore qu’un rêve malheureusement.
Morale et conclusion de ces quatre pages. — Tu dois contenter ton père en faisant ton droit le plus assidûment possible. Mais tu dois aussi travailler le dessin fort et ferme — unguibus et rostro [bec et ongles] — pour devenir un Jean Goujon, un Ary Scheffer, pour ne pas être un réaliste, enfin pour pouvoir illustrer certain volume qui me trotte dans le cerveau 1.
Tu me demandes la suite de la Mascarade. Je ne puis contenter ton désir, par la simple raison que, jusqu’à présent, cette suite n’existe pas. Le fragment que je t’ai envoyé fut fait en janvier, puis je ne sais ce qui me passa par la tête, j’abandonnai complètement cette pièce pour me mettre à écrire un petit proverbe en vers que je viens de terminer : quelque chose comme neuf cents alexandrins. Il est possible que je continue maintenant les faits et gestes du jeune et mélancolique Hermann ; en tous cas, dès qu’il existera une suite quelconque, je te l’expédierai.
Quant aux excuses que tu me fais, soit pour l’envoi des gravures, soit pour le prétendu ennui que tu me donnes par tes lettres, j’oserai dire que c’est du dernier mauvais goût. Tu ne penses pas ce que tu avances, et cela me console. Je ne me plains que d’une chose, c’est que tes épîtres ne soient pas plus longues, plus détaillées. Je les attends avec impatience, elles me donnent de la joie pour un jour. Et tu le sais : ainsi donc plus d’excuses. — J’aimerais mieux ne pas fumer, ne pas boire que de cesser de correspondre avec toi.
Tu m’écris ensuite que tu es bien triste : je te répondrai que je suis bien triste, bien triste. C’est le vent du siècle qui a passé sur nos têtes, nous ne devons en accuser personne, pas même nous ; la faute en est au temps dans lequel nous vivons. Puis tu ajoutes que : si je t’ai compris, tu ne te comprends pas. Je ne sais ce que tu entends par ce mot compris. Pour moi, voici ce qu’il en est : j’ai reconnu chez toi une grande bonté de cœur, une grande imagination, les deux premières qualités devant lesquelles je m’incline. Et cela suffit ; dès ce moment je t’ai compris, je t’ai jugé. Quelles que soient tes défaillances, quels que soient tes errements, tu seras toujours le même pour moi. Il n’y a que la pierre qui ne change pas, qui ne sorte pas de sa nature de pierre. Mais l’homme est tout un monde ; qui voudrait analyser les sentiments d’un seul pendant un jour, succomberait à l’œuvre. L’homme est incompréhensible, dès qu’on veut le connaître jusque dans ses plus légères pensées. Mais à moi, que m’importent tes contradictions apparentes. Je t’ai jugé bon et poète, et je le répéterai toujours : « Je t’ai compris ».
Mais foin de la tristesse ! Terminons par un éclat de rire. Nous boirons, nous fumerons, nous chanterons au mois d’août 2. La paresse est une belle chose, on n’en meurt pas plus vite. Puisque la vie est mauvaise et courte, allons nous étendre au soleil, babiller, nous moquer des sots, et attendre que la mort passe et nous emporte, tout aussi poliment que notre voisin qui a passé sa vie à l’ombre, sans parler, vivant comme un ours, afin d’amasser un peu d’or.
Je te serre la main.
Ton ami,
É. Zola. »
1. Cezanne n’a jamais illustré aucun texte de Zola.
2. Bien que Zola ne parle nulle part du fait que le voyage de Cezanne a été ajourné, la mention du mois d’août indique clairement que l’arrivée de son ami, qu’il avait attendu à Paris en avril, venait d’être reportée à plus tard. Mais le peintre était sans doute tellement découragé que Zola préférait ne pas discuter de ce voyage, et cela d’autant plus que leur réunion du mois d’août concernait les vacances d’été que Zola comptait passer à Aix. Les dernières phrases de sa lettre étaient donc destinées à réconforter Cezanne.
Zola ne sait pas encore que Cezanne va arrêter ses études de droit. S’il évoque le mois d’août, c’est peut-être parce que lui-même compte aller passer ses vacances à Aix.
16 avril
Lettre de Zola à Cezanne.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 207-213.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 143-147.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 72-74 :Zola essaie de consoler Cezanne en lui exposant sa conception du travail artistique : « Dans l’artiste il y a deux hommes, le poète et l’ouvrier. On naît poète, on devient ouvrier. Et toi qui a l’étincelle, qui possède ce qui ne s’acquiert pas, tu te plains ; lorsque tu n’as pour réussir qu’à exercer tes doigts, qu’à devenir ouvrier. » Il le dissuade de continuer à copier les tableaux d’un maître aixois que Cezanne admire, peut-être J.-F. Villevieille.
Brouille passagère avec Jean-Baptistin Baille.
« Paris, 16 avril 1860.
Mon cher Cezanne,
J’ai vu Villevieille, le lundi de Pâques. Le paresseux était mollement couché, sous le futile prétexte qu’il était malade. Malade ! vraiment oui. Jamais chanoine, jamais chantre, jamais bedeau, jamais enfant de chœur, ne fut plus gras, plus vermeil, plus joufflu, plus luisant de graisse. N’importe, il restait au lit. J’ai longtemps causé avec lui, nous avons parlé de Chaillan, de toi, etc. Je n’ai pas vu son atelier, où d’ailleurs, m’a-t-il dit, aucune toile n’était ébauchée. Je dois prochainement retourner chez lui un de ces soirs, pour prendre le thé.
Sa femme est toute mignonne, toute blanche et rose, c’est presque une enfant. Il me semble que je vivrais comme un ange avec cette petite fille. Réellement, il ne la flattait pas, quand il disait qu’elle était adorable : visage spirituel, un peu chiffonné, petite bouche, petit pied, enfin délicieuse. — Bon Dieu ! qu’ils ont tort de ne pas s’aimer toujours, de se disputer même parfois.
Je pense à notre mariage, à nous. Qui sait si le sort nous garde un bon lot. Sera-t-elle belle, sera-t-elle laide ? Sera-t-elle bonne, sera-t-elle méchante? Bonté et beauté ne vont pas toujours ensemble, hélas ! Espérons pourtant que nous aurons de la chance et dans le matériel et dans le spirituel. — Car, tout bien pesé, tout bien considéré, je crois que le bonheur est dans le mariage comme ailleurs. On dit que c’est une loterie ; je n’en crois rien. Le hasard a bon dos, et dès que l’homme fait une faute, il la met sur le dos du hasard, qui n’en peut mais. Je croirais plutôt qu’il n’y a là que de bons numéros ; quant aux mauvais, c’est l’homme qui les fait lui-même. Je m’explique : dans toute femme, il y a l’étoffe d’une bonne épouse, c’est au mari à disposer de cette étoffe le mieux possible. Tel maître, tel valet ; tel mari, telle épouse. — L’éducation de la jeune fille est si différente de celle du jeune homme, qu’à la sortie des écoles, même entre frère et sœur, il n’y a plus aucun lien, aucune parenté d’idée. Ce sera bien pire entre deux étrangers, entre deux époux. Le mari a donc une grande tâche, celle de la nouvelle éducation de la femme ; ce n’est pas tout de coucher ensemble pour être mariés, il faut encore penser de même : sinon, les époux ne peuvent manquer tôt ou tard de faire mauvais ménage. — Voilà pourquoi l’éducation des filles me paraît si imparfaite. Elles arrivent dans le monde ignorantes, bien plus, ne sachant que des choses qu’il leur faut oublier. — Je patauge d’une belle manière, je crois.
Ma nouvelle vie est assez monotone. Je vais à neuf heures au bureau, j’enregistre jusqu’à quatre heures des déclarations de douanes, je transcris la correspondance, etc., etc. ; ou mieux, je lis mon journal, je bâille, je me promène de long en large, etc., etc. Triste en vérité. Mais dès que je sors, je me secoue comme un oiseau mouillé, j’allume ma bouffarde, je respire, je vis. Je roule dans ma tête de longs poèmes, de longs drames, de longs romans ; j’attends l’été pour donner carrière à ma verve. Vertu Dieu ! je veux publier un livre de poésies et te le dédier 1.
Vois l’utilité de la transition. Je puis te remercier de ton envoi littéraire : — Un Trésor de belle-mère — sans commettre des phrases heurtées. Tout le monde doit avoir un avis et je vais te dire le mien sur cette comédie. Tu l’as sans doute vu jouer, tu l’as peut-être lue. Dans le premier cas, la mise en scène, la lumière, le jeu des acteurs, peuvent t’avoir égaré ; mais dans le second, je crois que tu as été de mon avis : que tu as trouvé cette pièce fort médiocre. Comme comédie, elle ne vaut rien ; pas de caractère soutenu, pas même de caractère dessiné. Comme vers, j’en dirais presque autant ; à part quelques alexandrins assez comiques, le reste ressemble à de la prose endimanchée. — Un auteur, quelque révolutionnaire qu’il soit, a toujours un but. M. Muscadel ne semble pas en avoir ; il n’y a pas d’exposition, pas de nœud, pas de dénouement ; ce sont des vers, puis des vers. Le public qui a applaudi cette bluette serait bien embarrassé pour en raconter le fond, car il n’y en a pas. Je le répète, les scènes se suivent sans avoir aucun lien entre elles, rien n’est observé, rien n’est amené à temps. On ne sait pas pourquoi la belle-mère est méchante, on ne sait pas pourquoi elle devient bonne. Les deux époux n’ont qu’une scène, où ils font de l’esprit assez plat. Ces deux rôles développés auraient sans doute eu du bon, mais tels qu’ils sont, ce sont de pâles ébauches. Quant à Valentin, l’âme de la pièce, celui qui a dû la faire réussir, son rôle est le rôle de tous les valets de vaudeville. Rien ne le lie avec les autres personnages, il ne sert pas à l’intrigue, intrigue qui, d’ailleurs, n’existe pas. Quant à la lettre qu’il écrit à sa maîtresse, c’est une ficelle qui n’en est pas même une, puisqu’elle n’amène rien. — Je ne nie pas le mérite de l’auteur, je nie le mérite de sa pièce, je proteste contre les comptes rendus que j’ai lus dans les journaux. Ce n’est pas un bon service à rendre à M. Muscadel, que de lui donner sans raison de l’encensoir par la figure. Et pour mon compte, si j’avais été rédacteur, je lui aurais dit : « Vous avez sans doute du talent, travaillez donc pour nous faire une comédie meilleure que celle que vous venez de nous donner ». — Voilà bien du bavardage à propos d’un étranger ; mais la littérature a toujours une petite pince dans mes missives et j’ai cru bien faire en te donnant franchement mon avis sur une pièce que tu as sans doute jugée toi-même. Je serais heureux que nos deux jugements se rencontrent. Je n’en veux nullement à M. Muscadel, que je ne connais pas ; ce n’est pas non plus une basse jalousie qui me conduit. J’ai lu la pièce avec la bonne volonté de la trouver excellente et je me contente de traduire le moins impoliment possible l’impression qu’elle m’a produite.
Je me trompe en disant que l’auteur n’avait pas de but. J’ai cru lui en découvrir un ; celui de peindre cette espèce de jalousie qu’éprouve une mère contre la femme qu’aime son fils. Elle croit que cette femme la vole, que l’amour doit lui appartenir tout entier, à elle qui l’a nourri, qui l’aime tant. On pourrait faire une charmante comédie avec cette donnée. Mais combien M. Muscadel a traité cela lourdement, si lourdement, que l’on se demande si le but de l’auteur était bien de peindre cet amour maternel luttant contre l’amour.
J’ai reçu ta lettre. — Tu as raison de ne pas trop te plaindre du sort : car, après tout, comme tu le dis. Avec deux amours au cœur, celui de la femme et celui du beau, on aurait grand tort de se désespérer. Le temps passe vite, même dans la solitude, lorsque vous peuplez cette solitude de fantômes chéris ; et qu’est-ce être malheureux, sinon être seul. Ce n’est pas, il est vrai, le seul fléau qui sévit sur l’humaine race, mais de là, du manque de toute affection, découlent tous nos malheurs. Aussi, moi l’isolé, moi le dédaigné, je me cramponne à ton amitié en désespéré. Lorsque mon œil interroge l’horizon, il ne voit que brouillard, que vagues nuées, mais au moins il aperçoit encore ta figure dans un rayon de soleil. Et cela me console. Mon pauvre ami. Si jamais mes pensées, mes actions te déplaisaient, dis-le moi franchement : je pourrais me défendre auprès de toi, raffermir ton amitié chancelante.
Mais que dis-je là : ne sommes-nous pas maintenant liés, n’avons-nous pas même pensée ? Notre amitié est bien solide encore : et ne prends ce que je viens de te dire que comme craintes exagérées d’un danger imaginaire.
Tu m’envoies quelques vers où respire une sombre tristesse. La rapidité de la vie, la brièveté de la jeunesse, et la mort, là-bas, à l’horizon : voilà ce qui nous ferait trembler si l’on y pensait quelques minutes. Mais n’est-ce pas un tableau plus sombre encore, lorsque dans le cours si précipité d’une existence, la jeunesse, ce printemps de la vie, manque entièrement, lorsqu’à l’âge de vingt ans, on n’a pas encore éprouvé le bonheur, qu’on voit avancer l’âge à grands pas et qu’on n’a pas même, pour égayer ces rudes jours d’hiver, les souvenirs des beaux jours. — Et voilà ce qui m’attend.
Tu me dis encore que quelquefois tu n’as pas le courage de m’écrire. Ne sois pas égoïste : tes joies comme tes douleurs m’appartiennent. Quand tu seras gai, égaye-moi ; quand tu seras triste, assombris mon ciel sans crainte : une larme est quelquefois plus douce qu’un sourire. D’ailleurs, écris-moi tes pensées au jour le jour ; dès qu’une nouvelle sensation naîtra dans ton âme, mets-la sur le papier. Puis, quand il y en aura quatre pages, expédie-les-moi.
Une autre phrase de ta lettre m’a aussi douloureusement impressionné. C’est celle-ci : « la peinture que j’aime, quoique je ne réussisse pas, etc., etc. » Toi ! ne pas réussir, je crois que tu te trompes sur toi-même. Je te l’ai déjà dit pourtant : dans l’artiste il y a deux hommes, le poète et l’ouvrier. On naît poète, on devient ouvrier. Et toi qui as l’étincelle, qui possèdes ce qui ne s’acquiert pas, tu te plains ; lorsque tu n’as pour réussir qu’à exercer tes doigts, qu’à devenir ouvrier. Je ne quitterai pas ce sujet sans ajouter deux mots. Je te mettais dernièrement en garde contre le réalisme ; aujourd’hui je veux te montrer un autre écueil, le commerce. Les réalistes font encore de l’art — à leur manière, — ils travaillent consciencieusement. Mais les commerçants, ceux qui peignent le matin pour le pain du soir, ceux-là rampent misérablement. Je te dis ceci non sans raison : tu vas travailler chez X***, tu copies ses tableaux, tu l’admires peut-être 2. Je crains pour toi ce chemin où tu t’engages, d’autant plus que celui que tu tâches peut-être d’imiter a de grandes qualités, qu’il emploie misérablement, mais qui ne font pas moins paraître ses tableaux meilleurs qu’ils ne sont. C’est joli, c’est frais, c’est bien brossé ; mais tout cela n’est qu’un tour de métier, et tu aurais tort de t’y arrêter. L’art est plus sublime que cela ; l’art ne s’arrête pas aux plis d’une étoffe, aux teintes rosées d’une vierge. Vois Rembrandt ; avec un rayon de lumière, tous ses personnages, même les plus laids, deviennent poétiques. Aussi, je te le répète, X*** est un bon maître pour t’apprendre le métier ; mais je doute que tu puisses apprendre autre chose dans ses tableaux. — Étant riche, tu songes sans doute à faire de l’art et non du commerce. Si je parlais à Chaillan, je lui dirais tout le contraire de ce que je viens de te dire. — Défie-toi donc d’une admiration exagérée pour ton compatriote ; mets tes rêves, ces beaux rêves dorés, sur tes toiles, et tâche d’y faire passer cet amour idéal que tu portes eu toi. — Surtout, et c’est là le gouffre, n’admire pas un tableau parce qu’il a été vite fait ; en un mot, et pour conclusion, n’admire pas et n’imite pas un peintre de commerce. — Je reviendrai sur ce sujet. — Je heurte peut-être bien quelques-unes de tes idées. Dis-le-moi franchement pour ne pas garder contre moi une rancune cachée, et par là même augmentant chaque jour. — Mes respects à tes parents.
Je te serre la main.
Ton ami,
É. Zola.
J’ai changé de demeure ; adresse tes lettres rue Saint-Victor, n° 35. »
1. Zola n’a pas publié de volume de poésies, mais son premier roman, La Confession de Claude, paru en 1865, sera dédié : « A mes amis P. Cezanne et J.-B. Baille. » Un an plus tard, Zola réunira ses premières critiques d’art, signées du nom de « Claude », dans une plaquette dédiée à Cezanne ; voir plus loin sa lettre-dédicace du 20 mai 1866.
2. On ne sait pas à quel peintre aixois il est fait allusion ici. Peut-être s’agit-il de J.-F. Villevieille dans l’atelier duquel Cezanne aurait travaillé.
26 avril
Lettre de Zola à Cezanne. En post-scriptum, il mentionne qu’il vient de recevoir à l’instant une lettre de lui qui suggère qu’il semble que son père « s’humanise » à propos de la situation de son fils : « Elle fait naître en moi une bien douce espérance. Ton père s’humanise ; sois ferme, sans être irrespectueux. Pense que c’est ton avenir qui se décide et que tout ton bonheur en dépend. »
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 213-219.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 16, p. 148-152.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 74-75 :« [Paris] 26 avril 1860, 7 heures du matin
Mon bon vieux,
Je ne cesserai de te répéter : ne crois pas que je sois devenu pédant. Chaque fois que je suis sur le point de te donner un conseil, j’hésite, je me demande si c’est bien là mon rôle, si tu ne te fatigueras pas de m’entendre toujours te crier : fais ceci, fais cela. J’ai peur que tu ne m’en veuilles, que mes pensées soient en contradiction avec les tiennes, partant que notre amitié en souffre. Que te dirai-je ? je suis sans doute bien fou de penser ainsi au mal ; mais je crains tant le plus léger nuage entre nous. Dis-moi, dis-moi sans cesse que tu reçois mes avis comme ceux d’un ami ; que tu ne te fâches pas contre moi lorsqu’ils sont en désaccord avec ta manière de voir ; que je n’en suis pas moins le joyeux, le rêveur, celui qui s’étend si volontiers sur l’herbe auprès de toi, la pipe à la bouche et le verre à la main. — L’amitié seule dicte mes paroles ; je vis mieux avec toi en me mêlant un peu de tes affaires ; je cause, je remplis mes lettres, je bâtis des châteaux en Espagne. Mais, pour Dieu ! ne crois pas que je veuille te tracer une ligne de conduite ; prends seulement, dans mes paroles, ce qui te conviendra, ce que tu trouveras bon, et ris du reste, sans seulement prendre la peine de le discuter.
Et maintenant j’aborde plus hardiment le sujet peinture.
Lorsque je vois un tableau, moi qui sais tout au plus distinguer le blanc du noir, il est évident que je ne puis me permettre de juger des coups de pinceau. Je me borne à dire si le sujet me plaît, si l’ensemble me fait rêver à quelque bonne et grande chose, si l’amour du beau respire dans la composition. En un mot, sans m’occuper du métier, je parle sur l’art, sur la pensée qui a présidé à l’œuvre. Et je pense agir sagement ; rien ne me fait plus pitié que ces exclamations des soi-disant amateurs qui, ayant retenu quelques termes techniques dans les ateliers, viennent les débiter avec aplomb et comme des perroquets. Toi, au contraire, toi qui as compris combien il est difficile de placer selon sa fantaisie des couleurs sur une toile, je comprends qu’à la vue d’un tableau tu t’occupes beaucoup du métier, que tu t’extasies sur tel ou tel coup de pinceau, sur une couleur obtenue, etc., etc. Cela est naturel ; l’idée, l’étincelle est en toi, tu cherches la forme que tu n’as pas, et tu l’admires de bonne foi partout où tu la rencontres. Mais prends garde ; cette forme n’est pas tout, et, quelle que soit ton excuse, tu dois mettre l’idée avant elle. Je m’explique : un tableau ne doit pas être seulement pour toi des couleurs broyées, placées sur une toile ; il ne te faut pas chercher constamment par quel procédé mécanique l’effet a été obtenu, quelle couleur a été employée ; mais voir l’ensemble, te demander si l’œuvre est bien ce qu’elle doit être, si l’artiste est réellement un artiste. Il y a si peu de différence, aux yeux du vulgaire, entre une croûte et un chef-d’œuvre. Des deux côtés, c’est du blanc, du rouge, etc., des coups de brosse, une toile, un cadre. La différence n’est que dans ce quelque chose qui n’a pas de nom, et que la pensée, que le goût seul révèle. C’est ce quelque chose, ce sentiment artistique du peut-être, qu’il faut surtout découvrir et admirer. Puis, tu pourras chercher à connaître sa manière de procéder, tu pourras faire du métier. Mais, je le répète, qu’avant de descendre à fouiller ainsi le matériel, ces couleurs puantes, cette toile grossière, qu’avant tout tu te laisses emporter au ciel, par la sublime harmonie, par la grande pensée qui s’épand du chef-d’œuvre, et l’entoure comme d’une auréole divine. — Loin de moi la pensée de mépriser la forme. Ce serait sottise ; car sans la forme on peut être grand peintre pour soi, mais non pour les autres. C’est elle qui fixe l’idée, et plus l’idée est grande, plus la forme doit être grande aussi. C’est par elle que le peintre est compris, apprécié ; et cette appréciation n’est favorable qu’autant que la forme est excellente. Je me servirai d’une comparaison ; si je voulais converser avec un Allemand, je ferais venir un interprète ; mais si je n’ai pas d’Allemand avec qui parler, je n’ai que faire d’un interprète. L’interprète est la forme, l’Allemand la pensée : sans la forme je ne comprendrai jamais la pensée, mais je n’ai que faire de la forme si la pensée n’existe pas. C’est te dire que le métier est tout et n’est rien ; qu’il faut absolument le savoir, mais qu’il ne faut pas perdre de vue que le sentiment artistique est aussi essentiel. En un mot, ce sont deux éléments qui s’annulent séparés, et qui réunis font un tout grandiose.
D’ailleurs, je ne parle pas pour toi : si tu as du bon, comme je le crois fermement, tu n’as pas à établir ces distinctions que je viens de faire un peu puérilement. Chaque génie naît avec sa pensée et avec sa forme originale ; ce sont choses qui ne peuvent se séparer sans entraîner une complète nullité, du moins apparente, chez l’homme. Cela se remarque surtout lorsque c’est la pensée qui règne seule ; le pauvre grand homme est rangé alors dans le rang des incompris ; son âme a beau rêver, elle ne peut se communiquer aux autres, il est ridicule et malheureux. Lorsque la forme seule existe, l’homme qui la possède sans posséder l’idée, réussit parfois et alors son exemple devient extrêmement dangereux. J’arrive enfin à la peinture de commerce, dont j’avais promis de te reparler ; tout ce qui précède n’est qu’un long préambule et c’est ceci que je voulais te dire. Le peintre de commerce exclut l’idée, il fait trop vite pour faire quelque chose de bon comme art. C’est un métier, un moyen de donner du pain à ses enfants ; rien de mieux. Mais c’est que ce diable de peintre, s’il n’a pas l’idée, a le plus souvent la forme pour lui ; et, dès lors, son tableau est un véritable piège pour les commerçants. On est forcé d’avouer que c’est joli, et si l’on ne va pas plus loin, voilà qu’on se met à admirer une œuvre indigne, l’imiter peut-être. Je sais bien que ce ne sont que les imbéciles qui se laissent prendre ; mais m’en voudras-tu si je me suis effrayé, même à tort, et si je t’ai dit en ami : « Prends garde ! songe à l’art, à l’art sublime ; ne considère pas que la forme, parce que la forme seule, c’est la peinture de commerce ; considère l’idée, fais de beaux rêves ; la forme viendra avec le travail et tout ce que tu feras sera beau, sera grand ». Voilà ce que je t’ai dit, voilà ce que je te répéterai toujours.
Si tu n’es pas content, tu n’es pas raisonnable. Voilà cinq pages, les plus sérieuses que j’aie écrites de ma vie. — Au moins, souviens-toi de nos engagements ; si je blessais ta manière de voir, ne fais pas attention à mon bavardage.
Chaillan a passé, dimanche dernier, la journée entière avec moi ; nous avons déjeuné, soupé ensemble, causant de toi, fumant nos bouffardes. C’est un excellent garçon ; mais quelle simplicité, bon Dieu ! quelle ignorance du monde ! Qu’il réussisse, cela me semble peu probable ; il ne sera cependant jamais malheureux, et c’est en quelque sorte ce qui me console de le voir rêver ainsi tout éveillé. Son caractère n’est plus jeune ; je le soupçonne même d’être un peu avare. Avec ces deux défauts, qui dans le cas présent sont des qualités, il ne peut mourir de faim, ni se faire trop de bile. Il se retirera toujours à temps dans son village, ou bien se contentera des portraits médiocres qu’il vendra le plus cher possible.
— Il est, me disait-il, dans une maison où logent douze fillettes ; et cela l’ennuie, car elles font un tapage à faire crouler les murs. Il va changer de demeure. L’innocent !
Chaque jour il se rend chez le père Suisse, depuis le matin 6 heures jusqu’à 11 heures. Puis, l’après-midi, il va au Louvre. Réellement il a du toupet. — Ah ! si tu étais ici, la belle vie ! Mais à quoi bon cette exclamation ? à nous donner des regrets superflus.
— Je ne t’en dirai pas plus long sur Chaillan : il doit t’écrire lui-même sous peu. — Je n’ai pas encore revu Villevieille ; je pense aller lui rendre bientôt visite.
Quant à moi, ma vie est toujours monotone. Lorsque, courbé sur mon pupitre, écrivant sans savoir ce que j’écris, je dors tout éveillé, comme abruti, soudain parfois un frais souvenir passe dans mon esprit, une de nos joyeuses parties, un des sites que nous affectionnions, et mon cœur se serre affreusement. Je lève la tête, et je vois la triste réalité ; la chambre poudreuse, encombrée de vieilles paperasses, peuplée par un monde de commis stupides pour la plupart ; j’entends le monotone grincement des plumes, des mots stridents, des termes bizarres pour moi ; et là, sur la vitre, comme pour me railler, les rayons de soleil viennent se jouer et m’annoncer qu’au dehors la nature est en fête, que les oiseaux ont des chants mélodieux, les fleurs des parfums enivrants. Je me renverse sur ma chaise, je ferme les yeux, et pour un instant je vous vois passer, vous, mes amis ; je les vois, elles aussi, ces femmes que j’aimais sans le savoir. Puis tout s’évanouit, la réalité revient plus terrible, je reprends ma plume et je me sens des envies de pleurer. — Oh ! la liberté, la liberté ! la vie contemplative de l’Orient ! la douce et poétique paresse ! mon beau rêve ! qu’êtes-vous devenus ?
J’ai fait cette lettre, currente calamo, sans me reposer, sans moucher ma chandelle. Il est bientôt minuit et je vais me mettre au lit. Je me sentais exalté ce soir, pardonne-moi donc si ma lettre est folle, privée de ce peu de raison que je possède.
Je n’ai pas pu attendre une lettre de toi pour t’écrire de nouveau et quoique je n’aie rien à te dire, il m’a pris une telle rage de noircir du papier, que j’ai cédé à la tentation.
Je te serre la main.
Ton ami.
Émile Zola.
Mes respects à tes parents.
Je reçois ta lettre à l’instant. — Elle fait naître en moi une bien douce espérance. Ton père s’humanise ; sois ferme, sans être irrespectueux. Pense que c’est ton avenir qui se décide et que tout ton bonheur en dépend. — Ce que tu dis sur la peinture devient inutile, du moment que tu reconnais toi-même les défauts de X***.
Je répondrai à ta lettre sous peu. »
2 mai
Lettre de Zola à Baille. Cezanne a reconnu auprès de lui qu’il a eu tort de mal recevoir Baille venu le rencontrer au Jas de Bouffan.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 40.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 17, p. 157.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 76 :« Paris, 2 mai 1860.
[…] Cezanne me parle de toi. Il confesse son tort 1 et m’assure qu’il va changer de caractère. Puisqu’il a entamé ce chapitre, je compte lui dire mon avis sur sa manière d’agir 2 ; je n’aurais pas commencé, mais je crois qu’il est inutile à présent d’attendre le mois d’août pour tenter votre rapprochement. »
1. Baille, qui menait ses études à Marseille, se plaignait d’avoir été très froidement reçu par Cezanne lors d’une visite au Jas de Bouffan.
2. Lorsque Zola comptait venir à Aix.
5 mai
Lettre de Zola à Cezanne. Il lui fait part à Cezanne de son « espoir lointain de réunion », ce qui indique que Cezanne n’a pas encore abandonné ses études de droit : « Quand j’aurai fini mon droit, peut-être, me dis-tu, serai-je libre de faire ce que bon me semblera ».
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 219-226.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 18, p. 159-162.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 76-78 :« Paris, 5 mai 1860.
Mon bon vieux,
Je suis seul dans ma chambre, un peu indisposé. J’ai fait l’école buissonnière pour aujourd’hui et je ne crois pouvoir mieux employer le temps passé loin de mon bureau, qu’en causant avec toi. Je vais donc répondre à tes deux dernières lettres.
Comme tu le présumes fort bien, je ne m’amuse nullement aux Docks. Voici un mois que je suis dans cette infâme boutique et j’en ai, par Dieu ! plein le dos, les jambes et tous les autres membres. — Je ne demande qu’une grotte dans le flanc d’un rocher, sur une haute montagne. Je vivrai là vêtu d’un froc s’il le faut, en ermite, ne me souciant ni du monde, ni de ses jugements. — Ne crois pas que ce soit là le vain désir d’un poète ; je pense sérieusement et, si je n’avais pas une mère, il y a longtemps que j’aurais tâché de mettre mon idée à exécution. — Quoi qu’il en soit je trouve mon bureau puant et je vais bientôt déguerpir de cette immonde écurie. Ce qui m’arrête, c’est que, sorti de là, je me trouverai de nouveau à la charge de ma famille ; je cherche une combinaison qui me permette de manger et de rester libre, combinaison, hélas ! que je ne trouve pas, que je ne trouverai jamais. Tu ne peux te douter de la souffrance que j’éprouve quand je pense à ces choses-là. C’est comme un damné labyrinthe ; j’ai beau marcher, je m’égare et toujours je reviens au même point, à penser en pleurant à l’art sublime, à la liberté, à toutes ces célestes choses dont l’amour ne veut pas mourir en moi, et qui se débat en désespéré, devant l’horrible réalité. — Car, te le dirai-je, si je suis malade de corps, ce n’est qu’une suite de ma maladie morale, de l’ennui, du désespoir que je ressens. Mais quittons ce triste sujet et tâchons de rire et de boire frais.
Tu me parles de Baille dans tes deux lettres. Il y a longtemps que je désire moi-même t’entretenir au sujet de ce brave garçon. ― C’est qu’il n’est pas comme nous, qu’il n’a pas le crâne fait dans le même moule ; il a bien des qualités que nous n’avons pas, bien des défauts aussi. Je ne puis pas essayer de te faire la peinture de son caractère, te dire par où il pèche, par où il l’emporte ; je ne lui donnerai pas non plus l’épithète de sage, pas plus que celle de fou ; cela n’est que relatif et dépend du point de vue d’où l’on envisage la vie. Que nous importe d’ailleurs, à nous ses amis ; ne suffit-il pas que nous l’ayons jugé bon garçon, supérieur à la foule, ou du moins plus apte à comprendre notre cœur et notre esprit ? Ne devons-nous pas le juger avec cette bienveillance que nous réclamons pour nous-mêmes, et, si quelque chose nous contrarie dans sa conduite, de quel droit irions-nous trouver mauvais ce qu’il trouve bon ? Crois-moi, nous ne savons ce que la vie nous garde ; nous sommes au début, tous trois riches d’espérance, tous trois égaux par notre jeunesse, par nos rêves. Serrons- nous la main : non pas une étreinte d’un moment, mais une étreinte qui empêche un jour de faiblir, ou qui console après la chute. — Que diable me marmotte-il là, dois-tu dire ? Mon pauvre vieux, j’ai cru m’apercevoir que le lien qui t’unissait avec Baille faiblissait, qu’un anneau de notre chaîne allait casser. Et, tremblant, je te prie de penser à nos joyeuses parties, à ce serment que nous avons fait, le verre en main, de marcher toute la vie, les bras enlacés, dans le même sentier ; de penser que Baille est mon ami, qu’il est le tien, et que si son caractère ne sympathise pas entièrement avec le nôtre, il n’en est pas moins dévoué pour nous, aimant, qu’enfin il me comprend, qu’il te comprend, qu’il est digne de nos confidences, de ton amitié. — Si tu as quelque chose à lui reprocher, dis-le moi, je tâcherai de le défendre, ou plutôt dis-lui à lui-même ce qui te contrarie en lui, — rien n’est à craindre comme les choses non avouées entre amis.
Tu te rappelles nos parties de nage, cette heureuse époque où, insoucieux de l’avenir, nous combinions un beau soir la tragédie du célèbre Pitot ; puis le grand jour ! là, sur le bord de l’eau, le soleil qui se couchait radieux, cette campagne que nous n’admirions peut-être pas alors, mais que le souvenir nous présente si calme et si riante. — On a dit — je crois que c’est Dante — que rien n’est plus pénible qu’un souvenir heureux dans les jours de malheur. Pénible, oui, mais âprement voluptueux aussi ; on pleure et on rit à la fois. — Malheureux que nous sommes ! à vingt ans nous regrettons déjà le passé ; nous tournons vers cette époque enfuie, tendant les bras, pleurant sans espoir de voir renaître ces beaux jours. Malheureux et fous ! nous gâtons notre vie comme à plaisir, toujours souhaitant de voir revivre le passé, ou implorant l’avenir à grands cris, ne sachant jamais jouir du présent. — Je te l’ai dit dans ma dernière lettre, parfois un souvenir, rapide comme un éclair, traverse ma pensée ; c’est un mot que tu m’as dit jadis, c’est une de nos parties : une montagne, un chemin, un buisson, et je regrette, et je désespère — malheureux et fou.
Dans tes deux lettres tu me donnes comme un espoir lointain de réunion. « Quand j’aurai fini mon droit, peut-être, me dis-tu, serai-je libre de faire ce que bon me semblera ; peut-être pourrai-je aller te rejoindre. » Que Dieu veuille que ce ne soit pas la joie d’un instant ; que ton père ouvre les yeux sur ton véritable intérêt. Peut-être, à ses yeux, suis-je un étourdi, un fou, même un mauvais ami de t’entretenir dans ton rêve, dans ton amour de l’idéal. Peut-être, s’il lisait mes lettres, me jugerait-il sévèrement ; mais quand bien même je devrais perdre son estime, je le dirais hautement devant lui comme je le dis à toi : « J’ai réfléchi longtemps à l’avenir, au bonheur de votre fils, et par mille raisons qu’il serait trop long de vous expliquer, je crois que vous devriez le laisser aller là où son penchant l’entraîne. »
Mon vieux, il s’agit donc d’un petit effort, d’un peu travailler. Voyons, que diable ! sommes-nous tout à fait privés de courage ? Après la nuit viendra l’aurore ; tâchons donc de la passer tant bien que mal, cette nuit, et que lorsque luira le jour tu puisses dire : « J’ai assez dormi, mon père, je me sens fort et courageux. Par pitié ! ne m’enfermez pas dans un bureau ; donnez-moi mon vol, j’étouffe, soyez bon, mon père. » — Je ferai ta commission à Chaillan.
Leclère met en doute, me dis-tu, mon voyage à Aix. Le cher homme se trompe ; je compte aller te serrer la main tout comme l’année dernière. Il est vrai, je préférerais que ce fût toi qui vins, et cela pour une foule de raisons ; mais, comme je doute encore de la bonne volonté de ton père, je me prépare à faire mes paquets. — Tu me parles vaguement d’une certaine aventure qui aurait amené des suites fâcheuses entre Leclère et De Julienne. Je juge à propos de joindre à cette lettre un mot pour ce dernier ; autant pour éclaircir l’affaire que pour désavouer toutes les mesures rigoureuses qu’on aurait pu prendre en mon nom. — Lis d’ailleurs ce mot et ne m’en veuille pas s’il rogne ta portion. — Serre la main de Leclère à mon intention et ne lui dis pas que tu m’as communiqué cette misère.
Quant à vous, mes beaux musiciens, chantez tout votre soûl ; riez, mes enfants, riez. Ma mansarde n’est certes pas belle, et cependant parfois je la regrette. Nous avons depuis une semaine un temps sublime ; je ne le croirais pas, si je ne suais pas. Mais que m’importe la pureté du ciel, à moi Parisien ; je sors si peu. Je ne vais jamais manger des anchois au bastidon, tout au plus si je vais m’installer à la porte d’un établissement dans le genre du Qu’a fait la belle eau (Oh ! Marguery !). Je ne t’ai pas décrit ma nouvelle demeure, mon voisinage : ce sera pour ma prochaine lettre.
Il y a eu soirée hier soir chez moi. J’ajoute cette feuille de papier à ma lettre pour te narrer cette rareté. Nous étions douze, ma mère, Pagès (du Tarn), Chaillan, Pajot, moi : le reste ne vaut pas l’honneur d’être nommé. Le but de cette réunion était de lire quelques vers et d’ouïr quelques chanteurs qui se trouvaient parmi nous ; ce fut tout artistique comme tu vois. On a servi, comme consommations, trois douzaines de biscuits, deux bouteilles, une de Champagne, une de malaga, puis le premier acte de la Nouvelle Phèdre, et le proverbe intitulé Perrette. On a fortement applaudi ; était-ce l’auteur à qui s’adressaient ces éloges, ou le maître de la maison qui offrait de si bon malaga ? Je livre ce problème à ta perspicacité. Pour moi, je juge incapables de m’apprécier la moitié des personnes qui m’écoutaient. Ce n’est pas orgueil, c’est simplement expérience et vérité. Ce qui m’a fait le plus plaisir, ce sont les éloges de Pajot, les bonnes grosses appréciations de Chaillan, puis les quelques admirations vraies de Pagès (du Tarn). Pardon d’avoir parlé de moi le premier ; j’ai voulu me débarrasser de ma pièce pour parler plus à l’aise de la Nouvelle Phèdre. On n’en a lu que le premier acte et ce n’est donc que d’après ce fragment que je puis en parler. — Une seule question. Qu’est-ce qui m’ennuie dans la tragédie ? C’est la tragédie elle-même ; ce sont tous ces vieux accessoires usés, les confidents, les tirades emphatiques, l’alexandrin lourd et régulier, etc., etc. Lorsque M. Pagès (du Tarn) me dit qu’il était le partisan des innovations, je crus qu’il avait aboli toutes ces vieilleries. Point du tout ; ses nouveautés se bornent à un changement de costume, l’habit noir au lieu de la toge romaine, à un changement de nom, le nom d’Abel au lieu de celui d’Hippolyte. D’autre part, il ne s’aperçoit pas d’un écueil ; voulant faire, comme il le dit, la tragédie de l’homme et non celle des rois et des héros, choisissant un sujet bourgeois, ne doit-il pas craindre de rendre plus ridicule encore l’emphase et la déclamation dans le cercle mesquin d’une famille. Thésée, Hippolyte, peuvent invoquer les dieux, ils en descendent. Mais tel ou tel marchand enrichi sera parfaitement ridicule de faire ainsi les grands bras. Est-ce à dire que ces drames qui s’agitent confusément dans l’ombre d’une maison, que ces passions terribles qui désolent une famille, ne présentent aucun intérêt, ne soient pas dignes d’être mis sur la scène. Loin de là, seulement il faut, selon moi, que le style s’accorde avec le genre, et certes, le vieux style classique, les exclamations, les périphrases sont ce qu’il y a de plus faux au monde dans la bouche d’une petite bourgeoise. — D’ailleurs, ce premier acte est rempli de beaux vers ; les situations sont copiées sur Racine, mais cela était dans le sujet même. — Si l’on me demandait mon avis sincère, je répondrais que cette tragédie est littéraire, bien versifiée, de beaucoup plus passionnée que les tragédies classiques, destinée selon moi à un succès éclatant ou à une chute complète ; mais qu’elle n’est nullement destinée à faire révolution en littérature, comme le pense son auteur, et qu’elle n’est pas le dernier mot de l’art dramatique. Je m’arrête faute de place. — Si bien que Chaillan a chanté et qu’il a été fort applaudi ; si bien qu’un monsieur qui se trouvait là nous a invités tous les deux à une soirée où doivent se trouver des acteurs de l’Odéon ; si bien qu’on a été se coucher sur les minuit. — M. Pagès (du Tarn) me demande soudain : « Voulez-vous six vers de désespoir ? — Pardieu ! lui dis-je, ce sont six verres vides. » ― Le brave homme resta bouche béante.
Je te serre la main. Ton ami,
É. Zola.
Je t’envoie trois feuilles et trois feuilles différentes. — Ceci prouve que jadis j’avais trois cahiers de papier et que je n’en ai plus maintenant. »
14 et 16 mai
Lettre de Zola à Baille.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 41-44.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 19, p. 163-167.« Aux Docks, 14 mai, 3 heures.
Aux choses sérieuses d’abord. — Ainsi, je te l’ai dit, j’ai écrit à Cezanne au sujet de la froideur avec laquelle il t’avait reçu. Je ne puis mieux faire que de te transcrire ici, textuellement, les quelques mots qu’il m’a répondus à cet égard ; les voici :
« Tu craindrais, d’après ta dernière lettre, que notre amitié avec Baille faiblît. Oh ! non, car, morbleu, c’est un bon garçon ; mais tu sais bien qu’avec mon caractère comme ça, je ne sais trop ce que je fais, et donc si j’avais envers lui quelques torts, eh bien, qu’il me les pardonne ; mais autrement, tu sais que nous sommes très bien ensemble, mais j’approuve ce que tu me dis, car tu as raison… Donc nous sommes toujours très amis. »
Tu le vois, mon cher Baille, j’avais bien jugé que ce n’était qu’un nuage léger qui s’évanouirait au premier vent ; je t’avais bien dit que ce pauvre vieux ne sait pas toujours ce qu’il fait, comme il l’avoue assez plaisamment lui-même ; et que, lorsqu’il vous chagrine, il ne faut pas s’en prendre à son cœur, mais au mauvais démon qui obscurcit sa pensée. C’est une âme d’or, je le répète, un ami qui peut nous comprendre, aussi fou que nous, aussi rêveur. — Je ne suis pas d’avis qu’il connaisse les lettres échangées entre nous, au sujet de votre paix ; il faut même qu’il croie que j’ai agi à ton insu, qu’il ignore, en un mot, que tu t’es plaint de lui, que vous avez été brouillés un instant. — Quant à ta conduite envers lui jusqu’au mois d’août, époque à laquelle nos belles parties recommenceront, elle doit être celle-ci, — toujours selon moi, bien entendu : — tu lui écriras régulièrement quelques lettres, sans trop te plaindre des retards qu’il pourra mettre lui-même à te répondre ; que ces lettres soient, comme par le passé, affectueuses, surtout exemptes de toute allusion, de tout souvenir qui pourraient rappeler votre petite brouille ; en un mot, qu’il en soit entre vous comme si rien ne s’était passé. C’est un convalescent que nous traitons, et si nous ne voulons pas de rechute, évitons les imprudences. — Tu comprends ce qui me fait parler ainsi, la crainte de voir se rompre notre amical triumvirat. Aussi tu excuseras mon ton de pédant, mes craintes exagérées, mes précautions peut-être inutiles, en mettant le tout sur l’amitié que je vous porte à tous les deux.
[…] Je viens de dire que je n’avais rencontré aucune âme qui sympathise avec la mienne. Tu sais bien le contraire, toi ; Cezanne aussi. Mais vous êtes si loin, les lettres sont un si faible moyen. Qui sait si nous ne sommes pas destinés à passer notre vie les uns loin des autres. Aussi, lorsque je pense à vous, à vous les seuls auxquels je me confie, je souffre encore davantage : n’avoir rencontré que vous et vous perdre !
Docks, 16 mai, 1 heure.
[…] Le temps est fort inégal, un jour de beau temps, un jour de pluie. Je suis allé pourtant m’égarer sous les ombrages de Saint-Cloud, de Saint-Mandé et de Versailles ; ces sites-là sont charmants, sauvages parfois, même pittoresques. Une bonne pipe à la bouche, un rêve doré dans la cervelle, et l’on peut encore y passer de doux instants. Nous irons visiter ces bois l’année prochaine, alors que tu seras ici, et que mercredis et dimanches t’appartiendront ; ce sera pour moi un temps de joie folle, en comparaison du temps présent. Je t’aurai près de moi ; je ne désespère pas d’entraîner Cezanne. Oh ! la belle vie, la belle vie que nous mènerons !
[…] Je termine cette lettre, qui n’est pas des plus intéressantes, en t’accusant une dernière fois de paresse. Je veux, au mois d’août, te montrer le nombre de lettres de Cezanne, et te faire rougir en le comparant à celui des tiennes.
N’importe, je te serre la main très affectueusement.
Ton ami,
É. Zola »
28 mai
Après le tirage au sort des conscrits, le 24 février, le conseil de révision déclare Cezanne, à qui est échu le n° 49, « propre au service ». Le 14 juin 1860, on lui délivre un certificat pour l’exonération. Après clôture de la liste du contingent cantonal, il sera exonéré de ses obligations militaires le 14 juillet 1860, et recevra son certificat d’exonération daté du 26 juillet 1860.
Il mesure 1,75 mètre. Il est inscrit comme étudiant en droit.
« Canton d’Aix (nord). Liste du tirage au sort des jeunes gens de la classe 1859 », Archives militaires, classe de 1859 ; Archives départementales des Bouches-du-Rhône, centre de Marseille, registre 1R 259 ; reproduit par Lioult Jean-Luc, Monsieur Paul Cezanne, rentier, artiste peintre. Un créateur au prisme des archives, Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Images en Manœuvres éditions, 2006, 299 pages, p. 68-69.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 36.
« Cependant, il avait tiré au sort. Son père lui avait payé un remplaçant. »
2 juin
Lettre de Zola à Baille.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 48-55.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 21, p. 168-173.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, 346 pages, p. 80 :« Paris, 2 juin 1860.
[…] A toi, mon meilleur ami, à toi et à Cezanne, je vous dirai tout un jour, mais croyez bien l’un et l’autre que je ne suis pas cet étourdi que vous pensez, que je ne prends un parti qu’après y avoir longtemps réfléchi, que la réalité m’occupe tout le jour et que je ne rêve que pour me délasser. D’ailleurs, je ne te le cacherai pas, je ne veux une position que pour me permettre de rêver à l’aise. Tôt ou tard j’en reviendrai à la poésie ; ce que je désire, c’est de pouvoir m’y livrer sans être à charge à personne et de pouvoir manger un morceau de pain et boire un verre d’eau. Tu me parles de la fausse gloire des poètes ; tu les appelles fous, tu cries que tu ne seras pas aussi sot qu’eux, d’aller pour un applaudissement mourir dans un grenier. Je t’ai déjà dit, dans une de mes lettres, une chose qui aurait dû t’empêcher d’avancer de nouveau ce blasphème. Crois-tu donc que le poète ne travaille que pour la gloire ? Crois-tu donc qu’il n’est poussé à chanter que par ce mobile ? Non, il prend sa lyre dans sa solitude, perd de vue ce monde, et ne vit que dans le monde des esprits. C’est sa vie, pourquoi le railler, l’accuser de folie : il te dira que tu ne comprends pas, que tu n’es pas poète, et il aura raison. Je veux vivre heureux : voilà ton éternel refrain. Eh ! mon Dieu, tout le monde veut vivre heureux ; tu as ton bonheur, le poète a le sien : chacun marche où Dieu l’appelle, le lâche est celui qui se plaint des épines et refuse d’avancer.
Bien entendu, que nos différentes manières de voir ne fassent pas faiblir notre amitié 1. Tu me connais et tu sais que je ne suis rien moins qu’un fat. Je sais ce que je veux ; […]
Le vieux Cezanne me dit dans chacune de ses lettres de te souhaiter le bonjour. Il me demande ton adresse, pour t’écrire fort souvent. Je m’étonne qu’il ne la sache pas, et cela prouve, non seulement qu’il ne t’écrivait pas, mais que tu gardais le même silence que lui. Enfin, comme c’est une demande qui montre ses bons sentiments, je vais le satisfaire. Voilà donc une petite brouille passée à l’état de légende.
[…] En attendant, pousse-toi de l’agrément, comme dit Cezanne : bois, ris, fume, et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je te serre la main. Mes respects à tes parents.
Ton ami,
E. Zola.»1. Malgré ces affirmations d’amitié, Zola reprochera bientôt à Baille d’être trop raisonnable, que l’expression « position dans la vie » se glissait trop souvent dans ses lettres, que celles-ci sonnaient comme provenant d’un épicier enrichi et lui portaient sur les nerfs. Dans son désespoir, Zola s’exclamera enfin : « Marche dans ton sentier ; moi, je ne sais ce que Dieu me garde, mais je mourrai content si je meurs libre. » Afin d’éviter toute argumentation trop personnelle, Zola finira par ne discuter que de questions littéraires avec Baille.
13 juin
Zola écrit à Cezanne. Au cours d’une promenade dans le village de Vitry, près de Paris, Zola a découvert dans un café de grandes peintures murales, « de grands panneaux comme tu veux en peindre chez toi, peints sur toile, représentant des fêtes de village ».
Cezanne s’est laissé pousser la barbe.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 226-232.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 21, p. 174-178.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 80-82 :« Paris, 13 juin 1860.
Mon cher Paul,
L’autre jour, par une belle matinée, je me suis égaré loin de Paris, dans les champs, à trois ou quatre lieues. — N’aimes-tu pas les bluets, ces petites étoiles qui scintillent dans les blés, ces fleurs si gracieusement jolies. Les poètes ont, hélas ! usé et abusé des fleurs. Qui oserait parler de la rose, écrire deux lignes sur la pensée, pousser des exclamations sur le lilas, le chèvrefeuille, etc., etc. Je suis donc fort mal venu de te vanter mes bluets, de te dire que j’en ai ramassé une grosse belle gerbe, tout comme une pensionnaire de couvent en robe blanche pudique et folâtre. Mon Dieu ! oui, une grosse gerbe, courant dans les prés, joyeux de ne plus voir de maisons, de marcher dans la rosée, de me croire en Provence, en chasse, en partie au bastidon. J’étais seul et je m’en donnais à cœur joie ; certain que personne ne m’épiait pour me railler, j’allais toujours, augmentant mon bouquet. Ces bluets, ce sont fleurs si charmantes ; je parie que tu ne les as jamais remarqués. Mon bon vieux, quelque jour imite-moi, cours en cueillir une pleine poignée le matin, avant que le soleil ait séché la rosée dans leurs corolles ; fais-toi enfant pour une heure ; puis tu verras quelle belle teinte bleue, quel fouillis gracieux ; on dirait un amas de fine dentelle.
Le fait est qu’après avoir couru deux grandes heures, je me sentis un grand appétit. Je levais la tête ; des arbres partout, du blé, des haies, etc. Je me trouvais dans un pays qui m’était totalement inconnu. Enfin, au-dessus d’un vieux chêne j’aperçus un clocher ; un clocher suppose un village ; un village, une auberge. Je marchai vers la bienheureuse église, et je ne tardai pas à me trouver installé devant un frugal déjeuner, dans un café quelconque. Dans ce café — et c’est à cela que je voulais en venir, tout le reste n’est qu’une préface, — je remarquai en entrant des peintures qui me frappèrent. C’étaient de grands panneaux comme tu veux en peindre chez toi 1, peints sur toile, représentant des fêtes de village ; mais un chic, un coup de pinceau si sûr, une entente si parfaite de l’effet à distance, que je demeurai ébahi. Jamais je n’avais vu de telles choses dans un café, même parisien. On me dit que c’était un artiste de vingt-trois ans qui avait commis ces petits chefs-d’œuvre. Vraiment, si tu viens à Paris, nous irons jusqu’à Vitry — c’est le nom du bienheureux village — et je suis certain que tu admireras comme moi. Je me suis laissé peut-être emporter par l’enthousiasme, mais je ne crois pas me tromper en avançant que ce jeune rapin a de l’avenir.
Tu m’apprends une nouvelle qui me surprend fort, le mariage d’Escoffier-Don Juan, d’Escoffier le coureur, le libertin, etc., etc. Du diable ! si je croyais que ce serait lui qui se marierait le premier de mes amis. Pousserai-je de grandes exclamations sur le mariage d’argent ? À quoi bon ? ce serait au moins ridicule et en tout cas plus qu’inutile. Gardons en avare nos belles rêveries ; laissons les autres barboter dans la prose. Qui sait d’ailleurs ? peut-être sont-ils plus heureux que nous. Je faisais même cette réflexion l’autre soir en pensant à ce cher Escoflier : Voilà un garçon, me disais-je, dont le sentier aura été bordé de roses sans épines. Jusqu’à vingt-deux ans il a mené une belle vie de paresse et de plaisir, puis en ce moment, où il lui faut choisir une carrière, faire un travail quelconque, il rencontre bonnement une dot de cent mille francs qui lui tend les bras. Voilà la carrière, la position trouvée. Je sais que cette fois la rose a une épine. Mais qu’importe ! combien il en est qui envieraient son sort ! Quand on peut marcher terre à terre, n’être pas tourmenté par de folles idées comme moi. n’est-on pas joyeux de voir cent mille francs tomber amoureux de vous ? Ma loi, vive la prose par moment, je le répète, Escoffier [Henri Escoffier, fils de notaire] doit être heureux. Ce n’est pas dire que je serais heureux, si j’étais à sa place ; que non pas ! Chacun dans son milieu, mon vieux ; l’oiseau dans l’air et le poisson dans l’eau.
Je vois Chaillan fort souvent. Hier nous avons passé la soirée ensemble ; cet après-midi je dois aller le retrouver au Louvre. Il m’a dit t’avoir écrit avant-hier, je crois, je ne te parle donc pas de ses travaux. Combes est ici, il doit t’en parler. Les autres artistes que je vois sont Truphème jeune [Auguste Truphème], Villevieille, Chautard ; quant à Emperaire, je n’ai pu encore le rencontrer 2. Nous parlons quelquefois avec Chaillan de Fournier ; sais-tu par où il réside, ce qu’il fait ? Pour nous, absence complète de notions à cet égard. — Nous attendons, pour commencer le superbe tableau dont je te parlais 3, que je sois installé dans une chambre que je viens de louer 4. Mon vieux, au septième ; l’habitation la plus haute du quartier ; une immense terrasse, la vue de tout Paris ; une chambrette délicieuse que je vais meubler dans le dernier chic, divan, piano, hamac, pipes en foule, narguilé turc, etc. Puis des fleurs, puis une volière, un jet d’eau, une véritable féerie. Je te reparlerai de mon grenier quand tous ces embellissements seront terminés. Au 8 juillet l’emménagement. — Baille, qui viendra sans doute à Paris au mois de septembre, jouira sans doute de mon asile : que ne puis-je en dire autant de toi. Chaillan doit te narrer toutes les félicités que les rapins rencontrent ici.
Voilà bientôt quinze jours que je file un amour des plus platoniques. Une jeune fille, une fleuriste qui reste à côté de chez moi, passe sous ma fenêtre deux fois par jour, le matin à six heures et demie, et le soir à huit heures. C’est une petite blonde, toute mignonne, toute gracieuse ; petite main, petit pied, une grisette des plus gentilles. Aux heures où elle doit passer, je me mets régulièrement à la fenêtre ; elle vient, lève les yeux ; nous échangeons un regard, même un sourire ; puis c’est tout. Est-ce folie, mon Dieu ! aimer ainsi une fleuriste, la moins cruelle des beautés parisiennes ! Ne pas la suivre, ne pas lui parler ! Veux-tu que je te le dise, c’est paresse et rêverie à la fois. C’est bien moins fatigant d’aimer ainsi ; je l’attends, mon adorée, en fumant ma pipe. Puis les beaux rêves ! ne la connaissant pas, je puis la doter de mille qualités, inventer mille aventures délirantes, la voir, l’entendre parler à travers le prisme de mon imagination. Mais, que te dis-je ? ne le sais-tu pas aussi bien que moi, les charmes de cet amour platonique dont ou se moque tant. Laissons railler les sots ; folie et sagesse sont des mots sur la signification desquels on ne s’entendra jamais. — Mon vieux, que ne suis-je près de toi, pour boire un bon coup, pour causer folie, couchés sur le gazon, la tête à l’ombre et les pieds au soleil. Épicure fut un sage ; le monde n’a que faire de nous, pauvres chétifs, nous n’avons que faire du monde. Eh ! morbleu ! qu’on nous laisse vivre en paix, le verre en main et la chanson aux lèvres, rêvant et dormant en attendant le grand sommeil. — Je veux aller près de toi au mois d’août rien que pour divaguer et boire de bons coups. Vive Dieu ! nous en viderons plus d’une et des meilleures encore !
Tu ne me parles plus du droit. Qu’en fais-tu ? es-tu toujours en brouille avec lui ? Ce pauvre droit qui n’en peut mais, comme tu dois l’arranger ! — J’ai remarqué que nous avons toujours besoin d’une peine ou d’un amour, sans lesquelles conditions la vie est incomplète. D’ailleurs, l’idée d’amour entraîne jusqu’à un certain point l’idée de haine et vice versa. Tu aimes les jolies femmes, donc tu détestes les laides ; tu hais la ville, donc tu aimes les champs. Bien entendu, qu’il ne faudrait pas pousser cela trop loin. Quoi qu’il en soit, je répète que nous avons besoin pour bien vivre d’aimer et de haïr quelque chose ; d’aimer pour laisser notre âme s’épancher dans nos bons moments ; de haïr pour jurer et briser les vitres dans nos mauvais moments. Tel est l’homme en général, c’est-à-dire l’homme bon et méchant, ayant des qualités et des défauts. Le véritable sage serait celui qui ne serait qu’amour, dans l’âme duquel la haine n’aurait pas de place. Mais comme nous ne sommes pas parfaits — Dieu merci ! ce serait trop ennuyant — et que tu ressembles à tous, ton amour à toi est la peinture et la haine du droit. Voilà, comme dirait Astier, ce qu’il fallait démontrer.
Tu relis quelquefois mes anciennes lettres, me dis-tu. C’est un plaisir que je me paie souvent. J’ai gardé toutes les tiennes ; ce sont là mes souvenirs de jeunesse. — Faut-il que l’homme soit misérable ! toujours désirer, toujours regretter, toujours vouloir devancer l’avenir, puis, chaque fois que le regard se porte vers le passé, toujours verser des pleurs amers. Quels pauvres animaux que nous ; ne pas savoir profiter de la minute présente, la gâter par un désir ou par un regret. Vraiment, je serais tenté de me dresser vers le ciel et de crier à Dieu : « Dis-moi pourquoi nous as-tu pétris d’une argile aussi immonde ? pourquoi as-tu enfermé ton souffle divin dans une si ignoble prison que les parois en ont souillé la céleste prisonnière ? » Certes, ce n’est pas à propos de tes lettres que je pousserais ce cri. Quand je les relis, si je regrette le temps passé, c’est un regret exempt de larmes ; au contraire, je suis heureux pour un quart d’heure, je nous revois plus jeunes, réunis et joyeux. Puis je pense au futur, je me demande si ce bon temps ne reviendra pas, et j’espère. Et pourquoi n’aurais-je pas d’espérance ? Ne sommes-nous pas jeunes encore, pleins de rêves, à peine au début de la vie. Tiens, laissons les souvenirs et les regrets aux vieillards ; c’est leur trésor à eux, c’est le livre du passé qu’ils feuillettent d’une main tremblante, s’attendrissant à chaque page. Et, puisque nous ne saurions jouir du présent, à nous l’avenir, ce bel avenir inconnu que nous pouvons embellir des plus riches couleurs. Espérons, mon bon vieux, espérons d’être réunis un jour, de jouir d’une sainte liberté, et de marcher en riant jusqu’à ce que nos pieds se heurtent contre la pierre d’un tombeau.
Mon poème en est toujours au même point : au commencement du troisième et dernier chant. Un de ces jours de beau temps, je lâcherai de le terminer. — Si tu vois Houchard, dis-lui que sa lettre ne m’est nullement parvenue ; dis-lui aussi que je lui écrirai bientôt et que je lui serre la main.
Parle-moi un peu des processions. C’est un temps de sainte coquetterie ; sous prétexte d’adorer Dieu dans ses plus beaux atours, on va se faire adorer soi-même. Que de billets doux une église a vu glisser dans des mains mignonnes. — Parle-moi de Marguery (de Mars guéri, entendons-nous). Parle-moi, parle-moi de tout : je suis avide de nouvelles. Toi qui ne regardes jamais pour toi, regarde un peu pour moi, puis tu me conteras tout ce que tu as vu. — Une dernière question : « Ta barbe, comment la portes-tu ? »
Mes respects à tes parents. — Je te serre la main.
Ton ami,
Émile Zola. »
1. Depuis que le père de Cezanne avait acquis en 1859 la propriété du Jas de Bouffan aux portes d’Aix, le peintre avait l’idée de décorer de peintures murales le grand salon dont la famille ne se servait pas d’abord. Il y peindra notamment quatre panneaux des saisons, signés ironiquement du nom d’Ingres, et, à la place d’honneur, un portrait de son père (R095).
2. Chaillan, Combes, Truphème, Villevieille, Chautard et Emperaire étaient des camarades d’Aix qui avaient presque tous participé avec Cezanne aux cours du soir de dessin à l’École d’art dirigée par Gibert. Cezanne fréquente ces cours de 1858 à 1862. Lui, aussi bien que Zola, avait une assez piètre opinion des talents de ces « compatriotes », à l’exception d’Emperaire. Joseph Chautard, ami intime de Villevieille, corrigera plus tard les travaux de Cezanne à Paris (voir la lettre de Cezanne à Numa Coste et à Villevieille du 5 janvier 1863).
3. Chaillan avait l’intention de peindre Zola en Amphyon, drapé dans une toge, une lyre à la main et les yeux tournés vers le ciel.
4. Zola devait occuper cette nouvelle chambre à partir du 8 juillet.
24 juin
Lettre de Zola à Baille.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 73-82.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 23, p. 184-190.« Quittons cette question brûlante. Je te transcris ci-dessous trois pages d’une lettre que j’ai envoyée à Cezanne. Je le les envoie parce qu’elles sont, en quelque sorte, la conclusion de tout ce que je t’ai écrit jusqu’ici sur l’amour et sur les amants. Les voici :
« L’autre soir je rêvais, me promenant sous les ombrages du Jardin des Plantes. La nuit tombait ; un doux parfum s’échappait des mille fleurs qui ornent les parterres. J’allais, fumant ma pipe, le nez au vent, admirant les blanches jeunes filles qui se lutinaient autour de moi, dans les allées. Soudain, j’en vis une qui ressemblait à l’Aérienne ; et voilà mon esprit qui court en Provence, qui divague. — J’ai lu quelquefois cette phrase dans les romans : « Ils se virent, une étincelle jaillit, ils comprirent qu’ils étaient faits l’un pour l’autre, et ils s’aimèrent. » Je ne m’étonne plus alors si des amours, commencées ainsi, finissent toujours misérablement. L’âme n’y est pour rien, dans ce simple coup d’œil ; vous n’avez pu apprécier que la beauté du corps. Ou, si votre amour est pur, si ce n’est pas le seul désir qui vous entraîne, ce n’est pas la femme que vous venez de voir si rapidement que vous aimez, c’est un être que crée votre imagination, qu’elle doue de mille qualités morales. Tu vois, dès lors, les deux écueils inévitables de ces amours si subites ; de deux choses l’une, ou vous n’aimez que le corps, et cela est infâme, ou vous aimez un être fictif qui n’est pas celui avec lequel vous allez vivre ; et c’est vous exposer à perdre toutes vos illusions, à trouver un diable, quand vous rêviez un ange. — Ne vaudrait-il pas mieux suivre une autre marche, connaître avant d’aimer, passer par l’estime pour arriver à l’amour ; voir en un mot sa passion, faible d’abord, croître ensuite chaque jour ? — Voilà qui est fort sage, me diras-tu, mais le moyen de mettre ces maximes en pratique lorsqu’on a vingt ans ? Patience donc ! c’est pour arriver justement à la pratique que je viens de faire ce bout de théorie. — Encore quelques mots. À notre âge, ce n’est pas la femme que l’on aime, c’est l’amour. Nous avons besoin d’une maîtresse, n’importe laquelle. La première femme qui nous sourit, c’est elle que nous voulons posséder ; nous nous jetons en aveugle à sa poursuite ; si elle nous résiste, nous n’en sommes que plus épris, nous déclarons que nous allons mourir pour elle : si elle nous cède, hélas ! nous perdons bien vite nos belles illusions, mes amis, écoutez-moi attentivement ; j’ai trouvé un remède pour tous : pour vous qui désespérez de ne pas avoir, pour vous qui désespérez d’avoir eu. — Je me promenais dans le Jardin des Plantes, rêvant à l’Aérienne. J’examinais ma conduite passée, et je la trouvais si sotte à son égard que je cherchais celle que j’aurais dû tenir. De ces réflexions jaillit le moyen pratique annoncé ci-dessus. J’aurais dû, me dis-je, tâcher de la voir seule à tout prix, ou, si cela eût été impossible, lui écrire une lettre contenant en abrégé ce que je désirais lui dire verbalement. Voici en quelques mots les idées qu’aurait contenues cette lettre : « Mademoiselle, ce n’est pas un amant qui vous écrit, c’est un frère. Je me sens si isolé dans ce monde, que j’éprouve le besoin de connaître un cœur jeune qui batte pour moi, qui me plaigne et me console, me juge et m’encourage. Je n’ose ni ne veux vous demander votre amour ; ce serait profaner un tel sentiment que de croire qu’il puisse naître dans deux cœurs qui ne se connaissent pas encore. La seule chose que je désire est votre amitié, une amitié augmentée par une connaissance réciproque de nos deux caractères. Si vous me pensez digne un jour d’un sentiment plus tendre, ce jour-là, nous interrogerons nos cœurs, et s’ils battent également tous les deux, nous pourrons commencer un nouveau genre de vie. Mais jusque-là ma main pressera votre main comme celle d’une sœur, mes lèvres ne vous donneront un baiser que lorsque je serai certain que les vôtres me le rendront, etc., etc. Votre frère ». — Cette lettre développée habilement ne manquerait pas son effet, surtout si la jeune fille était une âme généreuse, poétique, exempte de préjugés. Admettant qu’elle accepte cette amitié, soit à la suite de nouvelles lettres, soit par d’autres moyens, tu vois les mille conséquences qui en découlent. D’abord, tu n’aimes pas à l’aventure ; si la jeune fille est réellement digne de toi, si vos caractères sympathisent, ces titres de sœur et de frère se changeront bientôt en ceux de bien-aimée et d’amant : surtout, et c’est là le sublime, vous vous connaîtrez, partant vous vous aimerez avec l’âme, tels que vous êtes, éternellement ! Si l’amour ne vient pas, si l’amitié même faiblit, c’est un signe certain que vous ne vous convenez nullement ; vous auriez beaucoup souffert si, croyant vous aimer, tandis que vous n’aimiez que l’amour, vous vous étiez bientôt séparés, niant l’amour, ce qui est une monstruosité. C’est donc un bien que d’avoir essayé d’abord de l’amitié et de vous éloigner, reconnaissant simplement que vous n’avez pas le crâne fait de même. Si, au contraire, et c’est la dernière supposition possible, l’amitié reste et que l’amour ne vienne pas, n’est-ce pas déjà charmant d’être l’ami d’une jolie femme, d’avoir toujours l’espérance, cette douce chose, d’être son amant un jour ? L’amour où il mène n’est pas un de ces amours romantiques qui s’enlèvent comme du lait et retombent flasques et mornes. C’est un préservatif contre la désillusion, cet abîme où se noient tous les cœurs de vingt ans. Enfin, c’est un adoucissement aux peines qu’éprouvent les amants dédaignés. — Que diable ! on ne fait pas toujours d’une pierre trois coups. »
Voilà ce que j’ai écrit à Cezanne. Eh bien ! mon cher Baille, ne suis-je pas raisonnable ? Ne dirais-tu pas lire la discussion d’une formule d’algèbre ? Ce n’est plus un rêve ceci, c’est de- la pratique ; j’avoue que je ne donne pas mon moyen comme infaillible, tant que l’expérience ne sera pas venue le démontrer.
Je ne sais que te dire pour t’exciter à m’écrire plus souvent. Je sais que tu as toujours aimé la littérature, que tu te serais peut-être fait homme de lettres, si tu ne l’étais imposé de prétendus devoirs. Ne parlais-tu pas au mois d’août de prendre des leçons de littérature ? Mais la pratique n’est-elle pas la meilleure des leçons ? Crois-tu que ton style ne deviendrait pas plus facile, si tu m’écrivais une lettre chaque semaine. Tu me diras que tu n’as pas de sujet ; eh ! mon Dieu, prends le premier venu, la religion, nos vertus, la modestie, etc. ; nos penchants, l’amour, le jeu, l’ivrognerie, etc. ; prends la science si tu veux, la morale, que sais-je ? Écris-moi quatre, huit pages n’importe sur quoi ; cela te déliera la main, je te répondrai et nous étudierons ainsi réciproquement le domaine de nos pensées. Moi, j’attaque un peu tous les sujets dans mes lettres ; mais tu ne me réponds pas, et je finis par me taire, faute de contra- dicteur. — Voici tes examens qui approchent, tu me répondras que tu n’as pas le temps. — Je n’ajoute qu’une chose : j’ai vingt lettres de Cezanne, dix de Marguery, et cinq de toi. Ce n’est pas le temps qui te manque ; c’est impossible. Tu es donc un paresseux, et je jure devant Dieu que c’est la dernière fois que je me plains, — mais, comme on dit, je n’en pense pas moins.
Je vais envoyer mon poème — sept cents vers — à Cezanne. Je lui dis de te le faire remettre ; tâche de ton côté de te le procurer. À bientôt.
Mes respects à tes parents.
Je te serre la main. Ton ami,
Émile Zola. »
25 juin
Lettre de Zola à Cezanne.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 232-236.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 24, p. 191-193.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 82-83.« Paris, 25 juin 1860.
Mon cher vieux,
Tu me parais découragé dans ta dernière lettre ; tu ne parles rien moins que de jeter tes pinceaux au plafond. Tu gémis sur la solitude qui t’entoure ; tu t’ennuies. — N’est-ce pas notre maladie à tous, ce terrible ennui, n’est-ce pas la plaie de notre siècle ? et le découragement n’est-il pas une des conséquences de ce spleen qui nous étreint la gorge ? — Comme tu le dis, si j’étais près de toi, je tâcherais de te consoler, de t’encourager. Je te dirais que nous ne sommes plus des enfants, que l’avenir nous réclame et qu’il y a lâcheté à reculer devant la tâche qu’on s’est imposée ; que la grande sagesse est d’accepter la vie telle qu’elle est ; de l’embellir par des rêves, mais de bien savoir que ce sont des rêves que l’on fait. — Dieu me protège, si je suis ton mauvais génie, si je dois faire ton malheur en te vantant l’art et la rêverie. Je ne puis cependant le croire ; le démon ne peut se cacher sous notre amitié et nous entraîner tous deux à notre perte. Reprends donc courage ; saisis de nouveau tes pinceaux, laisse ton imagination errer vagabonde. J’ai foi en toi ; d’ailleurs, si je te pousse au mal, que ce mal retombe sur ma tête. Du courage surtout, et réfléchis bien avant de t’engager dans cette voie, aux épines que tu rencontres. Sois homme, laisse un instant le rêve de côté, et agis. — Si je te donne de mauvais conseils, je le répète, que Dieu me protège ! Je crois bien parler pour toi, j’en ai conscience ; si l’on m’accusait, ce ne serait pas la première fois que l’on me jetterait à la face des injures que je ne mérite pas. Mon cœur en saignerait, mais je dirais comme le Christ : « Seigneur, pitié pour eux ; ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Laisse-moi te parler un peu de moi ; ce que je viens de te dire a rouvert en moi des blessures saignantes. — J’arrivais au monde, le sourire sur les lèvres et l’amour dans le cœur. Je tendais la main à la foule, ignorant le mal, me sentant digne d’aimer et d’être aimé, je cherchais partout des amis. Sans orgueil comme sans humilité, je m’adressais à tous, ne voyant passer autour de moi ni supérieur ni inférieur. Dérision ! on me jeta à la figure des sarcasmes, des mépris ; j’entendis autour de moi murmurer des surnoms odieux, je vis la foule s’éloigner et me montrer au doigt. Je pliai la tête quelque temps, me demandant quel crime j’avais pu commettre, moi si jeune, moi dont l’âme était si aimante. Mais lorsque je connus mieux le monde, lorsque j’eus jeté un regard plus posé sur mes calomniateurs, lorsque j’eus vu à quelle lie j’avais affaire, vive Dieu ! je relevai le front et une immense fierté me vint au cœur. Je me reconnus grand à côté des nains qui s’agitaient autour de moi ; je vis combien mesquines étaient leurs idées, combien sot était leur personnage ; et, frémissant d’aise, je pris pour dieux l’orgueil et le mépris. Moi qui aurais pu me disculper, je ne voulus pas descendre jusque-là ; je conçus un autre projet : les écraser sous ma supériorité et les faire ronger par ce serpent qu’on nomme l’envie. Je m’adressai à la poésie, cette divine consolation ; et si Dieu me garde un nom, c’est avec volupté que je leur jetterai à mon tour ce nom à la face comme un sublime démenti de leurs sots mépris. — Mais si j’ai de l’orgueil avec ces brutes, je n’en ai pas avec vous, mes amis ; je reconnais ma faiblesse et, pour toute qualité, je ne me trouve alors que celle de vous aimer. — Comme le naufragé qui se cramponne à la planche qui surnage, je me suis cramponné à toi, mon vieux Paul. Tu me comprenais, ton caractère m’était sympathique ; j’avais trouvé un ami, et j’en remerciais le ciel. J’ai craint de te perdre à plusieurs reprises ; maintenant cela me semble impossible. Nous nous connaissons trop parfaitement pour jamais nous détacher. — Pardonne-moi de t’avoir parlé de ces questions brûlantes ; j’ai cru devoir le faire pour augmenter, s’il est possible, notre amitié.
J’ai passé la journée d’hier avec Chaillan. Comme tu me l’as dit, c’est un garçon qui a un certain fond de poésie ; la direction seule lui a manqué. — Je dois demain aller le voir travailler chez lui ; il est en train de faire une petite toile représentant une barque battue par la tempête et habitée par un matelot hagard ; dans le fond la Vierge apparaît à sa prière et éloigne d’une main l’ouragan. Ce sujet est tiré d’une gravure que l’on place sur la première feuille des romances. Telle est l’idée ; quant à l’exécution, c’est assez piètre, surtout comme couleur, comme harmonie des teintes. Le sujet étant très difficile à traiter, ce brouillard, cette mer, ces éclairs, cette apparition, ce chaos du ciel et des vagues présentant une grande difficulté pour être proprement rendus, et d’un autre côté le peintre n’ayant pas les talents requis, l’œuvre, je le crains, sera fort médiocre. — Par ce qui est déjà fait, je juge que cela ressemblera assez à ces ignobles ex-voto qui sont accrochés dans la Madeleine, à Aix. — Jeudi, je dois aller souper avec Chaillan dans une famille provençale, résidant à Paris, à l’occasion de la première communion du fils de la maison. — Quant à la journée d’hier, je crois — Dieu me pardonne — que nous nous sommes un peu pochardés. Titubant, lui prodiguant les plus doux noms, je l’ai accompagné jusque chez lui où je l’ai quitté, après mille serments d’amitié. — Il travaille unguibus et rostro souhaitant de tout cœur de t’avoir pour compagnon.
Je compte toujours aller te voir bientôt. J’ai besoin de te parler ; les lettres, c’est fort bon, mais on n’y dit pas tout ce que l’on voudrait dire. Je suis las de Paris ; je sors fort peu et, si c’était possible, j’irais m’établir près de toi. Mon avenir est toujours le même : fort sombre et si couvert de nuages que mon œil l’interroge en vain. Je ne sais vraiment où je vais : que Dieu me conduise. — Écris-moi souvent, cela me console. Je sais combien tu hais la foule, ne me parle donc que de toi ; et surtout ne crains jamais de m’ennuyer. — Courage. À bientôt.
Mes respects à tes parents.
Je te serre la main. — Ton ami,
Émile Zola.
Marguery m’écrit ; je n’ai pas le temps de lui répondre. Dis-lui seulement de signer de mon nom : Émile Zola, toutes les paroles de romances que je lui ai envoyées. Ces pièces devant paraître un jour, il serait ridicule de prendre un pseudonyme. — N’oublie pas, il paraît que c’est pressé. »
25 juin
Seconde lettre de Zola à Cezanne dans la même journée.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 25, p. 194-195.
« Paris, 25 juin 1860
On a si souvent répété qu’on ne lisait plus les préfaces, qu’un auteur s’interroge à deux fois avant d’écrire des lignes inutiles. Cependant, comme c’est mon premier crime en ce genre, comme je suis certain que tu me liras, je vais faire précéder de quelques mots le poème que je t’envoie.
Après tout, une préface, c’est chose fort ridicule. L’auteur semble vous dire : « Permettez, monsieur le lecteur ; je suis tellement obscur, tellement profond dans mon ouvrage, que vous seriez assez bête pour ne pas me comprendre, si je ne m’expliquais ici plus simplement. » On a donc grandement raison de ne pas lire les préfaces ; l’œuvre doit suffire pour juger l’auteur. Maintenant, continue, si cela te plaît.
Dans « Paolo » j’avais un double but : exalter l’amour platonique, le rendre plus attrayant que l’amour charnel ; puis, montrer que, dans ce siècle de doute, l’amour pur peut servir de foi, donner à l’amant la croyance d’un dieu, d’une âme immortelle. Quant au fond du poème, il est historique ; tu reconnaîtras ce Paolo, adorant son amante comme une sainte madone. Pour les détails, plusieurs sont inventés, les autres sont vrais ; bien entendu que le tout est présenté sous une forme poétique que la réalité n’a peut-être pas eue.
Le premier chant, le plus parfait des trois, ne présente pas de morceau qui tranche. Quant aux deux autres, bien moins polis, je te recommande seulement la tirade à Don Juan qui termine le second, et la prière qui termine le troisième.
On me dira peut-être que j’imite Musset. À cela je répondrais que ce poète est mon poète favori, que je lis chaque jour quelques pages de ses œuvres, et qu’il n’est pas étonnant alors si, même sans le vouloir, je prends sa forme et quelques-unes de ses idées. Mais je jure devant Dieu que ce n’est pas un crime prémédité, que j’ai horreur du plagiat, que j’écarte au contraire, lorsque je m’en aperçois, tout ce qui aurait l’air d’un emprunt.
D’ailleurs, je t’envoie mon œuvre telle quelle. Certes on pourrait la corriger ; mais lis-la lentement, attache-toi à la pensée, sans trop remarquer les répétitions, les expressions fausses, les oh !, les hélas !, etc., etc. ; peut-être alors penseras-tu que mes rêves sont de beaux rêves. Ce poème n’est pas mon dernier mot ; placé dans des conditions meilleures, tranquille du côté des intérêts matériels, je peux et je dois faire mieux. Je le dis sans vanité, parce que je sens que cela est. Fais parvenir ce cahier à Baille ; le moyen le plus facile serait, je crois, de le remettre sous pli à son père, qui le lui porterait lui-même, quand il irait à Marseille. Dites-moi franchement tous deux ce que vous pensez de cette nouvelle œuvre. »
Juin-juillet
Cezanne est à nouveau en proie à un profond découragement. Zola critique sa passivité. Il le pousse à s’engager dans la voie de la peinture.
Lettres de Zola à Cezanne, 25 juin et [juillet 1860] : Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 28, p. 191-192, 212-213.
4 juillet
Lettre de Zola à Baille.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 82-92.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 26, p. 195-201.« J’ai envoyé mon poème à Cezanne, ainsi que je te l’avais annoncé. Cette dernière œuvre pèche beaucoup par les détails ; même une faute de prosodie m’est échappée dans la copie que je vous ai envoyée. J’attends toutefois ton jugement pour comparer les défauts que tu me signaleras à ceux que je connais déjà.
[…] Quant au silence que garde Cezanne, il faudrait aviser. Je lui ai dit de t’envoyer mon poème ; tu pourrais de ton côté lui écrire que je t’ai averti de cet envoi et lui indiquer un moyen pour te le faire parvenir. Cette lettre serait inoffensive ; tu te tiendrais à l’écart, ne parlant que de moi ou d’autre chose, et cela renouerait sans doute. »
Juillet
Lettre de Zola à Cezanne.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 236-241.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 28, p. 212-215.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 83-86 :« [Paris,] juillet 1860.
Mon cher Paul,
Permets que je m’explique une dernière fois franchement et clairement ; tout me semble si mal aller dans nos affaires que j’en fais un mauvais sang incroyable. — La peinture n’est-elle pour toi qu’un caprice qui t’est venu prendre par les cheveux un beau jour que tu t’ennuyais ? N’est-ce qu’un passe-temps, un sujet de conversation, un prétexte à ne pas travailler au droit. Alors, s’il en est ainsi, je comprends ta conduite : tu fais bien de ne pas pousser les choses à l’extrême et de ne pas te créer de nouveaux soucis de famille. Mais si la peinture est ta vocation, — et c’est ainsi que je l’ai toujours envisagée, — si tu te sens capable de bien faire après avoir bien travaillé, alors tu deviens pour moi une énigme, un sphinx, un je ne sais quoi d’impossible et de ténébreux. De deux choses l’une : ou tu ne veux pas, et tu atteins admirablement ton but ; ou tu veux, et dès lors je n’y comprends plus rien. Tes lettres tantôt me donnent beaucoup d’espérance, tantôt m’en ôtent plus encore ; telle est la dernière, où tu me sembles presque dire adieu à tes rêves, que tu pourrais si bien changer en réalité. Dans cette lettre est cette phrase que j’ai cherché vainement à comprendre : « Je vais parler pour ne rien dire, car ma conduite contredit mes paroles. » J’ai bâti bien des hypothèses sur le sens de ces mots, aucune ne m’a satisfait. Quelle est donc ta conduite ? celle d’un paresseux sans doute ; mais qu’y a-t-il là d’étonnant ? on te force à faire un travail qui te répugne. Tu veux demander à ton père de te laisser venir à Paris pour te faire artiste ; je ne vois aucune contradiction entre cette demande et tes actions ; tu négliges le droit, tu vas au musée, la peinture est le seul ouvrage que tu acceptes ; voilà je pense un admirable accord entre tes désirs et tes actions. — Veux-tu que je te le dise ? — surtout ne va pas te fâcher, — tu manques de caractère ; tu as horreur de la fatigue, quelle qu’elle soit, en pensée comme en actions ; ton grand principe est de laisser couler l’eau, et t’en remettre au temps et au hasard. Je ne te dis pas que tu aies complètement tort ; chacun voit à sa manière et chacun le croit du moins. Seulement, ce système de conduite, tu l’as déjà suivi en amour ; tu attendais, disais-tu, le temps et une circonstance ; tu le sais mieux que moi, ni l’un ni l’autre ne sont arrivés. L’eau coule toujours, et le nageur est tout étonné un jour de ne plus trouver qu’un sable brûlant. — J’ai cru devoir te répéter une dernière fois ici ce que je t’ai déjà dit souvent : mon titre d’ami excuse ma franchise. Sous bien des rapports, nos caractères sont semblables ; mais, par la croix-Dieu ! si j’étais à ta place, je voudrais avoir le mot, risquer le tout pour le tout, ne pas flotter vaguement entre deux avenirs si différents, l’atelier et le barreau. Je te plains, car tu dois souffrir de cette incertitude, et ce serait pour moi un nouveau motif pour déchirer le voile ; une chose ou l’autre, sois véritablement avocat, ou bien sois véritablement artiste ; mais ne reste pas un être sans nom, porte une toge salie de peinture. — Tu es un peu négligent — soit dit sans te fâcher, — et sans doute mes lettres traînent et tes parents les lisent. Je ne crois pas te donner de mauvais conseils ; je pense parler en ami et selon la raison. Mais tout le monde ne voit peut-être pas comme moi, et, si ce que je suppose plus haut est vrai, je ne dois pas être au mieux avec ta famille. Je suis sans doute pour eux la liaison dangereuse, le pavé jeté sur ton chemin pour te faire trébucher. Tout cela m’afflige excessivement ; mais, je te l’ai déjà dit, je me suis vu si souvent mal jugé, qu’un jugement faux ajouté aux autres ne saurait m’étonner. Reste mon ami, c’est tout ce que je désire.
Un autre passage de ta lettre m’a chagriné. Tu jettes, me dis-tu, parfois tes pinceaux au plafond, lorsque ta forme ne suit pas ton idée. Pourquoi ce découragement, ces impatiences ? Je les comprendrais après des années d’étude, après des milliers d’efforts inutiles. Reconnaissant ta nullité, ton impossibilité de bien faire, tu agirais sagement alors en foulant palette, toile et pinceaux sous tes pieds. Mais toi qui n’as eu jusqu’ici que l’envie de travailler, toi qui n’as pas encore entrepris ta tâche sérieusement et régulièrement, tu n’es pas en ton droit de te juger incapable. Du courage donc ; tout ce que tu as fait jusqu’ici n’est rien. Du courage, et pense que, pour arriver à ton but, il te faut des années d’étude et de persévérance. — Ne suis-je pas dans le même cas que toi ; la forme n’est-elle pas également rebelle sous mes doigts ? Nous avons l’idée ; marchons donc franchement et bravement dans notre sentier, et que Dieu nous conduise ! — D’ailleurs, j’aime ce peu de confiance en soi. Vois Chaillan, il trouve tout ce qu’il fait excellent ; c’est qu’il n’a pas en tête un mieux, un idéal qu’il tâche d’atteindre. Aussi ne s’élèvera-t-il jamais, parce qu’il se croit déjà élevé, parce qu’il est content de lui.
Tu me demandes des détails sur ma vie matérielle. J’ai quitté les Docks ; ai-je bien fait, ai-je mal fait ? question relative, et selon les tempéraments. Je ne puis répondre qu’une chose : je ne pouvais plus y rester, et j’en suis sorti. — Ce que je pense faire, je te le dirai plus tard, lorsque j’aurai mis à exécution. — Pour l’instant, voici ma vie : nous avons commencé le tableau d’Amphyon dans ma petite chambre du septième, un paradis orné d’une terrasse, d’où nous découvrons tout Paris, une retraite tranquille et pleine de soleil. Chaillan vient sur les une heure. Pajot, jeune homme dont je t’ai parlé, ne tarde pas à le suivre ; nous allumons nos pipes, si bien qu’au bout de quelque temps nous ne nous voyons plus à quatre pas. Je ne te parle pas du bruit ; ces messieurs dansent et chaulent, et, ma foi, je les imite. Je parie que lu cherches déjà les verres et les bouteilles ; lu as pardieu raison, les voici sur le coin de mon bureau, pleins d’un certain vin blanc que l’on nomme du Saint-Georges, lequel vin ressemble assez au vin cuit, et par son goût délicieux et par sa traîtrise. Le filou a surpris avant-hier Chaillan à l’improviste, et l’a si bien étourdi d’un coup lâchement asséné, que le brave garçon peignait chaque mouche qui passait, et fumait son amadou à effacer, jurant qu’il fumait un excellent tabac. Moi, je pose à moitié nu ; la chose a ses désagréments, mais, au fond, c’est le sublime du spectacle. Pajot écrit sous ma dictée des vers qui me passent par la tête, tantôt bouffons, tantôt sérieux, éclos sous l’encens de nos pipes, au milieu des tintements des verres. C’est une véritable tabagie, un tableau qui n’a pas de nom ; je ne regrette qu’une chose, c’est que tu ne sois ici pour rire avec nous. — Le matin, j’écris toujours un peu ; le soir, après la séance, je lis quelques vers de Lamartine, ou de Musset, ou de V. Hugo. Telles s’écoulent mes journées ; je m’ennuie beaucoup moins que cet hiver, et pourtant ce n’est pas encore là le genre d’existence que je rêve. Le tumulte n’est bon qu’à ses heures ; toujours chanter, toujours rire, cela fatigue. Je ne travaille pas assez, et je m’en veux. Si tu viens à Paris, nous tâcherons de régler notre journée de façon à bûcher le plus possible, sans cependant oublier la pipe, ni le verre et la chanson.
Amphyon, sous le pinceau de Chaillan, prend assez la tournure d’un singe en mauvaise humeur. Tout bien considéré, je désespère plus que jamais de ce garçon comme artiste. Fort médiocre copiste, dès qu’il lui faut inventer il est complètement mauvais. C’est un bon enfant, et ce ne sera jamais rien de plus. Il travaille beaucoup, peine, prépare, je crois : j’ai, en l’écrivant, un triste échantillon de ses progrès sous les yeux. — Je t’envoie à la page suivante une de ces poésies dont je parlais tantôt, faite au milieu du bruit, et écrite, faute de papier, sur le mur de ma chambre.
Je viens de recevoir une lettre de Baille. Je n’y comprends plus rien ; voici une phrase que je lis dans cette épître : « Il est presque certain que Cezanne ira à Paris : quelle joie ! » Est-ce d’après toi qu’il parle, lui as-tu véritablement donné cette espérance dernièrement, lorsqu’il s’est rendu à Aix ? Ou bien a-t-il rêvé, s’est-il pris à croire réel ton désir seul ? Je te le répète, je n’y comprends plus rien. Je t’engage à me dire dans ta première lettre les choses franchement ; depuis trois mois, je suis à me dire successivement et selon les lettres que je reçois : il viendra, il ne viendra pas. — Tâchons, pour Dieu ! tâchons de ne pas imiter les girouettes. — La question est trop importante pour passer du blanc au noir ; là, franchement, où en sont tes affaires ?
Je ne t’envoie pas les vers qui précèdent comme quelque chose de sublime. Ils remplissent ma lettre, et rien de plus.
Mon voyage est toujours fixé au 15 septembre. Nous irons tous deux jusqu’à Trets, à pied, bien entendu ; Chaillan le demande à grands cris.
J’attends Houchard. À bientôt.
Mes respects à tes parents. Je te serre la main.
Ton ami,
Émile Zola.
À quand ton examen ? l’as-tu passé ? le passeras-tu ? Dis à Marguery que je ne l’oublie pas, que mon silence n’est dû qu’au manque de matières. Je lui écrirai cependant bientôt. »
1. Le voyage de Zola à Aix fut d’abord reporté d’août à la mi-septembre, mais finalement n’eut pas lieu, probablement faute d’argent.
25 juillet
Lettre de Zola à Baille.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 92-106.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 27, p. 202-211.« Paris, 25 juillet 1860.
Mon cher Baille,
Je m’étais promis de ne plus revenir sur notre dernière discussion ; mais la lettre que je reçois m’oblige à me parjurer.
Je suis peiné de la façon dont tu as pris mes paroles. Moi, te traiter de crétin ! N’as-tu pas rêvé ? Serai-je ton ami, te dirai-je toutes mes pensées, ces pensées que je cache de peur qu’on en rie ? Mon talent d’observation est peut-être médiocre, cependant jette un regard sur ceux que j’aime, et tu verras que j’ai trié de la foule les plus grands cœurs, les plus grandes intelligences. Paul, dont le caractère est si bon, si franc, dont l’âme est si aimante, si tendrement poétique ; toi, l’énergique, l’opiniâtre, qui aime comme il travaille, toi la belle intelligence qui n’a pas la petitesse de dédaigner l’étude parce que l’étude lui est facile. Puis, en descendant, Houchard que j’ai vu à l’œuvre, ami sur les bras, sur la bourse duquel on peut compter à toute heure, en tout lieu ; Marguery, le naïf, l’excellent garçon, médiocre, il est vrai, sous bien des rapports, mais qui n’en sort pas moins du vulgaire. Je pourrais encore te citer Pajot, jeune Parisien que tu connaîtras sans doute à l’école, imagination poétique, mais sans goût, intelligence supérieure. — Et je ne vante personne ; certes, vous avez vos défauts, mais, je l’affirme, ce sont là vos qualités. — Ceux que j’appelle du nom d’amis doivent donc en être fiers, non à cause de moi, mais à cause de ceux qui m’entourent, non pour mon faible mérite, mais pour les mérites que je trouve en eux. […]
Et moi je disais naguères, — pardon de me citer après un grand poète, — dans une épître adressée à Cezanne :
Allez, allez, mes vers ! bons ou mauvais, qu’importe !
Si du monde idéal vous m’entr’ouvrez la porte,
Si vos grelots bruyants me rappellent parfois
Le bal mystérieux des sylphides des bois.[…] Dans ma dernière lettre, celle que je crois perdue, je te demandais plusieurs choses. Des nouvelles d’Aix, dont Cezanne s’obstine à ne point me parler ; … »
Juillet
Lettre de Zola à Baille (voir plus bas, fin août-début septembre).
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 108 les Cahiers Rouges.
« [Paris,] juillet 1860.
[…] Quant à l’avenir, je ne sais ; si je prends définitivement la carrière littéraire, j’y veux suivre ma devise : Tout ou rien !
[…] Une charmante expression trouvée dans une Lettre de Cezanne : « Je suis en nourrice chez les illusions. » »
1er août
Lettre de Zola à Cezanne.
Il évoque un petit poème de Cezanne qu’il lui avait envoyé, sur Hercule à la croisée des chemins « entre le vice et la vertu ». « Que manque-t-il, se demande Zola, à ce brave Cezanne, pour être un grand poète ? La pureté. » Ce poème, qui semble avoir été d’une tenue plus sérieuse que les autres que Cezanne avait envoyés à Zola, est perdu, inspiré d’un thème classique tiré de ses lectures de Xénophon ou Cicéron, sur Hercule confronté au choix entre le chemin laborieux de la vertu et celui avilissant de la volupté.
Xénophon, Entretiens mémorables de Socrate, livre II, chapitre 1, 21-34. Cicéron, De Officiis, livre I, 32, 118.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 242-248.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 29, p. 216-220.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 87-89 :« Paris 1er août 1860.
Mon cher Paul,
En relisant tes lettres de l’année dernière, je suis tombé sur le petit poème d’Hercule, entre le vice et la vertu ; pauvre enfant égaré, que tu as oublié sans doute, et qui était également sorti de ma mémoire. Je ne sais, j’ai ressenti un grand plaisir à cette lecture ; divers passages, quelques vers isolés m’ont plu infiniment. Toi-même, j’en suis persuadé, si tu les parcourais, tu t’étonnerais, tu te demanderais si c’est bien toi qui as écrit cela. — C’est, d’ailleurs, l’effet que me font à moi-même les hémistiches perdus que je retrouve parfois sur mes vieilles paperasses. — Je dis donc que ces vers oubliés m’ont semblé meilleurs que jadis, et le front dans la main, je me suis mis à réfléchir. Que manque-t-il, me suis-je dit, à ce brave Cezanne, pour être un grand poète ? La pureté. Il a l’idée ; sa forme est nerveuse, originale, mais ce qui la gâte, ce qui gâte tout, ce sont les provençalismes, les barbarismes, etc. — Oui, mon vieux, plus poète que moi. Mon vers est peut-être plus pur que le tien, mais certes, le tien est plus poétique, plus vrai ; tu écris avec le cœur, moi, avec l’esprit ; tu penses fermement ce que tu avances, moi, souvent, ce n’est qu’un jeu, un mensonge brillant. Et ne crois pas que je plaisante ici ; ne crois pas surtout que je te vante ou que je me vante moi-même ; j’ai observé, et je te communique le résultat, rien de plus. — Le poète a bien des manières de s’exprimer : la plume, le pinceau, le ciseau, l’instrument. Tu as pris le pinceau, et tu as bien fait : on doit descendre sa pente. Je ne veux donc pas te conseiller maintenant de prendre la plume et, laissant la couleur, travailler le style ; pour faire une chose bien, il faut faire une seule chose. Seulement, permets-moi de pleurer sur l’écrivain qui meurt en toi ; je le répète, la terre est bonne et fertile ; un peu de culture, et la moisson devenait splendide. Ce n’est pas que tu ignores cette pureté dont je te parle ; tu en sais peut-être plus que moi. C’est qu’emporté par ton caractère, chantant pour chanter, peu soucieux, tu te sers des plus bizarres expressions, des plus drolatiques tournures provençales. Loin de moi de t’en faire un crime, surtout dans nos lettres, au contraire, cela me plaît. Tu écris pour moi, et je t’en remercie ; mais la foule, mon bon vieux, est bien autrement exigeante 1; il ne suffit pas de dire, il faut bien dire. Maintenait, si c’était un crétin, une croûte qui m’écrive, que m’importerait que sa forme fût aussi déguenillée que son idée. Mais toi, mon rêveur, toi, mon poète, je soupire quand je vois si pauvrement vêtues tes pensées, ces belles princesses. Elles sont étranges, ces belles dames, étranges comme de jeunes bohémiennes au regard bizarre, les pieds boueux et la tête fleurie. Oh ! pour ce grand poète qui s’en va, rends-moi un grand peintre, ou je t’en voudrai. Toi qui as guidé mes pas chancelants sur le Parnasse, toi qui m’as soudain abandonné, fais-moi oublier le Lamartine naissant par le Raphaël futur. — Je ne sais trop où je suis. Je voulais te rappeler en deux lignes ton ancien poème, et t’en demander un nouveau plus pur, plus soigné. Je voulais te dire que je ne me contentais pas des quelques vers que tu m’envoies dans chaque lettre ; te conseiller de ne pas quitter entièrement la plume, et, dans tes moments, de me parler de quelque belle sylphide. Et voilà — je ne sais trop pourquoi — que je me perds, que je dépense futilement le papier. Pardonne-moi, mon vieux, et contente-moi ; parle-moi de l’Aérienne, de quelqu’un, de quelque chose, en vers, et longuement. Bien entendu, après ton examen, et sans entraver en rien tes études au musée.
Le temps est déplorable ; de l’eau, de l’eau, puis encore de l’eau. Quelqu’un a dit spirituellement que l’hiver était venu passer l’été à Paris. Le fait est qu’en écrivant cette lettre, je vois, de ma fenêtre, les fiacres se cahoter dans les ruisseaux, éclaboussant chacun ; les grisettes sauter de pavé en pavé, sur la pointe des pieds, effarées, relevant leurs jupes ; la foule se précipiter, les parapluies s’agiter lourdement comme d’énormes phalènes ; et la pluie, railleuse, insolente, fouetter au visage le noble comme le vilain, la jolie fille comme la laide, l’aveugle comme son chien. Spectacle de fraternelle égalité qui me fait rire parfois, j’aime — est-ce instinct du mal ? — j’aime voir patauger les sots, les épiciers dans la boue. — Puis, les jolies choses qu’un jour de pluie vous fait voir ; la jambe fine et ronde, qui craint le soleil, se montre hardiment ; plus l’averse est forte, plus les jupes remontent, on aime mieux — c’est au moins étrange — tacher un bas blanc bien propre, bien tiré, qu’un vieux jupon de couleur ; certes, c’est un goût que je ne blâme pas, ô jeunes filles, relevez, relevez ces voiles incommodes ; si le jeu vous en plaît, il me plaît davantage. — N’importe, ce ciel gris m’attriste, m’indispose. Je suis boudeur, rechigné comme lui ; je sors encore moins, je m’ennuie, je bâille. Que Dieu m’envoie, avec un rayon de soleil, un rayon de joie et d’espérance.
J’ai reçu ta lettre ce matin. — Permets-moi de te dire mon avis sur les sujets que vous avez discutés, toi et Baille. — Je dis également comme toi, que l’artiste ne doit pas remanier son œuvre. Je m’explique : que le poète, en relisant son œuvre entière, retranche un vers par-ci, par-là, qu’il change la forme sans changer l’idée, je n’y vois pas de mal, je crois même que c’est une nécessité. Mais qu’après coup, des semaines, des mois, des années écoulées, il bouleverse son œuvre, abattant ici, reconstruisant plus loin, c’est selon moi une sottise et du temps perdu. Outre qu’il détruit un monument portant en quelque sorte le cachet de son époque, il ne fait jamais d’une pièce médiocre, mais originale, qu’une pièce tiraillée, froide. Que n’emploie-t-il plutôt ces longues heures d’une stérile correction à composer un nouveau poème, où son expérience acquise fera merveille. Pour ma part, j’ai toujours mieux aimé écrire vingt vers que d’en corriger deux ; c’est un travail des plus ingrats et que je soupçonne fort d’être contraire au développement de l’intelligence. D’ailleurs, où en serions-nous s’il fallait toujours corriger les défauts que le temps nous montre dans nos œuvres ? Chaque édition différerait de la précédente ; ce serait une Babel inextricable et la pensée passerait par tant de formes qu’elle changerait du blanc au noir. Ainsi donc, je suis complètement de ton avis : travaillez avec conscience, faites le mieux que vous pourrez, donnez quelques coups de lime, pour mieux ajuster les parties et présenter un tout convenable, puis abandonnez votre œuvre à sa bonne ou à sa mauvaise fortune, ayant soin de mettre au bas la date de sa composition. Il sera toujours plus sage de laisser mauvais ce qui est mauvais et de tâcher de faire meilleur sur un autre sujet. — Comme toi, je parle ici pour l’artiste en général : poète, peintre, sculpteur, musicien.
Quant au début d’un poète, je goûte l’idée de Baille. Il serait naïf de dire qu’il vaut mieux publier en premier un chef-d’œuvre qu’un livre médiocre ; c’est d’une complète évidence. D’ailleurs, si Baille pensait comme moi, en avançant cet avis, qu’il se rassure. Je sais bien que je patauge encore, que je ne suis pas mûr, que je cherche ma voie. D’un autre côté, je suis ignorant de tout, de la grammaire comme de l’histoire. Ce que j’ai fait jusqu’ici n’est pour ainsi dire qu’un essai, qu’un prélude. Je compte rester longtemps encore sans rien publier, me préparer par de fortes études, puis donner leur essor aux ailes que je crois sentir battre derrière moi. Certes, ce sont là de beaux rêves, et je ne les dis qu’à vous, pour que, si je tombe, ma chute soit moins ridicule et moins retentissante. N’importe, rêvons toujours, cela ne fait de mal à personne et sert de consolation. — J’aime la poésie pour la poésie et non pour le laurier ; personne ne comprend mes rêves, la plume et le papier sont mes confidents ; j’aime mes vers comme des amis qui pensent comme moi, je les aime pour eux, pour ce qu’ils disent. Non pas que je fasse fi de la gloire ; l’immortalité est une sublime ambition. Mais je pense avec Baille qu’il faut laisser mûrir le fruit avant de le cueillir, le laisser dorer par le soleil et se satiner sous les gouttes de rosée. — Attendons : qui vivra verra. Et je dis cela pour toi comme pour moi.
Baille, me dis-tu encore, regarde l’art comme un sacerdoce : c’est penser en poète. Oui, l’art est un culte, le culte du bon, du beau, de Dieu lui-même. Sous les vers il y a l’âme, comme le visage sous le masque. Alexandrin, hémistiche, rime, voilà la matière, voilà l’outil dont toute main peut se servir ; mais planant au-dessus de ces moyens grossiers, il y a l’Idée, fécondée par le cœur ; l’Idée, ce don céleste, cette empreinte du doigt de Dieu. Aussi, comme tu l’ajoutes, on n’admet pas tout le monde à l’adoration de l’Idole ; moi, j’aurais peut-être dit de Dieu, car poésie et divinité sont synonymes à mes yeux. Après avoir mis si haut le poète, je n’oserai te dire que je le suis ; mais, en toute sincérité, je puis avancer que je tâche de l’être et que je comprends la sublimité à laquelle je tends, ce que ne fait pas le vulgaire qui ne voit dans un poète qu’une machine à césures et à rimes. — Quant au profit qu’on peut retirer d’un ouvrage, je suis en désaccord avec Baille. Je ne veux pas que l’on fasse une œuvre en vue de la vendre, mais une fois faite, je veux qu’on la vende ; puisque le poète n’est pas soutenu par la société, comme le prêtre par exemple, puisque Hégésippe Moreau et, avant lui, Gilbert sont morts à l’hôpital, presque de faim, je veux qu’il s’assure du pain par son travail ; ce qui n’a rien que d’honorable. D’ailleurs, l’éditeur vend l’œuvre au libraire, le libraire au public ; il n’y aurait donc que le pauvre poète qui mourrait de famine, lui qui fait vivre tous ces gens-là. Ce ne serait ni sage, ni logique. Maintenant, qu’un romancier ne s’attèle pas à sa plume, comme un bœuf à sa charrue ; qu’il n’écrive pas à tant la ligne, comme Ponson du Terrail par exemple. Cet homme est un commerçant et non un littérateur ; c’est le menuisier du coin, plus il fait, plus il gagne. — Faites donc votre poème, votre roman en artiste consciencieux, mettez-y deux ans s’il le faut, ne pensez pas à l’argent et que cette pensée ne vienne pas entraver celle de l’art ; mais, que diable ! quand vous aurez bien travaillé, vendez votre ouvrage et ne commettez pas une folle générosité dont au reste on ne vous saurait aucun gré. — L’idée de Baille était peut-être celle-ci : le débutant, celui qui n’a pas de nom, ne doit pas chercher à faire de l’argent de ses ouvrages, maigre marchandise, d’ailleurs ; il ne doit pas prostituer l’art ; qu’il gagne plutôt sa nourriture à l’aide d’un métier manuel, puis, qu’il place dignement ses jeunes poèmes, attendant d’être célèbre et de jouir de la position que les lecteurs doivent à tout grand poète. Je suis alors complètement de son avis, plus même qu’il ne pense, l’avenir t’apprendra ce que je veux dire ici.
Quant à la grande question que tu sais, je ne puis que me répéter, te donner les conseils déjà donnés. Tant que deux avocats n’ont pas plaidé, la cause en est toujours au même point ; la discussion est le flambeau de toute chose. Si donc tu restes silencieux, comment veux-tu avancer et conclure ? c’est matériellement impossible. Et remarque que ce n’est pas celui qui crie le plus fort qui a raison ; parler tout doucement et sagement ; mais par les cornes, les pieds, la queue, le nombril du diable, parle, mais parle donc !!!…
Baille ne devant être libre que le 25 septembre, je n’irai jamais à Aix que le 15 du même mois, c’est-à-dire dans environ six semaines. Nous aurons ainsi une semaine à passer seuls ensemble ; je désire beaucoup marcher et escalader les rochers ; d’ailleurs, nous babillerons et nous fumerons à qui mieux mieux. — J’ai écrit à Houchard.
Mes respects à tes parents.
Je te serre la main. — Ton ami,
Émile Zola. »
1. Cette épître étrange était due sans doute au désir de Zola de prouver à Cezanne qu’il était en tout cas un artiste-né. Cependant, il est certain que le peintre se souciait fort peu des exigences de la foule et ne prenait pas ses produits poétiques trop au sérieux. D’autre part, il était évidemment plus facile à Zola d’analyser le talent littéraire de son ami que d’apprécier ses efforts picturaux.
Dans « Rolla », Musset avait repris le mythe d’Hercule à la croisée des chemins.
de Musset Alfred, « Rolla », Poésies nouvelles, Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 1850, réédition 1852, 298 pages, p. 7 :
« Hercule, fatigué de sa tâche éternelle,
S’assit un jour, dit-on, entre un double chemin.
Il vit la Volupté qui lui tendait la main :
Il suivit la Vertu, qui lui sembla plus belle.
Aujourd’hui rien n’est beau, ni le mal ni le bien.
Ce n’est pas notre temps qui s’arrête et qui doute ;
Les siècles, en passant, ont fait leur grande route
Entre les deux sentiers, dont il ne reste rien. »
10 août
Lettre de Zola à Baille, Paris, 10 août 1860.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 121-136, 346 pages, p. 135. Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 30, p. 221-228.
« Il m’est échappé une faute grossière dans mon Paolo, que Cezanne me dit t’avoir remis. »
[Fin août – début septembre]
Zola projette de fonder à Paris une « société artistique » avec Cezanne, Baille et Pajot, son condisciple du lycée Saint-Louis, afin « de former un puissant faisceau pour l’avenir, nous soutenir mutuellement, quelle que soit la position qui nous attende ».
Lettre de Zola à Baille.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 106-114, lettre datée juillet 1860.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 31, p. 230-234.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 87.« […] Quant à l’avenir, je ne sais ; si je prends définitivement la carrière littéraire, j’y veux suivre ma devise : Tout ou rien ! Je voudrais par conséquent ne marcher sur les traces de personne ― d’ordinaire un tel homme est toujours systématique ― mais je désirerais trouver quelque sentier inexploré, et sortir de la foule des écrivassiers de notre temps.
[…] Il m’est poussé ces jours derniers une certaine idée dans la tête. C’est de former une société artistique, un club, lorsque tu seras à Paris, ainsi que Cezanne. Nous serons quatre fondateurs, vous deux, moi, Pajot, jeune homme pour lequel je te demande ton amitié. Nous serons excessivement difficiles pour recevoir de nouveaux membres ; ce ne serait qu’après une longue connaissance et du caractère et des opinions que nous les accepterions dans notre sein. Nos réunions hebdomadaires, par exemple, seraient employées à se communiquer les uns aux autres les pensées que l’on aurait eues, les remarques que l’on aurait faites durant la semaine ; les arts seraient, bien entendu, le grand sujet de conversation, bien que la science n’en soit nullement exclue. Le but surtout de cette association serait de former un puissant faisceau pour l’avenir, de nous soutenir mutuellement, quelle que soit la position qui nous attende. Nous sommes jeunes, l’espace est à nous, ne serait-il pas sage avant de nous élancer de nous serrer la main, de former un nouveau lien entre nous, pour qu’une fois dans la lutte nous sentions à nos côtés un ami, ce rayon d’espoir dans la nuit humaine. Outre cet avantage futur, nous aurions celui de passer une agréable journée, chaque semaine, de vivre et de fumer quelques bonnes pipes.
— Si tu le désires, nous reparlerons de vive voix sur ce projet.
Cezanne a dû te parler de Chaillan, du fameux Amphyon qu’il a gâché d’après mon académie. Ce Chaillan est un garçon fort curieux, bon homme au fond, mais d’une surface tellement dépolie qu’on ne peut le prendre d’aucun côté sans éprouver un désenchantement. Il n’est pas fat, et c’est là ce qui fait que je l’aime presque ; s’il n’a pas de talent, au moins ne s’en croit-il pas, ce qui le rend très supportable. J’aime mieux aussi me promener avec lui qu’avec un Marguezi ; et il est pourvu de plus d’une certaine dose de bon sens qui fait qu’on l’écoute sans déplaisir. C’est le seul être avec Pajot que je fréquente ici ; nous avons vidé et nous vidons encore maintes bouteilles de vin blanc, voire de Champagne ; nous fumons, nous rions et une heure se passe sans trop d’ennui.
[…] Une charmante expression trouvée dans une lettre de Cezanne : « Je suis en nourrice chez les illusions. » »
21 septembre
Lettre de Zola à Baille.
Malgré le grand désir qu’a Zola de venir à Aix passer une quinzaine de jours de vacances, il prévient Baille qu’il n’est pas certain d’y parvenir.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 136-140.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 33, p. 237-239.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 89.« Paris, 21 septembre 1860.
Mon pauvre vieux,
J’ai reçu ta lettre avant-hier matin et, dans l’espérance de te donner une réponse décisive, j’ai attendu jusqu’à ce jour. Je me décide enfin à t’écrire, bien que mon voyage ne soit pas encore certain et que je ne puisse t’en fixer la date. Tu dois en être persuadé : les obstacles ne dépendent nullement de moi, ma volonté n’y est pour rien, et je désire peut-être plus que toi d’aller m’égayer quelque temps, sous votre beau ciel. Si je pouvais partir aujourd’hui, je partirais ; je travaille du bec et des ongles pour aller vous serrer la main, et si vous ne me voyez pas venir, dites-vous que j’ai tout fait et que rien n’a réussi. D’ailleurs, j’espère fortement et, si je ne craignais de vous causer une fausse joie, je vous dirais de compter sur ma venue. Tout ce que je redoute, c’est un retard plus ou moins long, c’est de laisser passer les jours de vacances. Écris-moi donc la date de votre rentrée, combien tu comptes passer de temps à Aix, afin que je fixe le dernier jour possible de mon départ. Je pense rester au moins quinze jours auprès de vous, et tant que tu auras ce laps de temps libre, je ne désespère de rien. Je ne saurai trop me plaire à te le répéter : pour moi, mon voyage est presque une certitude. Vous pouvez chaque jour recevoir une lettre vous annonçant définitivement ma venue. Mais ce qui me désespère aujourd’hui, ce qui nous chagrine, vous et moi, c’est de ne pouvoir vous dire : allez tel jour m’attendre à la gare. N’importe, tâchons de tuer le temps en attendant cette bienheureuse lettre que j’aurai autant de plaisir à vous écrire que vous à la recevoir. Écris-moi au plus tôt ce que je te demande : la durée de ta liberté. Ta lettre me trouvera encore à Paris, et dans le cas contraire, que vous importe.
Dis à mon vieux Cezanne que je suis triste et que je ne saurais répondre à sa dernière épître ; cette lettre est pour vous deux. Il est presque inutile qu’il m’écrive, jusqu’à ce que la question du voyage soit résolue. Qu’il attende une lettre de moi, soit pour lui annoncer nos longues causeries, soit pour lui dire de reprendre notre banale conversation écrite.
[…] Buvez et riez, mes bons amis. J’ai tant de choses à vous dire, à vous demander : mes projets, les vôtres. J’ai tant de choses à voir : les panneaux de Paul la moustache de Baille. Puis, d’ailleurs, n’est-ce donc rien que de fumer une pipe près de vous, même sans parler ; d’aller faire quelques lointaines courses, de revoir les objets, les personnes qui me rappellent ma première jeunesse, qui me parlent de vous et de nos rires enfantins ? Je veux aller à Aix ; je le jure sur ma pipe !!! »
Les « panneaux de Paul », sont peut-être ceux qu’il peint pour le salon du Jas de Bouffan, directement sur plâtre. Ces panneaux sont connus par la description qu’en a fait le conservateur du musée national du Luxembourg Léonce Bénédite chargé d’aller les examiner lorsque le propriétaire du Jas de Bouffan proposa, à la mort de Cezanne, de les céder à l’État.
2 octobre
Lettre de Zola à Cezanne et à Baille.
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 140-147.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 34, p. 240-244.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 90.« Paris, 2 octobre 1860.
Mes chers amis,
Puisque vous avez élu domicile cours Sextius, puisque c’est là votre café, votre tabagie, votre tout, je crois donc devoir y adresser mes lettres jusqu’à nouvel ordre. D’autre part, par raison d’économie, la même épître servira pour vous deux : économie de temps, économie d’argent.
Je remets à la fin de cette missive la question voyage. Comme je ne compte vous l’expédier que dans quatre ou cinq jours, j’espère alors pouvoir vous parler avec certitude. Si vous êtes pressés, interrogez donc les dernières lignes.
Je ne veux aujourd’hui que me désennuyer en bavardant un peu avec vous. — Baille me dit quelque part : « Passons le temps en lettres et en souvenirs. » — C’est bien dit et j’applaudis. Dante se trompe lorsqu’il écrit : « Rien n’est plus douloureux qu’un souvenir de bonheur dans un jour de tristesse. » Je lui réponds hardiment : « Rien ne repose mieux le cœur, et rien ne fait mieux briller le sourire parmi les larmes que le parfum du temps passé. » — Vous me prêchez l’économie ; vous souvenez-vous de l’an dernier, lorsque l’argent de Paris se faisait attendre, et que notre demi-tasse et notre partie de dames nous réclamaient au divan. On se cotisait, on finissait toujours par ramasser les quelques misérables sous qui devaient servir à tuer la soirée. Baille tournait à l’économie ; il prétendait comme aujourd’hui faire de nous des thésauriseurs, des avares ; pardonnables et prodigues avares que ceux qu’il rêvait. Mais la franchise avant tout, et je dois déclarer que le péché d’avarice trouvait en lui un terrible adversaire, un autre péché capital, bien gros, bien damnable : la Gourmandise. Il nous débauchait parfois, le saint prédicateur ; t’en souviens-tu, Cezanne ? Il me poussait chez Illy, et t’expédiait chez Leydet ; puis, lorsque tu lui rapportais une fiole d’un liquide quelconque, lorsque je pliais sous une charge de choux à la crème, il se frottait les mains et nous guidait en se léchant les lèvres vers ma mansarde, lieu de nos débauches gastronomiques. Parfois encore, après un long sermon très pathétique, très larmoyant sur l’abstinence, le soir au café, il rêvait une bavaroise, et, sans la commander pourtant, il parlait d’un certain mal de gorge et tâchait de nous apitoyer sur son œsophage irrité. Monstruosité ! une bavaroise ! ce liquide coûtait huit sous et la demi-tasse n’en coûtait que cinq. Et voilà les économies ! voilà les sermonneurs ! en paroles ils boivent de l’eau et mangent du pain bis ; mais en action ils ingurgitent des bavaroises et se bourrent de brioches. — Je me souviens d’un autre méfait de Baille, et puisqu’il est sur le banc des accusés, profitons-en pour faire contre lui un réquisitoire foudroyant, C’était au barrage, le jour de l’agréable hospitalité à nous offerte par messieurs les jésuites ; nous avions emporté, s’il m’en souvient, un gigot d’une certaine encolure. Or donc, nous nous mettons à table, c’est-à-dire sur le gazon, près de la fontaine. Je mange du jambon, puis je cherche le gigot : néant, éclipse totale. Je cherche le gigot de plus en plus introuvable. Enfin, j’entrevis le manche, puis, tout au bout. Baille suspendu encore à quelques lambeaux de chair. Ah ! monsieur l’économe, que vous en avez mangé ce jour-là du mouton ! Dénouement, je conclus qu’un gourmand est l’antipode d’un avare, un économe même est l’antipode de notre ami. Méfies-toi, Cezanne, pendant qu’il te prêchera, il séchera tout doucement les bouteilles, fumera le tabac, et si tu as la bonhomie de prêter les oreilles et les yeux, tu chercheras, après son discours, vainement et tout effaré, les ingrédients indispensables à la vie d’un honnête homme. — Or ça. Baille, mon ami, je veux, en allant à Aix, n’être économe que si j’y suis forcé ; sinon, je te promets des choux et des bavaroises et des gigots, — le tout pour fondre ton éloquence de pédagogue, comme la neige aux rayons de mai. — L’économie est un mythe chez vous et je m’en réjouis. Ne serait-il pas curieux que deux jeunes garçons de vingt ans calculent sou par sou leurs plaisirs. Vive Dieu ! rions aujourd’hui ; demain viendra avec des pleurs ou des sourires, et la grande sagesse est de le prendre tel qu’il se présentera. Voilà, direz-vous, une bien vilaine morale ; mais je la trouve sublime, bien qu’un peu imprudente. Je me rappelle à ce sujet un mot profond de Cezanne. Lorsqu’il avait de l’argent, il se hâtait ordinairement de le dépenser avant de gagner son lit. Interrogé par moi sur cette prodigalité : « Pardieu ! me disait-il, si je mourais cette nuit, voudrais-tu que mes parents héritent ? » — Baille, médite cette pensée profonde, et ne prends mes accusations, mes épithètes et mes railleries que comme le jeu d’un ami qui se berce doucement dans de lointains et joyeux souvenirs.
Marguery est à Paris. J’ai déjà passé deux journées avec ce grand dramaturge, ce célèbre vaudevilliste. Que vous dirai-je que vous ne sachiez déjà. L’enfant grandit, mais ne change que rarement ; notre ancien compagnon est toujours ce garçon excellent, cet impuissant romancier qui s’admire avec tant de bonne foi et de naïveté qu’on ne saurait lui en vouloir. Après vous, je l’estime mon meilleur ami ; je préfère sa naïveté enfantine à la fatuité superbe des De Julienne et des Marquezi. — Nous avons couru ensemble la capitale, ingurgitant çà et là quelques cafés. Puis je l’ai mené à l’administration du Journal du Dimanche, la Provence musicale. Enfin je lui ai lu un proverbe que j’ai écrit cet hiver et dont j’ai dû vous parler. Il a applaudi et m’a conseillé fortement de le présenter au théâtre de l’Odéon. Il est vrai que cela me rapporterait peut-être quelque argent ; mais je ne veux m’y décider qu’après vous avoir consultés, ce que je ne propose de faire si je vais à Aix.
Tu m’assures que Cezanne viendra ici au mois de mars 1. — C’est à Baille que je parle, et non à Paul auquel je me suis promis de ne plus parler de cela. — Puisses-tu dire vrai ; j’ai de longues journées d’ennui. Vous avoir près de moi serait une suprême consolation et un encouragement dans la tâche ardue que je me suis imposée. Je suis pas de ces êtres qui peuvent s’atteler impunément à leur travail comme à une charrue et traîner péniblement la charge imposée. Il me faut des distractions, des rires et du sérieux. Ah ! si vous étiez ici ! Je n’y compte pas, je l’espère ; c’est tout ce que peut dire un homme.
Je reçois à l’instant votre lettre et je reprends ces feuilles, abandonnées et reprises souvent. — Je ne puis que vous remercier des dispositions que vous avez cru bonnes pour notre tableau de famille et les papiers de ma mère. Quand même vous eussiez agi contre mon vouloir, je ne saurais encore que vous en rendre grâce, puisque votre amitié seule vous a conduit. Heureusement que ce déménagement partiel était dans mes vues, et que le plaisir que je trouve à vous voir prendre mes intérêts n’est obscurci par aucun nuage. Merci donc encore une fois. — Quant aux autres objets, misérable mobilier s’il en fût, vous pouvez parfaitement les laisser en place. Ce que vous avez enlevé m’est cher et je n’aurais voulu aucunement les laisser aux hasards des événements et aux mains crochues dont parle Cezanne. Mais le reste, je le livre de bon cœur aux vautours et aux tigres ; je le répète, ne touchez plus à rien.
D’ailleurs, j’ai un reproche à vous faire. Vos lettres sont obscures et je ne saurais y trouver rien de certain. Vous m’accusiez naguère de manquer de franchise, je puis vous renvoyer ce reproche avec plus de droit. Quels sont les objets disparus ? Quelles sont les personnes que vous soupçonnez ? Si vous avez pris cette mesure extrême de me déménager sans que j’en aie manifesté le désir, il est logique de penser que vous y avez été poussés par de graves événements. Mais, encore une fois, quels sont ces événements ? Craindriez-vous par hasard de m’offenser en me les racontant ? Dites toujours, mes pauvres amis, je commence à connaître le monde et, si rien ne m’étonne de la part des autres, rien ne m’offense de la vôtre. — Ainsi donc dans votre prochaine lettre, soyez explicites pour que je puisse remédier au mal s’il en est temps encore.
Cezanne a la clef de la maison ; qu’il la garde religieusement et tâche de faire oublier qu’il l’a en son pouvoir. Si même on la lui demandait, n’importe qui, qu’il la refuse tout net et dise, s’il veut se débarrasser, qu’il l’a égarée. Enfin, pour dernière recommandation, je vous dirai d’aller le moins possible à ma mansarde, de ne point vous en occuper et de laisser les choses en repos jusqu’au jour de mon arrivée — si ce jour doit luire toutefois. — Quant à mes cachets, soyez sans inquiétude. Ce sont de ces choses que je n’oublie pas et auxquelles je remédie longtemps à l’avance.
Maintenant reste à parler de la probabilité de mon voyage. Baille m’a écrit qu’il devait rester jusqu’aux premiers jours de novembre. Ainsi donc, voulant passer quinze jours près de vous, rien ne sera désespéré jusqu’au 15 octobre. Mon voyage n’est pas qu’un voyage d’agrément, j’ai certaines affaires qui réclament ma présence à Aix et qu’il serait trop long de vous expliquer ici ; c’est ce qui me fait encore espérer fortement de vous voir. — La proposition de Baille me prouve son affection et je l’en remercie ; mais je ne saurais l’accepter et lui-même dirait comme moi si je pouvais lui expliquer mes raisons. J’aurais toujours grand plaisir à passer une nuit avec lui, à déjeuner parfois à sa table, mais m’installer dans sa maison, que dis-je, dans la maison de ses parents, c’est-à-dire une maison où doit venir une foule de personnes, je ne puis y songer, sans songer en même temps aux bonnes langues d’une ville de province. D’ailleurs, si je pouvais me décider à devenir ainsi parasite, croyez-vous que cela allégerait beaucoup ma bourse. En allant à Aix, il me faut emporter une forte somme et ce n’est pas cent francs qui l’augmenteraient de beaucoup. — D’ailleurs nous serons économes c’est entendu. Aussi, lorsque vous aurez la gracieuseté de m’inviter à dîner, j’accepterai de grand cœur ; seulement vous accepterez de même mes invitations.
Je ne saurais trop le répéter, vos lettres m’ont causé une grande joie. J’y lis votre bon cœur et je vous remercie de nouveau de tout ce que vous faites et pensez pour moi, quand bien même votre amitié vous aveugle.
Tâchons donc d’être clair et de ne pas vous donner un désespoir ou une espérance inutile. Rien ne dit encore que mon voyage ne se fera pas : espérons jusqu’au 15 courant. Cette date passée, ne comptez plus sur moi. Nous tâcherons de nous en consoler, comme dit Cezanne, en songeant à notre prochaine réunion et au malheur de ces amis qui sont séparés pour jamais.
Je vous écrirai prochainement et vous enverrai sans doute un conte badin que je termine : il est un peu grivois, mais qu’importe ! Quant à vous, écrivez-moi plus souvent que vous ne le faites, et surtout pas de bégueulerie, soyez francs avant tout. — Pour moi, je compte vous expliquer ma position et mes projets de vive voix, et, si je ne le puis, de le faire plus tard par lettre. Je suis jeune, l’avenir est à moi et je n’ai qu’à avoir du courage pour parvenir.
Buvez et fumez à mon intention. Riez surtout, s’il est possible. Rabelais dit que le rire est le propre de l’homme ; suivez donc les préceptes de ce maître passé en joyeuseté.
À bientôt sans doute. Mes respects à vos parents.
Je vous serre la main. Votre ami.
Émile Zola.
On prie Baille d’écrire un peu plus lisiblement. — Vous avez de la bien belle cire bleue, messieurs les économes, et sans doute elle doit coûter gros. — Je ne sais trop comment j’écris.
Je suis en train d’apprendre la pâtisserie et la cuisine, le tout pour concilier l’économie que Baille prêche et ne pratique pas et la gourmandise qu’il pratique et ne prêche pas. J’ai la recette d’un certain punch aux œufs dont vous me direz des nouvelles. — Ne faut-il pas savoir un peu de tout ici-bas ? »
1. Il s’agit de mars 1861.
Sauveur Marquezi, né à Aix le 25 décembre 1839, a obtenu son baccalauréat en 1857.
Octobre
Cezanne et Baille prennent l’initiative de déménager des papiers, des meubles et un tableau, appartenant à la famille Zola, laissés dans leur appartement du cours Grillaud, pour les mettre à l’abri des créanciers.
Lettres de Zola à Baille, [fin août-début septembre 1860] et 2 octobre 1860 ; Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 31, 34, p. 233, 242-243.
Dans le recensement de l’année, Cezanne habite toujours avec sa famille 14, rue Matheron. Il est inscrit comme commis.
Recensement FI ART 19, 1860, Archives communales d’Aix-en-Provence.
Vers le 10 octobre
Zola écrit à Jean-Baptistin Baille et Cezanne.
Lettre de Zola à Jean-Baptistin Baille et Paul Cezanne, vers le 10 octobre 1860, archives familiales ; Mitterand Henri, Zola, tome I, « (1840-1871) », Paris, Fayard, 1999, 943 pages, p. 841-843.
« Je désirais vous envoyer quelques vers et j’ai choisi la plaisanterie précédente [« Le Diable boiteux »] de préférence à de longues jérémiades. D’ailleurs ne vous y trompez pas, il y a plus de mérite peut-être dans le vers léger et fin de La Fontaine que dans l’emphase de Lamartine ; il est plus facile de pleurer sur des blessures plus ou moins vraies que de rire franchement de ce bon rire gaulois de nos pères. Aussi n’ai-je jamais ressenti plus profondément mon peu de mérite littéraire qu’en écrivant le conte que je vous envoie. J’ai reconnu combien ce genre dont on fait fi demande de talent et de finesse pour être au moins supportable. C’est vous dire que je suis loin de penser avoir composé un chef-d’œuvre ; si mon projet était de publier des contes par la suite — ce qui n’est pas — j’aurais encore, je le reconnais hautement, de longues études à faire. — Quant à cet essai, prenez-le comme il vous vient, joyeux éclat de rire pendant un jour de pluie.
O mon pauvre Cezanne, Baille prétend que nous ne comprenons pas la plaisanterie, et le voilà lui-même qui se met martel en tête sur quelques souvenirs du bon vieux temps. Il affirme que je l’ai traité d’avare et de gourmand, et je me souviens, moi, que j’ai déclaré qu’il n’était ni l’un ni l’autre, puisque l’avarice chez lui combattait la gourmandise et que les deux défauts se neutralisaient ainsi mutuellement. D’ailleurs c’est bien vieux tout cela, j’aime à croire qu’il est devenu parfait.
Parfait ! cela ne vous fait-il pas sourire ? Pour moi, la perfection est chose si monstrueuse qu’un homme parfait ne sera jamais mon ami — Les mots sont très élastiques et ont le sens qu’on veut y trouver. Je laisse courir ma plume follement et sans trop peser les expressions. Je conjure Baille de lire mes lettres de même, et de prendre toujours le sens qui saute aux yeux, sans chercher des subtilités là où il n’y en a pas. Qu’il relise donc ma dernière lettre ; il y trouvera sans doute des paradoxes, des pointes émoussées, du verbiage comme il le dit lui-même ; mais je le défie d’y rencontrer ce qu’il appelle des railleries amères et des dures vérités. D’ailleurs si je commettais un de ces crimes ce serait le plus innocemment du monde, sans le savoir et la plupart du temps pour vous faire rire ou pour m’égayer moi-même. — Vive Dieu ! bois un coup, mon cher et antique Baille ; et prends tout ce que je dis comme les paroles d’un rêveur qui t’estime, qui t’aime, et qui par là-même garde son franc-parler avec toi.
Vous me racontez un long et périlleux voyage dont on pourrait faire facilement une nouvelle, genre Méry. J’aime beaucoup Cezanne en chemise dans le corridor, guettant la belle Charlotte et forcé de disparaître au moindre bruit de pas : cette façon de faire le pied de grue est tout à fait neuve et serait d’un effet saisissant. La vengeance sur les souliers du marchand de chapelets est aussi entièrement inédite et d’une couleur italienne sans exemple. Un seul point me tracassa : que faisait Baille pendant ce premier épisode ? Dormait-il ? Fumait-il sa pipe ? Complotait-il quelque autre trahison dans l’ombre ? — Puis, après ce sourire, le cri terrible de la fin, la grotte aux stalactites et ses puits effrayants. Baille suspendu sur l’abîme et Cezanne retiré demi-mort du fond du gouffre ; voilà certes des pages émouvantes et pleines d’intérêt. D’ailleurs vous avez vu et éprouvé, vous pouvez décrire les impressions mieux que personne. Pourquoi n’écririez-vous pas ces trois journées si remplies de contrastes, matières fertiles ou le conteur pourrait tour à tour faire vibrer toutes les cordes du cœur ?
Que ne me suis-je trouvé avec vous ; ces périls auraient un peu rompu l’uniformité de mes journées et j’aurais sans doute senti quelque temps la vie circuler en moi, cette vie qui m’abandonne chaque jour dans le cercle monotone que j’ai décrit. Espérons ; mon cœur a soif d’émotion, telle est notre misère, que nous ne savons vivre que de douleurs ; espérons donc dans la tristesse, puisque la joie semble nous avoir dit adieu. — C’est sans doute la pluie qui tombe qui me donne des idées noires. Le fait est que depuis huit jours, je m’ennuie terriblement. J’adresse à chacun, à chaque chose cette question constante : que suis-je venu faire ici-bas ? Je n’ai pas encore pu me prouver la nécessité, l’utilité de mon existence et c’est ce qui me désespère. Je ne puis vous dire ici toutes les sottises qui me passent par la cervelle, mais je vous en supplie, ne me prenez pas pour un fou, et plaignez-moi, car je souffre. Je voudrais bien vous voir et me consoler. Enfin, si je ne puis aller à vous, vous me promettez de venir vous-mêmes et je vais tâcher d’accepter mon mal avec patience.
Ne vous est-il jamais venu à l’idée de partir, de vous exiler, d’aller chercher au loin des émotions que ne saurait donner la société actuelle ? Par exemple de suivre Garibaldi sur les champs de bataille, ou quelque nouveau Colomb dans de lointains voyages ? Pour moi, je suis tellement dégoûté de ma misérable vie que je ne sais vraiment comment tout cela finira. — Décidément je suis triste et cette lettre va s’en ressentir.
Chaillan tourne aussi au désespoir. Il commence, je crois, à soupçonner sa nullité, et ses chères illusions lui brisent le cœur en prenant leur vol. Le voilà revenu de son voyage au pays des chimères. Hélas ! mes bons amis, le nôtre ne fait que de commencer. Gais matelots, nous sourions à l’aurore ; nous quittons le sol comme pour de nouvelles contrées et sans souci nous nous abandonnons aux vagues. Qui sait ce qui nous attend ; qui sait si la verte prairie que nous apercevons dans le lointain n’est pas un noir mirage qu’un coup de vent dissipera ? Qui sait ce que sera la réalité ?
N’importe, courage ! Je préfère l’écueil à la grande voûte poudreuse où se traîne l’humanité, je préfère vivre d’une vie terrible que de végéter misérablement. Puis ce phare lumineux qui brille à l’horizon, ce phare que l’on nomme gloire, richesse, immortalité et que je nomme existence, ce phare n’est pas un vain rêve et pour l’atteindre il ne faut que marcher avec courage sous le souffle de Dieu. Marchons donc ; la douleur, comme a dit Musset, la douleur grandit l’homme.
Je verrai Reynaud Jules avec un grand plaisir. Il me donnera verbalement des nouvelles de vous ; et, d’ailleurs, puisqu’il est ton ami, je ne cours aucun risque de devenir le sien. Donne-lui donc mon adresse, et engage-le fortement à venir me voir. Dis-moi à peu près l’époque de son arrivée.
Mon voyage ne va pas bien ; mais nous ne sommes pas encore au quinze. Je vous écrirai vers cette époque. — Chaillan demeure maintenant rue de Vaugirard, n° 3.
Mes respects à vos parents — Je vous serre la main. Votre ami.
Émile Zola.
Parlez-moi aussi des personnes que je connais ; des jeunes filles et des jeunes gens. Deux ou trois pages par jour ne coûtent pas beaucoup d’efforts et malgré votre économie vous pouvez bien dépenser 20 centimes tous les deux ou trois jours.
Écrivez-moi très souvent, — Tâchez de me parler un peu d’Aix, bien que vous sortiez peu. Ainsi de la fontaine de la rotonde et des inscriptions qu’on y a mises. Si le nom de mon père a été oublié je suis décidé à casser les vitres. »
24 octobre
Lettre de Zola à Cezanne et à Baille (apparemment envoyée à Cezanne).
Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 249-255.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 35, p. 245-249.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 90.« Paris, 24 octobre 1860.
Mes chers amis,
Quelques larmes sur mon voyage, et n’en parlons plus. Tout est désespéré, tout va de mal en pis. — J’ai fait à deux fois deux cent vingt lieues pour vous serrer la main, c’est à vous de venir à moi, puisque malgré ma bonne volonté et mes efforts, je ne puis aller à vous. J’ai mis tout en œuvre, je n’ai aucun reproche à me faire ; et fatigué de cette vaine lutte, j’attends avec impatience de vous voir, fidèles à votre parole, arriver, l’un au mois de mars, l’autre au mois d’octobre 1861. — C’est une nouvelle page noire dans ma vie. Dans mes longs jours d’ennui, l’hiver dernier, je pensais, pour unique consolation, à ce temps présent qui s’écoule si monotone et que je rêvais radieux. Je me disais alors que je rirais d’autant mieux que je bâillais plus longuement. Les mois se sont écoulés ; j’ai toujours bâillé et je bâille encore. — Plus j’avance, plus le doute grandit en moi. Si l’on m’eût dit, il y a six semaines : « Tu n’iras pas en Provence », j’aurais souri d’incrédulité. Mais maintenant qu’une de mes plus chères espérances vient de s’évanouir, si l’on me disait : « Tes amis ne viendront pas », je ne sais trop si je me montrerais aussi incrédule. Trompé, toujours trompé, même dans les réalités, on finit par ne plus croire qu’à ce que l’on voit. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ; je pense comme le fabuliste. — Faites-moi renaître à l’espérance, en accomplissant votre promesse ; personne ne le désire aussi ardemment que moi. Je vous attends donc fermement ; je vous attends, non pour rire sans cesse, mais pour partager nos rires et nos pleurs, et marcher plus sûrement sous l’aile d’une franche amitié.
Je suis dans une période bête de la vie, un de ces temps où l’on est incapable même de planter des choux. Depuis quelques jours je fais, le matin, un grand feu dans ma chambre et, jusqu’au soir, je me chauffe les mollets, désespéré, ne pensant à rien, bourrant et fumant ma pipe de la plus détestable façon du monde. Pas une idée neuve, encore moins la force d’en exprimer une de vieille date ; je me battrais vraiment si j’en valais la peine. — Ce qui m’empêche de trop n’inquiéter, c’est la connaissance parfaite que j’ai de mon individu ; ce n’est pas la première fois que j’éprouve une pareille attaque de spleen ; et comme chaque fois je n’en suis sorti que plus frais et plus riant, j’attends avec patience que le démon qui me tourmente se lasse et porte sa malice ailleurs. — Tout ceci n’est qu’une transition pour arriver à vous faire ingurgiter poliment une de mes élucubrations du mois dernier. Voici mon raisonnement : comme je ne puis, hélas ! vous parler de vive voix, comme, de plus, tout ce que je vous écrirais ces jours-ci serait mortellement ennuyeux, je ne saurais mieux faire que de vous transcrire quelques vers rimés dans une époque meilleure.
N’allez pas vous lécher les lèvres en pensant lire un chef-d’œuvre. Mes alexandrins ne sont guère mieux tournés que la présente prose. Pesez le bon, pesez le mauvais : puis dites-vous que je suis votre ami, et peut-être la jérémiade ci-jointe vous semblera supportable. Dans un flambeau, parmi les flots de fumée, parfois brillent de radieuses étincelles, et dites-vous que peut-être, un jour, il s’élèvera un bon vent qui chassera la fumée et permettra au flambeau de briller de tout son éclat. — Comme la pièce présente n’est pas encore corrigée, je recevrai vos critiques avec joie ; je vous prie même, puisque vous êtes oisifs, de me signaler tous les défauts — et ils sont nombreux — que vous remarquerez dans ce morceau.
J’ai fait, ces dernières semaines, la connaissance d’un homme de lettres, mon voisin. M. Pagès (du Tarn) — il a cette singulière manie de joindre à son nom, le nom de son département — M. Pagès (du Tarn) est un de ces mille incompris qui battent le pavé de Paris. D’un certain âge déjà, il a dans sa jeunesse coudoyé nos lyriques, jeunes audacieux alors que la gloire a couronnés depuis. Aussi faut-il voir, lui qui n’a pu parvenir, comme il envie, comme il dédaigne les couronnes de ces parvenus, les déchirant, ainsi que le renard de la fable, trop flétries et bonnes pour des goujats. Victor Hugo, de Musset, piètres auteurs à ses yeux, sachant tout au plus frapper un beau vers par ci, par là. Il explique leur réussite par la réclame, surtout par la camaraderie ; tout leur souriait, dit-il, et ils se faisaient applaudir quand même. Puis, par une habile transition, il ajoute que pour lui tout était obstacle et semble conclure que, malgré son talent, que dis-je, son génie, il n’a pu sortir de la commune ornière. Le raisonnement est grossier, et le moins clairvoyant s’aperçoit bientôt que son dédain pour nos contemporains provient de son amour-propre froissé. — Il n’a pu cependant vivre en contact avec les écrivains de 1830 sans leur prendre quelques-unes de leurs idées. Qu’on se garde de lui dire cela, il se fâcherait tout rouge et se croirait grandement offensé. Cependant la tragédie du xviie siècle lui semble une absurdité, tout comme aux romantiques. Par plusieurs autres points encore il touche à ces derniers, mais, je l’ai dit, il nie cette parenté. Dès lors, ayant rejeté ses premières opinions, la tragédie imitée des anciens et rejetant aujourd’hui le drame romantique, il est forcé de se poser en chef d’école et de suivre un sentier non frayé. Son ambition est noble, et tout homme vraiment artiste doit aspirer au but qu’il se propose. Régénérer le théâtre, ne faire ni tragédie, ni drame, genres également faux tous deux, créer un chef-d’œuvre de raison et de passion vraiment humaine, puisant sa grandeur dans le vrai, c’est là, je le répète, une noble ambition, mais aussi une tâche lourde et terrible. Qu’a fait M. Pagès (du Tarn) ? Pour faire une malice aux romantiques, il a commencé par nommer sa pièce tragédie ; puis il a mis dans la bouche de ses personnages l’alexandrin classique, monotone et fatigant lorsqu’il n’est pas sublime. D’autre part, ne pouvant renier ses premiers dieux et voulant se lancer dans l’innovation, il a vêtu ses héros d’habits noirs et a fait porter des jupons empesés à ses héroïnes. « Voyez-vous, me disait-il dernièrement, je ne veux imiter personne. Je prends mes personnages dans le siècle présent ; je les veux instruits, bien élevés, capables de prononcer les discours que je mets dans leur bouche. Quant à ces discours, je veux que les vers en soient harmonieux, corrects et majestueux ». — Le brave homme ne s’aperçoit pas que l’école qu’il croit prêcher le premier est la même que celle de Casimir Delavigne. Fondre le classique avec le romantique, en tirer une tragédie-drame ayant les qualités et les défauts des deux genres, n’est-ce pas en effet le but qu’a atteint l’auteur des Vêpres siciliennes ? Seulement ce que ce dernier a fait, M. Pagès (du Tarn) ne le fera jamais ; l’un était un véritable poète, chef d’école même, et tout ce qu’il a écrit porte son empreinte. L’autre, je le crains, ne sera jamais qu’un pâle imitateur, qu’un misérable glaneur ramassant quelques épis dans chaque champ et en formant une gerbe, mal faite et mal liée.
D’ailleurs, je ne le juge ici que par une ou deux conversations que j’ai eues avec lui. Jusqu’à présent il ne m’a confié que deux odes d’une faiblesse déplorable. Il doit me lire prochainement sa grande tragédie, quelque chose comme le programme de son école. Cette tragédie a pour titre : la Nouvelle Phèdre ; je me doute qu’il n’a pas fallu grande imagination pour en tracer le plan ; il doit être plus ou moins copié dans Racine. Cette pièce, bien qu’encore manuscrite, a été répandue, les journalistes de la petite presse en ont fait des gorges chaudes ; le Figaro surtout s’est beaucoup amusé sur M. Pagès (du Tarn) et sur l’orgueilleux et singulier titre qu’il a choisi pour son œuvre. Moi, je m’abstiens encore et j’attends pour juger définitivement mon voisin de connaître sa tragédie. — Je suis loin de dédaigner ce brave homme. Au milieu des erreurs qu’il avance, parfois brille une pensée vraie et pleine de raison. Je l’ai dit, qu’on ne cherche pas la cause de ses singulières théories, de ses dédains absurdes, qu’on ne cherche pas ailleurs que dans cette haine cachée que porte tout homme resté obscur contre celui qui s’est élevé. M. Pagès (du Tarn), ne voulant imiter personne et incapable de voler de ses propres ailes, doit rester nécessairement et prosaïquement sur la commune terre. C’est là, je m’en doute, un jugement que je n’aurai pas à modifier, même après avoir lu la Nouvelle Phèdre.
Vous vous demandez peut-être, mes chers amis, si je ne lui ai rien montré de ma composition. Si je me taisais sur ce sujet, vous pourriez avec raison penser que je vous cache un jugement désobligeant de mon estimable voisin. Vous connaîtriez donc bien peu les hommes. Je ne suis pour M. Pagès (du Tarn) qu’un débutant, un jeune fou, peu à craindre, et partant qu’on peut louer sans réserve. Aussi, à la lecture de quelques-uns de mes vers, il m’a fait force éloges, m’a conseillé de publier au plus tôt, me prédisant un succès de grâce. Je prends ces éloges pour ce qu’ils valent et ne suis pas assez imprudent pour courir chez un libraire sur l’admiration de M. Pagès (du Tarn). On ne doit pas cueillir un fruit avant sa maturité ; n’est-ce pas votre avis, vous les seuls dont je me déciderais à prendre les conseils ? — Si vous le désirez, je vous parlerai dans une autre lettre de la Nouvelle Phèdre.
Je remarque que, dans cette épître d’une certaine longueur déjà, je ne vous entretiens que de vers, d’auteurs et d’autres choses littéraires. Chacun a son dada ; parfois j’enfourche le mien. Mais qu’à cela ne tienne ; que Baille me parle mathématiques ; Cezanne peinture, vos lettres n’en auront pas moins d’intérêt pour moi, puisqu’elles viennent de vous.
J’ai reçu ce matin une lettre de Paul. Que devient Baille ? quelles graves occupations l’ont empêché depuis quinze jours de m’adresser quelques lignes ? Où sont donc ces belles promesses de m’écrire chaque semaine lorsque luisaient les jours de liberté ? Le long silence, basé sur d’autres travaux plus utiles, va-t-il donc recommencer dans ces temps de farniente ? Baille, j’ai bien envie, pour te punir, d’adresser cette lettre rue Matheron, Quoi ! Cezanne m’écrit, et toi pas un mot, pas un pauvre petit mot ! J’admets encore que cette lettre ait été envoyée à ton insu, que n’as-tu fait comme Cezanne ? que n’as-tu pensé à moi depuis deux semaines, à moi qui m’ennuie et qui attend vos épîtres avec tant d’impatience ? — Assez de morale ; sois sage à l’avenir et n’en parlons plus. Réponds-moi au plus tôt.
Cezanne m’a donc écrit, c’est à lui que je dois répondre. — La description de ta poseuse m’a fort égayé. Chaillan prétend qu’ici les modèles sont potables, sans être pourtant d’une première fraîcheur. On les dessine le jour, et la nuit on les caresse (le mot caresse est un peu faible). Tant pour la pose diurne, tant pour la pose nocturne ; on assure d’ailleurs qu’elles sont fort accommodantes, surtout pour les heures de nuit. Quant à la feuille de vigne, elle est inconnue dans les ateliers ; on s’y déshabille en famille, et l’amour de l’art voile ce qu’il y aurait de trop excitant dans les nudités. Viens, et tu verras.
Venez, venez tous deux, mes amis, je vous dirai moi mes longues rêveries ; et peut-être conviendrez-vous, même Baille le réaliste, qu’après tout la vie est comme on veut la prendre et que ma façon n’est pas la plus mauvaise.
Cette lettre est sans doute la dernière que je vous adresse collectivement. Je reprendrai bientôt mes correspondances intimes. — Surtout que Baille, n’oublie pas qu’il me doit une prompte réponse. Je le prie de nouveau de me parler de la fontaine de la rotonde et des inscriptions qui y ont été ou qui doivent y être gravées.
Dès sa rentrée au lycée, ledit Baille devra me donner l’adresse d’un correspondant pour que je puisse lui écrire. Cette lettre est longue et fort mal écrite. Lisez-la à petits traits, sinon, je crains qu’une forte dose ne vous endorme.
Mes respects à vos parents, je vous serre les mains.
Votre ami dévoué,
Émile Zola. »
31 octobre
Lettre de Zola à Baille.
Lettre de Zola à Baille, Paris, 31 octobre 1860 ; lettre de Zola à Baille, Paris, 2 octobre 1860 ; Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 147-151.
Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 35, p. 245-249.« J’écris en même temps à Cezanne ».
La lettre à Cezanne n’est pas connue.


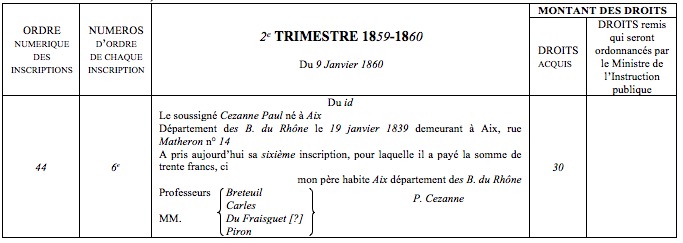
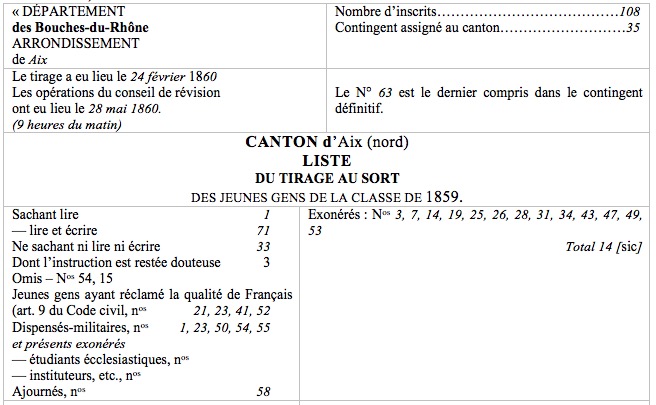
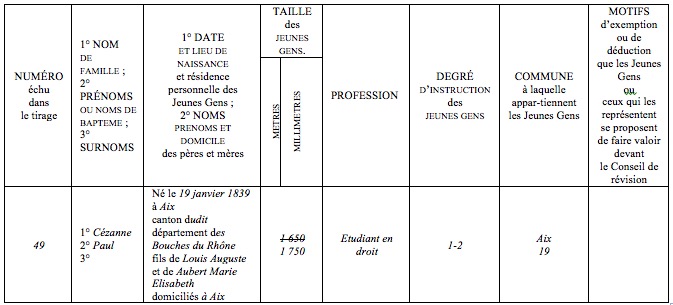
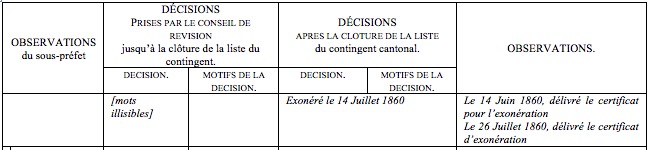

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.