6 janvier
Degas achète à Vollard une nature morte de Cezanne, Pommes, Linge et Verre (Verre et pommes) (FWN779-R424), pour 400 francs.
Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,2) f° 27.
6 janvier
L’Italien Egisto Fabbri achète à Vollard un tableau de Cezanne, Au bord de l’eau (FWN281-R724).
Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
11 janvier
D’après le livre de stock B de Vollard, Egisto Fabbri lui achète une toile de Cezanne pour 600 francs, n° 4349, « Portrait de jeune homme italien debout ‘voir le n° 4157) », 92 x 73 cm (Le Garçon au gilet rouge, FWN497-R659).
Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute.
Vers 1904, Fabbri échangera le tableau à Vollard, pour une valeur de 3 000 francs, contre Homme assis (FWN530-R789) et un paiement de 2 000 francs.
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 659, p. 426.
Il lui achète aussi Maison se reflétant dans l’eau, 500 francs et une esquisse, 100 francs.
Registre commercial de Vollard, 20 juin 1894 – 3 novembre 1897, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,2) f° 27.
11 janvier
Enrico Costa achète à Vollard un tableau de Cezanne, La Campagne d’Auvers-sur-Oise (FWN177-R505).
Agenda commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
13 janvier
Le Temps confirme que la famille Caillebotte, Renoir, exécuteur testamentaire du peintre Caillebotte, et l’État continuent de chercher un accord sur le legs Caillebotte, contrairement à ce qu’avait supposé Octave Mirbeau dans un article du Journal.
« Au jour le jour. Le legs Caillebotte », Le Temps, 356e année, n° 12282, dimanche 13 janvier 1895, p. 2-3. Mirbeau Octave, « Le legs Caillebotte et l’État », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 818, lundi 24 décembre 1894, p. 1 :
« AU JOUR LE JOUR
Le legs Caillebotte
On a lancé le bruit, dans la presse, du refus de la collection Caillebotte par l’État.
Cette collection, dont nous avons donné le détail l’an dernier et qui comprend une soixantaine de toiles de l’école impressionniste, à laquelle appartenait Gustave Caillebotte, avait été léguée par le peintre aux musées nationaux, qui s’étaient empressés de l’accepter. Nous sommes heureux d’annoncer qu’ils n’ont pas changé d’opinion, que les exécuteurs testamentaires ne songent nullement à la reprendre et qu’il n’y a en un mot rien de fondé dans la nouvelle que certains de nos confrères tambourinent.
C’est ce qui ressort des entretiens que nous avons eus avec M. Martial Caillebotte, un des deux frères du défunt, avec le peintre Renoir, exécuteur testamentaire, et avec M. Henry Roujon, directeur des beaux-arts.
« Je ne sais, nous a dit M. Caillebotte, d’où les bruits qui se sont répandus peuvent provenir, mais j’ai qualité pour vous affirmer qu’ils sont entièrement inexacts. L’État refuse si peu le legs de mon frère, qu’en ce moment même nous cherchons un terrain d’entente avec lui pour écarter toutes les difficultés que soulève l’acceptation de ce legs, subordonnée, d’après les clauses mêmes du testament, à certaines conditions dont la réalisation nous a toujours paru impossible, comme elle a paru impossible à l’État.
» Le testateur, en effet, demande d’une façon très expresse que les tableaux soient exposés au Luxembourg ou au Louvre, et qu’on ne les relègue ni dans des greniers ni en province. Informée dès l’ouverture du testament de ces clauses, la direction des beaux-arts nous a déclaré sa complète impuissance à se conformer à la lettre aux intentions de mon frère. Le Luxembourg est trop petit et les règlements interdisent le Louvre à toute toile dont l’auteur n’est pas mort depuis au moins dix ans.
» Ces raisons, nous les avons comprises à merveille, d’autant plus que l’administration des beaux-arts s’engageait à demander les crédits nécessaires pour la construction, au musée du Luxembourg, d’une annexe où les toiles les plus importantes de la collection seraient placées. J’étais d’ailleurs convaincu, et Renoir ne l’est pas moins que moi, que mon frère avait songé, non à forcer la main aux musées ou à leur chercher de mauvaises chicanes, mais à soumettre au public les travaux d’une école longtemps dénigrée, à permettre à tous de les voir et de les étudier.
» Donc, pas de difficulté en principe entre l’État et nous, mais des questions matérielles à régler. Il a donc fallu, de part et d’autre, chercher des solutions. Une de celles qui nous ont été soumises par l’État était la suivante : — Consentirions-nous à considérer comme succursales des musées nationaux les musées de Fontainebleau, de Compiègne et de Versailles ? Nous avons répondu par la négative.
C’est une solution nouvelle à chercher. Voilà tout.
» J’ajouterai qu’aucun des tableaux de mon frère, contrairement à ce que certains de vos confrères ont avancé, ne figure dans la collection et ne fait partie du legs. Le Jeune homme au piano, qui a été cité, ne m’appartient pas ; quant aux Raboteurs de parquet, c’est l’État qui a manifesté l’intention de le joindre à la collection, si les héritiers voulaient bien le lui offrir. C’est ce que nous avons fait. »
Le peintre Renoir n’a pas été moins net :
« Ces bruits sont ridicules, nous a dit le délicat artiste. Ils proviennent d’une conversation dans laquelle j’ai mis Claude Monet au courant de la démarche tentée par le notaire de l’administration, M. Cottin, auprès du notaire de la famille Caillebotte au sujet de Fontainebleau et de Compiègne. Entendue et mal interprétée par Mirbeau, cette conversation lui a fait croire, bien à tort, que l’État ne voulait pas du legs, et je regrette amèrement sa méprise.
« Il se fait trop d’histoires, voyez-vous, à ce propos.
On va criant partout que la collection ne comprend que des chefs-d’œuvre. Mais c’est fou ! Il y a des tableaux de premier ordre, des Manet, des Claude Monet, des Degas, des Pissaro, des Sissley, des Cezanne d’un très grand intérêt ; mais il y a quantité d’esquisses dans le nombre, d’études qui ne sont pas des morceaux de musée et que nous serions fâchés les premiers de voir travestis à l’avance en chefs-d’œuvre. Le jour où le public serait admis à les voir, il se gausserait de nous. Voilà, si nous la laissions se prolonger, quel serait le résultat de cette campagne. »
Quant au directeur des beaux-arts, il n’a pu que nous confirmer ce qui nous avait déjà été dit par MM. Martial Caillebotte et Renoir, nous déclarer que l’État ne songeait pas plus à refuser qu’à créer des difficultés, que le baraquement du Luxembourg serait prêt dans un délai assez rapproché, mais que le musée, en dépit de cette extension, serait malgré tout trop étroit pour abriter la collection tout entière. « Il faut donc, nous a-t-il dit en terminant, chercher de concert avec la famille Caillebotte et l’exécuteur testamentaire, M. Renoir, un moyen de tout concilier. C’est ce que, d’un commun accord, nous faisons ; c’est ce que nous sommes assurés de trouver, parce que nous sommes tous de bonne foi et tous désireux de nous entendre. »
18 janvier
Pissarro écrit à sa femme Julie. D’après lui, le docteur Aguiar ― l’un de ses amis qui connaît aussi Oller, Guillaumin, le docteur Gachet et Cezanne ― considère ce dernier comme malade.
« J’ai vu Oller hier, il m’a beaucoup parlé de Cezanne qui a été paraît-il fantastique ! Il a encore été pire qu’avec Renoir, il a amené Oller à Aix et l’a planté là dans des circonstances extraordinaires… Je te conterai cela, c’est trop long… Aguiar est venu passer quelques jours à Paris, il a vu Cezanne, il est persuadé qu’il est malade. Bref, ce pauvre Cezanne est furieux contre nous tous, même contre Monet, qui en somme a été fort gentil avec lui. »
Lettre de Pissarro, Paris, hôtel et restaurant de Rome. Garnier, 111, rue Saint-Lazare, 17, place du Havre, Paris, à sa femme Julie, samedi 18 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1201, p. 151.
19 janvier
Pissarro écrit à son fils Lucien.
« Beaucoup à te dire à propos d’Oller et Cezanne, mais ce sera pour une autre fois. »
Paris 111, rue Saint-Lazare, dimanche 19 janvier 1896, 1202
Lettre de Pissarro, Paris, 111, rue Saint-Lazare, à son son fils Lucien, dimanche 19 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1202, p. 152.
20 janvier
Pissarro, à Rouen, a reçu la visite d’Oller, qui lui a raconté ses incidents survenus avec Cezanne à Aix. Il écrit à son fils Lucien :
« Avant de quitter Paris, j’ai vu l’ami Oller qui m’a raconté des choses extraordinaires qui lui sont arrivées avec Cezanne, qui dénotent chez ce dernier une fêlure évidente. Ce serait trop long à te raconter… Après de grandes marques d’affection, avec cette expansion toute méridionale, Oller tout confiant a cru pouvoir suivre l’ami Cezanne à Aix, rendez-vous pris pour le lendemain au train de P.L.M. dans les troisièmes, dit le compère Cezanne ; le lendemain donc Oller sur les quais s’écarquille les yeux en regardant de tous côtés, pas de Cezanne, les trains filent, personne !!! Oller finit par se dire, « il est parti… me croyant aussi parti… » se décide, et file. Arrivé à Lyon on lui vole à l’hôtel cinq cents francs qu’il avait dans son porte-monnaie ; ne sachant comment se retourner, envoie un télégramme à tout hasard chez Cezanne : celui-ci était chez lui, parti en première classe !!… Oller reçoit une de ces lettres qu’il faudrait que tu lises pour t’en faire une idée. Il le mettait à la porte en lui demandant s’il le prenait pour un imbécile, etc., une lettre enfin atroce. Ma foi c’est une variante de ce qui est arrivé à Renoir. Il paraît qu’il est furieux contre nous tous : « Pissarro est une vieille bête, Monet un finaud, ils n’ont rien dans le ventre… il n’y a que moi qui ai du tempérament, il n’y a que moi qui sais faire un rouge !!… »
Aguiar a assisté à des scènes de ce genre. Comme docteur, il a assuré à Oller qu’il était malade, qu’il ne fallait pas y faire attention, qu’il n’était pas responsable. N’est-ce point triste et dommage qu’un homme doué d’un si beau tempérament soit si peu équilibré !!! »
Lettre de Pissarro, Rouen, quai de Paris, 51, à son fils Lucien, lundi 20 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1203, p. 153.
Rewald John, Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, note 7 p. 245 :
« Les quelques détails connus sur cet épisode étrange indiquent que, de Lyon, Oller s’était adressé non pas à Cezanne, mais avait télégraphié au fils de ce dernier à Paris, qui lui avait appris que son père était déjà à Aix. De son côté, arrivé à Aix, Oller aurait prévenu Cezanne de sa présence en ville et aurait reçu cette réponse : « Si c’est comme ça, viens tout de suite. Je t’attends. P. Cezanne. » »
22 janvier
Lucien Pissarro écrit à son père :
« Est-ce assez étrange ce que tu me dis de Cezanne ? Te rappelles-tu déjà que le pauvre Père Tanguy prétendait, il y a longtemps, qu’il était fou ? A cette époque nous mettions cela sur le dos de la simplicité de Tanguy, il avait peut-être raison ! Maintenant est-ce avarice ? et exitabilité combinées ? C’est bien curieux — j’aurai aimé avoir plus de détails. »
Lettre de Lucien Pissarro, Eragny House, Epping (Essex), à son père, 22 Janv. 96 ; Thorold Anne (édité par), The Letters of Lucien to Camille Pissarro 1883-1903, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 796 pages, p. 458-459.
31 janvier
Georges Lecomte rapporte à Pissarro que Cezanne aurait critiqué celui-ci devant Geffroy.
Pissarro écrit à son fils Lucien :
« Lecomte m’a dit à propos de Cezanne qu’il s’était mis à me bêcher ferme auprès de Geffroy, dont il fait le portrait, en ce moment, comme c’est gentil ; moi, qui depuis trente ans le défend avec tant d’énergie et conviction d’ailleurs, ce serait trop long à te raconter, mais c’est de là que vient cette espèce de silence et de doute… ah bah !… Travaillons ferme et tâchons de faire des gris épatants ! ce sera mieux que de bêcher les autres… »
Lettre de Pissarro, Rouen, hôtel de Paris, quai de Paris, 51, à son fils Lucien, 31 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1207, p. 159.
Il n’est pas exact que Cezanne se trouve encore à Paris et travaille encore au portrait de Geffroy « en ce moment ». Ou bien Lecomte a mal compris ce que lui a dit Geffroy, ou bien Pissarro a mal compris ce que lui a dit Lecomte.
1er février
Oller écrit à Pissarro :
« Paris ce 1. Fevrier 1896.
Mon cher Camille : ne fait pas attention à mon mauvais français et seulement à mon bon desir de te souhaité une bonne année, a toi et aux tiens ; je vous desire toute espèce de bonheure.
Mon cher, Mr. Paul Cézanne est une canaille ou un fou il m’a fait la saleté plus afreuse que tu pouvais t’imaginer, un jour j’irai te voir et nous en parleronts. Je dois te dire que je n’ai pas été avec lui je suis retourné sur mes pas et j’ai fais ma campagne chez Aguiar à Creusier-le-Vieux (Rhue) [Creuzier-le-Vieux] Allier, j’ai fait quelques etudes que je te porterai pour que tu me crois —
Il y aquelques jours que je suis revenu mais j’ai été malade, je suis déja vieux et le frais me fais du mal
Bonjour à Mme Pissarro et à tes enfants et tu sais que siempre soy tu viejo amigo
F. Oller.
Hotel Franklin
19 rue Buffault ».Lettre d’Oller à Pissarro. Paris, datée « Paris ce 1. Fevrier 1896 » ; vente Archives de Camille Pissarro, Paris, hôtel Drouot, 21 novembre 1975, n° 137.4 ; extrait cité par Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 144.
1er février
Hazard achète à Vollard un tableau de Cezanne, Deux Poires (FWN724-R353).
Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
6 février
Redon écrit à Bonger :
« Oui, certainement, je fus content de l’exposition de Cezanne. Il y avait du mélange, mais c’était sain, large, et voisin du style de bonne race, avec le point initial et original de l’impressionnisme synthétique, que les jeunes disent avoir découvert. Il y a eu des critiques faites, aveugles. C’est ainsi la loi. »
Lettre de Redon, Paris, à A. Bonger, jeudi 6 février 1896 ; Lévy Suzy (édition établie par), Lettres inédites d’Odilon Redon à Bonger, Jourdain, Viñes…, avant-propos de Michel Guiomar, Paris, Librairie José Corti, 1987, 295 pages, lettre 10 p. 48.
25 février
Un accord entre la Direction des Beaux-arts et les exécuteurs testamentaires du legs Caillebotte est enfin trouvé et validé en Conseil d’État, puis par décret du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes, en date du 25 février 1896. Seuls deux Cezanne sur les cinq légués sont acceptés : L’Estaque (Le Golfe de Marseille vu de l’Estaque, FWN119-R390) et Paysage à Auvers (Cour d’une ferme, FWN129-R389).
« Nos échos », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 5e année, n° 1295, mardi 14 avril 1896, p. 1 :
« L’entrée de la collection Caillebotte au Luxembourg est chose décidée. On sait que le peintre avait, par testament, légué ses tableaux à notre grand musée de la rive gauche, mais à la condition que tous fussent admis. La direction des Beaux-Arts, elle, voulait procéder à une sélection. Les héritiers du défunt voulant faire respecter les volontés du testateur, l’État refusa d’abord purement et simplement l’héritage. Mais le Conseil d’État vient de trancher le différend. 40 tableaux, sur 66, entreront au Luxembourg. »
« Le legs Caillebotte », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 16, 18 avril 1896, p. 144-145 :
« Le Legs Caillebotte
La question un peu brûlante du legs Caillebotte vient d’être résolue définitivement d’une façon à la fois conforme aux intentions du testateur et aux intérêts de sa collection. On n’a pas oublié encore tout le bruit qu’on fit, jadis, au sujet d’un prétendu refus par l’État d’accepter cette collection. La vérité est que, depuis le jour où un accord verbal semblait avoir réglé définitivement cette affaire au gré de tous, aucun changement n’est survenu ni dans l’attitude de l’Administration des Beaux-Arts, ni dans celle des héritiers. Entre les exagérations qui se sont produites d’une part et les omissions de l’autre, il n’est peut-être pas inutile de faire connaître simplement et entièrement la marche de cette affaire.
Voici d’abord le texte précis du testament :
« Je donne à l’État, dit le paragraphe spécial consacré à la collection, les tableaux que je possède ; seulement, comme je veux que ce don soit accepté et le soit de telle façon que ces tableaux n’aillent ni dans un grenier, ni dans un musée de province, mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre, il est nécessaire qu’il s’écoule un certain temps avant l’exécution de cette clause, jusqu’à ce que le public, je ne dis pas comprenne, mais admette cette peinture. Ce temps peut être de vingt ans au plus ; en attendant, mon frère Martial, et, à son défaut, un autre de mes héritiers, les conservera. »
Ce testament, daté du 3 novembre 1876, recevait le 20 novembre 1883 un codicille qui avait surtout pour but de modifier des dispositions relatives à l’Exposition universelle de 1878, à laquelle Caillebotte désirait que l’école impressionniste fût représentée avec éclat : il ajoutait en ce qui concerne sa collection : « Je maintiens toute la partie de ce testament qui a trait au don que je fais de la peinture des autres que je possède. »
On a déjà donné l’énumération des ouvrages de la collection Caillebotte. On sait qu’elle comprend, à côté de morceaux de choix, de très grand intérêt et que, suivant l’expression de M. L. Bénédite dans la notice qu’il lui a consacrée, le Luxembourg aurait eu le droit d’envier sans cette heureuse éventualité, un certain nombre d’études, d’ébauches, de toiles inachevées, souvenirs d’atelier, curieux à garder pour un artiste, mais de nature à perpétuer les préventions d’une partie du public au lieu de servir la cause des artistes intéressés. C’est au mois de mars, au lendemain de la vente Duret, où M. Roujon achetait pour le Luxembourg la Jeune femme au bal de Mme B. Morizot — ce qui ne marquait pas. semble-t-il, des dispositions très hostiles contre l’école impressionniste — que le Comité consultatif des musées nationaux fut saisi de l’examen de cette collection.
Quelques jours avant, au cours d’une entrevue avec l’un des héritiers et l’exécuteur testamentaire, M. Roujon avait fait connaître les difficultés dans lesquelles se trouvait l’Administration d’exécuter intégralement les clauses du legs, et les représentants du donateur, qui avaient eux-mêmes réfléchi à tous ces inconvénients, donnaient l’assurance qu’ils étaient prêts à faire toutes les concessions de nature à permettre l’exécution du legs, sans compromettre les intentions du testateur.
L’Administration faisait valoir que le défaut de place dans le Luxembourg, où il n’était plus possible de faire entrer un ouvrage sans en retirer un autre, et, en même temps, un sentiment de justice à l’égard des autres artistes représentés dans cette galerie ne permettaient pas de donner à chacun des peintres figurant dans la collection Caillebotte une place plus importante qu’aux maîtres les plus représentés dans ce musée. Il pensait donc qu’on ne pourrait accorder à chacun des artistes de la collection Caillebotte que le maximum admis au Luxembourg, à l’exception de M. Degas, dont les dessins sont de petites dimensions. C’était s’engager à exposer immédiatement 25 à 30 ouvrages sur les 65 qui composent la collection. Ces conclusions avaient été parfaitement admises par les héritiers et certains des plus célèbres parmi les artistes intéressés se reconnaissaient d’autant plus disposés à accepter cet arrangement qu’ils seraient très fâchés, disait-il, d’être représentés ou de voir représenter leurs amis dans un établissement public par des ouvrages incomplets, insuffisants, et qui seraient de nature à leur causer plutôt du préjudice.
L’un d’eux ajoutait, d’ailleurs, qu’à l’époque où M. Caillebotte avait fait son testament, sa collection ne comprenait que très peu d’ouvrages, et que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas hésité à parler de l’acceptation de l’ensemble. Les plus nombreuses acquisitions furent faites dans les années écoulées depuis la rédaction du testament. Dans l’esprit de Caillebotte, ce n’était donc pas pour tous les ouvrages qu’il réclamait la consécration de l’État, mais pour les noms formant le groupe. Du moment qu’aucun des noms n’était écarté et qu’on les accueillait dans une mesure très libérale, les héritiers étaient tout prêts à rechercher un arrangement qui permît d’interpréter dans ce sens les termes du legs.
En conséquence, le comité consultatif émettait un vote unanime sanctionnant cet arrangement.
Il ne restait donc plus qu’un point subsidiaire à décider : Que ferait-on des autres tableaux ?
C’est alors que, préoccupée de trouver une solution très prochaine, l’Administration pensa que le seul moyen possible de concilier les volontés du testateur avec les exigences de la situation, c’était d’attribuer les ouvrages non exposés aux palais de Fontainebleau et de Compiègne, annexes des Musées nationaux, qui ne sauraient être considérés comme des greniers, ni comme des musées de province.
C’est dans ces annexes organisées en musées, que le Louvre et le Luxembourg laissent en dépôt, dans des salles publiques, le trop-plein des ouvrages dont ils ne veulent point se dessaisir en raison de leur intérêt.
Avant de signer, les héritiers, pris de nouveaux scrupules, se sont demandé s’il ne resterait pas un moyen d’assurer la conclusion de cette affaire d’une manière plus conforme au texte du testament. C’est sur ce point que des négociations engagées très courtoisement entre eux et la Direction des Beaux-Arts ont amené la solution actuelle. À la suite d’une transaction qui a été approuvée par le Conseil d’État, un décret du 25 février 1896 autorisait l’Administration à faire choix définitivement d’un certain nombre d’ouvrages qu’elle s’engageait à exposer dans les conditions exigées par le testament, et les ouvrages, qui n’avaient pas été compris dans ce lot, devenaient la propriété définitive des héritiers.
Le Conservateur du Luxembourg a été chargé d’opérer ce choix, qui a été fait avec beaucoup de discernement et avec le concours des artistes intéressés.
Sur les 65 ouvrages de la collection, 40 ont été retenus, soit :
Millet : Deux dessins, destinés au Louvre.
Degas : Sept pastels (la totalité des œuvres offertes de cet artiste) : Danseuse sur la scène. —
Danseuse nouant son brodequin. — Café Boulevard Montmartre. — Les Choristes. — Le Bain. — Buste de femme. — Femme nue dans un cabinet de toilette.
Manet : Le Balcon. — Angelina.
Cezanne : L’Estaque [FWN119-R390]. — Paysage à Auvers [FWN129-R389].
Claude Monet : Les Rochers de Belle-Isle. — Intérieur à la campagne. — Église de Vétheuil. — Le Givre. — Les Tuileries. — Les Régates d’Argenteuil. — Le Déjeuner. — La Gare Saint-Lazare.
Renoir : Le Moulin de la Galette. — La Balançoire. — Le Pont de Chatou — Bords de la Seine. — Torse de jeune Femme. — Liseuse.
Sisley : Saint-Mammès. — La Cour de Ferme. — Bords de Seine. — Régates. — Une Rue à Louveciennes. — Lisière de Forêt.
Pissarro : Les Toits rouges. — La Moisson. — Chemin montant. — Potager. — La Brouette. — Chemin sous bois (été). — Le Lavoir.
Quant au placement de ces ouvrages, il ne pourra être effectué que vers le mois d’octobre, dans l’annexe provisoire qui doit être construite très prochainement sur la terrasse du côté du jardin, où sont actuellement exposées un certain nombre de figures en bronze. »
Tabarant, « Le peintre Caillebotte et sa collection », Bulletin de la vie artistique, Paris, MM. Bernheim-Jeune, éditeurs d’art, 2e année, n° 15, 1er août 1921, p. 405-413, citation p. 409-413 :
« C’est dans cette atmosphère de bataille que l’administration des Beaux-Arts eut à se prononcer sur le legs. Allons demander à M. Léonce Bénédite de rappeler à ce propos ses souvenirs.
*
— Après plus d’un quart de siècle, nous déclare le conservateur du Luxembourg, on peut enfin parler sans passion, ce qui permet de redresser quelques légendes fâcheuses. Voici : La donation Caillebotte trouvait Roujon partagé entre deux sentiments : sentiment d’inquiétude, car il était, en matière d’art, très retardataire, mais aussi sentiment de satisfaction. « Puisqu’on m’apporte des impressionnistes, disait-il, je serai débarrassé du souci d’en acheter. » Après une entrevue avec M. Martial Caillebotte, il fut donc convenu que nous irions voir les tableaux. Le petit père Kaempfen, Leprieur, mon beau-père (Georges Lafenestre) et Benoit, du Louvre, nous accompagnèrent…
— A Gennevilliers ?
— Non. Boulevard de Clichy, où Gustave Caillebotte avait un atelier. Oh ! cet atelier abandonné à la poussière ! Nous nous trouvions devant un fouillis de toiles sans cadres, gisant par terre, quelques-unes seulement étant accrochées aux murs. L’aspect en était lamentable. Je me rappelle notamment les Baigneurs, de Cezanne, qui se balançaient au-dessus d’une porte. On retourna les toiles et les sous-verre poussiéreux. Il y avait, à côté de morceaux importants, de simples études, des ébauches. Mon beau-père, qui prenait un vif intérêt à cet examen, dit à Roujon, qui gardait le silence : « Il faut accepter ça ! » Ce fut d’ailleurs l’avis unanime. « Eh bien ! décida Roujon, je vais saisir de cette question le Comité consultatif. »
— Qui se composait de… ?
— Il réunissait tous les conservateurs et conservateurs adjoints des musées. Donc, sans Roujon, cette fois, l’atelier du boulevard de Clichy fut visité de nouveau. Kaempfen présidait. Le soin de présenter les tableaux me revenait de droit, le Luxembourg étant le bénéficiaire.
Mais, afin de laisser à chacun sa pleine liberté, je passai la main à mon beau-père, qui fit les présentations avec beaucoup de chaleur. Une voix s’étant élevée — je ne saurais plus dire laquelle — pour souligner l’insuffisance de certaines pièces, Pottier répliqua vivement qu’il n’en jugeait pas ainsi. « Tout ceci est de l’histoire, messieurs, et pleine d’intérêt ! » fit-il. Le Comité se rallia à cette opinion en décidant que la collection serait acceptée en bloc…
— En bloc, vraiment ? C’est la première fois que nous l’entendons dire.
— Je m’en doute bien, mais attendez. Je me mis en rapport avec Renoir, exécuteur testamentaire, et avec Claude Monet. L’un et l’autre se montrèrent assez inquiets de l’attribution de toute la collection au Luxembourg. « Caillebotte nous achetait pour nous rendre service, disaient-ils, et il prenait un peu au hasard. Bonnat et Bouguereau sont représentés au Luxembourg par le meilleur de leur œuvre. Nous tenons donc à y être par le meilleur de la nôtre. Nous vous saurions gré de faire un tri. » Je me souviens notamment que j’entrai en discussion avec Monet, qui allait jusqu’à demander qu’on écartât deux de ses toiles, le Déjeuner et la Gare Saint-Lazare.
— Un tel excès de scrupule honore ce grand artiste.
— Cependant, tandis qu’en toute cordialité se poursuivaient ces formalités d’acceptation, je sentais Roujon très hésitant, plutôt disposé à faire machine en arrière. Car les protestations continuaient de s’élever, de plus en plus furibondes.
— Oui, intervenons-nous, les protestations du peintre Gérôme et de quelques-uns de ses collègues à l’Ecole des Beaux-Arts, qui adressèrent même à Georges Leygues leur démission collective, en déclarant qu’ils ne pouvaient plus enseigner un art dont les peintures admises au Musée violeraient toutes les lois.
— Celles-là notamment.
— Celles aussi de quelques grands maîtres académiques, recueillies par l’obscur Journal des Artistes, et dans l’une desquelles il était parlé sans aménité du « nommé Pissarro ».
— L’idée d’un tri ne vint donc pas de nous, mais en tout état de cause le manque de place nous obligeait à le faire, et c’est ce que l’administration fit valoir aux héritiers. Nous ne pouvions nous engager à exposer qu’un certain nombre d’ouvrages de chaque artiste. Soit une trentaine au total. Considérations qui furent admises à la fois par les héritiers et par les artistes. Mais que ferait-on des ouvrages non exposés ? C’est alors que je proposai de les attribuer aux palais de Fontainebleau et de Compiègne, qui ne sont ni des musées de province, ni des greniers, mais bien des dépôts d’État, annexes des musées nationaux. M. Martial Caillebotte accepta ce point de vue et tout semblait arrangé lorsque intervint le notaire, qui estima que ces dispositions n’étaient pas conformes aux termes du testament. Il fallait trouver autre chose, et la seule solution qu’on entrevit fut celle d’une transaction entre l’État et les héritiers, ceux-ci devant entrer en possession définitive des tableaux non retenus. A ce moment-là je forçai un peu la note et repris quelques tableaux. En même temps la famille Caillebotte faisait don au Luxembourg des Raboteurs de parquet et des Toits sous la neige, œuvres du testateur, qui s’était modestement oublié.
— Et cette transaction, cette amputation douloureuse, comment s’opéra-t-elle ?
— Deux dessins de Millet étant recueillis par le Louvre, le Comité consultatif se trouvait en présence de 65 peintures ou pastels. L’arrangement fut établi sur ces bases : 31 peintures et 7 pastels seraient retenus pour être exposés. Les 7 pastels étaient les Degas. Je ne me souviens plus au juste de la proportion des acceptations de peintures.
— Vous permettez ? Le Comité consultatif retint 2 Manet sur 3, 6 Renoir sur 8, 8 Monet sur 16, 6 Sisley sur 9, 7 Pissarro sur 18, 2 Cezanne sur 4.
— C’est cela. Mais la transaction ne pouvait être conclue à l’amiable. Il était nécessaire que le Conseil d’Etat l’approuvât. Plus de dix-huit mois s’écoulèrent. Enfin, le 25 février 1896, un décret autorisa le Comité consultatif des musées nationaux a faire officiellement le choix qui était fait depuis si longtemps à titre officieux.
— Et alors ?
— Alors, ce furent des difficultés nouvelles, et de nouveaux retards. À ces tableaux, il fallait des cadres. Il fallait organiser pour eux une installation. Or, je n’avais pas de crédits. Néanmoins, on put construire l’annexe provisoire, sur le jardin, et au commencement de 1897 on inaugurait la collection Caillebotte. Ah ! Quel tumulte ! Mais la démonstration de l’Institut, tout à fait incorrecte, fut loin d’être unanime, et 18 voix seulement contre 11 la décidèrent. Puis il y eut l’interpellation au Sénat (M. Hervé de Saisy). « Mon petit, je vous lâche », me dit Roujon. Et, de fait, il me lâcha. On me représentait comme vendu aux marchands. On me couvrait d’injures. On réclamait ma révocation.
— Heureusement, vous avez su faire front à la tempête…
— Un mot encore. Lorsque nous avons conclu l’arrangement, c’était avec l’arrière-pensée de récupérer les tableaux un jour ou l’autre. « Ils demeurent à vous ! » m’avait dit M. Martial Caillebotte. Je le revis quelques années après, à l’occasion de l’exposition Pissarro. « Ils sont toujours à vous, me répéta-t-il. Vous n’avez qu’à dire un mot. » J’espérais, sans plus attendre, récupérer tout au moins les Baigneurs, de Cezanne, et un Bouquet, de Monet, dont j’avais gardé une vive impression. Mais Dujardin-Beaumetz vint, qui m’interdit toute initiative. Et quand un peu plus tard je repris ma liberté, M. Martial Caillebotte était mort…
*
Nous avons laissé parler M. Léonce Bénédite, plaidant moins sa propre cause que celle de l’administration des musées. Hélas ! Tandis qu’il parlait, nous songions que tout ce qu’il pourrait nous dire ne serait pas pour nous consoler de l’irréparable perte que fit le Luxembourg lorsque, sous d’inconsistants prétextes, le Comité consultatif abandonna aux héritiers Caillebotte 27 peintures — et quelles peintures ! — des Monet, des Sisley, des Pissarro, et la si curieuse Partie de crocket, de Manet, et les deux Cezanne qu’on put admirer au Salon d’Automne de 1905, le fastueux Bouquet de roses et les formidables Baigneurs.
Ces peintures, elles sont aujourd’hui la propriété de Mme veuve Martial Caillebotte. Les unes sont accrochées dans son appartement de la rue Scribe, les autres ornent sa villa de Pornic.
Tabarant. »
Reproduction :
« Cezanne. — Les Baigneurs
(Tableau non retenu par le Comité consultatif des Musées) »
27 février
D’après le livre de stock A de Vollard, le comte Enrico Costa lui achète une toile de Cezanne, n° 3541, « Maisons étagées », 81 x 65 cm, acquise 500 francs de Cezanne (par Bernheim-Jeune) (Gardanne, vue verticale, FWN222-R570).
Livre de stock A de Vollard ; Wildenstein Institute.
Dans le courant de l’année, d’après le livre de stock C de Vollard, le comte lui achètera aussi une autre toile de Cezanne, n° 7035, « Auvers. La Route », 92 x 73 cm, acquise de Cezanne (La Campagne à Pontoise, près du Valhermeil, FWN176-R505).
Livre de stock C de Vollard ; Wildenstein Institute.
Février
D’après le livre de comptes de Vollard, P. Hazard lui achète quatre aquarelles de Cezanne :
– Femme piquant une tête dans l’eau (RW029),
– L’Éternel féminin (RW057),
– Baigneurs au repos (RW061),
– Trois Baigneuses surprises (RW062).
Catalogue des Tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par Barye, Bonvin, E. Boudin, Boulard, Breton, Caillebotte, Cezanne, Charlet, Gustave Colin, Courbet, Daubigny, Decamps, Eug. Delacroix, Fantin-Latour, Gauguin, Hervier, Jongkind, Le Sidaner, Loiseau, Ed. Manet, J.-F. Millet, Cl. Monet, Moreau-Nélaton, Pissarro, P.-A. Renoir, Th. Rousseau, Sisley, Tassaert, Vuillefroy, etc. Nombreuses œuvres de Cals, Corot, Daumier, Guillaumin, S. Lépine, Vignon composant la collection de M. Hazard (première partie), galerie Georges Petit, 1er, 2 et 3 décembre 1919, 160 pages, 392 numéros, nos 257, 259, 260, 258. Rewald John, Les Aquarelles de Cezanne, catalogue raisonné, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1984, 487 pages, 645 numéros, notices 29, 57, 61, 62, p. 90, 97, 99, 100.
7 mars
Vollard vend à monsieur Mondain un paysage de Cezanne, 600 francs, et à Halévy une nature morte, Grenade et Poire dans une assiette FWN799-R558, 250 francs.
Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
7 mars
Halévy achète le tableau Grenade et poires dans une assiette (FWN799-R558) à Vollard, pour 250 francs.
Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 558, p. 377.
21 mars
Fabri achète à Vollard un tableau de Cezanne, Gardanne (vue horizontale) (FWN224-R569).
Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
23 mars
Monet achète à Vollard « Cezanne, vue de Lestac [sic] » (L’Estaque, FWN154-R443), pour 600 francs.
Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,3) f° 37. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 443, p. 299.
Mars ou avril
Début des relations de Cezanne avec Joachim Gasquet (Aix, 31 mars 1873 – Paris, 6 mai 1921), fils d’Henri Gasquet, un camarade de jeunesse qui a été son condisciple au pensionnat Saint-Joseph.
Le peintre, soucieux de sa tranquillité, tente d’échapper aux relations qui l’étouffent :
« Je maudis les Geffroy et les quelques drôles qui, pour faire un article de cinquante francs, ont attiré l’attention du public sur moi. […] je croyais qu’on pouvait faire de la peinture bien faite sans attirer l’attention sur son existence privée. » À Aix, il fréquente Solari, Numa Coste et Henri Gasquet. Il se rend de temps en temps au café Oriental sur le cours Mirabeau où se retrouvent aussi Alexis et Coste. Il offre à Joachim Gasquet un paysage de la Sainte-Victoire, exposé l’année précédente au salon des Amis des arts d’Aix (La Montagne Sainte-Victoire au grand pin, FWN235-R599).
Lettre de Cezanne à Joachim Gasquet, Aix, 30 avril 1896 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 248-249 ; deux dernières pages de la lettre reproduites par Fritz Erpel (sélection par), Paul Cezanne, Ein Traum von Kunst. Der Maler in seinen Briefen, Berlin, Athenäum, 1986, 276 pages.
Joachim Gasquet vient de se marier, le 23 janvier, à Saint-Rémy, avec Marie Girard (Saint-Rémy, 15 août 1872 – Saint-Rémy, 26 février 1960), fille du poète, architecte et archéologue Marius Girard. Elle avait été élue reine du Félibrige pour sept ans, le 6 juin 1892, aux Baux. Henri Gasquet, le père de Joachim, est boulanger à Aix.
Guyot-de Lombardon Chantal, Jouannaud-Besson Magali, Marie et Joachim Gasquet, deux écrivains de Provence à l’épreuve du temps. Une biographie littéraire, Aix-en-Provence, Académie d’Aix éditions, 2011, 270 pages, p. 27, 40.
d’Arbaud Joseph, « Joachim Gasquet », Le Feu, 20e année, nouvelle série, n° 12, 1er juillet 1926, p.
« Je revois ce four flamboyant à la porte duquel souriait le maître Henri Gasquet avec la haute fierté d’avoir un fils grand poète. Je revois ce foyer de famille, plein de travail et de traditions où nous venons nous asseoir, accueillis par Marie Gasquet, la belle reine des félibres et dont les hôtes se nommaient alors Cezanne, Emmanuel Signoret, Louis Le Cardonnel. »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 86-89 :
« Je le connus en 1896. Il n’avait que cinquante-sept ans, mais, brûlé par son martyre intérieur, découragé, souffrant, il paraissait déjà un vieillard. Sa constitution robuste se redressait encore, crispée, nouée dans sa forte race, mais des maux de tête violents l’attaquaient presque chaque soir, le diabète le torturait. Il excédait constamment sa puissance. Nerveux, les yeux striés, le cerveau ravagé, la fièvre au cœur, son doute l’abattait. Travaillant dans la joie, il eût peint jusqu’à cent ans comme le Titien. Il surmenait la bête en lui, faisant toujours ces longues promenades dont il avait gardé la passion, escaladant le mont Victoire, seul, le carnier au dos, sous le soleil ou sous la pluie. Sobre, il déjeunait souvent d’un morceau de fromage, de pain et de quelques noix, sans quitter l’atelier. Un verre de bon vin là-dessus, une tasse de café, et ce régal d’ascète le soutenait jusqu’au soir. Il abominait l’alcool, mais adorait les vieux vins de pays, dont il arrosait de temps en temps quelque large ribote avec Solari ou Paul Alexis. Après les premières chaudes rasades, une flambée comme surnaturelle le mettait debout, redressait ses épaules un peu voûtées, lui embrasait la face. Une étrange lucidité l’animait. Une logique drue, un enthousiasme serré amenaient son émotion à son expression la plus haute. Son lyrisme éclatait. Une irrésistible éloquence le traduisait jusqu’aux plus intimes ressources de la langue et de sa pensée. Qui ne l’a pas écouté dans une de ces heures, où il apparaissait tout entier sublime, ne sait rien de lui. Sa misanthropie, ses airs farouches tombaient. Son érudition, sa tendresse, ses souvenirs se prodiguaient. Il enchaînait les théories, refaisait le monde, aimait, comprenait tout. Son génie persécuté triomphait tout entier. Ironique, ardent, joyeux, sa bonté constructive embrassait toutes choses. C’est ainsi sans doute qu’il eût toujours vécu, si la gloire fût venue à lui.
La première fois que je le vis, il était au café. Solari, Numa Coste, mon père causaient avec lui. C’était un dimanche, à l’heure de l’apéritif. Ils étaient attablés sur le cours Mirabeau, à la terrasse du café Oriental, que fréquentaient Alexis et Coste. La nuit tombait des grands platanes. La foule endimanchée rentrait de « la musique ». Un soir provincial tranquillisait la ville. Ses amis parlaient, lui, les bras croisés, écoutait et regardait. Le crâne chauve, avec sur la nuque de longs cheveux gris encore abondants, une barbiche et d’épaisses moustaches de vieux colonel cachant sa bouche sensuelle, rasé de frais, le teint coloré, il eût paru quelque grognard à la retraite, n’eussent été le large front bosselé de génie, d’une courbe, d’une plénitude admirables, et les yeux sanglants, dominateurs, qui s’emparaient tout de suite du monde et ne vous lâchaient plus. Ce jour-là une jaquette de bonne coupe lui enserrait le torse, un torse robuste de paysan et de maître. Un col bas lui découvrait le cou. Sa cravate noire était parfaitement nouée. Il négligeait parfois sa toilette, traînant en sabots et en chapeau dépenaillé. Il était « bien mis » lorsqu’il y songeait. Il avait dû, ce dimanche-là, passer la journée chez sa sœur.
Je n’étais rien, presqu’un enfant. J’avais vu dans une vague exposition aixoise deux paysages de lui, et toute la peinture m’était entrée dans les yeux. Ces deux toiles m’avaient ouvert le monde des couleurs et des lignes, et depuis une semaine je m’en allais enivré d’un univers nouveau. Mon père m’avait promis de me présenter à ce peintre, bafoué de toute la ville. Je le devinai, là. Je m’approchai, je lui murmurai mon admiration. Il rougit, se mit à bégayer. Puis il se redressa, me déchargea un regard terrible qui me fit rougir à mon tour, me brûla jusqu’aux talons.
« ― Ne vous fichez pas de moi, mon petit, hein ? »
Il ébranla le guéridon d’un formidable coup de poing. Les verres tintèrent. Tout chavira. Je crois que je n’ai jamais eu une plus grande angoisse. Ses yeux se remplirent de larmes. Ses deux mains m’empoignèrent.
« ― Asseyez-vous là… C’est ton petit, Henri ? dit-il en s’adressant à mon père… Il est gentil… » Sa voix de colère traînait maintenant, toute attendrie de bonté, et se tournant vers moi : « ― Vous êtes jeune… Vous ne savez pas, vous. Je ne veux plus peindre. J’ai tout lâché… Écoutez un, peu, je suis un malheureux… Il ne faut pas m’en vouloir… Comment puis-je croire que vous coupez dans ma peinture, pour deux toiles que vous avez aperçues, alors que tous ces… qui pondent de la copie sur moi n’y ont jamais vu goutte… Ah ! ils m’en ont fait un mal, ceux-là… C’est Sainte-Victoire surtout qui vous a tapé dans l’œil. Voyez-vous ça ? Elle vous plaît, cette toile… Demain, elle sera chez vous… Et je la signerai… »
Il se retourna vers les autres.
« ― Causez, vous. Moi, je veux bavarder avec le petit. Je l’emmène… Si on soupait ensemble, dis, Henri ? »
Il vida son verre, me prit sous le bras. Nous nous enfonçâmes dans la nuit, sur les boulevards, autour de la ville. Il était dans un état d’exaltation incroyable. Il m’ouvrit son âme, me dit son désespoir, l’abandon où il se mourait, le martyre de sa peinture et de sa vie, ce « sentiment profond », cette « unité » dont parle Renan et que je voudrais rendre, et dont, ce soir-là, j’eus le frisson, plus loin que l’admiration, jusqu’à l’extase. Je touchais son génie, du cœur. Il m’était sensible. Je n’aurais jamais cru qu’on pût être si grand et si malheureux, et je ne savais plus, lorsque je le quittai, si j’avais la religion de sa souffrance humaine ou le culte de son don surnaturel.
Durant une semaine, je le vis chaque jour. Il me mena au jas de Bouffan, me montra ses toiles. Il fit de grandes courses avec moi. Il venait me chercher le matin, nous ne rentrions que le soir, fourbus, poussiéreux, mais vaillants, prêts à recommencer le lendemain. Ce fut une semaine d’emportement où Cezanne avait l’air de se régénérer. Il était comme ivre. Une même naïveté, je crois, unissait mon ignorante jeunesse à son candide et plein savoir. Tous sujets nous étaient bons. Il ne parlait jamais de lui, mais, au seuil de la vie où j’entrais, il aurait voulu, me disait-il, me léguer son expérience. Il regrettait que je ne fusse pas peintre. Le pays nous exaltait. Il m’en découvrait, il m’en prolongeait toutes les beautés dans toutes les perspectives de son lyrisme et de son art. Il renaissait, à mon enthousiasme. Ce que je lui apportais n’était rien, qu’un souffle de jeunesse, une foi où il rajeunissait. Mais dans cette grande âme tout ce qu’on jetait, le moindre bruit, avait des échos immenses. Il voulait faire mon portrait, celui de ma femme. Il commença celui de mon père. Il l’abandonna dès la première séance, tenté par les escapades que nous faisions au Tholonet, au pont de l’Arc, les repas ensoleillés, arrosés de vieux vin. C’était au printemps. Il étreignait la campagne avec des yeux ravis. Les premières verdures l’émouvaient. Tout l’attendrissait. Il s’arrêtait pour voir fuir la route blanche ou se balancer un nuage. Il ramassait une poignée de terre humide qu’il pétrissait comme pour la posséder de plus près, la mieux mêler à son sang reverdi. Il buvait au creux des ruisseaux.
« ― C’est la première fois que je vois le printemps », disait-il.
Toute sa confiance aussi refleurissait. Il finissait par me parler de son génie. Un soir, dans un abandon de son être, il m’avoua : « Je suis le seul peintre vivant ».
Puis il serra les poings, tomba dans un sombre silence. Il rentra farouche. Comme si un désastre s’était abattu sur lui. Le lendemain, il ne vint pas. Il ne me reçut pas au Jas. J’insistai vainement, durant quelques jours. Puis je reçus ce billet :
« Cher monsieur, je pars demain pour Paris. Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments et mes plus sincères salutations. »
C’était le 15 avril. Les amandiers avaient passé fleurs, autour du Jas où j’allais rôder pour évoquer le maître parti. La frise amie du Pilon du Roi s’inquiétait d’un pâle azur dans le soir. C’est là-devant, dans tous ces champs, ces vergers et ces murs, que Cezanne peignait. »
Gasquet Marie, dans Tombeau de Cezanne, Paris, Société Paul Cezanne, palais du Louvre, 23 octobre 1956, textes d’Edouard Aude, Gaston Berger, Marcel Brion, Jean Cassou, Jean Cocteau, Paul Eluard, André Frénaud, Paul Gachet, Marie Gasquet, Francis Jourdain, Pierre Jean Jouve, André Lhote, André Masson, Darius Milhaud, Henry Mondor, Georges Rouault, Tal-Coat, Jean-Louis Vaudoyer, Vercors, Jacques Villon, 49 pages, p. 30-33 :
« Le culte qui lia à notre grand Cezanne le poète Joachim Gasquet, son cadet de plus de trente ans, avait, en amitié, de solides racines. Cezanne et mon beau-père, amis d’enfance, avaient appris à lire à la même petite école et l’amour du latin que Cezanne découvrit au lycée, pas plus que la sagesse d’Henri Gasquet gagnant la gloriette de son père, le boulanger de la rue Lacépède, pour pétrir comme lui
… le pain de lumière
À la bonne chaleur du four,
ne troubla leur camaraderie.Cependant les longues absences du peintre, son séjour presque continu à Paris, espacèrent si bien leurs rencontres qu’en 1896, l’année même de notre mariage — il y a soixante ans ! — Joachim Gasquet ne connaissait Cezanne que de nom. Il savait par son père que c’était « une crème d’homme, aumônier au possible, quasi malade de désespoir d’être traité de barbouilleur et résolu à ne plus voir personne. Il arrivait sans prévenir, repartait de même, fuyant maladivement tout le monde ».
De vagues échos de L’Œuvre, roman de Zola, quelques rumeurs venues de Paris, confirmaient cette réputation aixoise et ce fut presque par hasard que Joachim Gasquet se trouva brusquement en présence de deux maîtresses toiles de Cezanne égarées dans une aimable exposition de peinture locale.
Bouleversé, il accourut à la maison : « Viens voir ces merveilles ! » me cria-t-il.
Au moment où nous arrivâmes on venait d’accrocher dans une petite salle sacrifiée une admirable vue du bassin du Jas de Bouffan dans lequel se mirent des marronniers d’automne ; dans l’autre salle, on avait placé, soigneusement à contre-jour, une Sainte-Victoire ineffable…
Le soir, à la table de famille, comme le jeune poète, tout son lyrisme déchaîné, ne tarissait pas sur la révélation qu’avaient été pour lui ces deux œuvres éblouissantes, son père lui dit :
— Il est ici, Cezanne. J’ai passé un moment avec lui hier. Qui sait si savoir que tu l’admires ne lui ferait pas du bien ? Veux-tu que je lui demande de faire ta connaissance ? Ce sera peut-être difficile mais on peut toujours essayer…
Trois jours après nous arrivions au Jas. Cezanne s’était pompeusement mis en jaquette et, paralysé de timidité, ne put que balbutier au jeune homme incliné devant lui :
— Alors, c’est vrai, Monsieur, que vous coupez dans la peinture ?
Ne sachant comment « apprivoiser » son ami, mon beau-père risqua quelques jours après :
— Dis donc, Paul, est-ce que ça te chanterait de faire mon portrait ?
— Avec ta pipe et ton chapeau… oui… je veux bien…
Et les séances commencèrent. Cezanne, comme l’avait prévu son vieil ami, s’apprivoisait. Sa conversation, ahurissante d’érudition, réchauffée par l’enthousiasme de l’auditeur qui lui donnait la réplique, était un bel et profitable enchantement. Pour nous détendre, aux minutes de pause, mon beau-père égrenait avec lui de pittoresques souvenirs. Cezanne souriait d’un sourire triste et lointain et je garde, au coin le plus ensoleillé de ma mémoire, le souvenir du jour où j’ai vu pour la première fois un rire franc épanouir son visage tendu.
Négligemment il avait demandé :
— Te souviens-tu, Henri, de la jolie petite blanchisseuse de la rue Suffren qui avait un si beau perroquet ?
— Si je m’en souviens ! Et des sérénades qu’avec X. nous allions lui chanter au temps de Noël !
Comme j’ouvrais de grands yeux, mon beau-père chantant plus faux que les plus faux jetons, il me déclara, docte et rieur :
— Ma chère enfant, vous ne soupçonnez pas à quel point trois hommes chantant faux peuvent donner l’impression de la foule !
Oh ! Cezanne, combien y avait-il de saisons et d’années que vous n’aviez pas ri d’aussi bon cœur ? Quelle bénédiction d’avoir vu sur votre face désolée passer un rayon de la joie de vivre !
Le portrait d’Henri Gasquet achevé, mis dans un coin tourné contre le mur, Cezanne voulut faire celui de mon mari — portrait singulier qui est maintenant à Prague, devant lequel Georges Dumesnil, qui fut l’un des maîtres de Philosophie de Joachim Gasquet à la Faculté d’Aix, lui disait : « Je ne vous connaissais qu’à demi avant d’avoir vu ce que Cezanne a fait de vous. »
Et voilà que, le portrait de mon mari ayant rejoint, tourné aussi contre le mur, le portrait de son père, Cezanne devenu un familier de la maison, ressort son air le plus humble pour me glisser :
— J’aimerais vous peindre dans cette robe ni bleue ni grise dont les ombres sont indéfinissables…
Quelle joie ! Après bien des tergiversations, le Maître décida de me peindre de face, assise dans le coin d’un vieux canapé Louis XIII, près de la cheminée, les mains abandonnées sur les genoux. Nous étions en plein hiver. Les jours étaient courts, la lumière la plus favorable étant celle de midi à 3 heures, il fut convenu que Cezanne prendrait avec nous son repas à 11 heures, serait à l’œuvre « à l’Angélus sonnant », et demandait qu’on le laissât travailler seul pour ne troubler ni lui ni le modèle.
Ainsi fut fait. Sur une grande belle toile le Maître me dessina 3/4 nature, le bas de la jupe se perdant dans le cadre, l’intérêt concentré sur le visage et sur les mains.
Les premières séances nous comblèrent d’espoir. Mais, lorsque vint la dixième, le froid étant très vif et Cezanne frileux, la salamandre, qui n’était pas à un mètre de moi, fut mise à grande marche…
La chaleur m’endormit…
Lorsque je me réveillai, Cezanne avait roulé sa toile, rangé ses pinceaux, fermé sa boîte, éloigné sa palette et, atterré, contemplait mon réveil.
— Écoutez un peu, me dit-il lorsque j’ouvris tout à fait les yeux, il faut me pardonner. Je ne suis pas un homme du monde, moi, et parce que la couleur de votre robe m’intéressait j’ai été d’une impardonnable indiscrétion. Je suis navré d’avoir à ce point abusé de votre gentillesse…
Navré… et nous donc ! Prières, supplications, rien ne put décider le Maître à reprendre son œuvre. Ce que la belle esquisse est devenue ? Nul ne le sait. Mais ce que je sais bien, hélas ! c’est que je ne suis pas consolée de sa perte et qu’il m’arrive encore de soupirer : « Le plus beau portrait que l’on ait fait de moi est celui qui s’est perdu dans mon sommeil… »
Marie GASQUET. »
Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 174 :
« Cezanne avait malgré ses fréquents découragements conscience de sa valeur et n’hésitait pas, à l’occasion, de dire ouvertement sa pensée. « Il n’y a qu’un seul peintre vivant, c’est moi ! », déclare-t-il (2).
Et une autre fois, il coupe une discussion politique en disant : « Des hommes politiques, il y en a deux mille à chaque législature, mais un Cezanne, il n’y en a que tous les deux siècles » (3). […]
Quand le peintre Louis Le Bail lui demanda quelles œuvres il préférait en peinture, Cezanne lui répondit : « les miennes, si j’étais arrivé à réaliser ce que je cherche » (3).
(2) Renseignements communiqués par M. Maxime Conil et P. Cezanne fils.
(3) Renseignements communiqués par M. Louis Le Bail. »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 20 :
« Jusqu’à la fin, il a gardé cette merveilleuse mémoire, mémoire de l’œil et de l’oreille, de l’esprit comme du cœur. Je me souviens de ma stupeur, lorsque, retrouvant mon père, qu’il n’avait plus revu depuis trente ans, il lui rappela le coin de rue où il l’avait quitté, les mots insignifiants qu’ils avaient alors échangés, la bonne femme en caraco gris qui les regardait d’une fenêtre où caquetait un perroquet, et le bariolage d’un rideau qui se détachait sur un mur derrière elle.
Dans ses vieux jours, perclus de travail, travaillé de douleurs, harassé, il ne lisait presque plus. Que de fois pourtant, devant quelque horizon, à la campagne ou à Paris, devant une étude en train, à l’atelier, rythmant les syllabes de son pinceau levé, lui ai-je entendu réciter des vingtaines de vers de Baudelaire 1 ou de Virgile, de Lucrèce ou de Boileau. En parcourant le Louvre, il savait, à une année près, la provenance des toiles, et dans quelle église, quelle galerie, on pourrait trouver leurs répliques. Il connaissait admirablement les musées d’Europe. Comment ? Lui, qui ne les avait jamais visités, n’ayant presque pas voyagé ? C’est, je crois, qu’il lui suffisait de lire, de voir une chose une fois, pour s’en souvenir à jamais. Il regardait, il lisait très lentement, presque douloureusement ; mais la date, le morceau du monde qu’il arrachait à la terre ou au livre, il les emportait, gravés, enfouis en lui, sans que rien désormais les en pût déraciner.
1 Il savait les Fleurs du Mal par cœur. »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 78 :
« Avec mon père et ses vieux compagnons de collège il montrait des délicatesses de cœur infinies. »
A une date indéterminée, mais peut-être peu après leur première rencontre, Cezanne et Joachim Gasquet visitent ensemble le musée d’Aix.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 26-29 :
« Il allait au musée. L’exemple de Granet, un pauvre maçon d’Aix, recueilli et poussé par Ingres, l’enflammait. Il en admirait les quelques toiles qu’il pouvait voir, d’une honnêteté appliquée, d’une conviction, d’une bonhomie toute populaire sous leur tension académique, les études plus directes que Granet avait rapportées de Rome. Il y a dans certains de ces tableautins comme un pressentiment de Corot. Cezanne me le fit un jour remarquer. Il trouvait même que, dans le vivant portrait, gloire du musée d’Aix, qu’Ingres a peint de son élève, et où Granet, les yeux impérieux, se détache si magnifiquement, avec ses dures mèches de marbre noir, sur un ciel d’orage qui menace Rome, il trouvait que dans les fonds ― un pin, une haute façade ― Ingres, en grand psychologue, s’assimilant et portant à la perfection la manière tâtonnante du peintre qu’il était en train d’immortaliser avait d’un bond atteint, pour une fois, Corot.
« ― L’amitié, concluait-il, a de ces récompenses… Et ce Corot, lui, quel portrait il a peint de Daumier ! Tout le cœur des deux peintres y respire… Tandis qu’Ingres, oui, malgré lui, a flatté, voyez, transfiguré son modèle… Comparez-le à ses autres portraits, ses croûtes qui lui ressemblent. »
[…] Un autre portrait qu’il contemplait souvent, au musée d’Aix, et qui dut l’impressionner dans sa jeunesse, c’était celui, tout pensif, du vieux Puget désabusé, qui s’est peint lui-même, regardant tristement ses rêves, sa palette à la main.
« ― Hein ! faisait Cezanne, nous sommes loin du « mélancolique empereur », mais regardez ce vert dans les tons de la joue… Rubens, hein ?…
Comme il y a tout Delacroix dans son aquarelle au Centaure, à Marseille, cette Éducation d’Achille que je préfère à ses marbres, oui !… avec son couple dans le repli des terres, son emportement, l’héroïsme envolé de l’enfant, les tragiques teintes, la violence de mistral qui bouscule et tonifie les tons… oui, oui. Je le dis souvent, il y a du mistral dans Puget. »
Et à côté, il tombait en arrêt devant les Joueurs de cartes attribués à Lenain.
« ― Voilà comment je voudrais peindre !… »
Il me ramenait souvent devant ce tableau, où, dans un corps de garde, quelques soldats, un vieux qui serre sa bourse, un autre, tout jeune et blond, en cuirasse, dans une pose apprêtée, achèvent une partie autour d’une bouteille.
« ― Voilà comment je voudrais peindre !… »
Y avait-il une ironie naïve sous ces paroles du vieux peintre devant une toile qui m’apparaissait médiocre, lui qui avait assis, dans sa claire cuisine de ferme, des joueurs de cartes aussi, mais autrement massifs, solides et vivants, et d’une couleur, en face de ces tons enfumés, autrement vive, sentie et pénétrante ? Ne fallait-il y entendre qu’un touchant ressouvenir, un enthousiasme d’enfance pieusement prolongé et peut-être, joint aux jeudis du Jas, inspirateur d’un sujet analogue ? Il y avait en Cezanne un tel mélange de foi et de goguenardise, d’emballement sincère et de scepticisme enjoué, qu’il serait bien difficile de le démêler. Ah ! il était bien provençal, le vieux maître ! Et comme il le savait…
« ― Écoutez un peu, disait-il, le Forcés pas de nos pères n’est que la traduction familière du Rien de trop, gravé sur le fronton de Delphes. »
Et il souriait de lui-même alors, lui tout pétri d’élans, torturé d’une sorte de romantisme mystique que sa claire raison, sa lucidité latine d’observateur n’arrivaient pas à maîtriser. Oui, la plus frémissante sensibilité aux prises avec la raison la plus théorique, je serais bien tenté de définir ainsi le drame de sa vie. Il était bien parfois ce « visionnaire affolé, que le tourment du vrai jetait à l’exaltation de l’irréel », tel que nous l’a décrit Zola. »
19 mars
Degas achète chez Vollard une « étude » de Cezanne, Une poire, un citron, une 1/2 assiette (Deux fruits, FWN797-R557), pour 200 francs. Une note, de la main de Degas, décrit le petit tableau ainsi : « Poire verte, citron, assiette à gauche coupée ».
Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 557, p. 377.
26 mars
Vente à l’hôtel Drouot de tableaux, pastels, aquarelles, dessins, eaux-fortes et lithographies composant la collection d’Emmanuel Chabrier. Parmi les œuvres se trouvent Les Moissonneurs (FWN651-R301), de Cezanne, acheté par Chabrier deux ans auparavant à la vente Duret, que Durand-Ruel achète, pour 500 francs. Durand-Ruel revendra le tableau le 27 mars 1896 à Maurice Leclanché, pour 525 francs.
Archives Durand-Ruel, Paris, Les Moissonneurs, livre de stock, n° 3695.
Catalogue de tableaux, pastels, aquarelles, dessins, eaux-fortes et lithographiques composant la collection Emmanuel Chabrier et dont la vente aura lieu hôtel Drouot, salle n° 6, le jeudi 20 mars 1896, commissaire-priseur Me Paul Chevallier, expert M. Durand-Ruel, préface d’André Maurel, 24 pages, 38 numéros, Cezanne p. 7 :
« CÉZANNE
2 ― Les Moissonneurs.
Dans un champ bordé au fond par une colline où se dressent quelques maisons, des moissonneurs rentrent la récolte.
Au premier plan, vers la droite, leurs compagnons se reposent à l’ombre d’un bouquet d’arbres.
Toile. Haut., 43 cent. ; larg., 54 cent.
Vente Duret, 19 mars 1894,
n° 5 du Catalogue. »
« Lettres, sciences et arts », Journal des débats politiques et littéraires, 108e année, n° 88, samedi 28 mars 1896, p. 5 :
« La vente de la collection Emmanuel Chabrier a eu lieu hier ; c’était la plus importante mise aux enchères de tableaux de l’école impressionniste qui ait eu lieu depuis la vente de la collection Théodore Duret en 1894. Les 34 numéros de tableaux et d’aquarelles ont produit environ 70,000 francs. Le Bar des Folies-Bergère, l’un des tableaux les plus connus de Manet, qui avait difficilement atteint 3,000 fr. à la vente de l’atelier de l’auteur, en 1884, a fait cette fois 23,000 fr. ; le Skating, de Manet également, 10,000 fr, la Femme nue de Renoir, 8,000 fr., et sa Sortie du Conservatoire, 1,500 fr. De Claude Monet, les Bords de la Seine se sont vendus 3,600 fr., le Parc Monceau, 3,050, et la Fête nationale rue Saint-Denis, 2,200 fr. Notons encore de Cezanne, les Moissonneurs, 500 fr., et la Seine au Point-du- Jour de Sisley, 1,850 fr. »
« Mouvement des arts. Collection Emmanuel Chabrier », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 14, 14 avril 1896, p. 131 :
« MOUVEMENT DES ARTS
Collection Emmanuel Chabrier
Vente faite à l’hôtel Drouot, le 26 mars, par Me P. Chevallier et M. Durand-Ruel.
Produit : 60.615 francs.
Tableaux. — 2. Cezanne. Les Moissonneurs : 500. »
31 mars
Le comte de Takora achète deux aquarelles de Cezanne à Vollard pour 100 et 50 francs.
Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
Avril
Visa de la gendarmerie sur le livret militaire de Paul junior avec pour adresse : 58, rue des Dames (renseignement communiqué par Philippe Cezanne)
1er avril
Monet demande à Durand-Ruel de lui expédier à Giverny plusieurs tableaux lui appartenant, dont trois Cezanne.
Lettre de Monet à Durand-Ruel, 1er avril 1896 ; Wildenstein Daniel, Monet. Vie et œuvre, Lausanne Paris, Bibliothèque des arts, tome IV, 1985, n° 1344, p. 291.
3 avril
Cezanne se fait rapporter son matériel de peinture laissé chez Geffroy.
Geffroy Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Crès, 1922, 362 pages, réédition Paris, Macula, 1980, p. 197.
8 avril
Pissarro écrit à son fils Lucien.
« Arsène Alexandre est venu lundi voir ma collection, il a trouvé les Vieux toits de Rouen très beaux, et a beaucoup insisté pour l’exposer, je m’y suis décidé enfin. Tant pis ! c’est du reste si différent de Monet que, j’espère, les camarades n’y verront pas en cela de malice de ma part. Il n’y a en somme que Cezanne qui pourrait trouver à redire, mais je m’en moque pas mal, chacun fait ce qu’il peut. »
Lettre de Pissarro, Eragny-Bazincourt par Gisors, Eure, à son fils Lucien, 8 avril 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1232, p. 188.
15 avril
Cezanne prévient Joachim Gasquet qu’il compte partir à Paris le lendemain :
« Aix, 15 avril 1896.
Cher Monsieur,
Je pars demain pour Paris 2. Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments et mes plus sincères salutations.
Paul Cezanne 3 »
- Le poète aixois Joachim Gasquet (1873-1921), fils d’un condisciple de Cezanne, venait de rencontrer le peintre auquel il consacrera un livre paru en 1921. Gasquet connut Cezanne quelques mois après sa première exposition chez Vollard en nov.-déc. 1895 (à l’occasion de laquelle Geffroy lui consacra un nouvel article bienveillant). L’enthousiasme de son juvénile « compatriote » semble avoir beaucoup touché l’artiste qui lui offrit une vue de la montagne Sainte-Victoire (V 454 [FWN235-R599]). Pendant leurs nombreuses promenades et leurs interminables conversations, ce fut sans doute surtout le volubile poète qui tenait la parole.
- Cezanne n’avait nullement l’intention de quitter Aix (comme il résulte de la lettre suivante, écrite quinze jours plus tard). Mais comme il ne savait probablement pas comment se défaire de l’amitié un peu trop encombrante du jeune homme, il choisit cette excuse assez faible pour pouvoir se retirer une fois de plus dans son isolement habituel.
Lettre de Cezanne à Gasquet, datée « Aix, 15 avril 1896 », Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet, suivi de Souvenirs de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, 75 pages, reproduction de la lettre ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 249.
15 avril
D’après le livre de stock B de Vollard, Geffroy lui achète trois toiles de Cezanne : n° 3991, « Tête de femme », 22 x 14 cm, achetée 25 francs à Cezanne (Esquisse d’un portrait de madame Cezanne, FWN467-R533) ; Esquisse d’un portrait du fils de l’artiste (FWN469-R534), pour 50 francs ; Marronniers et ferme du Jas de Bouffan (FWN202-R538).
Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute. Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
16 avril
D’après le livre de stock B de Vollard, (Mary) Cassatt lui achète pour 200 francs une toile de Cezanne, n° 3576, « Nature morte. Fruits sur coin de nappe », 25 x 44 cm (Pommes et linge, FWN763-R339).
Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute.
19 avril
Geffroy achète à Vollard le tableau de Cezanne Marronniers et ferme du Jas de Bouffan (FWN202-R538), pour 400 francs.
Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 538, p. 365.
29 avril
Maufra achète à Vollard le tableau de Cezanne Cinq pommes (FWN469-R534).
30 avril
Lettre de Cezanne à Joachim Gasquet :
« Aix, 30 avril 1896
Cher Monsieur Gasquet,
Je vous ai rencontré au bas du cours, ce soir, vous étiez accompagné de Madame Gasquet. Si je ne me trompe, vous m’avez paru fortement fâché contre moi. ―
Si vous pouviez me voir, vous en dedans, l’homme du dedans, vous ne le seriez pas. Vous ne voyez donc pas à quel triste état je suis réduit, pas maître de moi, l’homme qui n’existe pas et c’est vous qui voulez être philosophe, qui voulez finir par m’achever. Mais je maudis les Geffroy 1 et les quelques drôles qui pour faire un article de 50 francs ont attiré l’attention du public sur moi. Toute ma vie, j’ai travaillé pour arriver à gagner ma vie, mais je croyais qu’on pouvait faire de la peinture bien faite sans attirer l’attention sur son existence privée. Certes un artiste désire s’élever intellectuellement le plus possible, mais l’homme doit rester obscur. Le plaisir doit résider dans l’étude. S’il m’avait été donné de réaliser, c’est moi qui serais resté dans mon coin, avec les quelques camarades d’atelier, avec qui nous allions boire chopine. J’ai encore un brave ami 2 de ce temps-là, eh bien, il n’est pas arrivé, n’empêche pas, qu’il est bougrement plus peintre que tous les galvaudeux à médailles et décorations, que c’est à faire suer ; et vous voulez qu’à mon âge, je croie encore à quelque chose. D’ailleurs je suis comme mort. Vous êtes jeune, et je comprends que vous vouliez réussir. Mais à moi que me reste-t-il à faire dans ma situation, c’est de filer doux, et n’eut été que j’aime énormément la configuration de mon pays, je ne serais pas ici.
― Mais je vous ai assez ― embêté, comme ça et après que je vous ai expliqué ma situation, j’espère que vous ne me regarderez plus, comme si j’avais commis quelque attentat, contre votre sûreté. ―
Veuillez, cher monsieur, et en considération de mon grand âge, agréer mes meilleurs ― sentiments et souhaits que je puisse faire pour vous. ―
Paul Cezanne »
- Cette allusion assez inattendue est une preuve de plus que Cezanne bêchait alors ses amis les uns auprès des autres. Il est vrai que Geffroy était ce qu’on peut appeler un homme « de gauche » et que son livre sur la vie du socialiste et révolutionnaire L.-A. Blanqui, paru en 1897, avait fait grand bruit. Cezanne, catholique pratiquant, ne pouvait partager les vues politiques de l’homme de lettres ; quant à Gasquet, il était royaliste. Il est même possible que le peintre ait renoncé à terminer le portrait de Geffroy parce que, pendant les séances de pose, il avait développé une certaine antipathie pour son modèle. Voir à ce sujet : Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet, suivi de Souvenirs de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, 75 pages.
- Cet artiste était peut-être Achille Emperaire dont Cezanne semble s’être rapproché vers cette époque.
- Gasquet a raconté dans son livre sur Cezanne comment, à la réception de cette lettre, il accourut au Jas de Bouffan et comment le peintre, dès qu’il le vit, lui ouvrit les bras. « N’en parlons plus, dit-il, je suis une vieille bête. Mettez-vous là. Je vais faire votre portrait. »
Lettres de Cezanne à Joachim Gasquet, datée « Aix, 30 avril 1896 » ; Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet, suivi de Souvenirs de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, 75 pages, lettre reproduite ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 249-250 ; Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 86-88.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 89-92 :
« Brusquement, le 30, je le rencontrai, revenant du Jas, le carnier à l’épaule, rentrant à Aix. Il n’était pas parti. Mon premier mouvement fut de courir à lui. Il marchait, accablé, effondré en lui-même et comme foudroyé, sans rien voir, semblait-il. Je respectai sa solitude. Une infinie, une douloureuse admiration m’angoissa. Je le saluai. Il passa, sans nous apercevoir, sans me rendre mon salut du moins. Le lendemain, je reçus la poignante, la terrible, la prodigieuse lettre que voici…
J’ai longtemps hésité à la transcrire. Elle est d’une nudité d’âme épouvantable. Mais cette âme y respire, tout entière souffrante, avec un tel sanglot, elle est d’une humilité si farouche, d’une humanité si tragique, d’une si divine détresse, qu’il me semblerait, au contraire, trahir son culte, en refusant ces larmes brûlantes à la religion de ses fidèles. Que ceux qui ont ri de cet homme comme de tout ce qui les dépasse avec une apparence de faiblesse, le sachent à la fin. Il y a des regards qui torturent les charitables, et tout génie est charité en son essence. Voilà jusqu’où peut mener l’incompréhension d’une œuvre par ceux à qui elle s’adresse, à quel supplice intérieur la persécution anonyme peut livrer un artiste tout pétri de bonté et de force, né pour aimer et consoler les siècles, mais rejeté par les siens et son temps. Pour moi, derrière ces lignes sanglantes, je vois monter le visage dramatique de mon vieux maître, tel qu’il s’est peint, un jour, presque hagard, immense et doux, halluciné et volontaire, d’une tendresse qui vous fouille et tout surgi, en sa colère bleue, d’on ne sait quelle ombre évangélique où a passé Rembrandt.
[citation de la lettre de Cezanne à Gasquet du 30 avril 1896]
Je courus au Jas. Dès qu’il me vit, il m’ouvrit les bras. « ― N’en parlons plus, dit-il, je suis une vieille bête Mettez-vous là. Je vais faire votre portrait. »
Je ne posai que cinq ou six fois. Je crus qu’il avait abandonné cette toile. Je sus plus tard qu’il y avait consacré une soixantaine de séances et que, lorsque durant nos entretiens, il me scrutait d’un regard fixe, c’est qu’il songeait à son œuvre, et qu’il y travaillait, après mon départ. Il voulait dégager la vie même, des traits, le frisson, de la parole, et sans que je m’en doute, il m’amenait à l’état d’expansion où il pouvait surprendre l’âme de l’être dans l’emportement passionné de la discussion et l’éloquence secrète que même le plus humble emprunte à sa colère ou à son enthousiasme. C’était d’ailleurs un de ses procédés, surtout lorsqu’il attaquait un portrait, de travailler souvent, le modèle parti. C’est ainsi qu’il a peint le beau et perspicace portrait de M. Ambroise Vollard. Durant de nombreuses séances, Cezanne, paraît-il, donnait à peine quelques coups de pinceau, mais ne cessait de dévorer des yeux son modèle. Le lendemain M. Vollard retrouvait la toile avancée par trois ou quatre heures de labeur acharné. Le portrait de mon père fut peint aussi d’après la même méthode. J’insiste, parce qu’on a souvent prétendu que Cezanne ne pouvait pas peindre, et même n’avait jamais peint, sans le modèle immédiat. Il avait la mémoire des couleurs et des lignes, comme pas un peut-être ; c’était par une soumission à la Flaubert, « la contemplation des plus humbles réalités », qu’il s’astreignait avec une volonté terrible à la copie directe où son lyrisme s’enchaînait. « La lecture du modèle et sa réalisation, écrivait-il, est quelquefois très lente à venir. » De là, je crois, cette âpreté apparente qui cache la tendresse humaine de ses plus belles toiles. Ici encore, sa raison constructive s’appuyait, pour mieux la dominer, sur la réalité austère et maîtrisait son imagination sensible. Une fois, dans son portrait à lui, il a laissé l’émotion l’emporter. Et la toile, dans un musée idéal, peut être suspendue entre un Rembrandt et un Tintoret ; elle rayonne de la même intensité ramassée, de la même concentration glorieuse.
Durant tout ce premier mois de mai où je le connus, je le vis presque chaque jour. »
Au printemps
Vollard rend visite à Cezanne à Aix (« après l’exposition de ses tableaux dans mon petit magasin de la rue Laffitte »). C’est la première fois que le marchand rencontre le peintre, qui, jusqu’à présent, n’avait eu affaire qu’à Paul Cezanne fils. Vollard décrit les murs de l’atelier du peintre où sont accrochées des gravures et des photographies : Les Bergers d’Arcadie de Poussin, Le vivant portant le mort de Luca Signorelli, des Delacroix, L’Enterrement à Ornans de Courbet, L’Assomption de Rubens, un Amour attribué alors à Puget, des Forain, la Psyché de Prud’hon, Les Romains de la décadence de Couture (1847).
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 95-105 :
« VI
MA VISITE A CÉZANNE
(1896)
Stendhal trouve abominablement laide la route s’étendant de Marseille à Aix. Pour moi ce trajet fut un enchantement : il me semblait que les rails du chemin de fer se déroulaient à travers des toiles de Cezanne.
Quand je fus en présence du peintre, j’eus peine à retenir un cri de surprise. Je reconnaissais un passant qui, deux ans auparavant, était entré voir chez moi une exposition d’œuvres de Forain. Après avoir tout examiné avec la plus grande attention, la main déjà sur le bec-de-cane de la porte, il m’avait dit : « Vers 1875, étant un jour au Louvre, j’ai vu un jeune homme qui copiait un Chardin ; je me suis approché, et, après avoir regardé son ouvrage, j’ai pensé : il arrivera, car il s’applique à dessiner dans la forme ! C’était votre Forain ! »
Cezanne était venu à moi les mains tendues. « Mon fils m’a parlé souvent de vous. Excusez un peu, monsieur Vollard, je vais me reposer jusqu’au dîner. Je reviens du « motif ». Paul va vous faire voir l’atelier. »
Le premier objet qui frappa mes yeux, dès le seuil de la porte, fut une grande figure de Paysan percée de coups de couteau à palette. Cezanne s’emportait pour les raisons les plus futiles, et même sans raison, et passait sa colère sur ses toiles. Lorsque, par exemple, voyant à son fils la mine un peu fatiguée, il s’imaginait que le jeune garçon « découchait », malheur à la toile qui se trouvait sous sa main ! J’ajouterai qu’on peut reprocher aussi à « Paul » enfant la destruction de quelques « Cezanne ». Il y faisait des trous, à la grande joie de son père : — « Le fils a ouvert les fenêtres et les cheminées ; il voit bien, le petit bougre, que c’est une maison ! »
Dans son entourage, on avait un tel respect pour le peintre, que lorsqu’il laissait dans le jardin, ou jetait sur le poussier, dans son atelier, une toile lacérée, on veillait à ce qu’elle fût mise au feu. Aussi peut-on citer comme un cas unique le sauvetage d’une nature morte que Cezanne avait jetée par la fenêtre et qui resta longtemps accrochée à la branche d’un cerisier. Comme on avait vu Cezanne rôder autour de l’arbre, armé d’une gaule, on pensa qu’il avait le dessein de « reprendre » son tableau, et l’on se garda d’y toucher.
J’assistai au décrochage de la toile. Je me promenais dans le jardin avec Cezanne et son fils ; le peintre, qui marchait à quelques pas en avant, la tête un peu inclinée, se retourna tout à coup, et s’adressant à son enfant : « Fils, il faudrait décrocher les pommes. J’essaierai de pousser cette étude ! »
Cezanne aimait passionnément les choses d’art ; mais il les voulait dans les musées, leur place naturelle. Aussi ne voyait-on dans son atelier ni tableaux rares, ni meubles précieux, rien enfin de ce bric-à-brac dont les artistes sont si friands. Par terre, gisait un gros carton bourré d’aquarelles ; sur une assiette, quelques pommes achevaient de pourrir, sans cesser de poser ; près de la fenêtre pendait un rideau, qui depuis toujours servait de fond pour les tableaux de figures ou de natures mortes ; enfin, aux murs, des gravures ou des photographies représentaient, tant bien que mal, plutôt mal, les Bergers d’Arcadie, de Poussin ; le Vivant portant le Mort, de Lucas Signorelli ; des Delacroix ; l’Enterrement d’Ornans, de Courbet ; l’Assomption, de Rubens ; un Amour, de Puget ; des Forain ; la Psyché, de Prud’hon, et même l’Orgie romaine, de Couture.
Au diner, où j’avais été invité, Cezanne se montra très gai. Ce qui me frappa surtout, ce fut son extrême politesse et toutes ses manières pour demander à ses voisins les moindres services. Son mot favori était : « Excusez un peu ! » Malgré tant de bonhomie et de courtoisie, je n’en surveillais pas moins mes paroles, appréhendant de faire éclater la colère de Cezanne, toujours prête à se manifester. Encore, toutes mes précautions ne m’empêchèrent-elles pas de commettre la « forte gaffe ». On avait parlé de Gustave Moreau. Je dis : « Il parait que c’est un professeur excellent. » Au moment où je pris la parole, Cezanne portait son verre à ses lèvres ; il s’arrêta sans le reposer, tandis que de l’autre main il faisait un cornet pour mieux écouter, étant un peu dur d’oreilles. Il reçut en plein ce mot de « professeur », qui lui fit l’effet d’une décharge électrique :
« Les professeurs, s’exclama-t-il, en reposant si violemment son verre qu’il le brisa, ce sont tous des salauds, des châtrés, des j. f… ; ils n’ont rien dans le venntrrre ! »
J’étais atterré. Devant le dégât dont il était l’auteur, Cezanne resta tout d’abord interdit. Puis, ayant éclaté d’un rire nerveux, il reprit, revenant à Gustave Moreau : « Si cet esthète si distingué ne fait que des vieilleries, c’est que ses rêves d’art sont suggérés non par l’émotion de la nature, mais par ce qu’il a pu voir dans les musées, et, plus encore, par un esprit philosophique qui lui vient de la connaissance trop grande qu’il a des maîtres qu’il admire. Je voudrais avoir ce brave homme sous ma coupe pour lui suggérer l’idée si saine, si réconfortante, et seule juste, d’un développement d’art au contact de la nature. Le grand point, comprenez, monsieur Vollard, c’est de sortir de l’École et de toutes les Écoles ! Pissarro ne se trompait donc pas. Il allait un peu loin, cependant, lorsqu’il disait qu’il fallait brûler les nécropoles de l’Art. » Un instant après, on cita le nom d’un jeune Aixois, qui venait d’être reçu bachelier ès-sciences à Paris. Alors, pour honorer la ville d’Aix, et tout heureux aussi d’avoir trouvé à dire quelque chose dont l’extrême banalité échappât à toute critique, j’émis cette idée qu’Aix devait être fière d’avoir donné le jour à un futur savant. M. Cezanne fils me fit un signe. Je ne cherchai pas à approfondir sur l’instant ; mais, en sortant de table, j’eus l’explication de ce geste. « Mon père, me dit le jeune homme, a horreur des savants : il trouve qu’un savant vaut un professeur. » On n’en vit point, heureusement, ce soir-là, de savants, ni de professeurs, de sorte que tout alla pour le mieux ; pendant le reste du repas, on continua, de plus belle, à parler peinture et littérature. Cezanne cria son enthousiasme pour Courbet, « mis à part qu’il est un peu lourd comme expression ». Je lui parlai de Verlaine ; au lieu de me répondre, se levant, il récita ces vers :
Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d’été si doux :
Au détour d’un sentier, une charogne infâme,
Sur un lit semé de cailloux,
Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d’exhalaisons.Quand il s’arrêta, je ramenai dans la conversation le nom de Verlaine… Cezanne m’interrompit : « Un qui est fort, c’est Baudelaire. Son Art romantique est épatant, et il ne se trompe pas sur les artistes qu’il apprécie. »
Cezanne ne pouvait souffrir ni Van Gogh, ni Gauguin. Émile Bernard raconte que, Van Gogh ayant fait voir de ses toiles à Cezanne en lui demandant ce qu’il en pensait, Cezanne répondit :
« Sincèrement, vous faites une peinture de fou (1) ! »
Et quant à Gauguin, il l’accusait d’avoir essayé de lui « chiper sa petite sensation ». Je ne manquai pas, à ce propos, de dire à Cezanne combien Gauguin avait pour lui d’admiration et de respect ; mais déjà Cezanne ne pensait plus au peintre de Tahiti. « Comprenez un peu, monsieur Vollard, me disait-il, en cherchant à m’apitoyer sur son propre sort : j’ai une petite sensation, mais je n’arrive pas à m’exprimer ; je suis comme qui posséderait une pièce d’or sans pouvoir s’en servir ! »
Pour changer les idées du maître, je lui appris qu’un amateur venait d’acquérir, d’un coup, à mon magasin, trois tableaux de lui. « C’est un compatriote ? » s’enquit Cezanne. — « C’est un étranger, un Hollandais. » — « Ils ont de beaux musées ! » Désireux de montrer mes connaissances en art, je vantai la Ronde de nuit. Cezanne m’interrompant : « Je ne connais rien de plus crevant que tous ces gens se pressant dans la salle de la Ronde de nuit, avec un air d’extase, les mêmes qui vomiraient dessus, si Rembrandt se mettait à baisser de prix… Mais en attendant, si j’avais seulement besoin de me moucher, il fallait m’en aller. Et puis le grandiose, je ne le dis pas en mauvaise part, finit par fatiguer. Il y a aussi des montagnes, quand on est devant, on crie : N. de D…, mais pour tous les jours, un simple coteau vous suffit très bien. Dites, monsieur Vollard, cela m’emm..derait d’avoir dans ma chambre à coucher le Radeau de la Méduse. » Puis soudain : « Ah ! quand donc verrai-je un tableau de moi dans un musée ? » Justement le directeur de la Galerie nationale de Berlin, M. de Tschudi, désirait acquérir un Jas de Bouffan. J’en fis part à Cezanne, et je déplorais à ce propos les préventions de l’empereur d’Allemagne contre l’école « impressionniste ». « Il est dans le vrai, s’écria Cezanne : on se fout dedans avec les impressionnistes ; ce qu’il faut, c’est refaire le Poussin sur nature. Tout est là. » Et, se penchant vers moi d’un air de confidence, mais sur le ton élevé habituel aux gens durs d’oreille : « Guillaume est très fort ! » J’eus pourtant bientôt l’occasion de voir que l’accord n’était pas complet entre l’empereur d’Allemagne et Cezanne, Comme je prononçais le nom de ce Kaulbach, dont on rapporte que Guillaume aime à dire « Nous avons, nous aussi, un Delaroche ! » Cezanne fulmina : « Je n’admets pas la peinture de châtré ! »
On parla de Corot. Cezanne, d’une voix étranglée par le rire : « Émile disait qu’il se laisserait aller à goûter pleinement Corot si, au lieu de nymphes, il avait peuplé ses bois de paysannes. » Et, se levant, le poing tendu vers un Zola imaginaire : « Bougre de crétin ! » Puis, sa fureur subitement tombée, mais avec un reste d’émotion dans la voix : « Excusez un peu, j’aime tant Zola ! » Quant à Puvis de Chavannes, je n’avais pas besoin de lui demander ce qu’il en pensait. Renoir m’avait raconté qu’un jour, dans l’atelier d’un de leurs amis, on parlait de Puvis, et chacun de faire l’éloge du Pauvre Pêcheur. Cezanne, que l’on croyait endormi sur le canapé, se soulevant à moitié, dit : « Oui, c’est bien imité ! » Je dois ajouter qu’à mon exposition de Cezanne, Puvis de Chavannes, après avoir regardé attentivement les toiles, s’en était allé en haussant les épaules.
Cezanne ne goûtait pas davantage Whistler, ni Fantin-Latour, qui le lui rendaient bien. Ayant eu l’occasion de voir chez moi le portrait de la Sœur de Cezanne, qui ressemble si étrangement à un Greco, Whistler dit sérieusement : « Si un enfant de dix ans avait dessiné cela sur son ardoise, sa mère, si elle est une bonne mère, l’aurait fouetté ! »
Même note chez Fantin-Latour. Je m’étais rencontré, chez ce peintre, avec un conservateur du Louvre, à qui je demandai l’autorisation d’apporter au musée un ou deux Cezanne, à fin de confrontation avec les tableaux de Chardin et de Rembrandt. Fantin Latour était la bienveillance même, et n’exprimait jamais que des vérités atténuées, surtout sur les peintres ; mais, à la seule vision d’une toile de Cezanne promenée à travers les salles du Louvre, il éclata : « Ne jouez pas chez moi avec le Louvre ! »
(1) Mercure de France, 16 décembre 1908, p. 607. »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 209-210 :
« Dans mon livre sur Cezanne, j’ai parlé de la visite que je fis au peintre à Aix, sa ville natale, après l’exposition de ses tableaux dans mon petit magasin de la rue Laffitte.
Comment ne donnerais-je pas encore un souvenir à cette époque à la fois si lointaine et si proche ? Comment taire mon émerveillement durant le trajet de Marseille à Aix, pendant que défilaient, devant la glace de mon compartiment, tous ces paysages où je retrouvais les tableaux de Cezanne ? Comment ne pas évoquer, une fois de plus, la ferveur du peintre, le pinceau à la main devant des toiles que, parfois, il n’hésita pas à détruire dans un mouvement d’irascibilité, tels un Paysan tout criblé de coups de couteau, ou aussi cette nature morte que, de l’atelier, on apercevait à travers les fenêtres, se balançant à la branche d’un cerisier !…
Chaque fois que je pense à Cezanne, je revois cet atelier où des reproductions piquées au mur attestaient l’amour que le peintre avait pour les anciens : Luca Signorelli, le Greco, le Tintoret, le Titien et, plus près de nous, Delacroix, Courbet, pour arriver à Forain… Pauvres reproductions, images d’un sou, mais qui suffisaient à l’artiste pour se recréer l’ambiance des musées.
Je ne puis résister non plus à la tentation de rappeler la forte culture classique du Maître d’Aix, son emballement pour Baudelaire, ses accès de colère s’il rencontrait un contempteur de l’une de ses admirations ; et, quand on le croyait le plus déchaîné, se révélant soudain avec la sensibilité, l’ingénuité de l’enfant. Cette fois, par exemple, où, me prenant à témoin, il vitupérait feu Zola qui avait osé reprocher à Corot de n’avoir pas, dans ses paysages, mis des paysannes au lieu de nymphes, et, au plus fort de son emportement, me disant avec un tremblement dans la voix ; « Excusez un peu, monsieur Vollard, j’aime tant Zola !… »
Au printemps
Pendant son séjour, Vollard achète des tableaux donnés par le peintre à des Aixois.
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 109-119 :
« VII
AIX ET LES AIXOIS
Cezanne aimait passionnément sa ville natale, dont chaque maison, chaque rue lui rappelait son enfance. En revanche, il tenait les Aixois pour des « barbares ». Ceux-ci le jugeaient avec une égale sévérité ; leur mépris toutefois pour leur compatriote ne fut plus aussi vif du jour où la peinture de Cezanne trouva acheteur.
Je m’imaginais n’avoir qu’à me baisser, à Aix, pour « ramasser » des Cezanne : on racontait que le peintre avait longtemps offert des toiles à tout venant, ou même les abandonnait sur « le motif », comme l’aquarelle des Baigneuses que Renoir découvrit, en se promenant, dans les rochers de l’Estaque. Mon attente fut trompée : les Aixois n’étaient pas gens à se laisser séduire par de pareilles « croûtes ». Mais voilà qu’un individu arrive à mon hôtel avec un objet enveloppé d’une toile. « J’en ai un, me dit-il sans préambule, et puisque les Parisiens en veulent, et qu’on fait des coups là-dessus, je veux en être ! » Et, défaisant le paquet, il me montra un Cezanne. « Pas moins de cent cinquante francs ! » cria-t-il en s’appliquant une forte claque sur la cuisse, pour mieux affirmer ses prétentions, et aussi pour se donner du courage. Quand je lui eus compté l’argent : « Cezanne se croit malin, me dit-il, mais il s’est foutu dedans quand il m’a fait cadeau de ça ! » Après avoir donné libre cours à sa joie, il continua : « Venez ! » Je le suivis dans une maison où sur le palier qui, à Aix, tient lieu généralement de dépotoir, quelques magnifiques Cezanne voisinaient avec les objets les plus disparates : cage d’oiseau, pot de chambre fêlé, vieux souliers, seringue hors d’usage (on sait que les gens du Midi se font scrupule de jeter ou détruire quoi que ce soit leur ayant appartenu). Mon guide frappa à la porte qui s’entre-bâilla, retenue par une chaîne de fer. Un couple était accouru. Des questions furent posées, nombreuses. Mais la confiance ne venait décidément, pas, car, le seuil franchi, je surprenais encore cette question à mon cicérone : « Connais-tu bien cet étranger qui t’accompagne ? » Un colloque suivit, interminable ; finalement, on me demanda mille francs pour les Cezanne du palier. Je m’empressai de donner un billet de banque. Nouveau conciliabule entre les trois Aixois ; l’affaire ne sera conclue, finit-on par me dire, qu’après vérification du billet au Crédit Lyonnais. Ce fut l’homme qui se chargea de l’opération ; la femme lui recommanda de rapporter de l’or, si le billet était déclaré bon, « que c’était plus sûr, rapport aux incendies ». Quand le mari revint, nanti du précieux métal, la joie fut si grande qu’on me donna, par-dessus le marché, un bout de ficelle pour lier les Cezanne. « C’est de la bonne corde, me fit remarquer la femme, nous ne la donnerions pas à tout le monde. » Je n’étais pas au bout de mes surprises. A peine avais-je quitté la maison que je m’entendis héler, de la fenêtre : « Eh ! l’artiste, vous en avez oublié un ! » Et un paysage de Cezanne s’abattait à mes pieds !
On m’avait parlé d’un autre Aixois qui possédait quelques études de Cezanne. A mes premiers mots : — « Cezanne, je le connais bien, je l’ai vu naître. Mais, en fait d’étude, je n’en ai eu jamais qu’une seule, que j’ai vendue pour me faire un viager, après avoir pratiqué pendant quarante ans. » Nous aurions pu converser longtemps sans nous entendre, car l’étude dont il parlait était une étude d’huissier. J’essayai d’un autre moyen pour me faire comprendre : « Cezanne ne vous a jamais rien donné ? » — « Ah ! le pôvre, il m’a donné des images qu’il faisait lui-même. Moi, je fais de la poésie. »
Et le vieillard, sortant un papier de sa poche, se mit à me lire plusieurs centaines de vers, sous ce titre alléchant mais trompeur : Ceci est un sonnet. Comme il reprenait péniblement haleine : « Et vos « images » de Cezanne, questionnai-je, sans perdre de temps, n’avez-vous jamais songé à les vendre ? » — « Je ne vends jamais les choses qu’on me donne, même quand ça n’est pas beau ! » En quittant « l’homme au sonnet », je me fis conduire dans une autre maison d’Aix, chez une certaine comtesse de R…, qui possédait, m’avait-on dit, quelques Cezanne dont elle ne faisait aucun cas. Je croyais tenir les toiles. Contre mon attente, mes propositions d’achat furent repoussées avec dédain. On ne consentit même pas à me laisser voir les Cezanne — « Ils sont au grenier… et puisqu’on vous répète que ce n’est pas de l’art…
Moi. — Mais çà vaut de l’argent, et si les rats…
La comtesse, vivement. — Eh bien ! que mes rats rongent mes Cezanne, mais je ne suis pas une marchande ! »
Ce fut ma dernière tentative. Je devais, à mon tour, être sollicité par les gens du pays qui faisaient de la peinture, ou qui aspiraient à en faire, « puisque ça se vendait à Paris ». Je décourageais de mon mieux ceux qui m’apportaient des échantillons de leurs travaux, en leur expliquant que c’était « trop bien fait » pour pouvoir trouver amateur à Paris, où la préférence ne va pas à la « bonne peinture ». Mes visiteurs ne se tinrent point pour battus ; ils m’objectèrent que ça leur serait bien facile de peindre « tout de travers », mais qu’il faudrait alors « travailler sur commande, parce que, si la mode elle change à Paris, que feront-ils de leurs tableaux à Aix, où l’on aime l’ouvrage bien faite ? »
Un autre Aixois crut avoir découvert la raison du succès de Cezanne auprès des « Parisiens ». « Je vois ce que c’est, me dit-il ; on achète ça à Paris pour se moquer de ceux d’Aix ! » C’est d’ailleurs une idée assez répandue dans le Midi, et même aussi, je crois, dans le Nord, que Paris a les yeux fixés sur la province pour en rire.
Parmi tous ces taquineurs de palette, brillait au premier rang une pharmacienne qui se vantait de recevoir des conseils et des encouragements de Cezanne et qui, dans ses moments de loisir, peignait avec amour des petits moutons mangeant de la paille dans des étables « art nouveau ». Je parlai à Cezanne de son élève. « Écoutez un peu, monsieur Vollard ! Mme S… m’a demandé de lui donner des leçons. Je lui ai dit : « Prenez exemple sur moi ; on doit s’efforcer, avant tout, de développer sa personnalité. » C’est une bonne travailleuse, et, si elle continue, elle fera, dans quelque vingt ans, un excellent sous-ordre à la Rosa Bonheur. Si j’étais aussi habile que Mme S… il y a longtemps que j’aurais été reçu au Salon. »
C’est ainsi que Cezanne réussissait à faire admettre, par tant de gens intéressés à le croire sur parole, qu’il n’était qu’un « raté ». Mais, quand il encourageait Mme S… à peindre, ce n’était pas pour s’en moquer, car il avait beaucoup d’estime pour quiconque travaillait sincèrement à développer sa personnalité. Cette sincérité, il ne la découvrait pas chez Signol, ni chez Dubufe, dont il voyait au musée d’Aix un Prisonnier de Chillon « affreusement bien fait ». Il trouvait à l’art de Bouguereau plus d’honnêteté. Quelquefois, dans ses accès de fureur contre lui-même, à propos de sa difficulté à « réaliser », n’allait-il pas jusqu’à s’écrier : « Je voudrais être Bouguereau ! » Et il s’expliquait aussitôt : « Celui-là a développé sa personnalité ! »
Cezanne avait voulu me faire voir une étude de lui, « assez bien réussie », chez sa sœur Mlle Marie ; mais nous ne trouvâmes personne à la maison, car c’était l’heure des vêpres. Faute de pouvoir admirer le tableau, je demandai à Cezanne de faire le tour du jardin ; et rarement promenade ne me fut aussi profitable. Partout des écriteaux avec des prières donnant droit à des indulgences, les unes de quelques jours, d’autres de plusieurs mois, voire d’années entières.
Après la visite à « Mademoiselle Marie », j’allai avec Cezanne le long de l’Arc. Nous fuyions la chaleur ; pas le moindre brin d’air. « Cette température, me disait Cezanne, ne doit être profitable qu’à la dilatation des métaux et à l’augmentation des débits de boissons, industrie qui semble prendre des proportions respectables dans Aix… Je suis très énervé des prétentions des intellectuels de mon pays ; tas d’enc…, de crétins et de drôles.
Moi. — Mais il y a certainement des exceptions ?
Cezanne. — Les exceptions, il peut s’en trouver, ne se font pas connaître. La modestie s’ignore toujours soi-même… J’aime Jo… (1).
Cezanne examina un certain endroit de la rivière, la main faisant visière à ses yeux : « Comme ce serait beau de peindre là un nu ! Ici, au bord de la rivière, les motifs se multiplient ; le même site, vu sous un angle différent, offre un sujet d’étude du plus puissant intérêt, et si varié, que je crois que je pourrais m’occuper pendant des mois sans changer de place, en m’inclinant tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche.
« Écoutez un peu, monsieur Vollard, la peinture est décidément ce qui me vaut le mieux. Je crois que je deviens plus lucide devant la nature. Malheureusement, chez moi, la réalisation de mes sensations est toujours très pénible. Je ne puis arriver à l’intensité qui se développe à mes sens ; je n’ai pas cette magnifique richesse de coloration qui anime la nature. Cependant, vu mes sensations colorantes, je regrette mon âge avancé. Il est attristant de ne pouvoir faire beaucoup de spécimens de mes idées et sensations. Regardez ce nuage ; je voudrais pouvoir rendre cela. Monet le peut, lui. Il a des muscles. »
Claude Monet était celui des peintres contemporains que Cezanne mettait le plus haut. Il lui arrivait bien quelquefois, dans sa haine contre l’impressionnisme, de lancer cette boutade à l’adresse du peintre des Heures : « Monet, ce n’est qu’un œil. » Mais il se reprenait aussitôt : « Mais, bon Dieu, quel œil ! »
Nous étions rentrés en ville ; Cezanne me conduisit devant l’église Saint-Sauveur, dont il tenait à me faire admirer les portes en noyer massif, ornées de sculptures d’un travail très fini, qui furent exécutées vers l’an 1500. Il me fit voir aussi, dans l’intérieur de l’édifice, un tableau, le Buisson ardent, que les bonnes gens d’Aix attribuent au Roi René. « En tout cas, dit-il, c’est rudement bien imité.
Moi. — J’ai lu, dans les Mémoires d’un Touriste de Stendhal, que c’était le bon Roi René qui avait institué à Aix la procession de la Fête-Dieu.
— Dites, monsieur Vollard, je l’ai suivie souvent, cette procession, avec mon ami Zola, quand nous étions jeunes. »
En sortant de Saint-Sauveur, Cezanne rentra chez lui, car c’était l’heure de sa sieste. Il me conseilla d’aller entendre la musique sur le « Coursse », un des plus jolis endroits d’Aix, avec ses platanes dorés et ses trois fontaines, dont celle du milieu donne de l’eau chaude. Je constatai, non sans surprise, que le plus bel ornement de la place, la statue du roi René, était barbouillée de noir. Je mis ce méfait au compte des républicains de la ville ; mais je ne tardai pas à apprendre que c’était un enragé régionaliste qui avait versé un encrier sur le chef de l’ancien souverain de la Provence, pour le punir d’avoir laissé, en mourant, ses États sans protection contre les convoitises du roi de France. Je sus, par la même occasion, qu’en manière de protestation contre l’incorporation de la Provence à la France, la vieille noblesse d’Aix se gardait soigneusement de tout commerce avec les « étrangers » ; ils entendent, par cette désignation, toute personne née au delà d’Avignon !
(1) Le poète Joachim Gasquet. »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 210-216 :
« Puisque je parle d’Aix, qu’on me permette de donner un souvenir à quelques-uns de ses habitants que j’ai connus : à cette famille J… notamment, qui possédait de si magnifiques Cezanne laissés pêle-mêle sur le palier, voisinant avec les objets les plus hétéroclites : cages d’oiseaux, chaises défoncées, pot de chambre ébréché, tous objets ayant participé à la vie de la maison et, par là, promus au rang de dieux lares… Et encore cette comtesse demeurée fière dans l’infortune et qui refusait énergiquement de se séparer de ses Cezanne relégués au grenier :
— Je ne suis pas marchande, monsieur !
— Et s’il y a des rats au grenier ?
— Mais quoi ! Ce sont mes rats…
Et enfin, pourrais-je oublier tous ces nigauds qui croyaient, dur comme fer, que si Paris paraissait s’engouer de Cezanne, c’était pour se moquer de la province, et qui prenaient à la lettre ce que leur compatriote leur disait de lui-même, quand il déplorait son impuissance à « réaliser » ou qu’il déclarait à une aquarelliste aixoise, sollicitant ses conseils : « Mais, madame, si j’étais seulement aussi habile que vous, il y a longtemps que je serais reçu au Salon. »
On ne peut donc pas s’étonner si tous ces gens estimaient que Cezanne manquait de discrétion, quand il envoyait deux de ses toiles à une exposition de la Société des peintres-amateurs aixois. Mais il puisait dans son art la force de supporter les moqueries, les déboires que lui attirait sa peinture.
— Écoutez un peu, monsieur Vollard. Je crois que la peinture est décidément ce qui me vaut le mieux, me disait-il un jour qu’il me parlait de la « prétention des crétins, des intellectuels et des drôles ».
Il est à peine utile d’ajouter qu’il évitait tout contact avec eux, voire avec… les « otres ». Si grande même était sa méfiance à l’endroit d’autrui que, croisant dans Aix un camarade qu’il n’avait pas revu depuis trente ans, comme celui-ci, après les premières effusions, lui demandait son adresse :
— Je demeure loin… dans une rue !…
Lors de ma visite à Aix, j’étais descendu dans un hôtel du cours Mirabeau. Je ne puis penser à la ville aux cent fontaines sans revoir son cours Mirabeau tout baigné de soleil, un soleil qui, à travers les branches des platanes, faisait par terre de si jolis jeux d’ombre et de lumière. Je me rappelle notamment ce Café des Deux Garçons, où j’ai passé tant d’agréables heures avec le poète Joachim Gasquet, l’animateur de la jeunesse intellectuelle d’Aix. Ce fut dans ce milieu que j’entendis, pour la première fois, parler d’autonomisme. Mais l’autonomisme aixois n’était pas comme celui qui se manifeste par des bombes. L’autonomisme provençal était bon enfant ; ses pires excès n’allaient pas plus loin que de verser un encrier sur le chef du roi René. De jeunes exaltés faisaient à celui-ci grief d’avoir, par le don de son duché à la France, ravalé au rang d’un département banal une antique province fière de son passé.
Quel souvenir j’ai gardé d’un déjeuner que je fis chez Gasquet ! En entrant dans la salle à manger, je me trouvais en face de trois Cezanne : La Femme au chapelet [FWN515-R808], passée plus tard dans la collection Jacques Doucet ; ce Champ de blé [FWN201-R521] que je retrouvai, si je ne me trompe, à la vente Bernstein et enfin la fameuse Sainte-Victoire [FWN235-R599], acquise depuis par Courtauld, le grand collectionneur londonien. Ce furent ces deux magnifiques toiles, le Champ de blé et la Sainte-Victoire, que Cezanne, voulant à tout prix « être accroché », avait envoyées à l’exposition d’un groupe d’amateurs dont il faisait partie. Les tableaux ne purent être refusés, car les statuts donnaient à tout membre le droit d’envoyer deux toiles. Mais les organisateurs de l’exposition crurent devoir s’excuser du discrédit qui était ainsi jeté sur une manifestation d’art.
Il y avait, à ce déjeuner, Demolin, un jeune littérateur aixois, dont Gasquet faisait cas, et un autre jeune homme dont je n’ai pas retenu le nom. Au dessert, notre hôte nous donna la primeur d’un de ses plus récents poèmes.
Comme nous nous levions de table, la bonne annonça : « M. Cezanne. » Le peintre était accompagné du père de Gasquet, un ancien boulanger, royaliste convaincu. Son fils l’« épatait », mais l’inquiétait davantage encore. Il éprouvait à peu près les mêmes appréhensions qu’exprimait le père de Cezanne, quand il disait à son fils : « Enfant, songe à l’avenir, on meurt avec du génie et on mange avec de l’argent. » En entendant « Joachim » exalter tant d’écrivains morts depuis si longtemps, l’ancien boulanger trouvait qu’il était déraisonnable de choisir un métier où il faut subir la concurrence, non seulement des vivants, mais encore des morts. Du moins, les enthousiasmes du jeune poète n’étaient pas pour déplaire à Cezanne, encore que le peintre, qui reprenait cent fois la même toile, dût souhaiter que se disciplinât cette fougue juvénile avec laquelle « Joachim » prodiguait ses vers, comme l’oiseau lance ses trilles.
En entrant, Cezanne avait jeté les yeux sur une revue d’art moderne où l’on voyait, en tête d’un article sur les maîtres provençaux, les portraits de Puget et de Daumier.
— Mais est-ce qu’ils savent seulement, à Marseille, que Puget et Daumier sont de chez eux ?
— Comme Cezanne est nôtre, s’écria l’un des convives.
Cezanne jeta à l’interrupteur un regard sévère. Sans doute, le compliment le flattait-il médiocrement, émanant de l’un de ses compatriotes dont il avait coutume de dire qu’ils étaient un peu « minces d’étoffe ».
Quand, au bout d’un instant, Cezanne se leva pour partir, Gasquet ayant prononcé un nom cher entre tous au maître d’Aix, le nom de Baudelaire, le peintre se mit à déclamer :
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par-delà le soleil, par-delà les éthers,
Par-delà les confins des sphères étoilées……………………………………………………………………………
Quand Cezanne se tut, il se fit un silence, un silence que personne n’osait rompre. Mme Joachim Gasquet glissa vers le piano, l’ouvrit doucement et joua une sonate de Beethoven à laquelle Cezanne ne ménagea pas ses applaudissements, encore que les musiques qui avaient sa prédilection fussent la musique militaire et l’orgue de Barbarie.
Platon a proposé de couronner de roses les poètes et de les reconduire à la porte de la République ; c’est qu’il méconnaissait le rôle qu’est appelé à jouer le poète aux heures critiques, quand les défenseurs de la Cité ont besoin d’être exaltés. Un compagnon de tranchées de Gasquet me disait : « Quand ce type-là arriva, nous étions dans la boue jusqu’au ventre, on avait un de ces cafards !… Il nous récita des vers de Calendal, ça nous a remis tout de suite l’estomac en place. Nous ne voyions plus le ciel noir ; positivement, nous entendions chanter les cigales. »
Cezanne fit de Gasquet un portrait, aujourd’hui au musée de Prague. Je me rappelle que l’ancien professeur de philosophie du poète, M. Dumesnil, après avoir longuement contemplé cette toile dans mon magasin :
— Comme c’est étrange ! s’écria-t-il. Je croyais bien connaître Gasquet, eh bien ! devant ce portrait, je comprends que le vrai Gasquet n’est pas le naïf que je m’imaginais.
L’ardeur de cette jeunesse d’Aix, si vibrante, ne trouvait pas d’écho dans les vieilles demeures aristocratiques de la ville, parmi les descendants des anciennes familles, descendants appauvris mais qui avaient le plus grand souci de garder leur rang, des messieurs qu’on voyait, dès le matin, en chapeau haut de forme et en cravate blanche, allant chez le boulanger acheter un petit pain d’un sou. Ils vivaient des derniers vestiges de leur opulence passée : meubles signés, portraits d’ancêtres, boiseries d’époque, qui, peu à peu, s’en allaient chez les antiquaires et les brocanteurs. Mais tant qu’il restait un toit, un parquet, des fenêtres, on recevait entre soi. Dans des tasses anciennes dépareillées, sans feu dans la cheminée, sans bonne, la dame et ses filles offraient le thé avec un cérémonial où les manières du Grand Siècle remplaçaient, le plus souvent, les petits gâteaux.
Or, un jour, passant devant un de ces anciens hôtels d’Aix, j’entendis une dame qui, en introduisant la clef dans la serrure, disait à une jeune fille au moment où celle-ci la quittait :
— Jeanne, viens goûter demain, avec ta sœur, à la maison ; il y aura du saucisson d’Arles à double boyau.
— Ah ! me dis-je, voilà du moins une demeure d’où l’aisance n’est pas tout à fait bannie.
Le hasard me fit rencontrer, quelque temps après, cette même jeune fille.
— Eh bien ! m’informai-je, il était bon le saucisson d’Arles ?
— Il n’y en a pas eu de saucisson ! Ma cousine nous expliqua qu’elle avait oublié que c’était vendredi. Pour nous dédommager, cousine ouvrit toutes grandes les fenêtres du salon et nous respirâmes l’air du jardin.
J’appris, du même coup, que les dames de la société d’Aix ne descendent jamais dans leur jardin. Je demandai pourquoi. « Parce que, me répondit mon interlocutrice, les voisins pourraient s’imaginer qu’on n’a pas de quoi aller à la campagne. » Il est admis, toutefois, sans que les convenances en souffrent, que l’on se promène dans le jardin public, étant entendu que l’on restera sur un strict quant à soi. À ce propos, une jeune artiste originaire du pays, Mlle Raymone, me racontait que sa grand’mère se retrouvait chaque jour dans le jardin public de sa ville natale avec une vieille dame que venait souvent rejoindre une ancienne compagne de pension. Cette dernière, la vieille dame étant restée plusieurs jours sans venir, lui écrivit pour lui demander, en l’appelant « ma chère amie », des nouvelles de sa santé.
— Concevez-vous, dit à ma grand-mère l’ombrageuse Aixoise, elle se permet de m’appeler « ma chère amie », parce que, depuis trente ans, on se connaît !…
L’admirable campagne que celle d’Aix ! Je la découvris en allant voir Marcel Provence. On sait quels efforts l’actif régionaliste fait pour sauvegarder tout ce qui subsiste des traditions du pays… Je pense notamment aux Santons. Ces aimables figurines, fantaisies du vieil artisanat méridional, doivent à leur fervent propagandiste d’avoir fait leur petit bonhomme de chemin qui les a menées jusqu’aux boutiques parisiennes des grands boulevards.
Quelle agréable journée j’ai passée chez Marcel Provence, dans sa maison familiale aux murs tendus d’anciennes toiles de Jouy, dont les motifs surannés et presque attendrissants évoquaient la « douceur de vivre » du bon vieux temps ! La sœur du poète faisait, avec quelle grâce, les honneurs de la maison. Et l’exquis déjeuner qui nous fut servi ! Je fus très frappé par la façon à la fois digne et respectueuse, dont les gens de la ferme, le soir venu, rentrant les charrettes de foin, saluaient leurs maîtres en passant.
Mais les braves paysans de la région d’Aix n’appartiendraient pas à l’humanité s’ils ne connaissaient pas les petites disputes, les petites animosités entre voisins.
Un jour, me promenant à quelques kilomètres de la ville, je dus demander mon chemin à une paysanne courbée dans son jardin, comme si elle parlait à la terre. Voulant lui montrer que je m’intéressais à « ceux » du pays, je lui fis compliment de son jardin, et aussi de celui de sa voisine.
— Oh ! monsieur, celle-là, c’est une femme à se méfier. Elle se cache des « otres ».
Et, à mi-voix, comme si elle me confiait un secret :
— Elle a semé son jardin avant que tout le monde soit levé pour qu’on ne sache pas ce qu’elle a planté. Et puis, c’est une qui n’est pas honnête. Il y avait des petits oiseaux qui venaient ici, qui chantaient pour moi, eh bien, monsieur, elle les a attirés dans son jardin avec le crottin de son cheval…
— Mais si, pour remplacer les graines qu’ils trouvent dans le crottin, vous leur jetiez du pain, ils aimeraient peut-être encore mieux ça ?
— Du pain, une chose qui coûte de l’argent, à des bêtes qui ne sont pas à vous ?… »
Mack Gerstle, La Vie de Paul Cezanne, Paris, Gallimard, « nrf », collection « Les contemporains vus de près », 2e série, n° 7, 1938, 362 pages, p. 30 :
« Mme Marie Gasquet, la veuve de Joachim Gasquet m’a raconté que Cezanne lui demandait parfois de jouer du piano — de préférence des morceaux [de Weber] d’Obéron [1826] ou du Freischütz [1821]. Mais presque chaque fois il s’endormait, elle jouait les derniers accords fortissimo pour le réveiller avant la fin et lui épargner l’embarras d’avouer qu’il s’était assoupi. Pourtant il est facile de comprendre la distraction de Cezanne qui était déjà vieux, malade, et très las. »
16 avril
Vollard vend à Cassatt un tableau de Cezanne, Pommes et linge (FWN763-R339).
Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
Avril
Coste, depuis Aix, donne des nouvelles de Cezanne à Zola :
« J’ai vu récemment et je vois assez souvent Cezanne et Solari qui sont ici depuis quelque temps. […] Cezanne est très déprimé et en proie souvent à de sombres pensées.
Il a pourtant quelque satisfaction d’amour-propre et ses œuvres ont dans les ventes un succès auquel il n’était pas accoutumé. Mais sa femme a dû lui faire commettre bien des sottises. Il est obligé d’aller à Paris ou d’en revenir suivant les ordres qu’elle lui donne. Pour avoir la paix il a été contraint de se dépouiller de son avoir et, d’après les confidences qu’il laisse échapper, on n’a dû lui laisser qu’une rente d’une centaine de francs par mois. Il a loué un cabanon aux carrières du barrage et y passe la plus grande partie de son temps. »
Lettre de Numa Coste, Aix, à Zola, [avril 1896] ; Rewald John, Cezanne, sa vie, son œuvre, son amitié pour Zola, Paris, Albin Michel éditeur, 1939, 460 pages, p. 340-341.
2 mai
Zola publie, dans Le Figaro, un article sur le Salon. Il se remémore l’époque où il menait le « bon combat » en écrivant « Mon Salon ». Il évoque Cezanne de façon désobligeante, « dont on s’avise seulement maintenant aujourd’hui de découvrir les parties géniales de grand peintre avorté ».
Zola Émile, « Peinture », Le Figaro, 42e année, 3e série, n° 123, samedi 2 mai 1896, p. 1 ; repris par Zola Émile, Nouvelle Campagne, Paris, Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1897, p. 172-173 :
« PEINTURE
Chaque année, en sortant des Salons de peinture, j’entends, depuis plus d’un quart de siècle, circuler des phrases semblables : « Eh bien ! et ce Salon ? — Oh ! toujours le même ! — Alors, comme l’année dernière ? — Mon Dieu, oui ! comme l’année dernière et comme les années d’auparavant ! » Et il semble que les Salons soient immuables dans leur médiocrité, qu’ils se répètent avec une uniformité sans fin et qu’il devienne même inutile d’aller les voir pour les connaître.
C’est une profonde erreur. La vérité seulement est que l’évolution à laquelle ils obéissent, d’une façon ininterrompue, est si lente dans ses résultats qu’elle n’est pas facile à constater. D’une année à une autre, les changements échappent, tellement les transitions paraissent naturelles et insensibles. Comme pour les personnes qu’on voit tous les jours, les traits principaux semblent rester les mêmes, on ne s’aperçoit pas des modifications successives et totales. Dans le train quotidien de l’existence, on jurerait qu’on coudoie toujours la même figure.
Mais, grand Dieu ! quelle stupeur si l’on pouvait évoquer d’un coup de baguette le Salon d’il y a trente ans et le mettre en comparaison avec les deux Salons d’aujourd’hui. Comme on verrait que les Salons ne sont pas toujours les mêmes, qu’ils se suivent mais qu’ils ne se ressemblent pas, que rien au contraire n’a évolué plus profondément que la peinture dans cette fin de siècle, sous la légitime fièvre de recherches originales, et aussi, il faut bien le dire, sous la passion de la mode !
Brusquement, ce Salon d’il y a trente ans m’est apparu, ces jours derniers, cependant que je visitais les deux Salons actuels. Et quel coup au cœur ! J’avais vingt-six ans, je venais d’entrer au Figaro, qui s’appelait alors l’Événement, et que Villemessant m’avait ouvert en m’y laissant toute liberté, avec son hospitalité si large, lorsqu’il se passionnait pour une idée ou pour un homme. J’étais alors ivre de jeunesse, ivre de la vérité et de l’intensité dans l’art, ivre du besoin d’affirmer mes croyances à coups de massue. Et j’écrivis ce Salon de 1866, « Mon Salon », comme je le nommai avec un orgueil provocant, ce Salon où j’affirmais hautement la maîtrise d’Édouard Manet, et dont les premiers articles soulevèrent un si violent orage, l’orage qui devait continuer autour de moi, qui, depuis trente années, n’a plus cessé de gronder un seul jour.
Oui, trente années se sont passées, et je me suis un peu désintéressé de la peinture. J’avais grandi presque dans le même berceau, avec mon ami, mon frère, Paul Cezanne, dont on s’avise seulement maintenant aujourd’hui de découvrir les parties géniales de grand peintre avorté. J’étais mêlé à tout un groupe d’artistes jeunes, Fantin, Degas, Renoir, Guillemet, d’autres encore que la vie a dispersés, a semés aux étapes diverses du succès. Et j’ai de même continué ma route, m’écartant des ateliers amis, portant ma passion ailleurs. Depuis trente ans, je crois bien que je n’ai plus rien écrit sur la peinture, si ce n’est dans mes correspondances à une revue russe, dont le texte français n’a même jamais paru. Aussi quelle secousse au cœur, lorsque tout ce passé a ressuscité en moi, à l’idée que je venais de reprendre du service au Figaro, et qu’il serait intéressant peut-être d’y reparler peinture une fois encore, après un silence d’un tiers de siècle bientôt.
Mettons, si vous voulez bien, que j’aie dormi pendant trente années. Hier, je battais encore la campagne avec Cezanne, le rude pavé de Paris, dans la fièvre de le conquérir. Hier, j’étais allé à ce Salon de 1866, avec Manet, avec Monet et avec Pissarro, dont on avait rudement refusé les tableaux. Et voilà, après une longue nuit, que je m’éveille et que je rends aux Salons du Champ-de-Mars et du palais de l’Industrie. Ô stupeur ! ô prodige toujours inattendu et renversant de la vie ! ô moisson dont j’ai vu les semailles et qui me surprend comme la plus imprévue des extravagances !
D’abord, ce qui me saisit, c’est la note claire, dominante. Tous des Manet alors, tous des Monet, tous des Pissarro ! Autrefois, lorsqu’on accrochait une toile de ceux-ci dans une salle, elle faisait un trou de lumière parmi les autres toiles, cuisinées avec les tons recuits de l’École. C’était la fenêtre ouverte sur la nature, le fameux plein-air qui entrait. Et voilà qu’aujourd’hui, il n’y a plus que du plein-air, tous se sont mis à la queue de mes amis, après les voir injuriés et m’avoir injurié moi-même. Allons, tant mieux ! Les conversions font toujours plaisir.
Même ce qui redouble mon étonnement, c’est la ferveur des convertis, l’abus de la note claire qui fait de certaines œuvres des linges décolorés par de longues lessives. Les religions nouvelles, quand la mode s’y met, ont ceci de terrible, qu’elles dépassent tout bon sens. Et, devant ce Salon délavé, passé à la chaux, d’une fadeur crayeuse désagréable, j’en viens presque à regretter le Salon noir, bitumineux d’autrefois. Il était trop noir, mais celui-ci est trop blanc. La vie est plus variée, plus chaude et plus souple. Et moi qui me suis si violemment battu pour le plein-air, les tonalités blondes, voilà que cette file continue de tableaux exsangues, d’une pâleur de rêve, d’une chlorose préméditée, aggravée par la mode, peu à peu m’exaspère, me jette au souhait d’un artiste de rudesse et de ténèbres !
C’est comme pour la tache. Ah ! Seigneur, ai-je rompu des lances pour le triomphe de la tache ! J’ai loué Manet, et je le loue encore, d’avoir simplifié les procédés, en peignant les objets et les êtres dans l’air où ils se baignent, tels qu’ils s’y comportent, simples taches souvent que mange la lumière. Mais pouvais-je prévoir l’abus effroyable qu’on se mettrait à faire de la tache, lorsque la théorie si juste de l’artiste aurait triomphé ? Au Salon, il n’y a plus que des taches, un portrait n’est plus qu’une tache, des figures ne sont plus que des taches, rien que des taches, des arbres, des maisons, des continents et des mers. Et ici le noir reparaît, la tache est noire, quand elle n’est pas blanche. On passe sans transition de l’envoi d’un peintre, cinq ou six toiles qui sont simplement une juxtaposition de taches blanches, à l’envoi d’un autre peintre, cinq ou six toiles qui sont une juxtaposition de taches noires. Noir sur noir, blanc sur blanc, et voilà une originalité ! Rien de plus commode. Et ma consternation augmente.
Mais où ma surprise tourne à la colère, c’est lorsque je constate la démence à laquelle a pu conduire, en trente ans, la théorie des reflets. Encore une des victoires gagnées par nous, les précurseurs ! Très justement, nous soutenions que l’éclairage des objets et des figures n’est point simple, que sous des arbres par exemple, les chairs nues verdissent, qu’il y a ainsi un continuel échange de reflets dont il faut tenir compte, si l’on veut donner à une œuvre la vie réelle de la lumière. Sans cesse, celle-ci se décompose, se brise et s’éparpille. Si l’on ne s’en tient pas aux académies peintes sous le jour factice de l’atelier, si l’on aborde la nature immense et changeante, la lumière devient l’âme de l’œuvre, éternellement diverse. Seulement, rien n’est plus délicat à saisir et à rendre que cette décomposition et ces reflets, ces jeux du soleil où, sans être déformées, baignent les créatures et les choses. Aussi, dès qu’on insiste, dès que le raisonnement s’en mêle, en arrive-t-on vite à la caricature. Et ce sont vraiment des œuvres déconcertantes, ces femmes multicolores, ces paysages violets et ces chevaux orange qu’on nous donne, en nous expliquant scientifiquement qu’ils sont tels par suite de tel reflet ou de telle décomposition du spectre solaire. Oh ! les dames qui ont une joue bleue, sous la lune, et l’autre joue vermillon, sous un abat-jour de lampe ! Oh ! les horizons où les arbres sont bleus, les eaux rouges et les cieux verts ! C’est affreux, affreux, affreux !
Monet et Pissarro, les premiers, je crois, ont délicieusement étudié ces reflets et cette décomposition de la lumière. Mais que de finesse et que d’art ils y mettaient ! L’engouement est venu, et je frissonne d’épouvante ! Où suis-je ? Dans un de ces anciens Salons des Refusés que l’âme charitable de Napoléon III ouvrait aux révoltés et aux égarés de la peinture ? Il est très certain que pas la moitié de ces toiles ne seraient entrées au Salon officiel.
Puis, c’est un débordement lamentable de mysticisme. Ici, je crois bien que le coupable est le très grand et très pur artiste, Puvis de Chavannes. Sa queue est désastreuse, plus désastreuse peut-être encore que celle de Manet, de Monet et de Pissarro.
Lui, sait et fait ce qu’il veut. Rien n’est d’une force ni d’une santé plus nettes que ses hautes figures simplifiées. Elles peuvent ne pas vivre de notre vie de tous les jours, elles n’en ont pas moins une vie à elles, logique et complète, soumise aux lois voulues par l’artiste. Je veux dire qu’elles évoluent dans ce monde des créations immortelles de l’art qui est fait de raison, de passion et de volonté.
Mais sa suite, grand Dieu ! Quel bégaiement à peine formulé, quel chaos des plus fâcheuses prétentions ! L’esthéticisme anglais est venu et a fini de détraquer notre clair et solide génie français. Toutes sortes d’influences, qu’il serait trop long d’analyser à cette place, se sont réunies et amassées pour jeter notre école dans ce défi à la nature, cette haine de la chair et du soleil, ce retour à l’extase des Primitifs ; et encore les Primitifs étaient-ils des ingénus, des copistes très sincères, tandis que nous avons affaire à une mode, à toute une bande de truqueurs rusés et de simulateurs avides de tapage. La foi manque, il ne reste que le troupeau des impuissants et des habiles.
Je sais bien tout ce qu’on peut dire, et ce mouvement, que j’appellerai idéaliste, pour simplement l’étiqueter, a eu sa raison d’être, comme une naturelle protestation contre le réalisme triomphant de la période précédente. Il s’est également déclaré dans la littérature, il est un résultat de la loi d’évolution, où toute action trop vive appelle une réaction. On doit admettre aussi la nécessité où les jeunes artistes se trouvent de ne pas s’immobiliser dans les formules existantes, de chercher du nouveau, même extravagant. Et je suis loin de dire qu’il n’y a pas eu des tentatives curieuses, des trouvailles intéressantes, dans ce retour du rêve et de la légende, de toute la flore délicieuse de nos anciens missels et de nos vitraux. Au point de vue de la décoration surtout, je suis ravi du réveil de l’art, pour les étoffes, les meubles, les bijoux, non pas, hélas ! qu’on ait créé encore un style moderne, mais parce qu’en vérité on est en train de retrouver le goût exquis d’autrefois, dans les objets usuels de la vie.
Seulement, oh ! de grâce pas de peinture d’âmes ! Rien n’est fâcheux comme la peinture d’idées. Qu’un artiste mette une pensée dans un crâne, oui ! mais que le crâne y soit et solidement peint, et d’une construction telle qu’il brave les siècles. La vie seule parle de la vie, il ne se dégage de la beauté et de la vérité que de la nature vivante. Dans un art, matériel comme la peinture surtout, je défie bien qu’on laisse une figure immortelle, si elle n’est pas dessinée et peinte humainement, aussi simplifiée qu’on voudra, gardant pourtant la logique de son anatomie et la proportion saine de ses formes. Et à quel effroyable défilé nous assistons depuis quelque temps, ces vierges insexuées qui n’ont ni seins ni hanches, ces filles qui sont presque des garçons, ces garçons qui sont presque des filles, ces larves de créatures sortant des limbes, volant par des espaces blêmes s’agitant dans de confuses contrées d’aubes grises et de crépuscules couleur de suie ! Ah ! le vilain monde, cela tourne au dégoût et au vomissement !
Heureusement, je crois bien que cette mascarade commence à écœurer tout le monde, et il m’a semblé que les Salons actuels comptaient beaucoup moins de ces lis fétides, poussés dans les marécages du faux mysticisme contemporain.
Et voilà donc le bilan de ces trente dernières années. Puvis de Chavannes a grandi dans son effort solitaire de pur artiste. À côté de lui, on citerait vingt artistes de grand mérite : Alfred Stevens, qui a également conquis la maîtrise par sa sincérité si fine et si juste ; Detaille, d’une précision et d’une netteté admirables ; Roll aux vastes ambitions, le peintre ensoleillé des foules et des espaces. Je nomme ceux-ci, j’en devrais nommer d’autres, car jamais peut-être on n’a fait de tentatives plus méritoires dans tous les sens. Mais, il faut bien le dire, aucun grand peintre nouveau ne s’est révélé, ni un Ingres, ni un Delacroix, ni un Courbet.
Ces toiles claires, ces fenêtres ouvertes de l’impressionnisme, mais je les connais, ce sont des Manet, pour lesquels, dans ma jeunesse, j’ai failli me faire assommer ! Ces études de reflets, ces chairs où passent des tons verts de feuilles, ces eaux où dansent toutes les couleurs du prisme, mais je les connais, ce sont des Monet, que j’ai défendus et qui m’ont fait traiter de fou ! Ces décompositions de la lumière, ces horizons où les arbres deviennent bleus, mais je les connais, ce sont des Pissarro, qui m’ont autrefois fermé les journaux, parce que j’osais dire que de tels effets se rencontraient dans la nature !
Et ce sont là les toiles que jadis on refusait violemment à chaque Salon, exagérées aujourd’hui, devenues affreuses et innombrables ! Les germes que j’ai vu jeter en terre ont poussé, ont fructifié d’une façon monstrueuse. Je recule d’effroi. Jamais je n’ai mieux senti le danger des formules, la fin pitoyable des Écoles, quand les initiateurs ont fait leur œuvre et que les maîtres sont partis. Tout mouvement s’exagère, tourne au procédé et au mensonge, dès que la mode s’en empare. Il n’est pas de vérité juste et bonne au début, pour laquelle on donnerait théoriquement son sang, qui ne devienne, par l’imitation la pire des erreurs, l’ivraie envahissante qu’il faut impitoyablement faucher.
Je m’éveille et je frémis. Eh quoi ! vraiment c’est pour ça que je me suis battu ? C’est pour cette peinture claire, pour ces taches, pour ces reflets, pour cette décomposition de la lumière ? Seigneur ! Étais-je fou ? Mais c’est très laid, cela me fait horreur ! Ah ! vanité des discussions, inutilité des formules et des Écoles. Et j’ai quitté les deux Salons de cette année en me demandant avec angoisse si ma besogne ancienne avait donc été mauvaise.
Non, j’ai fait ma tâche, j’ai combattu le bon combat. J’avais vingt-six ans, j’étais avec les jeunes et avec les braves. Ce que j’ai défendu, je le défendrais encore, car c’était l’audace du moment, le drapeau qu’il s’agissait de planter sur les terres ennemies. Nous n’avions raison que parce que nous étions l’enthousiasme et la foi. Si peu que nous ayons fait de vérité, elle est aujourd’hui acquise. Et, si la voie ouverte est devenue banale, c’est que nous l’avons élargie pour que l’art d’un moment puisse y passer.
Et puis, les Maîtres restent. D’autres viendront dans les voies nouvelles ; mais tous ceux qui ont déterminé l’évolution d’une époque demeurent, sur les ruines de leurs Écoles. Et il n’y a décidément que les créateurs qui triomphent, les faiseurs d’hommes, le génie qui enfante, qui fait de la vie et de la vérité !
Émile ZOLA. »
Geffroy Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Crès, 1922, 362 pages, p. 204-205, réédition Paris, Macula, 1980, p. 339-340 :
« Dans le Figaro du 2 mai 1896, sous le titre Peinture, Émile Zola publie un article qui est une sorte de fanfare de victoire jouée en marche funèbre, un émerveillement à voir que l’art de 1866, l’art de Manet, de Monet, de Pissarro, a triomphé, que la peinture claire, la peinture de taches, la peinture de reflets, a transformé le Salon, mais c’est en même temps une conclusion mélancolique sur l’imitation qui sévit. Et l’on ne sait pas bien si Zola se réjouit ou regrette. Il y a de l’incertitude sous son style affirmatif, une sorte d’irritation à voir ce que la victoire est devenue dans les mains des victorieux et des profiteurs, il y a même, on le croirait, un désaveu des batailles anciennes. Lisez plutôt : […]
On dirait une déception personnelle, et je me souviens d’avoir eu avec Zola, lorsque j’ai été le voir en Angleterre au moment de l’affaire Dreyfus, une conversation, même une discussion, à propos de Manet, de Monet, de Cezanne, sur l’impressionnisme. L’auteur des « Rougon-Macquart » m’avouait cette déception, ne trouvait pas dans les œuvres de ces maîtres, qu’il ne voyait pas dans leur ensemble, les éléments de composition qu’il affirmait nécessaires à l’œuvre d’art. Je lui objectais ses propres arguments d’autrefois et les notions nouvelles nées de l’évolution des artistes et de l’art qu’il avait soutenus. Il revenait toujours avec entêtement à son besoin de composition, à sa manière à lui, de construire un livre, il ne voyait chez ses anciens compagnons d’art que des morceaux, des ébauches. À part cela, il y a du vrai dans la conclusion de son article : « Tous ceux qui ont déterminé l’évolution d’une époque demeurent sur les ruines de leurs écoles. » » »
Mai
Cezanne entreprend le portrait de Joachim Gasquet (Portrait d’Henri Gasquet, FWN522-R810 selon Alain Mothe???).
Lettre de Cezanne à Joachim Gasquet, 21 mai 1896 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 250-251 ; Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 91.
Royère Jean, « Un Aixois, Joachim Gasquet (Souvenirs d’enfance) », Le Mémorial d’Aix, journal politique, commercial, littéraire et mondain, 92e année, n° 50, dimanche 15 décembre 1929, p. 4. Repris dans Royère Jean, Frontons (première série). Baudelaire, Verlaine, Renan, Mallarmé, Signoret, Gasquet, Nau, Ghil, de Faramond, Gide, Jammes, Valéry, Cantacuzène, Apollinaire, Larbaud, Godoy, Paris, éditions Seheur, 1932, collection « Masques et idées », 221 pages, p. 80 :
« Le père de Gasquet était boulanger. Il cuisait le meilleur pain d’Aix. Sa physionomie avenante est encore très nette dans ma mémoire : petit soigné d’allure cossue, les lèvres et le menton rasés, les joues aristocratiquement pavoisées de favoris bien égaux, il était toujours cravaté de blanc, comme le sont les conseillers d’État. »
4 mai
Félicien Roux achète à Vollard un tableau de Cezanne, un paysage, 300 francs.
Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
5 mai
D’après une inscription sur le châssis, Cezanne donne le tableau Baigneuses (FWN958-R668) à Mme Gasquet, Marie Girard, reine du Félibrige, à la suite de son mariage le 23 janvier 1896 avec Joachim Gasquet. L’inscription se lit : « Hommage respectueux de l’auteur à la Reine des Félibriges P. Cezanne, 5 mai 1896. »
Venturi Lionello, Cezanne, son art, son œuvre, 1936, Paris, Paul Rosenberg, éditeur, 1936, tome I, « Texte », 408 pages, notice 540 p. 181.
6 mai
Vollard vend à Degas un tableau de Cezanne, un portrait de Chocquet (FWN438-R297), 150 francs.
Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
21 mai
Lettre de Cezanne à Joachim Gasquet :
« Aix, 21 Mai 1896.
Cher Monsieur Gasquet,
Obligé de rentrer de bonne heure en ville ce soir, je ne pourrai me trouver au Jas. Je vous prie d’excuser ce contre temps 1.
Hier soir à cinq heures, je n’avais reçu ni le Cœur et l’Esprit de Geffroy, ni l’article du Figaro. J’ai th télégraphié à Paris à ce sujet 2. ―
A demain donc Vendredi, si vous voulez bien, à l’heure accoutumée 3.
Bien cordialement P. Cezanne. »
- Il semblerait que par ces mots Cezanne décommandait une séance de pose pour le portrait de Gasquet.
- Il s’agit de l’ouvrage pour lequel Cezanne avait remercié Geffroy dans sa lettre du 31 janvier 1895. Quant à l’article du Figaro, c’était un compte rendu du Salon par Zola, paru le 2 mai 1896. Le romancier y paraît prendre congé de ses vues d’autrefois, disant notamment : « Trente années se sont passées, et je me suis un peu désintéressé de la peinture. J’avais grandi presque dans le même berceau avec mon ami, mon frère Paul Cezanne, dont on s’avise seulement aujourd’hui de découvrir les parties géniales de ce grand peintre avorté. » On comprend que Cezanne ait été pressé de lire cet article, mais il est moins clair pourquoi il avait câblé à Paris afin de se faire envoyer le livre de Geffroy qu’il désirait apparemment montrer à Gasquet.
- L’heure accoutumée était sans doute celle des séances de pose pour le portrait de Gasquet.
Lettre de Cezanne à Gasquet, datée « Aix, 21 Mai 1896 » ; Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet, suivi de Souvenirs de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, 75 pages, reproduction de la lettre ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 250-251.
26 mai
Vollard règle une avance de 1 500 francs pour une nouvelle galerie au 6, rue Laffitte. Le local comprend une mezzanine et une « cave », où Vollard recevra souvent, mais rarement Cezanne.
Rabinow Rebecca A. et Warman Jayne, « Chronologie », sur CD-Rom dans De Cezanne à Picasso. Chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan Museum of Art, 13 septembre 2006 – 7 janvier 2007, Chicago, The Art Institute of Chicago, 17 février – 12 mai 2007, Paris, musée d’Orsay, 19 juin – 16 septembre 2007, Paris, musée d’Orsay et Réunion des musées nationaux, 2007, p. 208-245, p. 211.
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 109 :
« Cezanne venait rarement à la Cave. Il ne sortait guère. Un jour que nous dînions tous deux, je lui parlais de je ne sais quel fait-divers que j’avais lu dans le journal. Soudain, il mit la main sur mon bras. Ma bonne étant sortie de la salle à manger :
— Je vous ai arrêté, dit Cezanne, car ce que vous disiez n’était pas convenable devant une jeune fille.
— Quelle jeune fille ? fis-je, tout étonné.
— Eh bien ! la bonne…
— Mais elle connaît très bien tout ça ! Vous pouvez même être sûr qu’elle en sait plus que nous.
— Ça se peut. Mais il vaut mieux que nous fassions semblant d’ignorer qu’elle sait… »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 112 :
« Un soir, avant de descendre dîner, mes invités regardaient des Cezanne :
— Ce Paysan, trancha Forain, il pue des pieds.
Degas s’était arrêté devant une autre toile du peintre : une maison blanche dans les environs de Marseille.
— Quelle noblesse là dedans ! Voilà qui nous change de Pissarro.
— Allons, Degas, fit quelqu’un, ne vous rappelez-vous pas qu’étant chez Durand-Ruel, vous-même m’avez conduit devant un Pissarro, des Paysannes repiquant des choux, et que vous trouviez ça joliment bien.
— Oui, mais c’était avant l’affaire Dreyfus, dit Degas… »
4 juin
Cezanne assiste à Marseille à la première communion de sa nièce et filleule Paule Conil, chez les religieuses de Sion à Marseille.
C. [Marthe Conil], « Quelques souvenirs sur Paul Cezanne par une de ses nièces », Gazette des beaux-arts, VIe période, tome LVI, 1102e livraison, 102e année, novembre 1960, p. 299-302 :
« Paul Cezanne passe les dernières années de sa vie à Aix-en-Provence. Il n’a pas un caractère très facile, il est peu sociable, timide, méfiant, mais en famille il sait être agréable, sauf s’il parle peinture, alors le ton monte, mais quand il s’aperçoit qu’on l’écoute peu, il redevient plus calme.
On parle peu en général de la femme du peintre, elle n’est pourtant pas sans qualités, elle a une égalité d’humeur, et une patience à toute épreuve. Quand Cezanne ne dort pas, elle lui fait la lecture la nuit, et cela dure, parfois, des heures. Sa belle-mère, qui n’a pas pour elle une tendresse spéciale, reconnaît sa patience ; puis elle lui a donné un fils. Dans la famille, on l’appelle « La Reine Hortense ». Bien avant l’achat du Jas de Bouffan, Louis-Auguste Cezanne a loué pour sa famille une maison de campagne route des Alpes, au quartier des Platanes. Paul descend tous les matins en ville par le vieux chemin romain — et, pour que la route paraisse moins longue, il joue de la flûte — en se rendant au collège Bourbon (l’actuel lycée Mignet) ; le soir il remonte avec son père aux Platanes.
Paul et sa sœur Marie, tout enfants, allaient ensemble apprendre à lire chez Tata Rébory ; puis pour Paul, c’est l’École Saint-Joseph et ensuite le collège Bourbon dont il est un des bons élèves.
Après la mort du vieux père Cezanne, Paul abandonne un peu son atelier du Jas de Bouffan pour peindre dans le grand salon du rez-de-chaussée ; là règne un désordre incomparable : fleurs, fruits, nappes blanches, sur la cheminée trois crânes, un Christ d’ivoire sur croix d’ébène — le Christ de grand-mère, il existe encore. C’est dans ce salon qu’il peindra son Mardi-Gras (Arlequin et Pierrot) ; son fils Paul posera pour l’Arlequin.
En 1896, le 4 juin, il assiste à Marseille chez les Religieuses de Sion à la Première Communion de sa nièce et filleule Paule Conil. Il est très ému pendant cette cérémonie, car il est profondément croyant. Personne dans l’assistance ne se doute que ce précoce vieillard, presque complètement chauve, porte un nom qui dans quelques années sera connu du monde entier.
Sa sœur Marie, très dévote, avait sur lui une heureuse influence religieuse. Le père Cezanne avait coutume de dire : « Paul se laissera manger par la peinture, Marie par les Jésuites » ; il n’en fut rien, Marie très avisée donnait il est vrai pour les bonnes œuvres, mais elle savait aussi préserver son avoir. Quant à Paul !…
Les dernières années de sa vie, Paul Cezanne peint sans se lasser. Dans son pavillon des Lauves, ce sont les Grandes Baigneuses. Puis il va aussi au motif à Château-Noir pour peindre et repeindre cette Sainte Victoire qui le hante depuis son enfance ; il la peint sous différents aspects, mais elle est toujours lumineuse sur ses toiles, comme dans la nature. Et ce sont, après le travail, les repas chez Rosa Berne, au Tholonet. Ce n’est pas même une auberge de village mais une simple épicerie, et Rosa sait faire la cuisine qui convient à M. Cezanne. C’est toujours de la charcuterie de village, une omelette aux truffes ou aux champignons, et le fameux canard aux olives et aux carottes, les fruits de saison, le tout arrosé d’un bon petit vin blanc des coteaux de Sainte-Victoire.
En 1902 ou 1903, ses nièces ont un grand désir de voir sur le cours Mirabeau la revue du 14 juillet. Mais en 1900 les jeunes filles ne sortent pas seules pour assister à une revue militaire ; alors on demande à l’oncle Paul s’il accepterait de servir de guide aux quatre jeunes filles ; elles ont cette année-là entre treize et dix-huit ans, et sont, ma foi, très charmantes. Cezanne accepte, elles marchent fières, deux de chaque côté du Maître. Pendant le défilé des troupes, il s’arrête et dit : « Quel joli cadre vous faites au vieux tableau que je suis. »
Tous les dimanches il montait à la grand’messe à Saint-Sauveur. Sa place est toujours la même à l’extrémité du banc des fabriciens à gauche. Il suivait dans son livre les prières de la messe, et le jeu des grandes orgues le transportait dans un autre monde. En sortant de la cathédrale, il donnait toujours à un pauvre qui se tenait à la porte une pièce de cinq francs ; celui-ci le remerciait d’un petit sourire. Un jour que ses nièces sortaient de l’église après lui, elles se moquaient de ce pauvre, le comparant à saint Benoît-Labre. Alors le vieil oncle : « Mais vous ne savez pas, c’est Germain Nouveau, professeur, poète, il fut mon condisciple au collège Bourbon. »
Il disait parfois en sortant d’un office à Saint-Sauveur : « Je viens de prendre ma petite tranche de Moyen Âge. » Comme nos artistes du Moyen Âge, il pouvait bien dire en élevant ses bras vers le ciel : « Seigneur, je vous offre ces mains qui ont bien œuvré. »
On lui demandait un jour s’il croyait à Dieu. La réponse fut prompte : « Si je ne croyais pas à Dieu, je ne pourrais pas peindre. »
M. C »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 120-122 :
« Tantôt, avec un tremblement, lorsqu’un prêtre passait, il vous murmurait : « ― Les curés sont terribles… Ils vous mettent le grappin dessus ». Et tantôt, à un catholique fervent, à son ami Demolins qui lui demandait : « Maître, croyez-vous ? », il répondait : « Mais nom de Dieu, si je ne croyais pas, je ne pourrais pas peindre ». À M. Émile Bernard voulant lui suggérer l’idée de peindre un Christ, il objectait : « ― Je n’oserais jamais ; c’est trop difficile… D’autres l’ont fait mieux que moi… » Il mettait donc le respect et l’orgueil de son art au-dessus de la prière et de l’humilité de sa foi. Mais au Tholonet je l’ai vu, après les vêpres, tête nue, magnifique, en plein soleil, avec autour de lui un grand cercle de jeunes gens respectueux, derrière le dais suivre la procession des Rogations et s’agenouiller sur la route, au bord des blés, avec des larmes dans les yeux. Je l’ai entendu, lui, si positif d’ordinaire, célébrer la rhétorique biblique de Bossuet et admirer cette inflexible et dense raison qui lui fait ramener à l’apparition du Christ toute l’histoire universelle. Ces flottantes synthèses, ces perspectives catholiques l’enchantaient, lui qui détestait la pompe des Lebrun. Mais il aimait surtout les pauvres, les humbles, les ignorants, et c’est en cela surtout qu’on le pouvait dire chrétien. Il avait aussi un grand respect des familles établies, de la bonne noblesse provinciale. Il le poussait au point qu’ayant à rendre visite à l’un des descendants de Mirabeau, M. Lucas de Montigny, qui toujours lui avait témoigné de l’intérêt, il se fit tailler un vêtement neuf pour la circonstance et ne le remit jamais plus. Je dus même l’accompagner « chez le gentilhomme », sonner, et la porte ouverte, la refermer derrière lui ; il n’eût jamais osé entrer.
Autant il méprisait le bourgeois parvenu, autant il estimait l’aristocrate né. Mais sa vraie passion était pour le peuple, l’ouvrier, le paysan, le laborieux. Il ne fréquentait pour ainsi dire qu’eux. Tous en ont conservé un souvenir attendri. Il était avec eux d’une charité royale et non seulement de bourse, mais surtout de cœur et d’esprit. Il aurait voulu les mêler à ses émotions, comme il les mêlait à son œuvre. Lorsqu’il allait « au motif », que de fois, m’a raconté son cocher, se dressait-il brusquement dans la voiture, prenait le bras de cet homme : « ― Regardez… ces bleus, ces bleus sous les pins… Ce nuage là-bas… » Il rayonnait d’extase, et l’autre qui n’apercevait que des arbres, du ciel, pour lui toujours les mêmes, sentait pourtant, m’avouait-il, comme une vague force, une émotion l’envahir et qui lui venait de Cezanne, debout, transfiguré, les mains crispées à l’épaule du rustre, et tout plein d’une évidence qui le sanctifiait.
Une autre fois, le soleil tapait fort. On arrivait à mi-hauteur d’une montée accablante. Harassés, le cheval et le cocher s’étaient endormis. Cezanne, au lourd soleil, sans un mot, sans un geste, pour ne pas attrister, attendit leur réveil ; se frottant naïvement les yeux, ce fut lui qui eut l’air de s’être ensommeillé.
Dans les rues montueuses d’Éguilles son mouvement instinctif était toujours d’aider les autres, de pousser le charreton trop chargé d’un paysan, de prendre aux mains défaillantes d’une vieille la cruche d’eau qu’elle portait. Il aimait les bêtes. Il aimait les arbres. Vers la fin, dans son besoin de solitude tendre, un olivier devint son ami. Lorsque dans son atelier des Lauves, il avait fait une bonne séance, à la nuit tombante, il descendait devant sa porte, il regardait ses jours, sa ville s’endormir. L’olivier l’attendait. La première fois qu’il était venu là, avant d’acheter le terrain, tout de suite il l’avait remarqué. Il l’avait fait entourer d’un petit mur, tandis qu’on bâtissait, pour le protéger de toutes meurtrissures. Et maintenant, le vieil arbre crépusculaire avait comme un regard de sève et de parfum. Il le touchait. Il lui parlait. Le soir, en le quittant, parfois, il l’embrassait. Toute la ville, au pied de la murette, venait mourir, couchant ses tuiles roses, ses calmes boulevards. Au fond, les bleues collines se soulevaient un peu. On devinait la mer. Les clochers de miel et de sel, les tours de l’Horloge et du Saint-Esprit profilaient sur la nue leurs strophes italiennes. Une rumeur paisible montait des pauvres rues. La nuit rousse répandait Aix, ses fumées, l’automne, à travers la campagne. Cezanne, solitaire, écoutait l’olivier… La sagesse de l’arbre lui entrait dans le cœur.
« ― C’est un être vivant, me disait-il un jour, je l’aime comme un vieux camarade…. Il sait tout de ma vie et me donne d’excellents conseils… Je voudrais qu’on m’enterre à ses pieds… »
Vers le 8 juin
Cezanne part avec sa femme à Vichy suivre une cure. Ils s’installent à l’hôtel Molière à Vichy, rue du Casino, où ils séjournent un mois.
Lettres de Cezanne à Joachim Gasquet, 13 juin 1896, et à Solari, 23 juillet 1896, Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 251-252, 254.
Rivière Georges, Le Maître Paul Cezanne, Paris, H. Floury éditeur, 1923, 242 pages, p. 125 :
« La subordination de tout le détail de la vie matérielle aux exigences de l’art empêchait Cezanne de songer à sa santé, devenue assez chancelante vers la cinquantième année. Suivre un régime alimentaire approprié, ménager ses forces, c’eût été trop lui demander. Il se décida, cependant, en 1897, à faire un séjour à Vichy en s’efforçant de se plier aux prescriptions des médecins. Il lui fut impossible de se contraindre jusqu’au bout à suivre le rituel obligatoire et, pour échapper à la tyrannie des thérapeutes, il s’en alla à Talloires, au bord du lac d’Annecy, terminer sa cure. »
de Beucken Jean, Un portrait de Cezanne, Paris, « nrf », Gallimard, 1955, 341 pages, p. 254 :
« La santé de Cezanne laisse à désirer. Mme Cezanne s’ennuyant à Aix, et se plaignant toujours d’emphysème, parvient à convaincre son mari d’aller à Vichy, où il y aura au moins de la distraction. En juin, ils partent à eux trois. Ils arrivent par un temps maussade, mais dès que le soleil reparaît, Cezanne veut aller peindre. Il tente, pour commencer, quelques aquarelles, et comme le site est assez banal, il fait une grande aquarelle (45 x 31 cm) avec des arbres sur des prés vert bleu, et sous un ciel bleu clair. L’ensemble paraît fondu, délicat. A Vichy, on mange bien, et Cezanne le remarque.
Après un mois, ils sont revenus à Aix, où Cezanne a vu Henri Gasquet, à défaut de son fils, à Nîmes en ce moment. »
13 juin
Cezanne décline poliment une demande probable de collaboration à une nouvelle revue que Gasquet va fonder, Les Mois dorés (1896-1898), sa deuxième, après La Syrinx et avant Le Pays de France. Il l’informe qu’il se trouve à Vichy, depuis une huitaine de jours, hôtel Molière. Il va y passer un mois.
« Vichy, 13 Juin 1896,
Mon cher Gasquet, ―
Vous voulez fonder une Revue, ― je fais abstraction de mon individualité. Appelez à votre concours les personnes, qui répondant à votre manifestation ont adressé l’une et l’autre deux une lettre à Mr. D’Arbaud. Leur apport, je dirais leur assiette est nécessaire à la base même de votre Revue. Ils ont vécu, par ce seul fait, ils ont l’expérience. Ce n’est pas se diminuer que reconnaître ce qui est vrai. Vous êtes jeune, vous avez la vitalité, vous imprimerez à votre publication une impulsion, que seuls vous et vos amis qui ont l’avenir devant eux, peuvent lui donner. Il me semble que c’est un assez beau role pour en être fiers et que vous vous y intéressiez.
Appelez à vous, toutes les initiatives, qui ont fait leur preuve. Il n’est pas possible, que l’homme qui se sent vivre, et qui a gravi, consciemment ou non le sommet de l’existence, entrave la marche de ceux qui viennent à la vie. Le chemin qu’ils ont parcouru, est un indice pour la voie à suivre, et non pas une barrière à votres pas. ―
Mon fils a lu votre Revue, avec le plus vif intérêt, ― Il est jeune, il ne peut que s’associer à vos espérances.
Je suis débarqué ici à Vichy, ― depuis une huitaine de jours. Le temps pluvieux et maussade, à notre arrivée, s’est rassereiné. Le soleil brille, et l’espoir rit au cœur. ― J’irai tantôt à l’étude.
Si vous voyez mon ami Solari, veuillez lui dire le bonjour de ma part. Bon courage, ce dont je ne doute pas ; croyez moi de tout cœur avec vous et agréez mes meilleurs souhaits.
Paul Cezanne
Vichy, Hôtel Molière.
(Allier) »Lettre de Cezanne à Joachim Gasquet, datée « Vichy, 13 Juin 1896 » ; coll. bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence ; Jean-Claude, Paul Cezanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 39-40 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 251-252.
Josep d’Arbaud (Meyrargues, 4 octobre 1874 – Aix, 2 mars 1950) est un poète félibre.
de Beucken Jean, Un portrait de Cezanne, Paris, « nrf », Gallimard, 1955, 341 pages, p. 259-260, 340 :
« Joachim Gasquet essaie de faire partager son enthousiasme pour l’œuvre de Cezanne à quelques écrivains, entre autres à Joseph d’Arbaud, un tout jeune poète (d’Arbaud appartient pourtant à cette société aixoise si fermée, qui veut ignorer les Cezanne et les Gasquet). Ils iront plusieurs fois au Jas de Bouffan, où Gasquet s’annonce en clamant sous l’atelier un sonore : « Cezanne ouvre-toi ! », et le peintre vient leur ouvrir lui-même une petite porte. Cezanne paraît vraiment touché par l’admiration intelligente et assez lyrique de Gasquet. Quant au jeune d’Arbaud, s’il admirait certaines œuvres, il n’osait dire qu’il ne comprenait pas bien cette série de Joueurs de Cartes, dont une toile mise en évidence l’étonnait. Dans l’atelier où s’entassaient les peintures, posé sur une table, le tout petit « Ecorché » de plâtre, que Cezanne « copiait et recopiait comme une page d’écriture sur des bouts de toile ou de petits panneaux ». Le jeune homme entendit répéter le « Je ne veux pas qu’on me mette le grappin dessus », hantise du peintre, et devant une des toiles, Cezanne d’avouer : « Je sens que je puis aller jusque-là, mais il y a un point que je ne puis dépasser. »
Un jour, prenant à part d’Arbaud qui avait dans les environs de vingt ans, et qui en paraissait seize : « Dites, vous qui voyez des femmes, apportez-moi des photos… » ; celui-ci, un peu ahuri, ne comprit pas que l’artiste pensait sans doute à ses baigneuses, et que, faute de modèles, il se serait contenté de certaines photos… Voici une autre anecdote inédite : « J’avais accompagné Gasquet au Jas de Bouffan, nous rentrions en ville, Cezanne venait avec nous. En passant sur le cours Mirabeau, on fit halte à la « Rich Taverne », café disparu, situé sur le cours, à l’angle de la rue du 4-Septembre. Et, tout en buvant un bock, j’écoutais Cezanne parler. Je ne sais quelle question, peut-être sotte, je fus amené à lui poser. Il tourna brusquement la tête, me fixa de cet air méfiant que ses portraits rendent si bien : « Vous voulez peut-être fonder une école ? Je ne dis plus rien… » et il ne desserra plus les dents que pour avaler sa bière ». Le jeune homme n’en revenait pas : fonder une école ?… […]
Joseph d’Arbaud eut la gentillesse de consigner pour moi ses souvenirs. »
15 juin-20 juillet
Une eau-forte, six aquarelles et un dessin de Cezanne sont présentés à l’exposition des « Peintres-graveurs » qui inaugure la nouvelle galerie de Vollard, 6, rue Laffitte. Aucune de ces œuvres ne figure cependant dans l’Album des peintres-graveurs édité par Vollard et tiré à cent exemplaires numérotés et signés par les artistes. Sur son catalogue d’exposition, Pissarro note, en face de la mention de Cezanne et Maurice Denis : « Je vois aussi des lots entiers de pastels et d’aquarelles dans cette exposition spéciale. »
« 41. Cezanne, Paysage, eau-forte
- Cezanne, Maisons sur un coteau, aquarelle
- Cezanne, Bords de rivière, aquarelle
- Cezanne, Fleurs dans un vase, aquarelle
- Cezanne, Paysage, aquarelle
- Cezanne, Pêches dans une assiette, aquarelle
- Cezanne, Le Jardin, aquarelle
- Cezanne, Femmes au bain, dessin »
Catalogue d’exposition, Les Peintres graveurs, galerie Vollard, 6, rue Laffitte, du 15 juin au 20 juillet [1896], exemplaire de la Bibliothèque nationale, Cabinet des Estampes, Yd2 1338b (8e), annoté par Pissarro, 198 numéros, Cezanne nos 41 à 48.
« Les Peintres-Graveurs », L’Estampe, 21 juin, 28 juin, 5 juillet, et 12 juillet 1896, respectivement p. 1, 3, 1, 1.
Loÿs Delteil, « Les Salons. Les Peintres-Graveurs », Le Journal des artistes, 12 juillet 1896, p. 1516-1517.
Louis Désiré [Georges Lecomte], « Notes d’art. Les peintres-graveurs », La Justice, journal politique du matin, 17e année, n° 6027, vendredi 26 juin 1896, p. 1 :
« À la galerie Vollard, 6, rue Laffitte, sont exposés, jusqu’au 20 juillet, les eaux fortes, les lithographies, aquarelles de peintres- graveurs. J’y relève le nom d’artistes connus, Auriol, J.-C. Blanche, Besnard, Bonnard, Buhot, Eugène Carrière, Cezanne, Maurice Denis, Fantin-Latour, Gauguin, F. Jacque, Camille Pissaro, Lucien Pissaro, O. Redan [Redon], Renoir, Rops, Sisley, Vallotton, Vuillard, Willette. A côté d’œuvres anciennes, s’en trouvent de nouvelles fort intéressantes, et l’ensemble est bien choisi pour renseigner sur les productions si séduisantes de la gravure et de la lithographie.
Il y a lieu de citer aussi le faire curieux de To Roop [Toorop], Shannon, Lunois et quelques lithographies en couleurs. »
« Expositions nouvelles », La Chronique des arts et de la curiosité, n° 25, 11 juillet 1896, p. 240 :
« CONCOURS ET EXPOSITIONS
EXPOSITIONS NOUVELLES
Paris
Exposition des Peintres-graveurs, chez Vollard, 6, rue Laffitte, du 15 juin au 20 juillet. »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 298-301 :
« De tout temps, j’ai aimé les estampes. À peine installé rue Laffitte, vers 1895, mon plus grand désir fut d’en éditer, mais en les demandant à des peintres. « Peintre-graveur » est un terme dont on a abusé en l’appliquant à des professionnels de la gravure qui n’étaient rien moins que peintres. Mon idée, à moi, était de demander des gravures à des artistes qui n’étaient pas graveurs de profession. Ce qui pouvait être pris pour une gageure fut une grande réussite d’art. C’est ainsi notamment que Bonnard, Cézanne, Maurice Denis, Redon, Renoir, Sisley, Toulouse-Lautrec, Vuillard produisirent, pour leur coup d’essai, ces belles gravures qui sont aujourd’hui si recherchées.
Cézanne fit deux planches de Baigneurs ; Redon, une Béatrice ; Bonnard, La Petite Blanchisseuse et Le Canotage ; Vuilllard, Le Jardin des Tuileries et Jeux d’enfants ; Maurice Denis, L’Apparition et Jeune Fille à la fontaine ; Sisley, Les Oies ; Toulouse-Lautrec, La Charrette anglaise.
Je vois encore Lautrec, petit homme boiteux, me disant, avec son étonnant regard ingénu :
— Je vous ferai une « femme de maison ».
Et, finalement, il fit cette Charrette anglaise que l’on tient aujourd’hui pour un de ses chefs-d’œuvre.
Les planches que je viens de citer étaient en couleurs. Mais, en noir, la réussite devait être égale. Whistler me donna La Tasse de thé ; Albert Besnard, La Robe de soie ; Carrière, L’Enfant endormi ; Redon, Le Vieux Chevalier ; Renoir, Mère et Enfant ; Edouard Munch, un Intérieur ; Puvis de Chavannes, une réplique du Pauvre Pêcheur…
Toutes ces estampes, celles en couleurs et celles en noir, formèrent, avec plusieurs autres non énumérées ici, Les Peintres-Graveurs, dont il fut fait deux albums tirés chacun à cent exemplaires. J’avais fixé à cent francs le prix du premier album et à cent cinquante francs celui du second, qui contenait un plus grand nombre de pièces. L’un et l’autre album se vendirent assez mal. J’avais entrepris une troisième série qui resta inachevée. […]
Outre ses Baigneurs, Cézanne devait faire aussi pour moi son portrait : une litho en noir. […]
Fantin-Latour, pour sa part, devait me faire quelques-unes de ses plus belles planches. Le peintre des Filles du Rhin avait bien voulu s’intéresser à mes efforts pour éveiller dans le public le goût de l’estampe, encore que mes tendances « hardies » lui fissent peur. Il me souvient qu’un jour, dans son atelier, comme je lui faisais part de mon intention d’aller au Louvre pour confronter une nature morte de Cézanne avec un Chardin, le peintre, brusquement, se dressa :
— Ne jouez pas avec le Louvre, Vollard !… »
19 juin
Vollard vend une nature morte de Cezanne à Murat pour 150 francs.
Registre commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
16 juillet
John Osborne Sumner achète à Vollard une « étude » de Cezanne, Paysans se reposant (Les Moissonneurs, FWN659-R454), à, pour 150 francs. Sur le livre de comptes de Vollard est noté :
« 16
Doit Monsieur Sumner / (Hotel Metropolitain (ami de Loeser) / 1 etude de Cezanne (paysans se reposant) / 150 »Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 454, p. 306, extrait du livre de comptes de Vollard reproduit.
16 juillet
Pissarro écrit à Oller.
« Mon cher Oller,
Es-tu encore à Paris ? D’où vient que l’on ne t’ait pas vu ni à l’hôtel, ni chez Vollard, ni chez Durand-Ruel ?
Je me suis absenté pendant cinq jours et suis de retour pour continuer mon traitement, je pense que j’en aurai fini avec mon oculiste samedi, si tu as un moment demain vendredi, viens dîner avec moi.
Je te serre les mains.
C. Pissarro
Entre 6 h et 7 h à l’hôtel. Le matin comme à l’ordinaire. »Lettre de Pissarro Paris, 111 rue Saint-Lazare, à Oller, 16 juillet 1896, Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1272, p. 232.
Oller repartira pour Puerto Rico le 3 août.
Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, note n° 1 p. 232.
17 juillet
Enveloppe d’une lettre, semble-t-il perdue, écrite par Cezanne à Oller :
« Monsieur
F. Oller
Chez Mr le Docteur Aguiar,
Crozier-le-Vieux
Par Cusset — (Allier) »Enveloppe d’une lettre de Cezanne à Oller, cachet de la poste : « AIX-EN-PROVENCE B. DU R. 6H/17 JUIL 96 » ; vente Archives de Camille Pissarro, Paris, hôtel Drouot, 21 novembre 1975, n° 137.4.
Autre enveloppe écrite par Cezanne, sans cachet de la poste :
« Monsieur
Francesco Oller
Hôtel du Petit St Jean
Mezy, loueur de voiture
rue Mazarine : »Enveloppe d’une lettre de Cezanne à Oller, sans date ; vente Archives de Camille Pissarro, Paris, hôtel Drouot, 21 novembre 1975, n° 137.4.
Après le 17 juillet – avant le 29 septembre
À la demande de sa femme et de son fils, le peintre se rend avec eux à Talloires, au bord du lac d’Annecy. Ils passent par Chambéry (hôtel de Verdun) et Annecy (hôtel de la Paix). De Chambéry, ils se rendent à Saint-Laurent-du-Pont pour visiter la Grande Chartreuse. À Talloires, ils séjournent à l’hôtel de l’Abbaye, où il ne tarde pas à s’ennuyer : « La vie commence à être pour moi d’une monotonie sépulcrale. » Pendant son séjour, il fait plusieurs excursions dans les environs (Thônes, le château de Duingt sur la rive opposée à Talloires, etc.).
Lettres de Cezanne à Joachim Gasquet, 21 juillet 1896, et à Solari, 23 juillet 1896, Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 252-253, 254 ; Andersen Wayne V., « Cezanne’s carnet moiré », The Burlington Magazine, volume CVII, juin 1965, p. 313-317.
Une page du carnet de croquis dit « carnet violet moiré » contient ces notes de Cezanne :
« Chambéry
(hotel de la paix)Annecy —
hotel Verdun
Passage
Dulac
3 = »
Sur deux autres pages du carnet est écrit :
« Annecy – le lac
chateau de Thunn
de Duingt ».
« St Laurent[-du-Pont]
Brignoud »« Carnet violet-moiré », imprimé en fac-similé par Daniel Jacomet, Paris, éditions Quatre Chemins, 1956, n. p., p. V, I et I verso.
Andersen Wayne V., « Cezanne’s Carnet violet-moiré », The Burlington Magazine, volume CVII, n° 747, juin 1965, p. 313-318, p. 314 :
« Sur la page V [du carnet violet moiré] figure la note : « Chambéry (Hôtel de la Paix) » ; et sur la page I verso [C 1176] les noms de deux villes plus petites [de l’Isère], « St Laurent » [Saint-Laurent-du-Pont] et « Brignoud », qui doivent également se rapporter au voyage de Cezanne d’Aix-en-Provence à Annecy, ce qui prouve, ainsi que le séjour à l’hôtel sur la ligne de trains, qu’il ne s’est pas rendu directement au lac(15). Il a plutôt fait l’excursion classique de la Savoie et du Dauphiné, de Chambéry à Saint-Laurent-du-Pont (peut-être par le service d’été, le seul service ferroviaire disponible en 1896, à Brignoud(16)). Saint-Laurent était alors le pivot de la classique excursion qui aboutit à la Grande Chartreuse. La preuve en est, à la page IX [C1174] du carnet violet moiré, une esquisse de chapelle identifiée comme étant la façade nord de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, qui est contiguë à la partie nord du couvent de la Grande Chartreuse(17). Cette esquisse date, par conséquent, de l’été 1896 (voir fig. 49). […]
(15) Ibid.
(16) Ibid.
(17) Pour la confirmation définitive du motif, je suis redevable à M. L. Chavand du Syndicat d’Initiative, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère, qui a fidèlement suivi nos indications et a pris la photo à partir de laquelle nous travaillons. Tous les détails architecturaux ont été soigneusement vérifiés et tous les changements dans le paysage, y compris l’élargissement de la route en face de cette façade, ont été considérés.
Dans notre recherche pour identifier ce motif et d’autres du carnet de croquis, nous avons reçu l’aide amicale de Mlle Anne de Hardt, du musée d’Art et d’Histoire de Genève, et de M. Daniel Vouga du musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. »
Chappuis Adrien, The Drawings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, New York Graphic Society Ltd., Greenwich, Connecticut, 1973, volume I, « Introduction and Catalogue », 288 pages, notice 1174 p. 265-266 :
Traduction :
« 1174. PAYSAGE AVEC CROIX, 1890-1894
Un beau petit croquis, exécuté lors d’un voyage. Au premier plan, quelques tombes dans une enceinte en pierre sèche avec une croix sur la droite, et une autre croix sur la gauche coupée en deux par le bord du papier. Le bâtiment derrière les arbres semble avoir des ouvertures de style gothique. Il n’est pas facile d’interpréter le bord en diagonale vers la droite ou les parties ombrées de la paroi. W. V. Andersen date ce paysage de 1896, car il estime qu’il représente la façade nord de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette, à côté du monastère de la Grande Chartreuse (Isère). Dans son carnet violet moiré, l’artiste notait l’itinéraire menant de Chambéry à la Grande Chartreuse, où on sait qu’il a séjourné en 1896 (le nom du monastère, cependant, n’est pas mentionné). Andersen a reconnu le motif d’après une photographie prise au monastère par L. Chavand, de Saint-Pierre-de-Chartreuse. À son avis, le dessin peut donc être daté par des preuves externes, sans avoir besoin de comparaisons de style. Pour ma part, après avoir comparé cette esquisse avec beaucoup d’autres, je trouve son traitement plus proche des dessins attribués aux années 1889 à 1894 que de ceux datant d’un séjour de l’artiste à Talloires en 1896. Le 29 octobre 1970, j’ai visité la Grande Chartreuse pour examiner ce motif, mais je n’ai pas réussi à l’identifier tel qu’il est représenté dans le moiré carnet violet. M. L. Chavand a été assez aimable pour me faire un croquis de la localité, marquant le site, malheureusement il n’a pas pu me montrer la photo communiquée à W. V. Andersen. Un prêtre de l’intendance du monastère, un homme calme, intelligent, qui tient M. Chavand en haute estime, m’a accompagné à l’enceinte de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette. Reproduction du dessin en main, il a d’abord été enclin à reconnaître le site, mais, après avoir examiné les détails, il en est venu à la conclusion, comme moi, que même avec l’ajout d’une route, les différences très évidentes invalident l’identification du motif. Le bâtiment, par exemple, n’a pas d’ogives. Le prêtre a aussi affirmé qu’il n’y avait jamais eu de cimetière en plein air de ce côté, entre la chapelle et l’entrée principale du monastère. Andersen voit trop un cimetière dans le dessin. On peut remarquer que les croix ne sont pas similaires à la croix des Chartreux caractéristique, comprenant deux barres droites. En conclusion, par conséquent, la date de cette esquisse ne peut pas être établie avec certitude par des preuves externes, et pour moi, à l’heure actuelle 1890-1894 semble la date la plus probable. »
Pour rentrer à Aix, Cezanne passe par Lyon et Rognac via Miramas.
Sur une page de carnet, il note l’horaire de train :
« via Miramas 4h,35
départ à 5h31
Rognac 6h,07 »« Carnet violet-moiré », imprimé en fac-similé par Daniel Jacomet, Paris, éditions Quatre Chemins, 1956, n. p., p. X verso.
Wayne V. Andersen a montré que les deux horaires de train n’ont été en vigueur qu’en 1895-1896.
Andersen Wayne V., « Cezanne’s Carnet violet-moiré », The Burlington Magazine, volume CVII, n° 747, juin 1965, p. 313-318, p. 317 :
Traduction :
« Une date incontestable est donnée par le chemin de fer à la page II verso [du carnet violet moiré, C 1122] (fig. 49) pour un trajet de Paris à Marseille. L’horaire, d’une exactitude précise, n’a été en vigueur qu’entre le 1er octobre 1895 et 1er mai 1896, et correspond à son voyage pour le Midi au printemps 1896(12). Cezanne n’a pas effectué le voyage complètement, l’arrêt final à Marseille est barré. Il a changé de train à Lyon, pour Rognac via Miramas [il paraît plus probable que Cezanne a pris ce train quand il est rentré d’Annecy]. L’itinéraire de ce changement apparaît à la page X verso [C 1168] (fig. 41). Lui aussi correspond exactement à un horaire seulement en 1895-1896.
(12) Voir ci-dessous, note 26.
(26) Selon L’Indicateur Chaix, à La Vie du rail, Paris, cet horaire exact n’a été en vigueur qu’entre le 1er octobre 1895 et le 1er mai 1896. La note Laro est une abréviation de Laroche-Migennes, une ville entre Paris et Dijon, où le train faisait un court arrêt. La note ma signifie matin. Marseille, la destination finale, a été rayé. Cezanne a changé d’idée et est allé de Lyon à Rognac via Miramas. L’itinéraire de ce changement est noté sur la page X verso. Selon Selon l’Indicateur Chaix, cet horaire lui aussi n’a été en vigueur qu’en 1895-1896. »
Au cours de son séjour à Talloires, il peint semble-t-il au moins les œuvres suivantes :
- Le Lac d’Annecy (FWN311-R805), vu de Talloires vers le château de Duingt
- Profil du Roc de Chère, lac d’Annecy (aquarelle RW476)
- Au Lac d’Annecy (RW468), qui représente la presqu’île de Balmette
- Bords du lac d’Annecy (RW474), qui représente le col d’Évires vu d’Annecy-le-Vieux
- L’Enfant au chapeau de paille (FWN520-R813)
- L’Enfant au chapeau de paille (FWN537-R895)
- L’Enfant au chapeau de paille (aquarelle RW480)
- L’Enfant au chapeau de paille (aquarelle RW481)
- L’Enfant au chapeau de paille (aquarelle RW482)
- L’Enfant au chapeau de paille assis sur une chaise (aquarelle RW483)
- Portrait d’enfant (dessin C1085).
Identification de certains des sites par l’association Cezanne en Savoie.
Ce qui suggère que la série de L’Enfant au chapeau de paille a été réalisée pendant le séjour à Talloires, c’est qu’au dos de RW482 figure la vue d’un lac, probablement le lac d’Annecy, Au lac d’Annecy (RW468).
Cezanne Philippe, « My Great-Grandmother Marie-Hortense Fiquet », Madame Cezanne, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan Museum of Art, 19 novembre 2014 – 15 mars 2015, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2014, 224 pages, p. 43 :
Traduit de l’anglais :
« Il fait aussi le portrait d’un enfant au chapeau de paille [FWN537-R895], le fils de monsieur Vallet, un jardinier de l’hôtel, et plusieurs études pour ce portrait. »
21 juillet
Il remercie Joachim Gasquet de l’envoi du deuxième numéro de la revue qu’il vient de fonder, Les Mois dorés, où sont publiées quelques lignes sur lui.
« Talloires, 21 juillet 1896.
Mon cher Gasquet,
Me voici éloigné de notre Provence pour quelque temps. Après pas mal de tergiversations, ma famille, entre les mains de laquelle je me trouve en ce moment, m’a déterminé à me fixer momentanément au point où je me trouve. C’est une zone tempérée. L’altitude des collines environnantes est assez grande. Le lac, en cet endroit resserré par deux goulets, semble se prêter aux exercices linéaires de jeunes miss. C’est toujours la nature, assurément, mais un peu comme on nous a appris à la voir dans les albums des jeunes voyageuses.
Toujours vaillant, vous devez, avec votre magnifique puissance cérébrale, travailler toujours et sans trop de fatigue. Je suis trop distant de vous et par l’âge et par les connaissances que vous acquérez chaque jour ; néanmoins, je viens me recommander à vous et à votre bon souvenir pour que les chaînons qui me rattachent à ce vieux sol natal si vibrant, si âpre et réverbérant la lumière à faire clignoter les paupières et ensorceler le réceptacle des sensations, ne viennent point à se briser et me détacher pour ainsi dire de la terre où j’ai ressenti, même à mon insu. Ce sera donc une véritable compatissance et un réconfort à me servir que de vouloir bien me continuer l’envoi de votre revue, qui me rappellera et le pays absent et votre aimable jeune âge qu’il m’a été donné de côtoyer. A mon dernier passage à Aix, j’ai été peiné de ne point vous voir. Mais j’ai appris avec plaisir que Madame Gasquet et vous présidiez à des manifestations régionales et méridionales 1.
Que de remerciements et de grâces n’ai-je pas à vous rendre pour les bons souhaits que vous avez bien voulu formuler dans votre lettre pour ma femme. Et j’ai aussi à vous remercier pour votre envoi du second numéro de la revue, si nourri et si plein. J’ose donc espérer vous lire encore, vous et vos ardents collaborateurs.
Je vous prierai, en terminant, de vouloir bien faire agréer mes respects à la Reine de Provence, me rappeler à votre père et aux autres personnes de votre famille, et permettez-moi de me dire bien cordialement à vous.
Paul Cezanne
Adresse : Hôtel de l’Abbaye, Talloires par Annecy (Haute-Savoie).
Il faudrait la plume descriptive de Chateau[briand] pour vous donner une idée du vieux couvent où je loge. »
- Il y eut de nombreuses fêtes félibréennes en 1896, notamment le 23 janvier, lorsque Gasquet avait épousé Marie Girard, reine du Félibrige. Le 26 juillet eut lieu une grande fête des Félibres aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 252-253.
Gasquet Joachim, « Aix-en-Provence », Les Mois dorés, Aix, Imp. Bernex, juin 1896, p. 3-6, extrait cité p. 4 :
« Depuis de longues années, toute une race de penseurs et d’artistes a grandi là. C’est à la terre d’Aix que Zola a pris ce qu’il y a de substantiel dans son œuvre. Aujourd’hui encore le peintre Cezanne nourrit ses toiles de l’Air qu’on respire sur les hauteurs que la ville contemple. »
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 93 :
« Il faudrait la plume descriptive de Château 1 pour vous donner une idée du vieux couvent où je loge. » […]
1 C’est ainsi qu’il appelait toujours Chateaubriand. Même au restaurant, il demandait, à l’ébahissement des garçons : « Un Château ». Et quand on apportait un Château-Laffitte, il exultait comme un enfant qui a fait un bon tour, et faisant laisser la bouteille, bien entendu, il redemandait : « Et maintenant un Château, un vrai ! » Il avait ainsi des coins de gaminerie charmante, qu’il garda jusqu’à ses derniers jours. »
Le premier numéro de la revue de Gasquet paraît en juin, le deuxième en juillet, contenant un texte de Gasquet qui évoque Cezanne et la « parenté certaine » de son art avec celui de Paul Claudel.
Gasquet Joachim, « Juillet », Les Mois dorés, Aix, Imp. Bernex, juillet 1896, p. 93-98, p. 93-96 :
« JUILLET
L’Été merveilleux des idées.
E. Signoret.Ce Mois est celui de la Lumière. La déesse y préside à toutes les fêtes de la terre et des êtres. Les hommes lui immolent la fleur des moissons. Elle assiste aux saines épousailles qu’ils célèbrent au coin chaud des meules ou sur le revers des ruisseaux. Elle est chaste et brûlante. Je l’ai contemplée dans les grands soirs d’été où elle s’attarde avec délices, pour nous sourire à tous, sur ces coteaux de Provence qui sont pour elle l’autel le plus divinement mélancolique que les crépuscules aient donné à la terre. Elle s’élance aussi des flots de la mer avec une immense ivresse, et dans l’heure de midi elle s’abat sur les monts pareille dans sa splendeur aux ailes embrasées des Victoires. Elle a sous les ombres des parcs de tendres refuges que sa présence anime, et c’est là que l’adore avec extase et simplicité le vieux maître Cezanne dont elle visite le cœur et les toiles.
Sous les feuillages du Jas de Bouffan, près des fontaines, il se livre aux plus patientes études, et c’est merveille de voir soudain toute l’âme d’un paysage transfigurer les lignes colorées pour participer désormais à l’activité calme de nos esprits. Le peintre vient d’achever une toile qui est un pur chef-d’œuvre. Toute affaissée dans ses vêtements bleus, à la fin de ses épreuves, le visage accablé par des jours trop nombreux, une vieille femme, une servante, entre ses vieilles mains presse avec ferveur et résignation les grains d’un chapelet [R 808]. Un rayon descend sur sa face humble. Elle est dans l’oubli. Je ne sais quelle émotion m’a étreint devant ce dernier tableau de M. Cezanne. Je veux dire, plus tard, comme il le faut, toute la vie du noble maître aixois et le sens profond qui se dégage de ce millier de toiles entassées au hasard dans son lumineux atelier. C’est là seulement — comme dans ce tableau du Mont Victoire, où l’air lumineux apaise tous les désirs de la plaine et des collines avec tant de suave beauté ; comme dans cette toile où des rocs rougeâtres et forts se dressent sous des pins, — c’est là seulement que j’ai trouvé évidente et réelle la vie de notre lumière, présente et simple la beauté âpre et tendre de notre Provence. M. Montenard a une âme trop violente et ne peut traduire avec bonheur que certains aspects définis et certaines heures de la vie de nos contrées. J’ai vu de lui à l’exposition d’Aix une plaine misérable, où noircissent des cyprès et qu’accablaient d’aveuglants rayons, qui était très émouvante. M. Seyssaud a trop de rêve dans l’âme. Ses rêveries sont admirables d’ailleurs. Mais les études que M. Cezanne a rapportées de l’Estaque, par exemple, disent toute l’éclatante harmonie des rivages et devant mes yeux j’évoque souvent la petite ville, telle qu’elle est dans ces toiles, vivant sous son clocher debout dans la clarté ondoyante, et dont toute l’existence se nourrit des inoubliables caresses de la lumière et de la mer. La plaine, les bleuâtres collines, les horizons, la naturelle beauté des campagnes qui s’étendent autour d’Aix, les fraîcheurs dorées ou vertes où la rivière s’endort, revivent dans une centaine de toiles, et le maître a rendu aussi, dans sa robuste loyauté, la figure auguste et naïve des rustres qui cultivent ces terres et que glorifie de ses rayons toute la divine bonté de notre lumière. Il y a entre son art et celui de M. Paul Claudel, dans ce Chant à cinq heures qui révèle un poète ingénu et savant, une parenté certaine. Tous deux ont apporté dans leur art une conscience nouvelle, et pour exprimer l’émotion de leur âme devant le mystère accepté des choses, ils ont su trouver tous deux la même grâce et aussi la même farouche splendeur. […] »
Extraits cités par Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet suivi de Souvenirs sur Cezanne de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, p. 28-30.
Bernex Jules, « Souvenirs sur Cezanne », L’Art sacré, n° 7-8, mars-avril 1956, p. 22-31, p. 24-26 :
« Tel était l’Aix d’alors où Cezanne était insulté.
Il y avait…
Mais ce passé d’un mouvement littéraire, assez exceptionnel, qui commença avec les revues « La Cigale », les « Mois Dorés » où, de Montpellier, collabora Paul Valéry, qui continua avec le « Pays de France » et, un temps encore, avec ma revue « Les Gerbes » que je remis, partant pour l’armée, à la revue méditerranéenne « Le Feu » d’Émile Sicard, ne peut être ici qu’un détail.
Dans cet ensemble, on appréciait, on aimait un petit homme d’aspect bohème, toujours souriant dans sa barbe rousse, les yeux d’un enfant, le teint cuit par le soleil ; vêtu hiver comme été — et jusqu’à sa mort — d’un costume de velours à côte, couleur de l’argile à l’automne ; écrivain, musicien et plus encore et surtout un peintre, Joseph Ravaisou, un des « libertaires » qui défendaient Paul Cezanne. Par lui, je fus des leurs, près de celui que je vais évoquer.
Paul Cezanne. Tout a été dit sur lui. Mais il s’agit d’un témoignage resté silencieux jusqu’à présent.
« Vaï pinta de gabi », vas peindre des cages d’oiseaux, lui criaient les gamins et ce n’était qu’une moquerie ; il y eut des choses pires. Déjà, en 1878, il avait écrit à Zola [14 avril 1878] : « Les élèves de Villevieille (directeur de l’École de dessin) m’insultent au passage. Je me ferai couper les cheveux, ils sont peut-être trop longs. Je travaille ; peu de résultats et trop éloigné du sens général. »
Je l’ai vu — et je l’ai accompagné — très grand, les cheveux blanchis, s’inclinant vers la terre, la bouche semblant parler, les yeux presque hors des orbites, son chapeau melon enfoncé sur le front, sa jaquette noire froissée, embarrassé par son « en-cas » pour le soleil, par sa vieille boîte à couleurs. Très maniaque, très ombrageux, agitant parfois ses bras, en entier à son idée. Nul ne pouvait discerner la puissance qui était en lui et, dans ses manifestations, sa relative impuissance. D’elle je garde le sentiment profond et il la reconnaissait lui-même humblement en écrivant dans la lettre citée : « peu de résultats »…
Ce Cezanne, différent de l’officiel, il m’en faut encore compléter la nature en indiquant qu’il était, malgré sa misanthropie, sa violence, très bon et, quand il croyait devoir l’être, très généreux. Il obéissait à sa bonne parce qu’il avait en elle une confiance illimitée. Elle le déchargeait des soucis ménagers ; elle lui remettait son argent de poche. Il s’inclinait : « Madame Brémond, si vous vouliez, j’amènerais demain un ami pour déjeuner, mais si cela devait vous déranger nous irions à l’hôtel… » Bon catholique, s’il suivait la messe, les offices, ce n’était point tellement par une Foi instruite, mais parce qu’il aimait le cérémonial des liturgies, leur chant, qu’il se sentait bien dans l’église, qu’une émotion l’envahissait. De même était-il sensible à la beauté des sites.
Et fanatique dans son culte de l’art. Travailleur sans répit, sans merci, toujours devancé par sa vision et trop impulsif, il haïssait tout pontifisme. Il ne soignait même pas ses outils de travail. Il « n’enseignait » jamais, répétant seulement un axiome transmis par Ravaisou : « Il est impossible qu’une peinture soit vraie si elle ne vise qu’à l’imitation du modèle. Copier la nature est une folie. On ne copie ni l’air ni le mouvement ni la lumière ni la vie »… Mais à des peintres sans personnalité qui risquaient de se frotter à lui il disait avec une aimable ironie : « Oh ! vous, pour sûr, vous arriverez »…
… Il quittait souvent son logis de la rue Boulegon le matin, vers les cinq heures, pour aller « au motif ». Quand il l’avait trouvé, il restait en arrêt devant lui, les trois ou quatre toiles emportées chaque fois écroulées au bas d’un buisson. Il regardait avec une exceptionnelle acuité de perception. Les couleurs s’accentuaient, les formes se transformaient, au sommet du Mont de la Victoire qu’une Croix a sanctifié, le soleil étincelait comme une gloire, illuminait sur la ligne de faîte la brèche ouverte de main d’homme pour le couvent des Camaldules où, au Moyen Âge, on allait faire des cures d’air et d’âme ; la pourpre, les ors, les violets frissonnaient avec la terre, chantaient avec les arbres. Sans la tension de l’étude il se serait agenouillé. Puis, dans l’offrande des plaines, les champs apparaissaient avec leurs meules, le mouvement cadencé des laboureurs, le déroulement des sillons, le peuple agité des ceps de vigne, l’éblouissement des oliviers et, soudain midi brûlait sur la colline comme la flamme sur l’autel des Pénates. Les heures se succédaient, déesses passagères, et pour chacune d’elles le décor changeait en ses détails. Cezanne ne cessait d’observer, et malheur à qui venait le troubler. Dès qu’il prenait ses pinceaux commençait son drame.
Je l’ai compris devant le Mont de la Victoire : « Un des lieux où souffle l’esprit » a écrit le Barrès de « La Colline Inspirée ». La pureté quasi spirituelle de l’air, l’harmonie des lignes et des plans, les vibrations des couleurs ou des teintes selon les sensibilités de la lumière laissent percevoir la présence du Sacré. Et le silence méditatif de la campagne provençale, qui est celui d’une vie ayant le sens de l’éternel, le définit à l’âme de l’artiste assez pur pour l’entendre.
La matérialité des masses y participe par l’atmosphère et, par elle, le Mont a une construction abstraite ou devient tout proche, net et géométrique et, déjà il s’éloigne, féerique ou d’un bleu pâle, aérien à la base il semble s’incliner en déséquilibre, impression d’une des belles toiles de Cezanne où l’on a cru discerner une erreur de perspective.
Et lui voulait fixer l’éphémère et se posait en outre des problèmes : « Tu vois, expliquait-il à Solari, rien n’est droit dans la nature, et cet arbre, tu le représenterais plat car tu ne l’aperçois que d’un côté et, cependant il est rond. » Mais il « travaillait » trop lentement, surtout les derniers temps, peignant par frottis. Il raclait sans cesse, d’où la difficulté de suivre son dessin. Que de fois, s’interrompant brusquement, n’a-t-il pas balbutié : « Ce n’est plus ça, ce n’est pas ça… je ne puis pas. » Ou, furieux, il jetait le tableau ou le crevait.
Cerveau trop rapide, mains trop lentes. »
23 juillet
Lettre de Cezanne à Philippe Solari :
« Talloires, 23 juillet 1896.
Mon cher Solari —
Quand j’étais à Aix, il me semblait que je serais mieux autre part, maintenant que je suis ici, je regrette Aix. — La vie commence à être pour moi d’une monotonie sépulcrale. — Je suis passé à Aix, il y a trois semaines, j’ai vu le père Gasquet, son fils était à Nîmes. J’ai fait en juin un mois de Vichy, on y mange bien. Ici on ne mange pas mal non plus. — Je suis logé à l’hôtel de l’Abbaye. — Quelle superbe reste des temps anciens ; — un perron de cinq mètres de large, une porte épatante, une cour intérieure, avec des piliers formant tout autour galerie ; on monte un grand escalier, des chambres donnant sur un immense couloir, tout ça monacal. — Ton fils sera sans doute bientôt à Aix. Fais-lui part de mes souvenirs, des rappels de nos promenades aux Peirières, à Ste. Victoire et si tu vois Gasquet, qui doit nager dans la joie de la paternité revue, dis-lui bien des choses.
Rappelle-moi au souvenir de ton père et présente-lui mes respects.
Pour me désennuyer je fais de la peinture, ce n’est pas très drôle, mais le lac est très bien avec de grandes collines tout autour 1, on me dit de deux mille mètres, ça ne vaut pas notre pays, quoique sans charge ce soit bien. — Mais quand on est né là-bas, c’est foutu, rien ne vous dit plus. Il faudrait avoir un bon estomac, se ficher une bonne biture « la vigne est la mère du vin » de Pierre, tu te souviens ? Et dire que je vais remonter à Paris fin août. Quand te reverrai-je ? Si ton fils en retournant passait par Annecy, fais-le-moi savoir.
Une bonne poignée de main.
Ton vieux
Paul Cezanne.
Jo 2 m’a envoyé le numéro 2 de la Revue, quand j’étais encore à Vichy, vers la fin juin. — Mon cher, ça fait plaisir d’avoir des nouvelles de là-bas. —
———
Mon adresse ici est :
Hôtel de l’Abbaye,
Talloires par Annecy
(Haute-Savoie)
———
Gasquet m’a dit que tu as fait des choses très – réussies — tant mieux. — »
Cezanne a peint une vue du lac d’Annecy (Venturi n° 762).
Il s’agit de Joachim Gasquet.
Cité d’après une reproduction ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 252-253.
Mack Gerstle, La Vie de Paul Cezanne, Paris, Gallimard, « nrf », collection « Les contemporains vus de près », 2e série, n° 7, 1938, 362 pages, p. 280 :
« Ce fils, Émile Solari, non seulement a bien voulu me permettre de citer des extraits des lettres de Cezanne à son père et à lui-même, il m’a aussi fourni des notes et des souvenirs personnels très intéressants. À propos de la lettre citée, Monsieur Solari écrit qu’elle « n’abusera pas le lecteur par son caractère partiellement épicurien. Cezanne était un sobre et si, parfois, au souvenir de sa jeunesse, il s’enflammait par quelques verres de vin autour d’un bon plat de pays, c’était exceptionnel. Cezanne ne vivait que pour l’art. »
Fin août
Cezanne se rend à Paris où il passe beaucoup de temps à la recherche d’un atelier. Il loue (non, il rejoint l’appartement loué par Hortense avant avril 1896) un appartement au 3e étage du 58, rue des Dames, aux Batignolles, qui se compose d’une antichambre, d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine, d’un couloir, d’un cabinet, d’un w. c. et de deux pièces à feu.
Il relit Flaubert.
Lettres de Cezanne à J. Gasquet, 29 septembre 1896, Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 255. Calepins cadastraux D1P4, 1876, Archives de Paris.
4 septembre
Pissarro annonce à son fils Lucien que Vollard va installer une presse lithographique dans sa galerie.
« Vollard va avoir une presse lithographique rue Laffitte. Ce brave Créole est épatant, il virevolte d’une chose à l’autre, avec une facilité épatante ; il m’a prié de te demander l’adresse du marchand de papier de Ricketts pour faire une commande d’avance. Il me harcelait dernièrement et sa femme aussi pour faire de petites affaires de gouaches ou lithos avec moi, avant-hier je lui montrais trois choses que j’allais faire monter, il ne les a même pas regardées. Il m’a quitté en plan pour me montrer un Cezanne et n’y a plus pensé, aussi il fera chaud quand je me dérangerai pour lui montrer quoi que ce soit.
Ce garçon est vraiment trop volage. Il lance chaque fois des pointes sur le haut prix des lithos de Shannon et la réserve que vous mettez à faire des affaires ici… parbleu, c’est peu encourageant avec des bonshommes si fluides !… »
Lettre de Pissarro, Paris, 111, rue Saint-Lazare, à son fils Lucien, 4 septembre 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1288, p. 245-246.
18 septembre
Pissarro écrit à son fils Lucien :
« Pauvre Vollard ! c’est moi qui lui ai dit que ce papier était de la fabrique de Ricketts, laisse-le donc chercher, je lui ai dit qu’il s’embarquait dans une affaire qu’il faut connaître, et que les estampes ne se vendaient pas, que les marchands n’y entendaient pas grand chose et ne s’en tiraient qu’à force de trucs, tels que les affiches, les épreuves en couleurs, etc.
Je lui ai dit vingt fois que le papier de Ricketts ne se vendait pas dans le commerce, mais têtu comme il est, il voudrait acheter une bonne quantité par l’entremise de Ricketts, et avec ta recommandation !!!! quel drôle de garçon !… »
Lettre de Pissarro, Rouen, hôtel d’Angleterre, à son fils Lucien, 18 septembre 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1298, p. 256.
29 septembre
Cezanne écrit à Joachim Gasquet :
« Paris, 29 septembre 1896.
Mon cher Gasquet,
Me voici bien en retard pour vous accuser réception de l’aimable envoi que vous avez bien voulu me faire des deux derniers numéros parus des Mois dorés. Mais rentré à Paris, en quittant Talloires, j’ai consacré pas mal de jours à trouver un atelier pour y passer l’hiver. Les circonstances, je le crains fort, vont me retenir quelque temps à Montmartre où se trouve mon chantier. Je suis à une portée de fusil du Sacré Cœur [58, rue des Dames] dont s’élancent dans le ciel les campaniles et clochetons [en cours de construction depuis 1875].
En ce moment, je relis Flaubert que j’entrecoupe en parcourant la revue. Je suis exposé à me répéter souvent : elle embaume la Provence. Je vous revois en vous lisant et, la tête plus calme, je pense à la sympathie fraternelle que vous m’aviez manifestée. Je ne puis pas dire que j’envie votre jeunesse, c’est impossible, mais votre sève, votre inépuisable vitalité.
Je vous remercie donc vivement de ne pas m’oublier, maintenant que je suis éloigné.
Je vous prie de me rappeler au souvenir de votre père, mon ancien condisciple, et veuillez faire agréer mes respects à la Reine qui préside si magnifiquement au renouveau d’Art qui s’éveille en Provence.
A vous l’expression de mes meilleurs sentiments et les souhaits que je fais pour votre succès continu. Bien à vous.
Paul Cezanne
P. S. Mais j’ai malheureusement à vous faire part de l’insuccès de Vollard pour placer les dessins de Monsieur Heiriès. Il prétend avoir fait plusieurs démarches restées infructueuses, à cause de la difficulté pour trouver des débouchés, tant sont [peu] recherchées les illustrations de livres. Je me ferai remettre les dessins et vous les adresserai à mon grand regret.
P. Cezanne »Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 255-256.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 94 :
« Il a loué un atelier, cité des Arts, non loin de celui de Carrière, mais il ne voit personne. »
1er-3 novembre
Zola est arrivé à Marseille, le 29 octobre, pour y retrouver sa femme, Alexandrine, de retour d’un voyage en Italie qui a duré six semaines. Il passe ensuite trois jours à Aix chez Numa Coste, avant de regagner Marseille, puis Paris. Cezanne est probablement à Paris à cette époque.
Rentré à Paris, Zola écrit quelques mots à Numa Coste :
« Mon court voyage à Aix me paraît déjà comme un songe, mais un songe charmant, où revit un peu de ma jeunesse, et où je vous revois, mon vieil ami, vous qui avez été de cette jeunesse ».
Lettre inédite de Zola à Numa Coste, sans date [Paris, 1896], communiquée à John Rewald par Marcel Provence ; Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 141-142 ; dates d’après Alain Pagès, « J’irai te voir pour te serrer la main… », site internet de la Société Paul Cezanne, 2014.
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 177-180 :
« « Écoutez un peu, monsieur Vollard, il faut que je vous dise ! J’avais cessé d’aller chez Zola, mais je ne pouvais me faire à l’idée qu’il n’avait plus d’amitié pour moi. Quand je me suis logé rue Ballu, à coté de son hôtel, il y avait bien longtemps que nous ne nous étions vus ; mais, demeurant si près de lui, j’espérais que le hasard nous ferait nous rencontrer, et qu’il viendrait à moi… Me trouvant plus tard à Aix, j’appris que Zola y était arrivé récemment. Je m’imaginais, comme de juste, qu’il n’osait pas venir me voir ; mais comment penser encore au passé ? Comprenez un peu, monsieur Vollard, mon cher Zola était à Aix ! J’oubliais tout, l’œuvre et bien d’autres choses aussi, comme cette sacrée garce de bonne qui me regardait jadis de travers pendant que je m’essuyais les pieds sur le paillasson avant d’entrer dans le salon de Zola. J’étais, en ce moment, sur le motif ; j’avais une étude qui ne venait pas mal ; mais je m’en f… bien, de mon étude : Zola était à Aix ! Sans même prendre le temps de plier mon bagage, je cours à l’hôtel où il était descendu ; mais un camarade que je croisai en route me rapporta que l’on avait dit la veille, devant lui, à Zola : « Irez-vous manger la soupe chez Cezanne ? » et que Zola avait répondu : « À quoi bon revoir ce raté ? » Alors je retournai au motif.
Les yeux de Cezanne étaient pleins de larmes. Il se moucha pour cacher son émotion, et me dit :
« Voyez-vous, monsieur Vollard, Zola n’était pas un méchant homme, mais il vivait sous l’influence des événements ! »
Pour faire diversion, je demandai à Cezanne : « Quelles raisons avaient pu pousser Zola à vouloir être de l’Académie française ?
Cezanne. — La véritable cause remonte bien loin. À l’apparition de l’œuvre, il y eut brouille entre Zola et Edmond de Goncourt. Zola fut pardonné, mais seulement en apparence, et Goncourt le raya de son Académie. Zola voulut alors faire partie de l’autre académie, pour lui faire la pige. Et si l’on avait voulu de lui, il aurait trouvé là son contentement, et n’aurait pas eu besoin, pour épater le pauvre monde, d’entrer dans cette affaire Dreyfus, où il n’était pas de force ! Seulement, quand on est un peu mince d’étoffe, on cherche toujours à péter plus haut que le nez. Voyez-vous, monsieur Vollard, pour réussir dans la vie, il faut avoir du « temmpérammennte » !..
Moi. — Mais qu’y a-t-il dans l’œuvre dont Goncourt ait pu prendre ombrage ?
Cezanne. — C’était à cause du titre que Zola avait donné à son livre. Goncourt prétendait que ce titre, l’œuvre, leur appartenait à lui et à son frère défunt, qui avaient écrit l’œuvre de François Boucher. »
Cezanne se mit à rire de bon cœur, puis, les yeux pleins de malice : « On n’est tout de même pas si bête que cela, entre peintres, n’est-ce pas, monsieur Vollard ? »
Je citai cependant à Cezanne le cas de Rosa Bonheur, qui avait fait défense à des parents pauvres, qu’elle aidait de ses libéralités, de représenter des animaux au premier plan de leurs tableaux, pour ne pas lui faire concurrence.
En entendant parler d’entraves à l’exercice du métier de peintre, Cezanne était devenu attentif. Mais une interdiction de ce genre, à ses yeux, n’était pas pour empêcher de faire de la peinture : il suffisait d’avoir du « temmpérammennte ».
Il me demanda ce que les amateurs pensaient de Rosa Bonheur. Je lui dis qu’on s’accordait généralement à trouver le Labourage Nivernais très fort. « Oui, repartit Cezanne, c’est horriblement ressemblant ».
(1) Cet autre était Barbey d’Aurevilly. »
15 novembre
Renoir échange à Vollard « un grand tableau ancien (Idylle) » (peut-être Les Amoureux, D 127) contre un tableau de Cezanne, « rochers rouges, collines lilas » (peut-être La Montagne Sainte-Victoire, FWN258-R631, peinte en compagnie de Renoir près de Bellevue), évalués à 2 000 francs chacun.
Registre commercial de Vollard, 20 juin 1894 – 3 novembre 1897, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,2) f° 36.
30 novembre
Cezanne écrit à Émile Solari, fils de Philippe :
« Paris, 30 novembre 1896.
Mon cher Solari,
J’ai regretté vivement de n’être pas rue des Dames [l’appartement qu’il loue au 58] quand vous y êtes venu. Il n’y a qu’un moyen de réparer cela, c’est en me fixant un rendez-vous, pour demain par exemple. — Un lieu bien déterminé, une heure bien précise, que je laisse à votre choix. Je suis libre à partir de quatre heures du soir. — Un petit mot donc, je vous prie, et croyez-moi bien cordialement à vous.
Paul Cezanne »
Lettre de Cezanne à Solari, datée « Paris, 30 novembre 1896 » ; galerie Kenneth W. Rendell, New York, reproduction de la page 1/2 sur le site http ://www.kwrendell.com/full-description.aspx?ItemID=20403645 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 256.
Émile Solari livrera quelques appréciations sur Cezanne, Zola et son père, dans Le National.
Solari Émile, « Trois destinées d’Artistes », Le National, organe de la démocratie de l’arrondissement d’Aix, 41e année, n° 2073, dimanche 9 juillet 1911, p. 4 :
« Trois Destinées d’Artistes
Cezanne, Solari, Zola, trois artistes, l’un peintre, le second sculpteur, le troisième écrivain, ont suivi trois destinées diverses. Un seul a réalisé complètement son œuvre, par la qualité et la quantité. Les deux autres, gênés par des obstacles différents n’ont pas recueilli la récompense entière de leurs efforts.
Zola était un producteur complet comme les exige l’organisation sociale actuelle. Il joignait à l’organisation créatrice un sens pratique puissant qui aidait à son développement matériel. Il a pu ainsi, en écrivant ses œuvres sans concession, les imposer étapes par étapes au public, en annihilant de bonne heure, en ce qui le concernait, l’initiative néfaste de l’intermédiaire, en l’espèce l’éditeur.
Cezanne, pauvre, serait mort de faim. Un père riche, un patrimoine considérable lui permirent de subsister. Et, s’il n’arriva pas à la maîtrise complète, s’il ne triompha pas comme un génie, il dut cet échec douloureux pour lui plus qu’on ne l’a jamais dit, à une organisation physiologique défectueuse, qui, si elle lui laissait concevoir les efforts à faire pour créer les chefs-d’œuvre et lui désignait le chemin à suivre, lui interdisait, en général, les réalisations équilibrées qui seules traversent d’elles-mêmes les siècles et défient vaillamment le temps. Il restera à Cezanne, ainsi que je le lui disais un jour, dans une pensée de piété presque filiale, il lui restera d’avoir été l’initiateur de toute une époque d’art en révélant avec quelques-uns la possibilité du retour à la nature et de l’étude directe.
La lutte d’un cerveau clairvoyant et volontaire contre des yeux insuffisants et contre une main malhabile : l’héroïsme de ne pas vouloir des secours trop commodes que l’étude de procédés connus lui aurait vite donnés, en gâchant, comme tant d’autres sa personnalité — la volonté de tout faire par lui-même — ces cinquante années de travail acharné, sincère furieux, lesteront sa gloire quand le temps aura fait un tri parmi ses œuvres et en aura laissé subsister les quelques-unes qui caractérisent cet effort énorme el cette initiative presque sauvage.
Mon père, lui, avait l’organisation complète de l’artiste, mais telle que l’aurait permise seulement une civilisation plus avancée, capable d’utiliser, sans plus, ses éléments productifs. Il était merveilleux dans l’effort contre la matière et contre les difficultés de l’art quelles qu’elles fussent, insuffisant, nul, dans la lutte contre les hommes. Aucune fortune n’est venue le secourir et, jugulé par la misère, il n’a laissé que des fragments de l’œuvre colossale qu’une initiative étrangère intelligente ou qu’une société plus complètement organisée aurait pu tirer de ses moyens puissants.
La contemplation du buste d’Émile Zola révélera cela aux penseurs. Il faut méditer devant cette œuvre, non pour la personnalité de l’artiste, qui exagérément modeste durant sa vie s’effacera encore dans la mort, mais pour la compréhension d’une génération d’art. Il y a dans cette tête ce que les critiques d’art ne sauraient exprimer. Il y a la force et l’équilibre. Il y a la forme du modèle et l’expression de toute son œuvre et de tout son caractère — présent et futur. — La pensée d’Émile Zola, sa brutalité et sa délicatesse sont là ; il y a ses traits, reproduits avec une exactitude que n’atteignit aucune photographie, mais il y a aussi toute la philosophie, toute la documentation que le maître devait plus tard faire éclater dans l’ensemble de ses travaux et dans la signification de sa vie. Ce buste est symbolique — hors du sens qu’on donne à ce mot à propos d’une école littéraire. Il est symbolique parce qu’il condense, en une seule œuvre, l’harmonie et l’exactitude de la forme, la beauté et l’expression totale de la pensée existante et possible du sujet.
Ceux qui pénétreront le sens de ce morceau de sculpture comprendront les causes des Rougon-Macquart, des Trois Villes el des Quatre Évangiles et de J’accuse… Ils comprendront en même temps et toute une époque d’art d’où va sortir notre art européen et américain moderne — et les principes de l’art éternel. Aix aura l’orgueil d’avoir recueilli ce document inestimable et de l’avoir fait naître, en en formant l’auteur et le sujet.
Émile SOLARI. »
Bernex Jules, « Zola, Cezanne, Solari », Les Cahiers d’Aix-en-Provence, cahier d’automne 1923, p. 49-53, p. 50-53 :
« Il [Philippe Solari] n’avait ni l’énergie audacieuse de Zola, ni les revenus de Cezanne. Parti boursier de l’école de dessin d’Aix, il se joignit, dès son arrivée à Paris, au groupe des impressionnistes. La Guerre et la Commune ravagèrent la capitale. Après avoir participé à diverses tentatives, il termina ses exploits civiques en aidant avec Dalou et Renoir’ à renverser la colonne Vendôme…
… Il gagna au Salon de 1871 une médaille d’argent en exposant une tête de nègre. Pendant vingt ans, il adressa des envois, chaque fois accepté, Le besoin l’obligea à bricoler chez les marbriers et les plâtriers, à mouler des images religieuses. Puis à Versailles, il sculpta près du bassin de Neptune, à droite du grand canal, un cygne portant un enfant. Il répara les dégâts du Louvre. Il travailla comme premier ouvrier, à l’Opéra dont un de nos compatriotes, le sculpteur Chabaud, avait l’entreprise. Il fit deux bustes d’Émile Zola à 25 ans, l’un qui est chez Mme Zola et l’autre sur le socle du monument Zola, à Aix. Ce dernier, symbolique, est plus grand que nature : chevelure touffue, front haut, bombé, épaules renflées.
Ouvrier d’art, il passa à Lyon où il laissa sur une place une statue. Il s’occupa au château de Blois, au théâtre de Reims, à celui de Tarascon, puis, il regagna Aix où il produisit quantité d’études. Il cisela une République pour le village de Chateaurenard ; il ouvragea des cheminées, dont une gothique, représentant les anciens jeux locaux de la Fête-Dieu, chez M. Ducros, le peintre aixois bien connu. De ses maquettes, ne doit plus exister qu’un groupe de lutteurs, une femme en proie aux loups, une nymphe au satyre et deux études de nu.
La peinture aussi le tenta. Il avait les roses de Renoir, la touche nette et essentielle de Cezanne. Il écrivit même une pièce de théâtre…
Solari n’eut pas le sentiment des exigences de la vie. Merveilleusement indifférent, sobre, distrait, toujours pareillement calme, il était un bohème libre de tout intérêt et aussi un timide. À l’anniversaire de la mort d’Émile Zola, à Paris, alors qu’Anatole France détaillait, pour une plus savoureuse dégustation, les périodes impeccables de son discours, il salua la tombe et, à peine arrivé du train, il repartit en secret : La statue que l’on inaugurait était son œuvre !
Allant d’une esquisse à l’autre sans jamais épuiser les sujets qu’il tirait de la nudité des femmes charnues à la Rubens et de la plastique des poses, il agit en sculpture comme Zola en littérature. Il imaginait des choses grandioses. Il disait, pour s’expliquer : « J’ai fait du Rodin avant lui ». Il souhaitait tailler à même dans le roc. Lorsque ses regards, suivant la courbe des horizons dilatés par le soleil, s’arrêtaient devant le Mont-Victoire, large et à pic sur la plaine, il dessinait des fresques dans le vide. Avisant des blocs de pierre éboulés, il se désolait de n’avoir pas les instruments nécessaires « pour en créer des êtres ». Le soir, il regagnait l’atelier sombre et froid, ― l’atelier, une remise de la rue du Louvre ― et pétrissait. Soulagé ensuite de sa peine et de son impuissance par la détente, il prenait ce qui venait de jaillir de ses doigts. S’approchant de la lampe, il se réjouissait de pressentir la flamme à travers la matière colorée d’un sang.
Il ne dépassa qu’exceptionnellement l’esquisse ou la maquette ; il vendit peu. Il se préparait à façonner des colonnes et des amphores géantes pour placer à l’entrée des portails de campagne quand la maladie le coucha, l’hiver, dans la remise sans feu. Deux humbles amis le conduisirent à l’hôpital où il mourut, peu après. Il avait 63 ans.
Ainsi, des trois conquérants, le plus combattif et le moins artiste, Émile Zola, réalisa seul son ambition, On lui a décerné les honneurs suprêmes. Sur son cercueil, qu’une pompe officielle accompagnait au Panthéon, ovations et sifflets se croisèrent avec un cliquetis d’armes. Sa mort n’avait pas interrompu la bataille. Paul Cezanne « détermina à son insu, à Paris, puis dans le monde, enfin en Provence la décisive révolution qu’ou sait » selon la véridique expression de l’éminent critique d’art Guillaume Janneau. Et, simple, abandonné, le meilleur de tous, Philippe Solari garda jusqu’à la mort son rêve de jeunesse, Jamais la foi ne délaissa son réduit sombre et misérable. Peu importe qu’il eût manqué de pain mais il manqua de pierres taillables. Dans sa profession, rien de durable sans elles, Le temps désagrégeait vite ses créations en argile. Elles redevenaient poussière.
Solari apporte à l’histoire sa part humaine. Comme il serait triste et poignant de la définir si des formules sur l’art et la misère, sur l’ingratitude, n’existaient depuis longtemps. De même qu’un parent riche s’écarte d’un parent pauvre, de même Zola et Cezanne de Solari. Il suffit qu’ils aient réussi. Les instructeurs de la foule suivent son mouvement : Ils ne s’inquiètent que de ceux qui parviennent. Parmi tant de gens qui ont écrit sur Zola et Cezanne, pas un n’a pensé à Solari, ne l’a cité à côté de ses camarades. On continuera demain. Qu’on ne s’embarrasse pas d’une banale sentimentalité ! Qu’on laisse à sa solitude cette ombre inoffensive, fervente, naïve ― et sans bénéfices !…..
….. Et, pourtant, le geste eût été pieux de les unir à leur fin comme ils le furent à leur début….
Jules Bernex. »
Solari Émile, « Notes sur le statuaire Philippe Solari », Les Cahiers d’Aix-en-Provence, cahier de printemps, 1924, p. I-II, p. II :
« Voici ces notes suivant l’ordre des énonciations de l’article de Bernex :
Page 50. Note 1. ― Philippe Solari ne prit point de part aux mouvements de la Commune. Il était non pas particulièrement démocrate ou socialiste ; il aimait la force et l’ingéniosité du peuple ; il appréciait l’élégance des rois. Mais par dessus tout, comme il est de tradition séculaire dans notre famille, il était profondément et irrésistiblement épris de l’Intelligence et de la Liberté. C’est, dans un état d’âme, une assise de constitution mentale plutôt qu’une opinion. Il faillit être fusillé pendant la Commune, mais par les communistes, à la suite d’une méprise : on avait tiré sur eux. Ce n’était pas, bien entendu, mon père qui, garde national désarmé ― et chez lui ― n’avait tiré sur personne, et qui comprit, humainement, mieux que quiconque peut-être, le soulèvement de la Commune. Il ne toucha point à la Colonne Vendôme.
Page 51. Note 2. ― ce ne fut pas une Tête de nègre qu’il exposa au salon, de 1871 mais, aux Salons d’avant 1870, où ils eurent grand succès : Un esclave nègre attaqué par des chiens et d’autres grands groupes ou figures que la gêne pécuniaire l’obligea de détruire plus tard faute de les pouvoir loger et dont j’ai vu, étant enfant, les têtes. Mon père exposa ensuite à tous les Salons durant trente ans.
Page 51. Note 3. ― Il est y a [sic] trois bustes d’Émile Zola, à 26 ans, par Philippe Solari : un plâtre et deux bronzes. Peut-être existe-il aussi, un moulage.
Page 51. Note 4. ― À l’hôtel de ville de Lyon, c’est le buste en marbre de Simon Saint-Jean, peintre de fleurs.
Page 51. Note 4. ― II reste, outre de nombreux médaillons dispersés, parmi ses terres sèches : un buste de Cezanne rêveur, et parmi ses plâtres : un buste, mutilé, de Cezanne, également.
Je répète que ces notes n’amoindrissent pas l’article de Bernex, article qui est un beau morceau de prose et de pensée.
Émile SOLARI. »
1er décembre
Thadée Natanson engage ses lecteurs à aller voir l’exposition d’œuvres de Gauguin chez Vollard :
« L’occasion ne s’était pas présentée jusqu’ici d’engager les lecteurs de cette revue à aller considérer une collection importante (1) de tableaux, de grès, et de bois sculptés de M. Gauguin.
[…] Son influence moins profonde que fut et sera encore celle de M. Cezanne — dont on peut voir d’admirables tableaux dans la même galerie — comptera cependant parmi celles qui auront agi sur la plus jeune génération des peintres contemporains. […]
(1) Galerie Vollard, 6, rue Laffitte, Paris. »Natanson Thadée, « Peinture. À propos de MM. Charles Cottet, Gauguin, Édouard Vuillard et d’Édouard Manet », La Revue blanche, tome XI, 1er décembre 1896, p. 516-518, Cezanne p. 517.
Fin décembre
Émile Solari, le fils du sculpteur, rend visite à Cezanne à Paris.
Lettre de Cezanne à P. Solari, 30 janvier 1897 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 258.
Publication de l’ouvrage d’André Mellerio, Le Mouvement idéaliste en peinture. Aux quatre artistes fondateurs de ce courant, Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, Odilon Redon et Paul Gauguin, il ajoute van Gogh et Cezanne, « un personnage fantastique. Encore vivant, de lui on parle comme d’un disparu ».
Mellerio André, Le Mouvement idéaliste en peinture, frontispice de Odilon Redon, Paris, H. Floury, éditeur, 1896, 74 pages ; Cezanne p. 26-28 :
« Paul Cezanne et Vincent Van Gogh.
Après ces artistes il convient de citer Paul Cezanne et Vincent Van Gogh.
Cezanne semble d’un personnage fantastique. Encore vivant, de lui on parle comme d’un disparu. De rares pièces de son œuvre sont disséminées chez un petit nombre d’amateurs. Il n’a plus exposé depuis les époques déjà lointaines, où, participant aux manifestations impressionnistes, il y occupait une place si particulière. Chez Cezanne il y a quelque chose de naïf et d’affiné tout ensemble, il présente la nature d’après une vision à lui propre, où la juxtaposition des teintes, un certain agencement des lignes font de sa peinture si franche comme une synthèse des couleurs et des formes en leur beauté intrinsèque. On dirait qu’à chaque objet il a voulu restituer intact, dans sa force primitive non aveulie par des pratiques d’art, son éclat vrai et essentiel. Ainsi ces paysages, ces figures, surtout ces fruits sur du linge, si facilement reconnaissables et qui ont ému maint artiste, l’incitant même parfois jusqu’à l’imitation, presque textuelle…
[…] En somme, des artistes bien faits pour intéresser. Tous deux éminemment peintres dans l’acception du mot, c’est-à-dire considérant le spectacle qui les entoure sous le presque unique point de vue du jeu des couleurs et des lignes ― arrivant ainsi à d’étranges et imprévus effets. Chez Cezanne, le vouloir de se remettre directement en rapport avec la nature, l’ardeur à s’en saisir pleinement avec une ingénuité maintenue jusqu’à la gaucherie. Chez Van Gogh, un élan, une fièvre, presque du délire à poursuivre le summum de richesse de la splendeur colorée. Voilà ce qui de ces deux artistes a dû attirer et séduire des esprits jeunes, enthousiastes de leur originalité et qui ont voulu voir en eux des précurseurs, malgré leur incomplet. Ou peut-être ― qui sait ― à cause même de cet incomplet ajoutant à de réelles qualités le mystère de la chose ébauchée semblant toujours près de s’épanouir en chef-d’œuvre….. »
29 décembre
Hortense Cezanne envoie à Mme Pissarro une carte où elle donne des nouvelles d’elle et de son fils Paul :
« Vous êtes donc restée à la campagne, puisque je n’ai rien reçu de vous […]. Pour moi, j’ai continué à trainer et j’ai eu encore des crises de rhumatisme […]. [Le mauvais temps la force à rester chez elle.] Paul est un peu enrhumé, cela lui passe et lui revient. Vous devez avoir vos petites filles avec vous [lesquelles ? pour vérifier la date] […]. J’ai bien regretté depuis que je suis malade de n’être pas à la Condamine où le ciel doit être un peu plus beau […]. [Elle adresse ses salutations à Lucien Pissarro.]
Carte en bristol liseré de noir d’Hortense Cezanne à Mme Pissarro, mardi 29 [décembre 1896], 10 h ; vente « Manuscrits, photographies, livres anciens et modernes », Me Tajan, Paris, hôtel Drouot, 11 juin 2014, n° 19.
Courant de l’année
Andries Bonger achète à Vollard le tableau de Cezanne Fleurs dans un vase rouge (FWN791-R478).
Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 954 numéros, notice 478, p. 319.
1896 ?
Lettre de Cezanne à un jeune artiste ami de Joachim Gasquet (le dessinateur aixois Gustave Bertin Heiriès, né le 7 décembre 1867 à Marseille ?) :
« […] Je suis peut-être venu trop tôt. J’étais le peintre de votre génération plus que de la mienne. […] Vous êtes jeune, vous avez la vitalité, vous imprimerez à votre art une impulsion que seuls ceux qui ont l’émotion peuvent lui donner. Moi, je me fais vieux. Je n’aurai pas le temps de m’exprimer. […] Travaillons. […]
[…] La lecture du modèle et sa réalisation est quelquefois très lente à venir. »
Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 256.


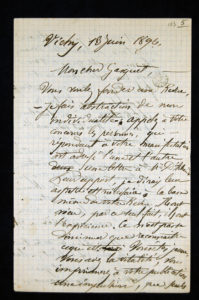
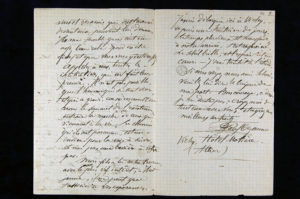
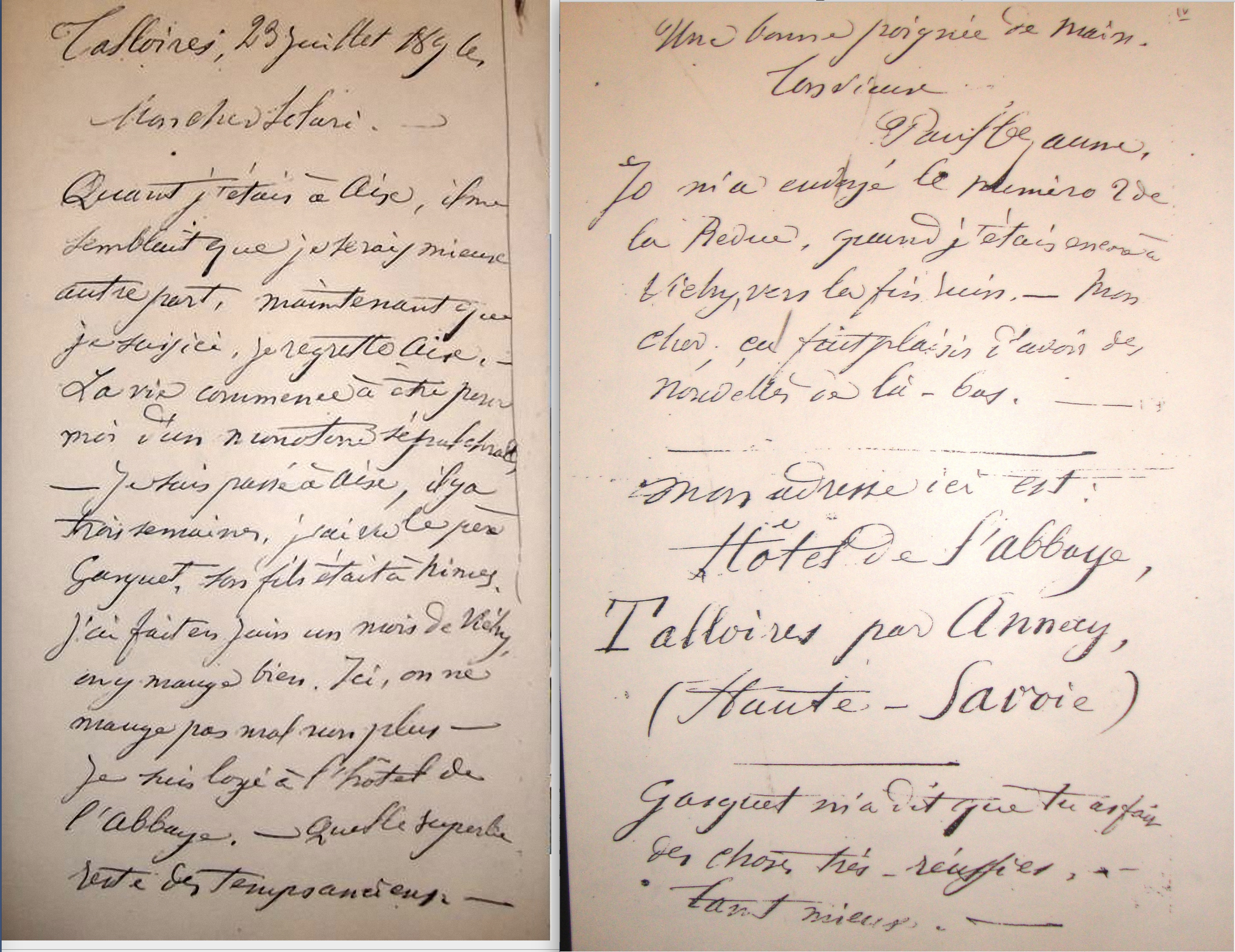
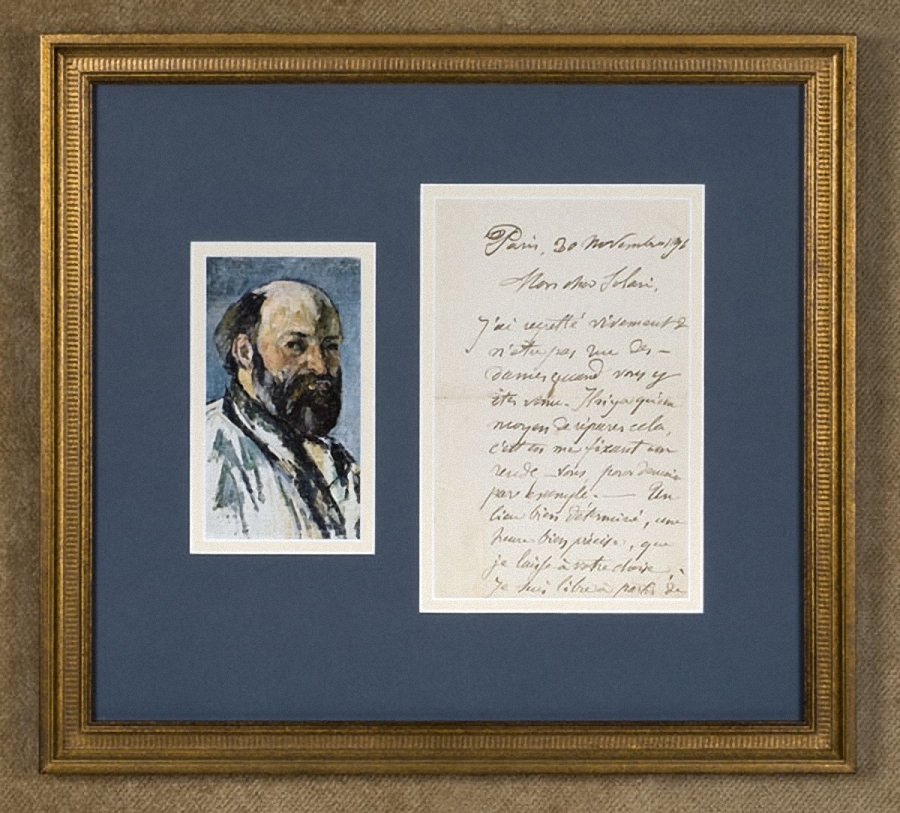

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.