17 janvier
Cézanne, en réponse au bon souvenir que lui a transmis le peintre Louis Leydet, lui souhaite de « formuler suffisamment les sensations que nous éprouvons au contact de cette belle nature, homme, femme, nature morte ».
« Aix, 17 janvier 1904
Mon cher confrère,
J’ai reçu votre bon souvenir, et je vous en remercie. Si je peux au printemps monter à Paris, j’irai vous souhaiter la main.
Arriver à formuler suffisamment les sensations que nous éprouvons au contact de cette belle nature, homme, femme, nature morte et que les ciel circonstances vous soient favorables, c’est ce que je dois souhaiter à toute sympathie d’art, votre ancien,
P. Cezanne.Lettre de Cézanne, Aix, à Louis Leydet, 17 janvier 1904 ; collection Leydet (en 1998) ; Baille Franck, À Aix, autour de Cézanne. La Belle Époque 1870-1914, Marseille, édition Grammage, 1998, 137 pages, p. 67.
25 janvier
Cézanne confie à Aurenche l’importance pour un artiste de la maîtrise des moyens d’expression. Il est heureux des succès de Larguier et n’a pas vu Gasquet depuis longtemps, « qui vit complètement à la campagne ».
« Aix, 25 janvier 1904.
Mon cher Monsieur Aurenche,
Je vous remercie beaucoup des vœux que vous et les vôtres m’adressez à l’occasion du nouvel an.
Je vous prie de recevoir les miens à votre tour, et de les faire agréer chez vous.
Vous me parlez dans votre lettre de ma réalisation en art. Je crois y parvenir chaque jour davantage, bien qu’un peu péniblement. Car si la sensation forte de la nature — et certes, je l’ai vive — est la base nécessaire de toute conception d’art, et sur laquelle repose la grandeur et la beauté de l’œuvre future, la connaissance des moyens d’exprimer notre émotion n’est pas moins essentielle, et ne s’acquiert que par une très longue expérience.
L’approbation des autres est un stimulant, dont il est bon quelquefois de se défier. Le sentiment de sa force rend modeste.
Je suis heureux des succès de notre ami Larguier. Gasquet, qui vit complètement à la campagne, je ne l’ai plus vu depuis longtemps.
Recevez, cher Monsieur Aurenche, l’assurance de mes meilleurs sentiments.
Paul Cezanne »Lettre de Cézanne à Aurenche, 25 janvier 1904 ; Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 298.
Les « succès » de Larguier concernent la publication de son premier livre de poèmes, La Maison du poète, qui remportera un prix de l’Académie française de 500 francs l’année suivante.
Larguier Léo, La Maison du poète, Paris, A. Storck, 1903, 199 pages.
« Les prix de l’Académie », Le Figaro, 50e année, 3e série, n° 148, vendredi 27 mai 1904, p. 3 :
« Les prix de l’Académie
L’Académie française a statué hier [26 mai 1904] sur les concours des prix Montyon (ouvrages utiles aux mœurs) et sur le prix de poésie Archon-Despérouses. […]
Le prix Archon-Despérouses (2,500), réparti 1,000 fr. à M. Vermenouze et 3 prix de 500 fr. à MM. Léon Larguier, Malteste et Chapman. »
Van Bever Ad. et Léautaud Paul, Poètes d’aujourd’hui. Morceaux choisis, accompagnés de notices bibliographiques et d’un essai de bibliographie, tome I, Paris, Mercure de France, 1913, 358 pages, p. 235-237 :
« LÉO LARGUIER
1878
M. Léo Larguier est né, le 6 décembre 1878, à La Grand’Combe (Gard) d’une forte race de paysans cévenols. Il fit ses études au Lycée d’Alais [Alès], de mauvaises études, selon lui, mauvais élève comme l’ont été beaucoup de poètes, et jusqu’à vingt ans il vécut dans sa ville natale. C’est pendant son service militaire, à Aix-en-Provence, où il eut l’occasion de connaître le peintre Cezanne, qu’il écrivit ses premiers vers, qui devaient composer son livre de début : La Maison du Poète, publié en 1903, et couronné la même année par l’Académie française. M. Léo Larguier n’aura pas attendu longtemps, sinon la gloire, du moins une certaine réputation littéraire. Il la connut dès son premier livre, son prix à l’Académie vient de le montrer, et elle s’accrut encore quand il publia son deuxième recueil de vers : Les Isolements. Les poètes de sa génération, ses rivaux courtois, se plaisent à voir en lui un grand poète prochain, et lui-même est plein de confiance dans sa force et son talent pour leur donner raison un jour. Peut-être même pourrait-on dire qu’il a commencé, avec ce même livre : Les Isolements, où se trouvent nombre de poèmes remarquables par leur lyrisme, leurs images, leurs qualités d’évocation, et l’émotion que l’auteur y a mise. M. Léo Larguier occupe une place bien à lui, en ce sens qu’il est, parmi les nouveaux poètes, le seul disciple, on pourrait même dire le seul continuateur de Hugo et de Lamartine, par son verbe sonore, son éloquence, et aussi son intransigeante fidélité à l’alexandrin régulier. Un néoromantique, ce terme le peindrait parfaitement. Hugo et Lamartine, leurs noms reviennent, du reste, souvent dans ses vers. Leurs livres sont ses livres, et ce sont leurs portraits, surtout celui de Hugo, qu’il a devant les yeux quand, assis à sa table, il rêve ou il travaille. On pourrait aussi y ajouter Vigny. En tout cas, son influence fut beaucoup moindre sur lui. Le dernier ouvrage de M. Léo Larguier, dont nous n’avons pu donner qu’un court extrait, est une sorte de roman en vers : Jacques, qui s’apparente d’assez près à Jocelyn en même temps qu’à Olivier, de François Coppée. À notre époque de lecture paresseuse, c’est une tentative peut-être un peu bien hardie, un peu bien téméraire aussi, un poème de longue haleine, formant à lui seul tout un volume ! Elle prouve, en tout cas, que M. Léo Larguier, en vrai poète, n’a d’autre fluide, dans son art, que son goût, son inspiration, le songe qui le séduit.
Le côté anecdotique, le côté curiosité dans la biographie d’un écrivain, surtout quand elle contient, comme celle-ci, peu de détails, n’est pas à dédaigner. Voici, dans ce sens, sur l’auteur des Isolements, qui a eu l’esprit de s’en amuser tout le premier, un sonnet humoristique paru dans la revue Psyché, numéro de mai 1906.
LÉO LARGUIER
Poète ayant tété des muses surhumaines,
Dès l’âge le plus tendre il tutoya Hugo ;
— Il est fécond — il chante en rimes toulousaines
Les bourgeoises vertus, l’âme du Calico,Son jardin, sa « maison » et le vin de Suresnes !
— Il « raccroche » la gloire. — il est illustre et beau ;
— Ancien sous-officier aux légions romaines,
Il a vaincu Mardrus, mis César au tombeau !Il aime Cicéron, — il sera député,
Il connaîtra — enfin ! — la « popularité » —
Il vivra dix mille ans, — il aura du génie !Il est imperator, il est ménétrier,
Membre d’un orphéon et d’une académie,
Et Joseph, et Prud’homme,… Ubu,… Léo Larguier !
ROBUR.
M. Léo Larguier a collaboré au Mercure de France, à L’Ermitage, aux Lettres, au Mouvement, à Antée, à La Revue Bleue, à La Revue forézienne, au Gaulois, au Petit Parisien. Il publie régulièrement des Contes dans Le Journal et de petites chroniques pittoresques dans L’Intransigeant.
Bibliographie :
Les œuvres. — La Maison du Poète, poèmes. Paris, Storek [Storck], 1903, in-18. — Les Isolements, poèmes. Paris, Storek [Storck], 1906, in-18.— Jacques, poème. Paris Soc. du Mercure de France, 1907, in-18. (Il a été tiré, pour la Société des XX, 20 ex. de format in-8. Ces exempl. portent tous la signature de l’auteur.)
À consulter. — L. N. Baragnon : Le Poète Léo Larguier. Soleil, 4 février 1908. — Henri Chantavoine : Léo Larguier. Journal des Débats, 20 juillet 1903. — Gaston Deschamps : Léo Larguier, Le Temps, juillet 1905. — Georges Casella et Ernest Gaubert : La Jeune littérature avec un portrait de Léo Larguier. Revue illustrée, 15 avril 1905 : La Nouvelle littérature 1895-1905. Paris, Sansot. 1906, in-18. — Ernest Gaubert : Jacques. Un roman moderne en vers. Intransigeant, 1er février 1908. — Jean de Gourmont : Poètes nouveaux, Mercure de France, 1er septembre. — Georges Le Cardonnel et Charles Vellay : La Littérature contemporaine, 1905. Opinions des Écrivains de ce temps. Paris, Soc. du Mercure de France, 1906, in-18. — Robur : Léo Larguier, sonnet. Psyché, mai-juin 1906. »
29 janvier
Lettre de Cézanne à Louis Aurenche :
« Aix, 29 janvier 1904.
Cher Monsieur Aurenche,
Votre sollicitude me touche beaucoup. Je me porte en ce moment assez bien. Si je n’ai pas répondu plus tôt à votre première lettre, l’explication en est facile. Après toute une journée de travail à vaincre les difficultés de la réalisation sur nature, je sens le besoin, le soir venu, de prendre quelque ― repos, et n’ai pas alors cette liberté d’esprit qu’il faut en écrivant.
Je ne sais quand j’aurai l’occasion de remonter à Paris. Si le fait se présente, je n’oublierai pas que je suis attendu à Pierrelatte par des amis.
Si vous venez à Marseille, j’aurai plus sûrement, je crois, le plaisir de vous voir.
Agréez, cher Monsieur Aurenche, l’expression de mes meilleurs sentiments.
P. Cezanne »Lettre de Cézanne à Louis Aurenche, datée « Aix, 29 janvier 1904 » ; vente « Succession Larguier », Alde, Paris, hôtel Drouot, 4 octobre 2006, n° 60, première page reproduite.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 299.
Reproduit par Larguier Léo, Le Dimanche avec Paul Cézanne (souvenirs), Paris, L’Édition, 1925, 166 pages, p. 100-100-102.
4 février
Émile Bernard, de retour d’Égypte, par Marseille, rend visite pour la première fois à Cézanne à Aix, où il reste un mois. Il l’accompagne sur le motif ― la Sainte-Victoire, Château noir ― et travaille dans une pièce du rez-de-chaussée de son atelier.
Bernard Émile, « Souvenirs sur Paul Cézanne et lettres inédites », Mercure de France, tome n° 69, n° 247, 1er octobre 1907, p. 385-404, tome n° 69, n° 248, 16 octobre 1907 ; p. 606-627.
Émile Bernard, 1868-1941, A Pioneer of Modern Art, catalogue d’exposition, Mannheim, Städtische Kunsthalle, 12 mai – 5 août 1990, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh, 24 août – 4 novembre 1990, 384 pages, 171 numéros, p. 103.
5 février
Dès le lendemain de sa première visite à Cézanne, Émile Bernard en fait le récit détaillé à sa mère :
« Hier je suis allé à Aix voir Cézanne, c’était un rêve de ma jeunesse, éprise de sa peinture, que j’ai pu réaliser grâce à un tramway qui va de Marseille à cette ville. La route est fort belle comme paysage. J’ai eu beaucoup de mal à dénicher mon vieux maître. Je n’avais pas son adresse et je questionnait tout le monde inutilement sur lui. C’est un ouvrier qui m’a dit d’aller à la mairie demander son adresse. C’est ainsi que j’ai su où il habitait, et je m’y suis rendu aussitôt. Il descendait de son appartement comme je montais l’escalier. Je lui dit le motif de ma visite et il m’a fait très bon accueil. C’est un homme âgé, simple, un peu méfiant et bizarre. Comme il se rendait à son travail, je l’ai accompagné. Il m’a parlé avec amitié et m’a répété cent fois : « C’est effrayant, la vie ! ». Je ne sais de quoi il en a à se plaindre. Il me paraît tranquille, faisant son art à sa guise, vivant comme un rentier. Il a en outre une maison à lui, hors la ville, construite selon ses désirs et où il m’a conduit mystérieusement, me disant que personne n’y entrait. Je le juge un peu maniaque, fatigué par un diabète, avec beaucoup d’idées provinciales et des préjugés en tous genres. Il ne parle que de gens qui veulent lui mettre « le grappin dessus ». En un mot, il me paraît misanthrope et
dérangé d’esprit. En art il ne parle que de peindre la nature selon sa personnalité et non selon l’art lui-même. J’ai vu de ses tableaux, entre autres une grande toile de femmes nues [FWN980-R856] qui est une choseeffrayantetant parla laideurdes formes que par l’impuissance à l’ensemble etl’ignorancede l’anatomie humaine. Il paraît qu’il y travaille depuis dix ans. Il y a cette particularité chez lui, qu’il est un originalpar ce qu’il ne sait pas, alors que les maîtres le sont par leur savoir: mais que penser d’une originalité de ce genre ? J’ai acquis la certitude que Cézanne parle des maîtres (Michel-Ange, Raphaël) comme beaucoup d’écrivains parlent d’Homère, de Dante, de Milton,sans les avoir jamais lus. S’il croit avoir vu Raphaël au Louvre, il se trompe, car à peine y a-t-il deux ou trois tableaux de lui. Dans ceux que nous avons, il encor [sic] sont-ils gâtés par des nettoyages et des retouches. Moi qui ai vu plus de dix mille tableaux, j’en ai à peine trouvé trois qui fussent intacts et qui m’ont fait connaître ce qu’était réellement la peinture parfaite des grands peintres. On a tellement frotté, récuré, retouché les œuvres des maîtres que peu de gens peuvent se douter de l’admirable harmonie qu’ils avaient réalisée. Cézanne tout le premier ; n’étant jamais allé en Italie, quoique né à sa porte, il parle de Michel-Ange, Raphaël, Tintoret par ouï-dire ou d’après de mauvaises gravures. Au fond Cézanne est un brave homme, très ignorant de l’Art, une sorte de paysan de la peinture qui retourne d’épais empâtements comme une terre grasse, mais qui n’y fait rien pousser que de mauvaises herbes. Il professe les Théories du naturalisme et de l’impressionnisme, me parle que par Pissarro, qu’il déclare colossal. Je ne lui ai rien montré de ma peinture, mon œuvre d’Égypte t’ayant toute été envoyée. Il me prend pour un intellectuel et il ne sait pas que j’ai produit une grande œuvre et me croit un amateur.Selon lui, celui qui suit l’Art s’égare, il ne fait que du pastiche. La personnalité lui paraît bonne, aussi faible qu’elle soit.et l’art pour lui se résume tout dans la vision optique soit la technique. Il s’est fait une méthode de gradations des couleurs qui est intéressante mais qu’il ne peut pas conduire à la perfection. Il voit trop par petits tons. Ses toiles sont faites de morceaux qu’ilne peut pasréunir. Il y laisse partout des blancsinexplicables. En somme, il travaille comme faisait Ingres (qu’il déteste) en procédant par le détail et en finissant des partiessansavant de mener de front l’ensemble ! Ma conversation le trouble beaucoup se sent que je fais de l’art à un autre dans le même point de vue que lui, que c’est l’âme des chosesqui m’yqui nous intéresse, alorsqu’il n’en conçoit que que nous en connaissons aussi la partie matérielle. Comme je suis venu le voir pour découvrir ce qu’il est, je ne le heurte pas trop (car il se fâcherait fort), ne supportant que très peu pas la contradiction) et je me soumets à ses plus faibles raisons avec grande déférence. Je retournerai à Aix. Je m’y fixerai pour tout savoir de lui ;non que j’espère acquérir quelque chose d’un homme qui, je le vois, en sait moins long que moi, maispour le pénétrer à fond et révéler la méthode qu’il s’est faite (convention comme une autre).En somme de ma visite à mon vieux maître je suis revenu heureux d’avoir trouvé un homme excellent quoique maniaque et bizarre, mais attristé de constater
son indigence intellectuelle et ses ignorancesla méconnaissance qu’il a de lui cet entêtées de l’art, dont le but,je le maintiensn’est pas de réaliser une personnalité,maiscomme les Grecs et les grands de partout l’ont prouvé, de répondre à l’idéal universel de l’âme par la création du Beau. Quiconque s’écarte de cette voie (et Cézanne le démontre) tombe dans l’impuissance et la laideur.En somme de ma visite à mon vieux maître je suis revenu heureux d’avoir trouvé un homme excellent quoique maniaque et bizarre, mais attristé de constater son indigence intellectuelle et ses ignorances la méconnaissance qu’il a de lui cet entêtées de l’art, dont le but, je le maintiens n’est pas de réaliser une personnalité, mais comme les Grecs et les grands de partout l’ont prouvé, de répondre à l’idéal universel de l’âme par la création du Beau. Quiconque s’écarte de cette voie (et Cézanne le démontre) tombe dans l’impuissance et la laideur.
Je t’embrasse mille fois ma chère mère de ma part et de la part de nous tous. En attendant d’être dans tes bras et ceux de père.
Ton fils qui t’aime,
Émile Bernard
Je te donnerai bientôt mon adresse à Aix. »Lettre d’Émile Bernard à sa mère, Marseille, 5 février 1904 ; Roubaix, La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent, n° 2013-50-7 (L.1).
Harscoët-Maire Lorédana et Delcourt Amandine, « Lettres d’Émile Bernard (1868-1941) », Les Émile Bernard de la Piscine. Œuvres et correspondance, Paris, éditions Gourcuff Gradenigo, 2014, 173 pages, p. 29-30.
Rapetti Rodolphe, « L’inquiétude cézannienne : Émile Bernard et Cézanne au début du XXe siècle », Revue de l’art, n° 144, février 2004, Centre national de la Recherche scientifique, Paris, 2004, p. 35-50, lettre p. 49, une page reproduite.
Émile Bernard. Les lettres d’un artiste (1884-1941), édition établie par McWilliam Neil, textes recueillis par Lorédana Harscöet-Maire, Neil McWilliam, Bogomila Welsh-Ovcharov, Les Presses du Réel, 2012, 429 lettres, 981 pages, lettre 292 p. 682-684.
Émile Bernard prend une photographie de Cézanne dans son atelier devant les Grandes Baigneuses. Une épreuve porte cette annotation écrite par Émile Bernard : « [à gauche] Paul Cézanne [à droite] photographie faite à Aix dans son atelier fév. 1904 »
Vente « Photographies xixe-xxe. Une collection française », Enghien-les-Bains, 13 juin 2014, n° 500.
En 1907, un an après le décès de Cézanne, Émile Bernard publiera ses souvenirs du peintre et les lettres qu’il a reçues de lui.
Bernard Émile, « Paul Cezanne », L’Occident, n° 32, juillet 1904, p. 17-30 :
« Paul Cezanne
Frenhofer est un homme passionné pour notre art qui voit plus haut et plus loin que les autres peintres.
BALZAC (Le chef-d’œuvre inconnu).
Il y aura vingt années bientôt que de jeunes peintres, dont aujourd’hui Paris se préoccupe, se rendaient en pieux pèlerinage en une petite et sombre boutique de la rue Clauzel. Arrivés là, ils demandaient à un vieillard armoricain au socratique visage, des tableaux de Paul Cezanne. Malgré les murs de l’endroit tapissés de rutilantes toiles, ils ne se trouvaient satisfaits que lorsque, sur une chaise disposant son dos en chevalet, les études requises par leur désir d’art leur enseignaient la voie à suivre. Religieusement ils consultaient ces pages d’un livre écrivant la nature et une esthétique contemporaine, comme tels feuillets d’un dogme, dont le révélateur à eux inconnu s’affirmait pourtant souverain. Puis, de là, ils retournaient, en maints admiratifs discours, à leurs propres toiles et pinceaux, pris du besoin qu’avaient les paralytiques de marcher lorsque soudain le Sauveur avait miraculé pour leur bon vouloir. Ainsi naquit, d’œuvres quasiment ravies à leur auteur qui certes, les jugeant non conformes à sa vision ne les eût jamais laissé aller hors son logis, une école picturale que d’autres, ambitieux trop ou pas artistes assez, étiquetèrent de noms faux, dévoyèrent vers la fantaisie et la surface.
Et pourtant que profitable eût pu être la révélation, si elle avait été entièrement aimée et connue !
Un louable effort de personnalité doit différencier les peintres, mais cet effort, qu’il soit profond et non extérieur ; qu’il puise aux sources saines les ondes de sa vitalité jouvente. De cette préoccupation de personnalité, maladive, disons le mot, naît toute déliquescence, faute de ce soin. Nous assistons annuellement, hélas ! au décortiquement des jeunes troncs prévus de branchages virils. Nous voici à la retombée des feuilles, à un automne de monotonie. Toute sève vainement se perd à l’approche d’un trop précoce hiver. Un à un s’éteignent les soleils, la lumière du temps s’en va, déclinante, et de nos maîtres, après Manet, après Puvis, Cezanne seul reste.
Monet, œil de lumière qui ouvrit les portes de la peinture sur l’infini du ciel, de la mer et des plaines a fait une grande œuvre qu’il serait ingrat de méconnaître. Ni Corot, ni Millet ne sortirent d’un art de musée, leur supériorité incontestable perpétue glorieusement les écoles de Claude Gellée et du Corrège. Monet regarda résolument la nature et la vit en peintre.
Quand Manet admira Monet, il créa ce symbole : les maîtres d’autrefois (que sa palette représentait, que son œuvre vénérait), reconnaissant dans un élève du soleil, orné du sens artistique le plus délicat, un parent, un frère. Alors que les faux classiques, c’est-à-dire les mauvais peintres, repoussaient un découvreur apportant la vision la plus radieuse et la plus neuve, un classique au sens précis de ce mot se trouva là, qui démentit, au nom des ancêtres, cet acte de lâche repoussement, et qui tendit sa main et son admiration, comme un chaînon s’ouvre afin de rattacher à soi celui qui le suit. Et l’influence de Claude Monet a été immense, de quelque manière qu’on la regarde. Le tort de ses élèves fut de ne la pas comprendre dans son principe, de s’en tenir au pastiche pur ; de ses critiques de la limiter ; de ses admirateurs d’y tout circonscrire. Il sied d’en proclamer le bénéfice, d’y voir l’observation s’y allier au don le meilleur, bref d’en reconnaître l’emprise sur toute la peinture de ces vingt dernières années, non seulement en France, mais dans le monde. A ce point de vue la victoire de Claude Monet a été complète, elle a renversé l’École des Beaux-Arts ; et elle partit d’un lieu si simple : du petit bateau atelier avec lequel il côtoyait la Seine, et dont Manet nous a laissé, en une magistrale pochade, un souvenir. Loin l’idée enfantine que l’art ancien soit surpassé ! Les meilleurs peintres, se dénomment-ils Courbet, Manet ou Monet, ne peuvent faire oublier les Michel-Ange, les Raphaël, les Léonard, les Titien, les Giorgione, les Tintoret, les Véronèse, les Rubens ; ils ne feront même pas trembler les petits maîtres français, flamands ou hollandais ; ils n’effaceront pas les primitifs ; et là n’est pas leur ambition. Ce ne sont point des anarchistes qui veulent recommencer le monde et le faire dater à eux ; nés très doués, ils se sont dit : « la peinture contemporaine est viciée, l’Art après avoir erré dans les musées a vécu de formules académiques ; pourtant les Maîtres, que nous connaissons mieux que personne, que nous admirons plus que tous, n’ont rien de ces dogmes froids, lourds et sans vie ; c’est donc qu’ils ont puisé leur classicisme à la nature… Retournons à la nature ! » Et ces bons nourrissons ont collé leurs lèvres aux pis multiples et pleins de lait de la déesse, et voici qu’après avoir travaillé comme des ouvriers, dans des villages et des provinces reculés ou proches : en Normandie, en Oise, en Provence, dans la Creuse ou le long de la Seine, de l’Océan, de la Méditerranée, ils ont approfondi ce qu’ils avaient le désir de faire, ils se sont différenciés. Au contact de la Création ils sont devenus créateurs.
Ils ont épuré la vision de leur œil et la logique de leur esprit, c’est pourquoi le travail qu’ils ont accompli a été excellent, et, malgré sa simple apparence documentaire, est d’une capitale importance.
Paul Cezanne ne fut pas le premier à entrer dans cette voie, il se plaît à reconnaître que c’est à Monet et à Pissarro, qu’il doit de s’être dégagé de l’influence trop prépondérante des musées, pour se ranger sous celle de la Nature. Malgré ces voisinages, son œuvre ne s’en ressent pas. Seulement, de gigantesques qu’elles auraient été avec plaisir, les toiles primitivement sombres et rudes de Cezanne, descendirent à des proportions restreintes ; exigence du travail sur nature. Le maître délaisse l’atelier, va matin et soir au motif, suit le travail de l’air sur les formes et les localités, analyse, cherche, trouve. Bientôt ce n’est plus Pissarro qui le conseille, c’est lui qui agit sur l’évolution picturale de ce dernier. Il n’adopta donc pas la manière de travailler de Monet ou de Pissarro ; il resta ce qu’il était, c’est-à-dire un peintre, avec un œil qui se clarifie, qui s’éduque, s’exalte devant le ciel et les monts, devant les choses et les êtres. Il se refait, selon son expression, une optique, car la sienne a été oblitérée, entraînée par une illimitée passion vers trop d’images, de gravures, de tableaux. Il a voulu trop voir ; son insatiable désir de beauté lui a fait trop compulser le multiforme tome de l’Art ; désormais, il éprouve qu’il se faut restreindre, s’enfermer dans une conception et un idéal esthétique ; aussi, s’il va au Louvre, s’il contemple longuement devant Véronèse, c’est pour, cette fois, en décortiquer l’apparence, en scruter les lois : il y apprend les contrastes, les oppositions tonales, y distille son goût, l’anoblit, l’élève. S’il va revoir Delacroix, c’est pour suivre en lui l’épanouissement de l’effet dans la sensation colorée ; car, affirme-t-il : Delacroix fut un imaginatif et un sensitif de colorations, don le plus puissant et le plus rare ; en effet l’artiste possède parfois un cerveau et pas d’œil, parfois un œil et pas de cerveau ; et aussitôt Cezanne cite Manet comme exemple : une nature de peintre, une intelligence d’artiste, mais un sensitif de colorations médiocres.
C’était à Auvers, près de Pissarro, après avoir peint sous l’empire de Courbet de grandes et puissantes toiles, que Cezanne s’était retiré, pour se dégager de toute influence, devant la Nature ; et c’est à Auvers qu’il commence la création stupéfiante de l’art sincère et si naïvement savant qu’il nous a depuis montré.
Il est aussi difficile, aujourd’hui que les toiles du maître sont dispersées dans des collections privées, de parler de l’ensemble de son œuvre, qu’il l’était autrefois, alors qu’il ne laissait rien sortir de son atelier et vivait dans la solitude ; c’est donc bien plus de son apport personnel, de son esthétique, de sa vision, de ses tendances que l’on peut disserter.
Dès le jour que Paul Cezanne se mit en face de la nature avec le parti pris de tout oublier, il commença ces découvertes, qui désormais répandues par l’imitation superficielle, ont eu sur la compréhension contemporaine le définitif d’une révolution.
Mais tout cela se fit à son insu, car insoucieux de gloriole, de réputation, de succès, insatisfait de lui-même, le peintre s’était enfoncé dans l’absolu de son art sans plus rien vouloir entendre du dehors, poursuivant l’approfondissement occulte de son analyse, donnant avec lenteur, réflexion et puissance les coups de bêche qui devaient un jour rencontrer le filon merveilleux d’où surgirait toute splendeur.Telle est sa méthode de travail : d’abord une soumission complète au modèle ; avec soin, l’établissement de la mise en place, la recherche des galbes, les relations de proportions ; puis, à très méditatives séances, l’exaltation des sensations colorantes, l’élévation de la forme vers une conception décorative ; de la couleur vers le plus chantant diapason. Ainsi plus l’artiste travaille, plus son ouvrage s’éloigne de l’objectif, plus il se distance de l’opacité du modèle lui servant de point de départ, plus il entre dans la peinture nue, sans autre but qu’elle-même ; plus il abstrait son tableau, plus il le simplifie avec ampleur, après l’avoir enfanté étroit, conforme, hésitant.
Peu à peu l’œuvre a grandi, est parvenue au résultat d’une conception pure. Dans cette marche attentive et patiente toute partie est menée de front, accompagne les autres, et l’on peut dire que chaque jour une vision plus exaspérée vient se superposer à celle de la veille, jusqu’à ce que l’artiste, lassé, sente fondre ses ailes à l’approche du soleil, c’est-à-dire abandonne au point le plus haut où il a pu l’élever son travail ; en sorte que s’il avait pris autant de toiles qu’il a passé de séances, il résulterait de son analyse une somme de visions ascendantes, graduellement vivantes, chantantes, abstraites, harmonieuses, dont la plus surnature serait la plus définitive ; mais en ne prenant qu’une seule toile pour cette lente et fervente élaboration, Paul Cezanne nous démontre que l’analyse n’est pas son but, qu’elle n’est que son moyen, qu’il se sert d’elle comme de piédestal et qu’il ne tient qu’à la synthèse destructive et concluante. Cette méthode de travail qui est sienne, il la préconise comme la seule juste, la seule devant mener à un résultat sérieux, et condamne sans merci tout parti pris de simplification qui ne passe pas par la soumission à la Nature, par l’analyse réfléchie et progressive. Si un peintre se satisfait de peu, c’est que, selon Paul Cezanne, sa vision est médiocre, son tempérament de mince valeur.
Léonard de Vinci a émis une idée semblable dans son traité de la peinture, quand il a dit : « Le peintre à qui rien ne semble douteux ne profite guère en son étude. Quand l’ouvrage passe la portée du jugement de l’ouvrier, celui qui travaille s’avance peu ; mais lorsque le jugement surpasse l’ouvrage, cet ouvrage va toujours de plus en plus se perfectionnant si la diversité ne l’en empêche. »
Ce ne sera donc pas par la patience, mais par l’amour, qui donne la vue et le désir d’approfondir, que le peintre arrivera à la possession de lui-même et à la perfection de son art. Il faut qu’il dégage de la Nature une image qui sera à proprement parler la sienne ; et c’est seulement par l’analyse, s’il a la force de la pousser jusqu’au bout, qu’il se signifiera définitivement, abstraitement.
Les synthèses expressives de Cezanne sont de minutieuses et soumises études. Prenant la nature comme point d’appui, il se conforme aux phénomènes et les transcrit lentement, attentivement, jusqu’à ce qu’il ait découvert les lois qui les produisent. Alors, avec logique, il s’en empare, et achève son travail par une imposante et vivante synthèse. Sa conclusion, d’accord avec sa nature méridionale et expansive, est décorative ; c’est-à-dire libre et exaltée.
Mme de Staël écrit dans son livre sur l’Allemagne : « les Français considèrent les objets extérieurs comme le mobile de toutes les idées, et les Allemands les idées comme le mobile de toutes les impressions ». Paul Cezanne justifie cette opinion de Mme de Staël sur les Français, mais il sait aller jusqu’à une profondeur d’art qui n’est pas commune à nos contemporains. En bon traditionniste, il soutient que la Nature est notre point d’appui, qu’il ne faut rien tirer que d’elle seule, toutefois en se donnant la liberté d’improviser avec ce que nous lui empruntons…
Ce qu’il faut d’abord au peintre, selon Cezanne, c’est une optique personnelle, laquelle optique ne se peut obtenir qu’au contact obstiné de la vision de l’univers.
Certes il faut avoir fréquenté le Louvre, les musées, cela afin de se rendre compte de l’élévation de la Nature jusqu’à l’art. « Le Louvre est un bon livre à consulter, mais ce ne doit être encore qu’un intermédiaire ; l’étude réelle et prodigieuse à entreprendre c’est la diversité du tableau de la Nature(1). »
Sans la vision d’art, la copie de la Nature deviendrait une sottise, cela est évident ; mais il faut craindre de limiter son invention à des répétitions ou des pastiches, de perdre pied dans des abstractions ou des redites ; il faut se maintenir sur le terrain de l’analyse et de l’observation, oublier les œuvres faites pour en créer d’imprévues, tirées du sein de l’ouvrage de Dieu.
Paul Cezanne considère qu’il est deux plastiques, l’une sculpturale ou linéaire, l’autre décorative ou coloriste. Ce qu’il nomme la plastique sculpturale serait amplement signifié par le type de la Vénus de Milo. Ce qu’il nomme plastique décorative se rattache à Michel-Ange, à Rubens. L’une de ces plastiques, servile, l’autre, libre ; l’une dans laquelle le contour l’emporte, l’autre dans laquelle domine la saillie, la couleur et la fougue. Ingres est de la première, Delacroix est de la seconde.Voici quelques opinions de Paul Cezanne :
Ingres est un classique nuisible, et en général tous ceux qui, niant la nature ou la copiant de parti pris, cherchent le style dans l’imitation des Grecs et des Romains.
L’art gothique est essentiellement vivifiant, il est de notre race.
Lisons la nature ; réalisons nos sensations dans une esthétique personnelle et traditionnelle à la fois. Le plus fort sera celui qui aura vu le plus à fond et qui réalisera pleinement, comme les grands vénitiens.
Peindre d’après nature ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser ses sensations.
Dans le peintre il y a deux choses : l’œil et le cerveau, tous deux doivent s’entre-aider : il faut travailler à leur développement mutuel ; à l’œil par la vision sur nature, au cerveau par la logique des sensations organisées, qui donne les moyens d’expression.
Lire la nature, c’est la voir sous le voile de l’interprétation par taches colorées se succédant selon une loi d’harmonie. Ces grandes teintes s’analysent ainsi par les modulations. Peindre c’est enregistrer ses sensations colorées.
Il n’y a pas de ligne, il n’y a pas de modelé, il n’y a que des contrastes. Ces contrastes, ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnent, c’est la sensation colorée. Du rapport exact des tons résulte le modelé. Quand ils sont harmonieusement juxtaposés et qu’ils y sont tous, le tableau se modèle tout seul.
On ne devrait pas dire modeler, on devrait dire moduler.
L’ombre est une couleur comme la lumière, mais elle est moins brillante ; lumière et ombre ne sont qu’un rapport de deux tons.
Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Il faut s’apprendre à peindre sur ces figures simples, on pourra ensuite faire tout ce qu’on voudra.
Le dessin et la couleur ne sont point distincts ; au fur et à mesure que l’on peint ou dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Les contrastes et les rapports de tous, voilà le secret du dessin et du modelé.
L’effet constitue le tableau, il l’unifie et le concentre ; c’est sur l’existence d’une tache dominante qu’il faut l’établir.
Il faut être ouvrier dans son art. Savoir de bonne heure sa méthode de réalisation. Être peintre par les qualités mêmes de la peinture. Se servir de matériaux grossiers.
Il faut redevenir classique par la nature c’est-à-dire la sensation.
Tout se résume en ceci : avoir des sensations et lire la Nature.
A notre époque il n’y a plus de vrais peintres. Monet a donné une vision. Renoir a fait la femme de Paris. Pissarro a été très près de la nature. Ce qui suit ne compte pas, ne se composant que de farceurs qui ne sentent rien, qui font des acrobaties… Delacroix, Courbet, Manet ont fait des tableaux.
Travailler sans souci de personne, et devenir fort tel est le but de l’artiste, le reste ne vaut même pas le mot de Cambronne.
L’artiste doit dédaigner l’opinion qui ne repose pas sur l’observation intelligente du caractère. Il doit redouter l’esprit littéraire, qui fait si souvent le peintre s’écarter de la vraie voie : l’étude concrète de la nature, pour se rendre trop longtemps dans des spéculations intangibles.
Le peintre doit se consacrer entièrement à l’étude de la nature et tâcher de produire des tableaux qui soient un enseignement. Les causeries sur l’art sont presque inutiles. Le travail qui fait réaliser un progrès dans son propre métier est un dédommagement suffisant à l’incompréhension des imbéciles. Le littérateur s’exprime avec des abstractions tandis que le peintre concrète, au moyen du dessin et de la couleur, ses sensations, ses perceptions.
On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins maître de son modèle, et surtout de ses moyens d’expression. Pénétrer ce qu’on a devant soi, et persévérer à s’exprimer le plus logiquement possible.Tel est Cezanne, telle est sa leçon d’art. Comme on le voit, il se différencie essentiellement de l’impressionnisme, dont il dérive, mais dans lequel il ne put pas emprisonner sa nature. Loin d’être un spontané, Cezanne est un réfléchi, son génie est un éclair en profondeur. Il résulte donc que son tempérament très peintre l’a conduit à des créations décoratives nouvelles, à des synthèses inattendues ; et ces synthèses ont été en vérité le plus grand progrès jailli des aperceptions modernes ; car elles ont terrassé la routine des écoles, maintenu la tradition et condamné la fantaisie hâtive des excellents artistes dont j’ai parlé. En somme, Cezanne, par le fondé de ses œuvres, s’est prouvé le seul maître sur lequel l’art futur pourrait greffer sa fruition. Combien peu appréciées pourtant furent ses découvertes ! Considérées à tort par les uns, à cause de leur inachevé, comme des recherches sans aboutissement ; par les autres comme des étrangetés sans avenir, dues à l’unique fantaisie d’un artiste maladif ; par lui-même, devant qui un idéal d’absolu se dressait, comme mauvaises plutôt que bonnes, sans doute de dépit de s’y voir trahi (il en détruisit un grand nombre, n’en montra aucune) telle qu’elles sont, elles constituent cependant le plus bel effort vers une renaissance picturale et coloriste que, depuis Delacroix, la France ait pu voir.
Je ne crains pas d’affirmer que Cezanne est un peintre à tempérament mystique, et que c’est à tort, qu’on l’a toujours rangé dans la déplorable école inaugurée par M. Zola, qui, en dépit de ses blasphèmes contre la nature, s’était octroyé hyperboliquement le titre de naturaliste. Je dis que Cezanne est un peintre à tempérament mystique en raison de sa vision purement abstraite et esthétique des choses. Là, où d’autres se préoccupent, pour se traduire, de créer un sujet, lui se contente de quelques harmonies de lignes et de tonalités prises sur des objets quelconques, sans se soucier de ces objets en eux-mêmes ; ainsi d’un musicien, qui dédaigneux de broder sur un livret, se satisferait à plaquer des suites d’accords dont la nature exquise nous plongerait infailliblement dans un au-delà d’art inaccessible à ses habiles confrères. Cezanne est un mystique précisément par ce dédain de tout sujet, par l’absence de vision matérielle, par un goût qu’avouent ses paysages, ses natures mortes, ses portraits, le plus noble et le plus haut : le style. Et la nature même de son style confirme ce que je disais par une qualité de candeur et de grâce tout giottesque, montrent les choses dans l’essentiel de leur beauté. Prenez telle peinture du maître, elle est dans sa science et sa qualité vraiment superlatives, une leçon d’interprétation sensitive et sentimentale. Par une prise de contact, non avec notre instinct grossier, avide d’imitation, mais avec la partie contemplative de notre être, émue seulement par la mystérieuse influence des harmonies éparses dans ce monde, elle éveille le retour des sensations les plus rares éprouvées sur le divin modèle. Un mystique seul considère ainsi la beauté qui revêt le monde, plutôt qu’il ne s’emprisonne dans la matérialité de ce même monde, c’est dire qu’il est le seul à bien voir. Le vulgaire les regarde sans doute tout autrement, d’où la différence et l’inversion. Plus l’homme s’est éloigné des mystagogies, plus à coup sûr il a perdu cette pénétration dans le domaine de la splendeur et du sentiment, plus il s’est incliné vers la réalité extérieur. L’art, qui fut d’abord le langage des aspirations divines, est devenu peu à peu, à travers les siècles, comme cet homme même, factice et fourbe ; désormais il ne cherche plus à insérer dans son tissu une expression particulière de l’âme ou de la pensée, ne se plaît plus même à la beauté pure, mais se satisfait d’imitations. Il en résulte la triste catastrophe photographique que nous inflige journellement l’École des Beaux-Arts et qui obstrue à fond notre compréhension esthétique. D’autre part les vains mots d’humanité, de vitalité, de réalité, empruntés au vocabulaire d’une politique insane, et répétés à foison par des critiques patentés, achèvent de persuader à une race animalisée, que l’art progresse par l’imitation. Ces préjugés joints à d’autres qui s’élèvent de toutes parts, soit du sein d’une école officielle, soit des cénacles de jeunes gens avides de gloriole, périront tous, misérablement, anéantis avec les fronts qui les abritent. Il faut avouer sans ambages qu’en fait de peinture l’obstruction est assez générale. La démocratie montante ne sera point — tout le présage — la salvatrice des rares cerveaux qui conservent en serre, par cette hyémale époque, les fleurs d’un printemps possible. Habile à déformer, elle aura sans doute assez de bateleurs et de charlatans pour détourner l’attention vers les déliquescences qui lui sont chères, déliquescences sans charmes, anémiques, ignorantes et d’une assez dégoûtante barbarie.
Ainsi parmi les peintres qui sont grands, Paul Cezanne se peut placer comme un mystique, car c’est la leçon d’art qu’il nous donne, il voit les choses non pas par elles-mêmes, mais par leur rapport direct avec la peinture, c’est-à-dire avec l’expression concrète de leur beauté. Il est un contemplatif, il regarde esthétiquement, non objectivement ; il s’exprime par la sensibilité c’est-à-dire par la perception instinctive et sentimentale des rapports et des accords. Et puisque ainsi son œuvre confine à la musique, on peut répéter irréfragablement qu’il est un mystique, ce dernier moyen étant le suprême, celui du ciel. Tout art qui se musicalise est en chemin de son absolue perfection. Dans le langage il devient poésie, dans la peinture il devient beauté.
Ce mot de beauté, prononcé à propos de l’œuvre de Paul Cezanne, demande qu’on s’en explique. Je voudrais en ce cas qu’il soit entendu ainsi : « l’expansion absolue de l’art employé ». Certainement, dans ses portraits, par exemple, le maître peintre ne s’est guère soucié de choisir un modèle. Il a travaillé d’après la première personne de bonne volonté qui se trouvait auprès de lui, sa femme, son fils, et plus souvent des gens du peuple, un terrassier ou une laitière, de préférence à un gandin ou à quelque civilisé qu’il abhorre pour ses goûts corrompus et sa fausseté mondaine.
Ici il ne s’agit plus, bien entendu, de chercher la beauté en dehors des moyens mêmes de la peinture ; les lignes, les valeurs, le coloris, la pâte, le style, la présentation, le caractère. Nous sommes loin assurément d’une beauté convenue ou matérielle, et l’œuvre ne sera belle pour nous qu’autant que nous posséderons la sensibilité très élevée, capable de nous faire perdre de vue la chose représentée pour jouir artistement. « Il faut bien voir son modèle, sentir très juste, et encore s’exprimer avec distinction et force. Le goût est le meilleur juge. Il est rare. L’art ne s’adresse qu’à un nombre excessivement restreint d’individus. » Ce sont les propres paroles du maître, corroborées par son œuvre ; elles expriment ses préoccupations. Le goût est le sens spécial (si peu et si mal cultivé, hélas !) auquel seul il s’adresse.De la tradition, le maître se plaît à se recommander, il connaît le Louvre mieux que nul peintre, il a même trop, selon lui, regardé les vieux tableaux. Ce qu’il croit qu’on doit demander aux anciens, c’est leur façon classique et sérieuse de logiquement organiser son œuvre. La nature intervenant dans le travail de l’artiste, animera ce que la raison laisserait mort, il recommande surtout de partir de la Nature.
Théoriste, on doit l’être certes, pour entrer en possession de soi et mener à bien son ouvrage ; mais il faut l’être de ses sensations et non seulement de ses moyens. La sensation exige que les moyens soient constamment transformés, recréés, pour l’exprimer dans son intensité. Il ne faut donc pas tenter de faire entrer la sensation dans un moyen préétabli, mais mettre son génie inventif d’expressions au service de la sensation. D’une part ce serait l’école des Beaux-Arts, qui ramène tout à un moule uniforme ; tandis que de l’autre c’est le renouvellement constant. Organiser ses sensations, voici donc le premier précepte de la doctrine de Cezanne, doctrine non point sensualiste, mais sensitive. L’artiste gagnera alors en logique sans perdre en expression ; il pourra être imprévu tout en restant classique par la Nature.
A bien considérer cette doctrine, elle apparaît la plus saine, la meilleure, la plus méconnue ; elle entre en directe opposition avec ce que les officiels ont imposé et avec tout ce que les créateurs de genres (soit impressionnisme, symbolisme, divisionnisme, etc.) ont toujours tenté. Ceux-là offraient des méthodes routinières, ceux-ci des conventions scientifiques ou personnelles ; aucun d’eux une marche de conduite sûre, sauvegardant l’étude approfondie et le respect de la Nature. Certes, c’était bien commode de trouver des recettes pour devenir autre chose que pompier ; et l’école des Beaux-Arts est actuellement plus avancée dans cette route que les plus révolutionnaires des peintres d’autrefois ; mais aucun de ses élèves ne s’est rendu compte qu’il n’est qu’une doctrine d’art valable, celle qui dit au peintre : « Sens la Nature, organise tes perceptions, exprime-moi profondément et avec ordre, c’est-à-dire classiquement. »
A une heure où nous sommes débordés de gâcheurs de toile, de subtils faiseurs, depuis M. Carrière qui croit bon de se réclamer de Vélasquez, jusqu’aux dupeurs qui prétendent créer un art nouveau, la leçon de Paul Cezanne surgit comme une rédemption possible pour la peinture française.Ce grand artiste est un humble, il a compris l’ignorance et l’obstruction dévolues à ses contemporains ; il a donc clos sa porte pour se plonger dans l’absolu. Uniquement possédé par l’amour de peindre, dont sa vie subit la ténacité tyrannique et bienfaisante, il considère que le travail est une jouissance suffisante en soi pour ne point désirer l’approbation ou l’éloge. Il déteste l’esprit littéraire qui fit tant d’intrusions malsaines dans la peinture et en a défiguré la plus simple compréhension. Il ne connaît que sa toile, sa palette, ses couleurs, et certes il n’aurait jamais laissé sortir de son atelier la moindre étude, si des amateurs intelligents, mais rares, n’en avaient emporté, presque à son insu. Depuis, M. Ambroise Vollard, le sympathique expert de la rue Laffitte, a satisfait à nos désirs de connaître plus complètement l’œuvre de Cezanne, il y travaille encore de son mieux(2).
Quoi que pense d’elle le maître, trop sévère pour lui-même, elle domine toute la production contemporaine, elle s’impose par la saveur et l’originalité de sa vision, la beauté de sa matière, la richesse de son coloris, son caractère sérieux et durable, son ampleur décorative. Elle nous attire par sa croyance et sa saine doctrine, elle nous persuade de l’évidente vérité qu’elle annonce, et dans la dégénérescence actuelle s’offre à nous comme une oasis salutaire. Se rattachant par sa sensibilité raffinée à l’art gothique, elle est moderne, elle est neuve, elle est française, elle est géniale. Retiré des peintres, des mondains, des intrigants et des cabotins de notre misérable siècle, Cezanne ne laisse approcher de lui que le moins d’individus possible. L’école de la vie lui fut assez ingrate pour qu’il craigne l’intrusion. L’exemple qu’il nous donne est donc double, il est d’un homme en plus qu’il est d’un maître. Une vie simple, régulière, toute distribuée aux heures du jour pour le travail, un œil sans cesse en éveil, un esprit toujours en contemplation, voilà Paul Cezanne. Sa peinture franche, naïve, honnête, précise, dit son génie d’artiste ; son existence retirée des vanités, des glorioles, dit sa bonté et son humilité d’homme. Ce qu’il espère, c’est prouver par son œuvre qu’il est sincère et qu’il travaille au meilleur art. Bien des gloires contemporaines, orgueilleuses et stupides, tomberont, lorsque la sienne se lèvera ; alors comme chrétien et comme artiste, il assistera à la réalisation de ces paroles du Magnificat : « Les puissants seront déposés et les humbles seront exaltés. »
(1) Ce sont les propres paroles de Cezanne.
(2) M. Vollard prépare diligemment un catalogue illustré de l’œuvre de Cezanne. »
Bernard Émile, « Souvenirs sur Paul Cezanne et lettres inédites », Mercure de France, tome n° 69, n° 247, 1er octobre 1907, p. 385-404 :
« SOUVENIRS
SUR PAUL CEZANNE
ET LETTRES INÉDITESCelui qui écrit ces lignes a été pendant vingt ans de sa vie un admirateur fervent de Paul Cezanne. Alors que la méconnaissance, la malveillance et la méchanceté jalouse entouraient les œuvres de l’artiste, qu’il appelait son maître, de rires hostiles ou de silence obscur, il a déchiffré avec passion les toiles (rares alors) que l’on pouvait voir de ce peintre dans une petite boutique de la rue Clauzel, à Paris. Il était loin de s’attendre au succès retentissant qui, depuis, a fait des moindres tentatives de Paul Cezanne des ouvrages d’un intérêt spécial ; il s’indignait du mutisme de la critique, du mépris des amis et de l’ignorance des peintres, ses contemporains, simplement.
Aujourd’hui tout a changé, et la petite notice qu’il écrivit dans les « Hommes d’aujourd’hui 1 » vers 1889 et qui fut un des premiers hommages à son maître d’alors, à son initiateur dès le début, semble une bien maigre offrande au peintre dont l’influence s’est faite si multiple et si nombreuse. C’est qu’alors il était fort difficile de voir des œuvres de Cezanne, et quant à sa personne même elle semblait absolument inaccessible, perdue dans le poudroiement lointain du soleil méridional, à Aix. Tout ce que l’on en savait était raconté par le père Tanguy, le bon et généreux Breton dont la boutique était l’unique repaire, en ces temps si vite devenus passés, de la peinture de l’avenir. Donc, l’élève passionné qui parle ici n’avait point formé le projet fantastique de risquer son ignorance et sa modeste personne vers le maître dont les ouvrages lui disaient suffisamment la supériorité et la grandeur. Du moins, alors, il en jugeait ainsi. Son ferme rêve n’était point autre que de continuer celui pour lequel son admiration absolue lui ôtait la tolérance de tous les autres efforts actuels et qu’il nommera toujours avec plaisir son premier initiateur. Aussi ce ne fut que vingt ans plus tard, en 1904, que, revenant d’Égypte, et devant séjourner à Marseille, il songea à la proximité d’Aix, et s’y rendit, désireux d’accomplir enfin la visite projetée autrefois, et jamais faite par timidité et aussi (disons-le) par pauvreté.
Aujourd’hui, Paul Cezanne est mort et son élève a pris de l’âge. A la veille de la quarantaine, et après beaucoup de fatigues pour découvrir le meilleur art, il se trouve moins novice, moins innocemment persuadé de ce qu’il admirait autrefois. Il croit surtout à un art complet, traditionnel, faisant abstraction des recherches curieuses. Il vise à la vie, à la réalisation du vrai, car il sait, pour avoir vu Michel-Ange, Raphaël, Titien, Rubens, Rembrandt dans la majesté de leurs ensembles que : l’art est une imitation du naturel dans une invention.
Il sait que, sous la vie seulement, habite l’âme et que toute théorie, toute abstraction dessèchent lentement l’artiste, et aussi sûrement que l’habileté manuelle ou exercice sans inspiration du métier. Appuyée sur les immuables méthodes qui ont constitué dès le début l’art même, il se méfie des paradoxes et des jeux de l’intelligence, même géniale, qui peut n’être qu’un apport dissolvant dans le patrimoine ancestral.
Réaliser, tout est là. Et c’est Cezanne qui le lui disait, alors que déjà l’Italie, la Flandre et l’Espagne le lui avaient bien persuadé. L’œuvre, en effet, compte non pas par ses intentions, mais par sa réalisation. Son but n’est pas ici d’analyser l’œuvre entière de Paul Cezanne, ni même de prononcer un verdict pour ou contre elle, comme hélas ! il nous est donné si souvent d’en entendre par des peintres bien à plaindre. Le respect qu’il porte à la mémoire de son vieux maître ne l’y autorise nullement. Ce qu’il a admiré en lui ; le don étonnant de l’originalité, de la force dans l’ensemble, du chant chromatique, du style, il persiste, à le regarder avec plaisir et comme une manifestation captante. Ce sur quoi il se croira autorisé à parler, c’est sur l’influence assez généralement déformée qu’exerça cette œuvre le jour de son succès. Il s’efforcera de démontrer que le plus grand nombre des imitateurs n’a connu ni pénétré la sagesse du peintre qu’il avait en vue de qualifier son maître ; erreur qui a en grande partie causé l’avortement de ce que sa tendance pouvait avoir d’honnête, de régénérateur, de bienfaisant, et fait croire l’original dénué des qualités qu’il possédait à un très haut point. La mise à jour des idées de Cezanne aidera à cette connaissance et sauvegardera au moins son apport, en condamnant l’avatar monstrueux qu’il a subi dans des mains plutôt ennemies qu’amies.
En outre, l’auteur de ces souvenirs espère dire, par un mémoire presque journalier d’une existence mêlée avec celle de Paul Cezanne durant un mois, ce qu’était l’homme dont la, physionomie reste si voilée ou si déformée par ceux qui ― rarement ― l’approchèrent. Sans prétendre tout dire, il espère dire beaucoup, car c’est là un cœur qu’il a senti, une nature qu’il a aimée. Quelle que soit son affection, aujourd’hui plus grande encore peut-être pour l’homme que pour l’artiste, il dessinera son caractère, inégal, bizarre, tourmenté, dont le fond était la bonté, et que la misanthropie avait fini par dominer, comme il advient généralement à ceux qui n’ont rencontré que la malice, l’intérêt et la méchanceté de ce monde.I
L’ARRIVÉE À AIXAprès une assez belle traversée, nous étions arrivés à Marseille en février 1904. Cette ville était inondée d’un soleil qui tentait de continuer l’illusion de l’Égypte, dont nous venions. L’idée me hanta de nous fixer au moins un mois dans le midi, afin d’attendre que le froid s’apaisât avant de remonter vers le nord. Comme nous étions dans un restaurant, mangeant une exquise bouillabaisse, gloire de ce pays, le garçon nous annonça, je ne sais plus à quel propos, qu’un tramway électrique venait d’être installé entre Aix et Marseille. Ce nom d’Aix éveilla en moi le souvenir de mon vieux maître, peintre dont je ne connaissais que les ouvrages et dont mes premiers essais dans l’art avaient tiré leur leçon. Ayant appris qu’il n’y avait que deux heures de voyage de Marseille à Aix, je résolus d’employer la journée du lendemain à une visite chez Paul Cezanne.
Le lendemain, en effet, dès 7 heures du matin, muni de la notice que j’avais publiée aux « Hommes d’aujourd’hui » chez l’éditeur Vanier, vers 1889, j’abordai le fameux tramway et j’y pris place pour Aix. Mes appréhensions étaient grandes, je ne savais pas l’adresse de Paul Cezanne, et je ne connaissais personne qui la sût. Il est vrai que j’avais pensé qu’un peintre devenu quasi célèbre à Paris devait être quelque peu répandu dans son pays ; mais j’avais en vain questionné déjà quelques personnes à Marseille, exhibant, comme pièce propre à éclairer la mémoire, ma notice ornée d’un portrait de Paul Cezanne par Camille Pissarro. On retournait ma feuille dans tous les sens, et toujours la réponse était négative. D’ailleurs je m’apercevais bien que l’image du personnage, habillé en paysan et de mine rébarbative, ne pouvait nullement enorgueillir quiconque de le connaître ou de savoir seulement son nom.
Il n’y eut pas dans le tramway de Marseille à Aix une personne que je ne passai au crible de mes questions ; elles étaient invariables. ― « Vous habitez Aix ? depuis longtemps ?… » Puis rassemblant tout mon courage « Y connaissez-vous un grand peintre, célèbre à Paris aujourd’hui, l’honneur de sa ville : Paul Cezanne ? » Mais la réponse restait négative, après une révision du plafond de la voiture par les yeux du questionné. Le conducteur lui-même ignorait absolument le nom de Paul Cezanne et fut incapable de me donner aucune indication, quoique je lui eusse fourni force explications et montré longuement l’effigie dessinée par Pissarro. Ce qui fait qu’étant arrivé au lieu de destination je me résolus à demander simplement la route de la cathédrale.
La petite ville d’Aix, avec son Cours spacieux planté de beaux arbres, ses fontaines d’eau chaude s’épanchant dans des vasques moussues, ses hôtels aux cariatides classiques, ses façades silencieuses et aristocratiques, me fit une excellente impression. Il me semblait que l’âme de mon vieux maître y répandait une atmosphère de sympathique intimité. Après des ruelles tortueuses, une station devant l’hôtel de ville et son beffroi, j’arrivai à la cathédrale. Là, des saints d’une naïveté grossière, sous laquelle se cachait presque un aveu de foi, me firent de suite penser à Cezanne. C’était comme un reflet de cette bonhomie qu’il a souvent dans ses portraits d’hommes du peuple. Ces saints, je ne sais pour quelle raison, me le rendaient presque présent, ce pourquoi ne le rencontrant pas là, je me remis à questionner les rares passants qui troublaient d’un rythme de pas la solitude de ce lieu. Les réponses continuèrent à être négatives. Personne, à Aix même, ne connaissait, ou ne semblait connaître Paul Cezanne. Je me désespérais déjà, lorsqu’un ouvrier vint stationner sous le porche que je regardais, et se mit à suivre mon exemple, c’est-à-dire à consulter comme moi les vieux saints naïvement grotesques du seuil. Je le questionnai, mais il ne put me répondre plus que les autres ; puis se ravisant il me dit : « En dernier recours vous pouvez aller à la mairie ; si ce monsieur est sur la liste des électeurs on vous donnera son adresse. » Ignorant de toute formule administrative, je n’avais pas songé à cet expédient si simple. Je remerciai cet intelligent passant, et je me rendis à la mairie d’Aix. Elle était à deux pas, et j’étais passé devant en montant à la cathédrale. Là, immédiatement, je sus que « M. Cezanne Paul était né à Aix en Provence, le 19 janvier 1839, et qu’il habitait rue Boulegon, 25 ».
Je me rendis de suite à l’adresse indiquée ; c’était une maison de la plus simple apparence, un atelier la terminait. De chaque côté de la porte pendaient des sonnettes. Je lus sur une plaque : PAUL CEZANNE. C’était là. Enfin, vingt années de désir allaient trouver leur satisfaction ! Je sonnai prudemment, la porte s’ouvrit d’elle-même et je me trouvai dans un corridor très gai, par ses vitres montrant un jardin ensoleillé et des murs tapissés de lierre. Un large escalier était devant moi ; je commençai à le gravir. J’avais à peine monté quelques marches qu’un vieillard le tourna, se présentant de face à ma vue. Il était couvert d’une ample pèlerine et avait une sorte de carnier à son côté ; sa marche était pénible et lourde, il s’inclinait vers le sol. Quand je fus auprès de lui, je lui demandai, croyant bien qu’il était mon vieux maître, mais incertain de la ressemblance avec le portrait de Pissarro : « M. Paul Cezanne, s’il vous plaît ? »Alors il fit un pas en arrière, se campa, tira son chapeau jusqu’à terre, et découvrant un front chauve et un visage de vieux général dit : « Le voilà! Que lui voulez-vous ? »
Je lui expliquai le but de ma visite, je lui dis mon admiration longue et ancienne, mon désir de le connaître, les difficultés de sa rencontre, enfin mon arrivée du Caire. Il parut fort surpris de tout cela, puis il conclut :
« Alors vous êtes un confrère ? » ― Je déclinai ce titre vis-à-vis de l’âge et du talent que j’avais sous les yeux. « Pas de tout cela, me dit-il, vous êtes peintre, n’est-ce pas, donc vous êtes un confrère. » L’accent était plein de douceur quoique fort décidé ; en outre le méridionalisme de la prononciation faisait sauter bizarrement les syllabes, mettait un peu de risible à cette paternelle bonhomie. M’ayant redemandé mon nom, il s’écria :
« Ah ! vous êtes Émile Bernard C’est vous qui avez. Écrit sur moi. Vous faites donc des biographies ? Mon ami Paul Alexis m’a envoyé cela dans le temps. C’était Signac qui le lui avait passé. Comme je m’étais informé de vous, on m’avait répondu : C’est un homme qui fait des biographies. Mais vous êtes peintre, n’est-ce pas ? » C’est ainsi que d’agréables confrères vous font des réputations singulières. Je n’ai rien à dire à cela, quoique Cezanne y perdît de savoir de suite l’unique vérité : que j’étais alors son plus fervent admirateur et son défenseur acharné, ― en outre ― ce qui l’eût beaucoup plus intéressé : son élève.
Cependant toute cette conversation avait lieu sur l’escalier et mon vieux maître semblait être en route pour le travail ; je lui exprimai mon désir de le voir quelques heures et je lui demandai la permission de le mener jusque sur place. « J’allais au motif, me dit-il, allons-y ensemble. »
Dans la rue des gamins se moquaient de lui et lui jetaient des pierres, je les écartai. Pour ces enfants l’allure de brigand qu’avait Cezanne était une autorisation au sarcasme. Il devait leur apparaître comme une sorte de « père fouettard ». Je souffris bien souvent, plus tard, des méchancetés que les petits gamins d’Aix semaient sur son passage et des espiègleries dont il était le but.
Nous marchâmes longuement en causant :
« Alors vous n’êtes pas qu’un faiseur de biographies ?… Vous êtes un peintre !… » Il avait du mal à s’en persuader, car il y avait vingt ans qu’il le croyait. Nous sortîmes de la ville après avoir passé devant la cathédrale, là je lui avais dit : « Ces saints m’ont parlé de vous. ― Oui, me répondit-il, je les aime bien. C’est un vieux tailleur de pierres d’ici qui les à faits, voici longtemps ; il est mort. » Au sommet d’une côte, une maison neuve présentait sa face surmontée d’un fronton grec.
« Voilà mon atelier, me dit-il mystérieusement, là, personne n’entre, que moi ; mais puisque vous êtes un ami, nous irons ensemble » Il ouvrit un portail de bois, nous pénétrâmes dans un jardin dont la pente allait se perdre dans un ruisseau ; il poudroyait d’oliviers, au fond quelques sapins. Sous une grosse pierre il prit une clef et ouvrit la maison neuve et silencieuse, que le soleil semblait cuire. A droite, sitôt dans le corridor, une pièce était béante, un paravent [R 1, 2, 3] fort ancien m’y attira :
« J’ai joué bien souvent dans ce paravent avec Zola, me dit-il. Tenez, nous en avons même gâté les fleurs. » C’était une réunion de châssis peints de grands feuillages et de scènes champêtres ; il y avait de ci, de là des floraisons. Mais la main qui avait orné cet accessoire était habile, italienne presque. « Voilà la peinture, me dit Cezanne, ce n’est pas plus difficile que cela. Il y a là tout le métier, tout. » Sur la cheminée de la pièce un buste était commencé, en terre rouge ; il voulait représenter Cezanne : « C’est Solari qui fait ça, un pauvre diable de sculpteur, un ami de toute ma vie. Je lui ai toujours dit qu’il se foutait dedans avec son École des Beaux-Arts ; il m’a supplié de le laisser faire. Je lui ai dit : « Tu sais je n’ai pas le goût de la pose. Viens si tu veux dans la chambre d’en bas ; je travaille en haut. Quand tu me verras, observe, et fais ton affaire. » Il a fini par lâcher en laissant cette ordure ; c’est désespérant. » Alors il saisit le petit buste et le porta dans le jardin ; puis là, le cognant furieusement du pied sur une dalle, il s’écria : « C’est idiot à la fin ! » et il le brisa. Séparée de son pied, l’avortée effigie roula dans les cailloux, sous les oliviers, où elle resta tout le temps que je fus à Aix, achevant de se fendre au soleil.
Nous ne montâmes pas à l’atelier. Cezanne prit un carton dans le. vestibule et me mena « sur le motif » C’était à deux kilomètres encore, en vue d’une vallée, au pied de la Sainte- Victoire, montagne hardie qu’il ne cessait de peindre à l’eau et à l’huile et qui le remplissait d’admiration. « Dire que ce cochon de Menier est venu ici, exclamait-il, et qu’il voulait en tirer du savon pour le monde entier ! » Là-dessus il commença à me dire ses idées sur le monde actuel, l’industrie et le reste : « Ça va mal, me murmurait-il avec un œil furieux… C’est effrayant la vie ! » Je le laissai sur le motif, afin de ne point gêner son travail, et retournai à Aix, déjeuner. Quand je vins le reprendre il était quatre heures du soir. Après avoir reporté son carton il voulut me conduire au tramway et me fit promettre de revenir le lendemain, déjeuner avec lui. Je le fis avec d’autant plus de plaisir que je sentais que mon vieux maître était devenu mon ami.II
NOTRE ÉTABLISSEMENT A AIXLe lendemain j’arrivai à Aix de fort bonne heure avec la résolution de louer pour un mois dans une famille du pays. Je visitai divers lieux et je me fixai sur le choix d’une fort belle pièce à l’allure ancienne, desservie par une cuisine. Il y avait une cheminée fort large, des panneaux du xviiie siècle et une armoire-placard pleine de vaisselle que l’on devait explorer au moyen d’une échelle. J’ai toujours eu dans le regard une gravure du temps de Louis XV, chaque fois que j’ai vu cette armoire ouverte ; je me représentais une soubrette élégante, comme les dessinèrent les peintres de ce temps, dans cette haute porte aux moulures compliquées, parmi ces compotiers et ces plats de porcelaine fine aux transparences japonaises. Je signai un contrat et je quittai, fort satisfait, Mme de S…, qui avait consenti à me louer. En attendant qu’il fût onze heures j’allai au Musée, mais je le trouvai fermé et je repris le chemin de la cathédrale pour en visiter l’intérieur. Je fus surtout ravi par les tapisseries flamandes dont se décore le chœur, les grandes armoires contenant les précieuses peintures de Nicolas Froment étant fermées. Je remarquai aussi un autel surmonté d’un groupe gothique avec la Tarasque, et un baptistère d’une fort belle architecture.
A onze heures, je sonnais de nouveau rue Boulegon. La porte à peine ouverte, une femme d’environ quarante ans, assez corpulente et de mine aimable se pencha sur la rampe de l’escalier et me cria de monter, sitôt mon nom décliné. C’était au second. L’appartement était modeste, la pièce où Cezanne m’attendait était tapissée de papier à dessins démodés, petite, occupée presque en entier par une table, un poêle où brûlait du bois coupé en petites bûches. A peine fus-je arrivé que Cezanne dit : « Madame Brémond, servez-nous, s’il vous plaît. » Alors la personne qui m’avait reçu se mit en devoir d’apporter les plats. La conversation de la veille fut reprise et je pus à mon aise mieux voir mon vieux maître. Il était bien fatigué pour son âge, malade du diabète, astreint à des abstentions de mets et asservi à des potions et des régimes. Ses yeux étaient enflés et rouges, ses traits boursouflés et son nez légèrement violacé. Nous parlâmes de Zola, dont l’affaire Dreyfus avait fait l’homme du jour : « C’était une intelligence fort médiocre, me dit Cezanne, et un ami détestable ; il ne voyait que lui ; c’est ainsi que L’Œuvre, où il a prétendu me peindre, n’est qu’une épouvantable déformation, un mensonge tout à sa gloire. Quand j’arrivai à Paris pour faire des images de Saint-Sulpice ― puisque ma naïveté d’alors ne me faisait pas ambitionner plus et que j’avais été élevé pieusement, ― je retrouvai Zola à Paris. Il avait été mon camarade de collège, nous allions jouer ensemble au bord de l’Arc et il faisait des vers. J’en inventais aussi, des latins et des français. J’étais plus fort que lui en latin et j’avais composé dans cette langue une pièce entière. Alors on faisait encore de bonnes humanités. » Là dessus la conversation déviait sur les négligences de l’éducation moderne, puis, après des citations d’Horace, de Virgile, de Lucrèce, Cezanne se remettait au fil de son discours : « Donc, lorsque j’arrivai à Paris, Zola, qui m’avait dédié la Confession de Claude, ainsi qu’à Bail, un camarade mort, me présenta à Manet. Je fus très épris de ce peintre et de son bon accueil, mais ma timidité naturelle m’empêcha de fréquenter beaucoup chez lui. Zola lui-même, au fur et à mesure qu’il établissait sa réputation, devenait féroce et semblait me recevoir comme par complaisance ; si bien que je me dégoûtai de le voir ; et je fus de longues années sans le rechercher. Un beau jour je reçus l’Œuvre. Ce fut un coup pour moi, je reconnus son intime pensée sur nous. En définitive, c’est là un fort mauvais livre et complètement faux. » Cezanne se versait et me versait du vin ; la conversation arriva sur ce liquide : « Voyez-vous, me dit-il, le vin a nui à beaucoup d’entre nous. Mon compatriote Daumier en buvait trop : quel grand maître il aurait pu faire sans cela ! »
Après le repas nous allâmes à l’atelier hors la ville, il m’introduisit enfin parmi ses tableaux, dans sa propre salle de travail ; c’était une grande pièce peinte à la colle, en gris, prenant le jour sur le nord, par un éclairage à hauteur d’appui. Il me parut que cette prise de jour était fort gênante, parce qu’elle donnait le reflet sur toutes les choses qu’il peignait de quelques arbres et d’une roche. Il me dit : » On ne peut plus, rien obtenir de personne. J’ai fait bâtir ici à mes frais et l’architecte n’a jamais voulu suivre ce que je désirais. Je suis un timide, un bohème, me criait-il, on se moque de moi. Je n’ai pas de force de résistance. L’isolement, voilà ce dont je suis digne. Au moins, ainsi, personne ne me met le grappin dessus. » En disant cela, il singeait cet imaginaire ustensile avec sa vieille main et ses doigts crispés.
Il était à l’ouvrage d’une toile représentant trois têtes de mort sur un tapis d’Orient. Il y avait un mois qu’il y travaillait tous les matins, de six heures à dix heures et demie. Car telle était sa règle de vie : il se levait très tôt, allait à son atelier en toute saison, de six heures à dix heures et demie, revenait à Aix manger, et repartait, aussitôt après, au motif ou paysage, jusqu’au soir à cinq heures. Ensuite il soupait et se couchait immédiatement. Je l’ai vu parfois si fatigué de son travail qu’il ne pouvait plus causer ni rien entendre. Il se mettait au lit dans un état de coma inquiétant ; le lendemain il n’y paraissait plus.
« Ce qui me manque, me disait-il devant ses trois têtes de mort [Trois crânes sur un tapis d’Orient, R 824], c’est la réalisation. J’y arriverai peut-être, mais je suis vieux et il se peut que je meure sans avoir touché à ce point suprême : Réaliser ! comme les Vénitiens. » Puis il retombait à cette idée souvent exprimée par lui plus tard : « Je voudrais être reçu au salon de Bouguereau. Je sais très bien que ce qui fait obstacle, c’est que je ne réalise pas assez ; l’optique n’y est pour rien. » Évidemment, il ne pouvait que trouver mauvais le maître des ateliers à la mode ; mais l’idée qu’il exprimait avait sa parfaite justesse, l’originalité ne fait pas obstacle à la compréhension d’un artiste, c’est l’imperfection de son ouvrage. Cela est tellement évident que les grands maîtres ne manquent jamais d’originalité, et que la main-d’œuvre chez eux est d’autant plus parfaite qu’ils sont plus personnels. Le grand écueil de l’art, c’est cette répartition exacte de l’imitation par rapport à l’originalité ; l’imitation satisfait tous les hommes, tandis que l’originalité seule, dépourvue de cette puissance, reste une curiosité sans vie, ne passionnant que de rares artistes. Le point capital est le lien étroit de la nature, de la création individuelle et des règles de l’art.
Cezanne était une intelligence passionnée de nouveauté, ses moyens avaient le mérite de n’être qu’à lui seul, mais sa logique en avait, à son insu, compliqué tellement les rouages que son travail devenait extrêmement pénible et comme paralysé. Sa nature était pourtant plus libre qu’il ne le pensait ; il s’asservissait à force de recherches. L’idée de beauté n’était pas en lui, il n’avait que celle de vérité. Il insistait sur la nécessité d’une optique et d’une logique. Il y avait une extrême volonté dans ce cerveau, qui endiguait peu à peu les dons spontanés jusqu’à faire croire à une impuissance ; mais il n’était pas un impuissant. Trop bien doué, il allait trop loin dans la réflexion et la raison d’agir. S’il avait agi sans tant de doutes sur ce qui pouvait être le mieux, il n’eût pas été à l’absolu, il eût peut-être cessé d’être un cas, mais il nous aurait donné des pages magistrales.
C’est ainsi que je le vis peiner, durant tout le mois que je fus à Aix, sur ce tableau des têtes de mort, que je considère comme son testament [R 824]. Ce tableau a changé de couleur et de forme presque chaque jour, et quand j’arrivai dans son atelier on eût pu cependant le retirer du chevalet comme un ouvrage suffisant. Véritablement son mode d’étude était une méditation le pinceau à la main.
Il y avait encore, sur un chevalet mécanique qu’il venait de faire installer, une grande toile de femmes nues se baignant, qui était dans un état complet de bouleversement. Le dessin m’en parut assez difforme. Je demandai à Cezanne pourquoi il ne prenait pas de modèles pour faire ses nus. Il me répondit qu’à son âge on avait le devoir de s’abstenir de dénuder une femme pour la peindre, qu’il lui serait permis à la rigueur de s’adresser à une personne de cinquante ans, mais qu’il était à peu près sûr qu’à Aix il ne la trouverait pas. Il alla vers des cartons et me montra des dessins qu’il faisait à l’atelier Suisse, dans sa jeunesse. « Je me suis toujours servi de ces dessins, me dit-il, cela n’est guère suffisant, mais il faut bien à mon âge. » Je devinai qu’il était esclave d’une extrême convenance et que cet esclavage avait deux raisons, l’une qu’il se méfiait de lui-même vis-à-vis des femmes ; l’autre, qu’il avait des scrupules religieux et un vrai sentiment que ces choses ne peuvent se faire, dans une petite ville de province, sans scandaliser. Au mur de l’atelier je remarquai, outre des toiles de paysage qui séchaient sans châssis, des pommes vertes sur une planche (quel est le jeune peintre qui aujourd’hui n’a pas fait des pommes imitées de celles-là ?), la photographie de l’Orgie Romaine de Thomas Couture, une petite peinture d’Eugène Delacroix, Agar dans le désert, un dessin de Daumier et un de Forain. Nous parlâmes de Couture. Je fus surpris de le trouver très admirateur de ce peintre. Il avait raison, j’ai reconnu depuis que Couture était un vrai maître et qu’il avait formé d’excellents élèves : Courbet, Manet, Puvis. Ce qui lui plaisait encore là, c’était cette fameuse réalisation dont j’allais entendre parler durant tout un mois.
La conversation ayant tourné vers le Louvre, nous nous mîmes sur les Vénitiens. Son admiration de ce côté était absolue. Véronèse encore plus que Titien le passionnait. Je fus surpris de découvrir qu’il aimait moins les primitifs ; d’ailleurs il concluait toujours que quelque bon livre que fût le Louvre, il valait mieux s’en remettre à l’étude de la nature. Ce jour-là encore, il alla travailler à son aquarelle de la Sainte-Victoire ; je restai près de lui. Sa méthode était singulière, absolument en dehors des moyens habituels et d’une excessive complication. Il commençait par l’ombre et avec une tache qu’il recouvrait d’une seconde plus débordante, puis d’une troisième, jusqu’à ce que toutes ces teintes, faisant écrans, modelassent, en colorant, l’objet.
Je compris de suite que c’était une loi d’harmonie qui guidait son travail et que toutes ces modulations avaient une direction fixée d’avance, dans sa raison. Il procédait en somme comme ont dû l’observer les tapissiers anciens, faisant se suivre les couleurs apparentées jusqu’à ce qu’elles rencontrassent leur contraste dans l’opposition ; mais je sentis de suite qu’un pareil travail appliqué à la nature créait comme une contradiction, car toute formule de raison se plie bien plus librement et plus facilement à une création qu’à la nature même. Il eût fallu, pour suivre la nature avec la naïveté d’un enfant, n’avoir aucun parti-pris, agir sans délibération, observer et enregistrer sans plus. Or, sa méthode n’était point cela ; généralisant des lois, il en avait tiré des principes qu’il appliquait par une sorte de convention ; de telle manière qu’il ne faisait qu’interpréter, et non copier ce qu’il voyait. Son optique était donc bien plus dans sa cervelle que dans son œil. Tout cela je l’avais constaté sur ses toiles depuis bien des années ; mais me trouvant sur le naturel avec lui, je pus en acquérir la preuve décisive. En somme, ce qu’il faisait sortait absolument de son génie et s’il avait eu l’imagination créatrice, il eût pu se dispenser d’aller au paysage ou de poser de la nature morte devant lui ; mais il était dépourvu de cette imagination qui a distingué les plus grands maîtres ; ce qui faisait sa seule force était son intelligence unie à son goût.
« J’ai loué à Aix pour un mois, lui dis-je, pendant qu’il lavait avec soin et réflexion son aquarelle. ― Où donc ? demanda-t- il. ― Chez Mme de S. rue du Théâtre. » Il se trouva que c’étaient de ses amis. Il me fit l’éloge de cette maison.
Le soir je repris le tramway de Marseille, où mon cher maître me reconduisit encore. C’était l’heure du dîner et Mme Brémond, sa gouvernante, devait s’impatienter de ne pas le voir rentrer. Je lui promis de revenir le visiter sitôt que nous serions installés, « car, lui dis-je, je viens surtout pour vous ». Il me serra la main et s’enfuit vers son souper, pendant que le tramway s’ébranlait. Je le vis encore, sa pèlerine au vent, tourner, une rue.III
VIE EN SOCIÉTÉ À L’ATELIER ET CHEZ NOUSDeux jours après nous étions installés dans l’appartement que nous avait loué Mme de S… Cezanne nous avait invités chez lui dès notre arrivée, et m’avait offert, à son atelier hors la ville, la pièce du bas où se trouvait le paravent [R 1, 2, 3] ; mais, craignant de le déranger, je ne m’y étais pas rendu ; cela parce qu’un après-midi qu’il m’avait conduit dans son propre atelier, j’avais remarqué qu’après avoir disposé sa toile sur le chevalet et préparé sa palette il attendait que je m’en allasse. Et à cette question : « Je vous dérange, sans doute ? » il avait répondu : « Je n’ai jamais souffert que l’on me regarde travailler, je ne veux rien faire devant quelqu’un. » Il m’avait ensuite narré l’histoire des curiosités locales. Des gens qui se raillaient de lui, ayant su par les journaux ses succès à Paris, l’avaient recherché, avaient voulu rentrer dans sa vie et se mêler de son travail. « Ils croient, disait-il, en faisant de terribles yeux, que j’ai un truc et ils veulent me le chiper ; mais je les ai tous éconduits ; et pas un, pas un (et il devenait de plus en plus furieux) ne me mettra le grappin dessus. »
Voir travailler mon vieux maître était évidemment un de mes plus vifs désirs ; mais je n’insistai pas, et me retirai poussé dans la crainte des intrus qu’il me manifestait. J’étais venu à Aix rendre à Paul Cezanne un hommage de vingt années d’admiration. Je me souciais fort qu’il n’eût pas de doutes sur la sincérité de ma visite. Ce fut pour cette raison que je ne me rendis pas d’abord dans la salle qu’il avait mise à ma disposition, dans sa maison hors la ville. J’avais installé une nature morte dans notre chambre et j’y travaillais assidûment. Cezanne le sut et voulut venir la voir. Il était si persuadé de ce que Paul Alexis lui avait dit de moi sur la bonne recommandation du petit pointiste Signac, qu’il ne pouvait croire que je fisse de la peinture. Un jour, vers midi, il vint chez Mme de S… pour s’assurer que je n’étais pas qu’un « faiseur de biographies », et il parut étonné que je susse dessiner et peindre. Sa première exclamation fut que ce que je faisais était d’un peintre. « Vous êtes peintre, » me disait-il avec son accent méridional. Plusieurs choses ne lui plaisant pas dans ma toile, il me demanda ma palette et mes brosses pour y retoucher. J’étais fort curieux de sa correction, qui allait être pour moi la révélation de sa manière de faire. Lorsque je lui apportai ma palette, qui n’était chargée que de quatre couleurs et du blanc, il me demanda : « Vous peignez avec cela seulement ? ― Mais oui. ― Où est donc votre jaune de Naples ? Où est votre noir de pêche ? où, votre terre de Sienne, votre bleu de cobalt, votre laque brûlée?… Il est impossible de peindre sans ces couleurs. » Il était inutile de répondre, Cezanne en tout était absolu. Je n’avais sur ma palette que le jaune de chrome, le vermillon, le bleu d’outremer, la laque de garance, et le blanc d’argent ; et il me réclamait au moins vingt couleurs dont je ne m’étais jamais servi. Je compris de suite que, loin de procéder par beaucoup de mélanges, Cezanne avait des gammes faites sur sa palette pour toute une gradation de teintes, et qu’il procédait en les appliquant ; aussi il était si désorienté devant la composition si simple qui couvrait ma planche à peindre qu’il se mit en colère et le chevalet, mal équilibré, ayant cédé sous ses coups de pinceau emportés, il s’en fallut de peu que le tableau ne tombât à terre, couvrant le tapis de Mme de S… de sa gamme devenue exaspérée sous les corrections du vieux maître. « Vous ne pouvez pas travailler ici, me dit-il, c’est impossible ; il faut absolument que vous veniez à mon atelier, dans la chambre du bas. Je vous y attends cet après-midi même. » Nous avions, pendue au mur, une petite nature morte de Cezanne que j’avais achetée à Paris il y avait au moins quinze ans. Je la lui fis voir. « C’est bien mauvais, me dit-il. ― C’est de vous, répondis-je, et je la trouve fort bien. ― C’est donc ça que l’on admire aujourd’hui à Paris ? reprit-il, eh bien, il faut que le reste soit joliment bas ! » Cezanne n’aimait pas qu’on lui parlât de lui. Il me souvient qu’un jour ayant reçu de Bruxelles un catalogue relatant au moins vingt de ses toiles exposées, je le lui montrai il ne le regarda même pas et affecta de me parler d’autre chose. Il n’y avait aucune pose dans sa manière, mais seulement la certitude que ce qu’il avait fait jusqu’alors n’était que le commencement de ce qu’il produirait, s’il vivait encore longtemps. « Je fais tous les jours des progrès, me disait- il, l’essentiel est là. »
Je fus maintes fois très interdit de ce qu’il me montrait en m’affirmant qu’il était en progrès, car souvent je le trouvais inférieur à ce que j’avais vu de lui auparavant ; mais il avait son idéal, et sans doute il savait fort bien ce qu’il disait en affirmant cela. Il ne lui aura manqué, pour se justifier, que d’aller jusqu’au bout de son ouvrage. Comme il avait le travail très lent, il arrivait souvent que son tableau restait au beau milieu ; ainsi j’ai vu beaucoup de paysages, dans un galetas contigu à l’atelier qu’il avait au-dessus de chez lui, rue Boulegon, qui n’étaient ni des ébauches ni des études, mais seulement des gammes commencées et que le temps avait interrompues. Il y avait comme cela des quantités de motifs dont la toile n’était même pas entièrement couverte. On a eu le tort de juger Cezanne sur ces débuts, que lui-même abandonnait.
J’eus une idée de la lenteur de son travail lorsque je fus installé par lui dans l’atelier en dehors d’Aix. Tandis que j’étais à l’ouvrage d’une nature morte qu’il m’avait voulu arranger dans la salle du bas, je l’entendais aller et venir dans l’atelier du haut ; c’était comme une méditative promenade de long en large de la pièce ; il descendait aussi maintes fois, allait au jardin s’asseoir et remontait précipitamment. Je le surpris souvent dans le jardin avec un air fort découragé ; il me disait que quelque chose l’arrêtait. Alors nous regardions, droit devant nous, Aix, dans le soleil, levant la tour de son Église vers le ciel nous causions sur l’atmosphère, la couleur, les impressionnistes et les questions qui le tourmentaient ; le passage des tons.
Une fois je lui dis : « Pour moi, le passage du ton a son origine dans le reflet ; tout objet participe sur ses bords ombreux de son voisin. » Il trouva ma définition si excellente qu’il me dit : « Vous voyez juste, vous irez loin. » J’en fus fort satisfait, cela venant de celui que j’avais toujours reconnu pour mon maître. A propos des impressionnistes il me disait : « Pissarro s’est approché de la nature, Renoir a fait la femme de Paris, Monet a donné une vision, ce qui suit ne compte pas. » Il me disait surtout beaucoup de mal de Gauguin, dont l’influence lui paraissait désastreuse. « Gauguin aimait beaucoup votre peinture, lui dis-je, et il vous a beaucoup imité. ― Eh bien ! il ne m’a pas compris, répondait-il furieusement, jamais je n’ai voulu et je n’accepterai jamais le manque de modelé ou de graduation c’est un non-sens. Gauguin n’était pas peintre, il n’a fait que des images chinoises. » Alors il m’expliquait toutes ses idées sur la forme, sur la couleur, sur l’art, sur l’éducation d’un artiste : tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre, il faut s’apprendre à peindre sur ces figures simples, on pourra ensuite faire tout ce qu’on voudra. » Il disait encore : « Le dessin et la couleur ne sont point distincts ; au fur et à mesure que l’on peint, on dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude.
Les contrastes et les rapports de tons, voilà le secret du dessin et du modelé. » Puis il insistait en disant : « Il faut être ouvrier dans son art, savoir de bonne heure sa méthode de réalisation. Être peintre par les qualités mêmes de la peinture, se servir de matériaux grossiers. » Lorsque je lui parlais des impressionnistes, je sentais bien que, par bonne camaraderie, il n’en voulait pas dire de mal (combien cependant ils furent autres pour lui !), mais qu’il considérait qu’il fallait aller plus loin qu’eux. « Il faut redevenir classique par la nature, c’est-à-dire par la sensation, » affirmait-il. Quant à la critique, combien de fois il l’attaqua devant moi ; composée la plupart du temps de littérateurs ratés et impuissants, elle ne s’exerce que pour dénigrer le talent ou le génie que l’on n’a pas ou pour égarer, par des phrases en dehors de la question, la compréhension la plus saine. « Le littérateur s’exprime avec des abstractions, tandis que le peintre concrète, au moyen du dessin et de la couleur, ses sensations, ses perceptions. » Les deux modes étant différents, il s’ensuit l’incompréhension du peintre par l’écrivain, surtout dans le tissu des qualités propres à l’art mis en jeu. Aussi il concluait : « Travailler sans le souci de personne et devenir fort, tel est le but de l’artiste le reste ne vaut pas le mot de Cambronne. » En criant cela il relevait fièrement la tête, et je devinais qu’il l’avait toujours suivi si scrupuleusement que jamais la critique ne l’avait pris en considération. N’avait-il pas fallu, pour que son nom fût enfin connu, que la spéculation accaparât la majorité de son œuvre passée et en fît une sorte de marché ayant sa hausse et sa baisse ? Ainsi par un moyen ou par un autre le talent conquiert sa place. Lui, très en dehors de tout cela, n’avait même pas voulu s’en mêler. Un chargé d’affaires avait résolu cette question pour laquelle il ne se sentait aucune aptitude. Il n’avait même jamais songé que sa peinture pût se vendre, fût-ce en un temps fort lointain : « Mon père, qui était un intelligent et un bon cœur, s’est dit : Mon fils est un bohème qui mourra dans la misère, je vais travailler pour lui, et mon père m’a laissé de quoi faire ma peinture jusqu’à ma mort. C’était un petit chapelier qui coiffait toute l’aristocratie d’Aix, il avait la confiance de tous, il se fit banquier et réalisa une rapide fortune, car il était honnête et le monde venait à lui ; il est mort en nous laissant, à mes deux sœurs et à moi, d’honorables rentes. » Le souvenir de son père lui amenait les larmes aux yeux ; il l’avait trouvé sévère étant jeune, mais il avait enfin compris la sagesse généreuse qui le guidait.
Après ces conversations nous rentrions à nouveau du travail ou nous revenions ensemble à Aix déjeuner ou dîner ; le dimanche nous allions à la messe, il s’asseyait au banc de la Fabrique, et suivait attentivement l’office. Dès son arrivée dans un petit cloître qui précède la cathédrale, il était assailli par les mendiants ; ils le connaissaient et lui ne les oubliait pas. Il préparait des gros sous avant de quitter sa chambre et il leur en donnait à poignées en passant près d’eux. « Je vais prendre ma tranche de moyen-âge, me murmurait-il, près du bénitier. Les chants liturgiques, le développement de la pompe épiscopale lui plaisaient, c’était un souvenir de sa très pieuse enfance et aussi tout un éveil d’art en lui. Cependant sa présence à l’église n’était pas qu’une réjouissance artistique, il croyait et il s’abstenait de travailler toute la journée, allant aussi aux vêpres. Comme il se sentait joyeux d’avoir sanctifié le dimanche, il nous invitait tous chez lui. « Mme Brémond, disait-il avec beaucoup de politesse à sa bonne, faites-nous un bon déjeuner aujourd’hui. » On peut dire sans hyperbole que si Cezanne pensait aux autres en des accès de générosité peu commune, il s’oubliait lui-même. Il était si distrait qu’il se promenait son gilet ouvert ; le dimanche il allait à la messe vêtu de son mieux ; mais il lui arrivait souvent d’attacher le col de sa chemise avec une ficelle, en ayant perdu le bouton. Son chapeau, malgré un coup de brosse rapide, avait des bosses romantiques et sur son paletot s’égaraient quelques taches de peinture. A table il était fort gai, d’une gaieté que je ne lui soupçonnais pas, une gaieté pleine de cœur et presque ancienne par sa bonhomie franche et son abandon. En ces instants on pouvait connaître l’homme, indépendamment du peintre, et on en voyait toute la bonté.
D’autres fois il venait chez nous le soir ; nous nous plaisions à le recevoir de notre mieux. Durant le repas il s’arrêtait souvent de manger pour dire : « Cela me rappelle mon jeune temps, ma vie à Paris, » et si on touchait le piano il s’écriait : « C’est comme en 57, je suis redevenu jeune. Ah la bohème d’alors ! » En fait de musique Cezanne n’y entendait absolument rien. Il avait autrefois manifesté pour Wagner, ce pourquoi ce nom lui était sympathique ; mais il n’y discernait d’autre intention que du bruit imposant ou vivant. Il n’avait pas eu le temps de se livrer à autre chose que sa peinture. « Jusqu’à quarante ans j’ai vécu en bohème, j’ai perdu ma vie. Ce n’est que plus tard, quand j’ai connu Pissarro, qui était infatigable, que le goût du travail m’est venu. » Et il lui était venu si fort qu’il avait comme tout à coup creusé un gouffre en lequel il s’était englouti. Le jour de l’enterrement de sa mère il n’avait pu suivre le convoi parce qu’il devait aller au motif ; et pourtant nul ne l’aimait et ne l’avait pleurée plus que lui. Un soir que je lui parlais du Chef-d’œuvre inconnu et Frenhofer, le héros du drame de Balzac, il se leva de table, se dressa devant moi et, frappant sa poitrine avec son index, il s’accusa, sans un mot, mais par ce geste multiplié, le personnage même du roman. Il en était si ému que des larmes emplissaient ses yeux. Quelqu’un par qui il était devancé dans la vie, mais dont l’âme était prophétique, l’avait deviné. Ah ! il y avait loin de ce Frenhofer impuissant par génie à ce Claude impuissant par naissance que Zola avait vu malencontreusement en lui ! Aussi lorsque j’écrivis plus tard sur Cezanne pour l’Occident 2 je mis en épigraphe cette phrase, qui le résume bien en somme et qui le confond avec le héros de Balzac : « Frenhofer est un homme passionné pour notre art qui voit plus haut et plus loin que les autres peintres. »
On peut dire que Cezanne était la peinture vivante, car il n’y avait pas un instant où il ne se considérât comme le pinceau à la main. A table il s’arrêtait à chaque instant pour étudier nos figures selon l’effet de la lampe et de l’ombre ; toute assiette, tout plat, tout fruit, tout verre, tout objet qui était près de lui faisait le sujet de ses commentaires et de sa réflexion. « Quel roublard que ce Chardin avec sa visière », me disait-il. Puis il mettait son index entre ses deux yeux et balbutiait : « Oui, comme ça j’ai une vision nette des plans ! » Les plans ! c’était sa continuelle préoccupation. « Voilà ce que Gauguin n’a jamais compris, insinuait-il. Je devais aussi pour beaucoup prendre ma part de ce reproche et je sentais que Cezanne avait raison, il n’est pas de belle peinture si la surface plane reste plate, il faut que les objets tournent, s’éloignent, vivent. C’est là toute la magie de notre art.
À dix heures sonnantes je reconduisais mon vieux maître rue Boulegon. Nous nous arrêtions encore à parler dans les rues silencieuses visitées par la lune « La ville d’Aix est gâtée par l’agent-voyer, il faut se presser de voir, tout s’en va. Avec les trottoirs on a ruiné la beauté des vieilles villes ; la plupart des rues anciennes ne peuvent s’en accommoder ; et puis pourquoi des trottoirs dans des villes comme celle-ci ? deux ou trois rues en ont tout au plus besoin ! On pouvait laisser les autres comme elles étaient ; non, c’est une manie d’aligner, de déranger l’harmonie du temps. » Il se mettait alors en colère contre cet agent-voyer invisible, agitait sa canne, puis tombait tout à coup au mutisme, après avoir dit : « Ne parlons plus, je suis trop fatigué, je devrais être raisonnable, rester chez moi, travailler, travailler seulement. » Malade du diabète il se sentait souvent de ces soudaines faiblesses. Je l’accompagnais jusqu’à sa porte, et il rentrait après un serrement de main. En revenant seul par les voies désertes je pensais à sa mort. Je le voyais si vieux, si fatigué. Il me semblait que déjà passait devant moi son convoi ; il y avait peu de monde, et malgré mon désir d’y être, je n’y étais pas. La vie m’avait jeté ailleurs. Je n’avais pas été prévenu à temps… et c’est ce qui arriva, voici un an bientôt. En rentrant chez moi j’étais plein de tristes pensées : une vie entière consacrée, dans ce qu’elle a de sérieux et de sage, à la plus noble aspiration de l’homme civilisé, à l’art ; et pourtant le rire, le mépris, la fatigue, l’insatisfaction et la mort. La gloire se lèverait sans doute un jour, tardive, disputée, mettant au point l’effort constant de cette intelligence supérieure ; mais, surtout abominablement travestie par les spéculateurs, déformée par une critique jusqu’alors muette et à ce moment intéressée et vénale. Devant tant de tristesse et devant tant de néant une espérance me venait, comme une caresse, réveiller le cœur Cezanne était un croyant. Sans doute il trouverait dans un monde meilleur la récompense de sa vie offerte avec le sublime renoncement d’un volontaire martyre.
ÉMILE BERNARD.
(À suivre.) »
1 Paul Cezanne par E. Bernard, avec dessin-portrait de Camille Pissarro, chez Vanier, 19, quai Saint-Michel.
2 Voir le numéro de juillet 1904.
Bernard Émile, « Souvenirs sur Paul Cezanne et lettres inédites », Mercure de France, tome n° 69, n° 248, 16 octobre 1907, p. 606-627 :
« SOUVENIRS
SUR PAUL CEZANNE
ET LETTRES INÉDITES
(Suite 1)
IV
PROMENADES ET AVENTURES DIVERSESTanis que je peignais chez lui la nature morte qu’il m’avait arrangée dans la chambre du bas de sa maison hors la ville, Cezanne venait souvent causer des grands maîtres avec moi. Il avait les livres de Charles Blanc sur les écoles espagnoles et flamandes, et il les feuilletait assidûment. Malheureusement cet ouvrage est médiocre et les reproductions en sont plus que mauvaises. L’éditeur et l’auteur n’ont pu comprendre qu’ils auraient dû au moins s’adresser à de vrais artistes pour copier et graver les chefs-d’œuvre qu’ils voulaient reproduire ; mais là, comme en tout, en France, l’esprit de gain l’avait emporté sur l’esprit de vérité. J’étais outré de la déformation grotesque que ces gravures sur bois faisaient des tableaux des maîtres, c’était à n’y rien reconnaître. Cezanne, qui n’avait vu que le Louvre et ignorait la plupart des originaux, croyait à la sincérité de ces copies et il les admirait. J’arrivai ainsi à comprendre qu’il prenait pour véritables certains défauts introduits par le graveur ou le dessinateur copiste. Je lui fis part de mon opinion et il sembla en douter. Il aimait beaucoup le Louvre ; mais ce qu’il voyait surtout dans les tableaux, c’était la naïveté et la couleur. La naïveté, même ignorante, le séduisait par trop. D’ailleurs sa jeunesse s’était passée à feuilleter le Magasin Pittoresque, et souvent il s’était amusé à y copier des images. Un soir il voulut que j’allasse avec lui dans sa chambre afin d’y voir un tome qui contenait la gravure d’un Van Ostade 2, qui était pour lui l’idéal des désirs. Ce que je vis de beau dans cette chambre ce fut une aquarelle de fleurs de Delacroix, qu’il avait acquise de Vollard après la vente Choquet. Il l’avait toujours admirée chez son vieil ami le collectionneur, et il y avait souvent puisé de bonnes leçons d’harmonie. Il entourait cette aquarelle de très grands soins ; elle était encadrée, et pour éviter la décoloration de la lumière, il la tenait face au mur, à portée de la main. Sa chambre était fort simple, grande et claire, le lit était dans une alcôve, un crucifix se voyait juste au milieu du mur de cette alcôve.
Comme dans l’atelier traînait une nouvelle réimpression du traité d’anatomie de l’Académie des Beaux-Arts sous Louis XIV par Tortebat, dont les planches sont dites du Titien et que d’autres prétendent de Jean de Calcar [M. de Pilès, Abrégé d’anatomie, accommodé aux arts de peinture et de sculpture, mis en lumière par François Tortebat, Paris, chez Jean Mariette, 1733, ou autre édition], nous parlâmes des maîtres anatomistes. En cette science, Cezanne était peu versé, pourtant Lucas Signorelli avait toujours fait l’objet de son attention ; mais bien plus sous le rapport du style que sous celui de l’étude des muscles. Et c’était bien là ce qui l’embarrassait dans ses ouvrages d’imagination : il ne possédait pas la forme par le savoir et par l’habitude du modèle. Quiconque veut être maître en cette partie ne saurait trop faire pour apprendre, et je ne sais aujourd’hui, parmi les peintres, que Louis Anquetin qui soit capable de bâtir des figures de grandeur naturelle sans modèle et dans tous les mouvements possibles ; cela parce qu’il s’est plié à la patiente étude de la nature humaine, parce qu’il a disséqué avec soin pendant longtemps, et a consenti à se renseigner sur les insertions et les jeux musculaires. À l’heure actuelle, les peintres sont devenus si paresseux qu’ils adhèrent à leur affaiblissement par l’ignorance de cette partie de leur art, et ils traitent le nu de pratique, substituant l’habileté de la main et la ruse de l’escamotage au savoir réel par quoi un ouvrage peut espérer de durer.
La jeunesse de Cezanne avait été exclusivement de paresse et de littérature, il avait beaucoup peint en ce temps, il est vrai, mais jamais d’une manière assurée ; il se cherchait encore à travers Courbet et Manet. J’aime beaucoup pour ma part ce que je connais de ces moments-là, ce sont déjà des œuvres de vrai peintre ; mais la pâte en alourdissait souvent la forme qui, loin d’être aussi noble qu’il la trouva plus tard, était chargée de bosses à l’excès comme Daumier en avait la coutume. J’ai vu autrefois, chez le père Tanguy, le marchand de couleurs de la rue Clauzel, une femme nue couchée [R 140], qui, quoique bien laide, était un magistral morceau ; car cette laideur même avait la grandeur incompréhensible qui s’impose et qui a fait dire à Baudelaire :
Les charmes de l’horreur n’enivrent que les forts.
Étendue tout de son long, cette femme vraiment immense, et qui faisait songer, couchée sur son lit ouvert, à la Géante du poète plus haut cité, se détachait en lumière sur un fond de mur gris où une image naïve était collée. Au premier plan flamboyait une étoffe rouge jetée sur une chaise grossière. Outre cette femme couchée, je vis encore le portrait d’Achille Empéreire, peintre et compagnon de Cezanne. Je questionnai Cezanne plusieurs fois sur cet artiste qu’il semblait avoir aimé beaucoup et dont il m’avait montré une belle académie dessinée chez Suisse : « C’était un garçon d’un grand talent, me dit-il, et il n’y avait rien qui lui fût caché de l’art des Vénitiens. Je l’ai vu souvent les égaler. Dernièrement, on a vendu ici le mobilier d’un café où il y avait deux de ses toiles ; mais je n’ai pas su le jour de la vente. Je m’étais proposé pourtant de les acquérir ; je regrette beaucoup de les avoir manquées. » Le père Tanguy m’avait parlé autrefois de cet Achille Empéreire et m’avait raconté son existence misérable, car il ne recevait que quinze francs par mois de sa famille ; et il avait résolu le difficile problème de vivre à Paris à raison de cinquante centimes par jour. Sans doute la misère l’aura tué, car il est mort de langueur et d’épuisement, encore jeune [le 8 janvier 1898, à près de soixante-neuf ans]. Dans le portrait fait par mon vieux maître, il est représenté assis, en robe de chambre, dans un grand fauteuil ; ses mains maigres pendent sur les bras de ce meuble, sa robe entr’ouverte laisse voir de maigres jambes vêtues seulement d’un caleçon il a les deux pieds sur une chaufferette. Cezanne l’a peint tel qu’il était lorsqu’il venait de prendre son bain matinal. La tête, plus grande que nature, est belle et expressive, ornée de longs cheveux. La moustache et l’impériale ornent les lèvres et le menton, les yeux très grands, aux lourdes paupières, sont remplis de lassitude. Ce tableau avait été envoyé au Salon, probablement après la guerre, et refusé ainsi que la femme couchée. Je l’ai découvert sous un monceau d’autres toiles fort médiocres, chez Julien Tanguy qui m’en a conté l’histoire. Il devait le cacher de Cezanne, qui venait souvent chez lui, car il avait résolu de le détruire. C’est Eugène Boch, l’artiste belge qui s’est consacré aux paysages du borinage, qui le possède, à Monthyon, près Meaux.
Cezanne toute sa vie a rêvé l’entrée au Salon. Il a souffert toute sa vie d’avoir été refusé ; il parlait encore souvent de ce qu’il ferait pour le salon de Bouguereau. (Il se souciait peu que cet entrepreneur soit mort, pour lui rien n’avait changé.) Il avait en vue une Apothéose de Delacroix, et il m’en montra le croquis [R 746]. Le maître romantique était emporté, mort, par des anges ; l’un tenait ses pinceaux, l’autre sa palette. En dessous s’étendait un paysage dans lequel Pissarro, debout devant son chevalet, était sur le motif. A droite Claude Monet, et au premier plan Cezanne, arrivant de dos, pique à la main et carnier au côté, un vaste chapeau de Barbizon recouvrait son chef ; à gauche M. Choquet applaudissant les anges, et dans un coin un chien aboyant (symbole de l’envie selon Cezanne) représentait la critique. Il me fit l’honneur de vouloir remplacer M. Choquet par moi. Il fit même faire une photographie de mon individu dans la pose voulue à cet effet. Mais il mourut sans avoir accompli son œuvre.
Je ne pense pas que l’on doive beaucoup le regretter, car l’arrangement en était peu original et le temps qu’il y eût passé nous aurait sans doute privés des belles natures mortes qui feront toute sa gloire. L’imagination de Cezanne était pauvre, il n’avait qu’un goût très fin d’arrangement. Il ne savait pas dessiner sans le modèle, obstacle sérieux à toute création valide.
Je viens à propos de moi-même de parler de photographie. Cezanne n’était pas, à mon grand étonnement, ennemi qu’un peintre s’en servît mais pour lui il fallait interpréter cette reproduction exacte comme on interprète la nature. Il a fait quelques peintures de cette manière, il me les a désignées ; je ne m’en souviens plus.
Nous quittâmes bientôt l’atelier pour aller ensemble sur le motif. Il me conduisit en vue de la Sainte-Victoire et nous commençâmes là chacun une étude, lui à l’aquarelle, moi à l’huile. Comme nous en revenions, il se trouva que pour abroger un petit de chemin il me mena dans un endroit escarpé et très glissant.
Il marchait devant moi et je le suivais. A un moment le pied vint à lui manquer et il alla en arrière. Je me portai immédiatement pour le retenir. A peine eus-je mis la main sur lui pour cet office, qu’il entra dans une grande colère, jura et me maltraita, puis il courut devant, jetant de temps à autre des regards craintifs de mon côté comme si j’avais attenté à sa vie. Je ne pouvais absolument rien comprendre à cette conduite singulière. Il semblait se méfier maintenant autant de moi qu’il s’était déclaré de suite mon ami. J’en étais si troublé que je ne savais que faire.
Je connaissais depuis trop peu de temps mon vieux maître pour savoir toute la bizarrerie de son caractère. Comme je marchais loin derrière lui et qu’il pressait de plus en plus le pas, je m’étais résolu à ne pas entrer à l’atelier s’il m’en fermait le portail ; je devais continuer sur Aix, quitte à revenir le lendemain pour une explication. Il rentra dans la maison, en laissant toutes les portes ouvertes comme pour m’inviter. Je me rendis à cette invite, et je vins déposer, dans ma chambre de travail, ma boîte de couleurs. Alors que j’y étais, j’entendis ouvrir à grand fracas la porte de son atelier et un pas précipité secoua l’escalier, il surgit les yeux hors de la tête : « Je vous prie de m’excuser, je n’ai voulu que vous retenir de tomber. » Alors il jura affreusement et me fit peur par sa mine terrible, il balbutiait : « Personne ne me touchera… ne me mettra le grappin dessus. Jamais ! Jamais ! » J’avais beau lui représenter que mon acte avait été cordial et respectueux, que je voulais éviter qu’il tombât. Rien n’y fit. Il sacra et remonta dans son atelier en cognant si rudement la porte que la maison trembla jusqu’à sa base, puis j’entendis encore des « grappin dessus » pendant un instant. Alors je quittai t’atelier hors la ville, bien résolu à n’y pas revenir, mais le cœur navré et tout à fait ennuyé de cette affaire imprévue et imprévoyable. Je rentrai chez moi si attristé que je ne pus souper. Comme j’allais me mettre au lit, on cogna à notre porte. C’était Cezanne il venait voir comment j’allais de mon oreille (car j’avais pris mal dans une oreille depuis quelques jours). Il fut très aimable et sembla ignorer ce qui avait eu lieu quelques heures avant. J’en fus énervé que je ne pus dormir de la nuit, et le lendemain, en son absence de la maison d’Aix, je fus trouver Mme Brémond. Je lui racontai l’affaire et mon chagrin que Cezanne ait pu voir là un manque de respect de ma part. « Il n’a cessé de faire votre éloge hier toute la soirée, » me dit-elle ; « d’ailleurs ne vous étonnez pas de cela, il ne peut souffrir qu’on le touche. J’ai vu ici bien souvent des choses en ce genre avec M. Gasquet, un poète qui l’a beaucoup fréquenté. Moi-même j’ai ordre de passer à côté de lui sans le toucher, même de ma jupe. »
Comme je lui exprimais mon désir de quitter l’atelier hors la ville, elle me dit : « Vous auriez bien tort, cela lui fera beaucoup de peine ; il n’a cessé de me dire hier combien votre société lui est agréable ; vous êtes la seule personne avec qui il a pu s’entendre. » Vers onze heures, je revins chez Cezanne, en ville ; il était à son déjeuner. Je dis à Mme Brémond au bas de l’escalier : « Demandez à M. Cezanne s’il veut me recevoir ? » Mais avant qu’elle ne l’eût visité, comme il avait reconnu ma voix, il cria : « Venez, venez, Émile Bernard ! » et il se leva de table pour me recevoir. Je m’abstins, comme lui la veille au soir, de parler de l’aventure et de sa colère, il me dit : « Ne faites pas attention, ces choses m’arrivent malgré moi ; je ne puis souffrir qu’on me touche et cela date de loin. » Alors il me raconta une méchanceté que lui avait faite un enfant et qu’il n’avait pu oublier : « Je descendais tranquillement un escalier, quand un gamin qui se laissait glisser sur la rampe, et lancé à toute vitesse, en passant m’allongea un si grand coup de pied dans le cul que je faillis tomber ; l’imprévu et l’inattendu du choc me frappèrent si fort que depuis des années je suis obsédé que cela se renouvelle, au point que je ne puis souffrir l’attouchement ou le frôlement de personne. » Nous conversâmes de diverses choses, et naturellement de notre art, puis il m’invita à une promenade au château noir, un lieu qui me semblait très beau, d’après ses études.
Il vint nous prendre un après-midi de beau soleil avec une voiture qu’il louait à l’année pour se rendre, en cas de fatigue, sur le motif ou à son atelier hors la ville. Nous partîmes tous joyeusement, suivant une route qui se fit de plus en plus admirable enfin des bois de sapins nous apparurent ; alors il me fit descendre pour mieux voir les lieux, que nous explorâmes tous les deux. Malgré son âge il était d’une extrême agilité pour courir dans les rochers. J’observais de ne l’aider en rien ; quand il était dans une situation difficile, il se mettait à quatre pattes et marchait ainsi tout en causant : « Rosa Bonheur était une sacrée femme, me disait-il, elle a su se livrer toute à la peinture. » C’était le préambule d’un discours à propos des femmes peintres qui ont l’amour en tête beaucoup plus que l’art. Il voulait me décider à rester encore à Aix pour peindre avec lui dans cet endroit. Il me montra un Mas que l’on pourrait louer pour y déposer son bagage. Le lieu était vraiment surprenant d’imprévu et de sauvagerie ; mais je ne pouvais rester, devant installer les miens définitivement. Comme nous revenions, il parla de Baudelaire. Il récita sans se tromper « la Charogne » ; il le préférait à Hugo, dont la redondance et le grandiloque lui déplaisaient. Je m’arrête aux Contemplations, me dit-il ; la Légende des siècles par sa boursouflure m’ennuie et du reste je ne veux rien lire. » Baudelairien, Cezanne avait dû l’être lorsqu’il imaginait ces femmes nues singulières, allongées et fluettes à l’excès, qui se baignent ou fuient dans les bois. J’ai trouvé au revers même de l’Apothéose de Delacroix (l’esquisse dont j’ai parlé) les vers que voici et qui sont tout baudelairiens, quoique de Cezanne :
Voici la jeune femme aux fesses rebondies.
Comme elle étale bien au milieu des prairies
Son corps souple, splendide épanouissement ;
La couleuvre n’a pas de souplesse plus grande
Et le soleil qui luit darde complaisamment
Quelques rayons dorés sur cette belle viande.
En lisant cela je n’ai pu m’empêcher de songer à la grande femme nue couchée, et ces vers doivent être de ce temps. N’y trouve-t-on pas la couleur magnifique, la désinvolture galbeuse et un magistral sans-gêne qui brave le bourgeois, côté très romantique du caractère de mon vieux maître ?V
NOUS QUITTONS AIX, ET JE NE REVOIS CEZANNE QUE L’ANNÉE SUIVANTE. ― SA MORTUne palette ! telle la question captivante de la vie d’un peintre.
Voici comment était composée celle de Cezanne lorsque je le trouvai à Aix.
LES JAUNES. Jaune brillant.
Jaune de chrome.
Ocre jaune.
Terre de sienne naturelle.
LES ROUGES. Vermillon.
Ocre rouge.
Terre de Sienne brûlée.
Laque de garance.
Laque carminée fine.
Laque brûlée.
LES VERTS. Vert Véronèse.
Vert émeraude.
Terre verte.
LES BLEUS. Bleu de cobalt.
Bleu d’outremer.
Bleu de Prusse.
Noir de pêche.
Comme on le voit, la composition colorée est ici répartie selon le cercle chromatique et de la façon la plus étendue ; de telle sorte que, du blanc d’argent, qui en forme le sommet, jusqu’à la base, qui en est le noir, elle passe par une parfaite gradation des bleus au vert et des laques aux jaunes. Une telle palette a l’avantage de ne point pousser à trop de mélanges et de donner beaucoup de relief à ce que l’on peint, car elle permet les écarts du foncé et du clair, c’est-à-dire les contrastes vigoureux. Il n’en est pas de même de celle des impressionnistes qui, par son arrêt au bleu, crée l’impuissance du noir et aussi l’absence de chaleur dans l’ombre. On peut arriver à tout le relief désirable, il est vrai, avec le blanc et le noir seuls ; mais alors c’est au prix de l’absence de coloris. En adjoignant au blanc et au noir les trois couleurs primaires, soit le rouge, le bleu, le jaune, on se dirige déjà vers une gamme chantante, mais le grand nombre d’altérations que l’on fait subir à ces trois couleurs fondamentales leur enlève leur fraîcheur, et on perd alors en intensité et en éclat ce que l’on peut gagner en harmonie et en intimité. La palette de Cezanne est donc la vraie palette d’un peintre ; et celle d’un Rubens ou d’un Delacroix ne devait pas beaucoup en différer. Quant au mode d’emploi, il était de la part de mon vieux maître l’objet d’un très grand souci. Dans la nature morte que je fis chez lui avec toute la soumission possible à sa volonté afin de mieux connaître sa méthode, il me recommanda de commencer légèrement et avec des tons presque neutres. Ensuite il fallait aller en montant toujours la gamme et en serrant davantage les chromatismes. Comme je lui disais tout le désir que j’avais eu à dix-huit ans de le connaître et de me faire son élève, afin de le continuer, il me dit que certainement il avait besoin d’un continuateur, parce que, quant à lui, il ne se considérait que comme ayant ouvert le chemin. « Je suis trop vieux, je n’ai pas réalisé et je ne réaliserai pas maintenant. Je reste le primitif de la voie que j’ai découverte. » Alors je lui parlai de ses continuateurs prétendus qui à Paris réussissent si bien, avec si peu de qualités, à tromper le public étranger et surtout les Allemands. Il me dit « Tout cela ne compte pas, ce sont des farceurs. » Je ne fus pas surpris d’une parole si sage, car je savais bien que mon vieux maître avait avant tout l’amour de son art et se souciait peu de traîner à sa suite une queue déformatrice de factices élèves.
Cezanne était d’une conviction si absolue en ses idées qu’il avait des discussions terribles avec son ami Solari : « Un soir, m’a raconté sa servante, on vint me chercher, alors que j’allais me mettre au lit, tant on poussait de cris et l’on donnait de coups de poing sur la table, rue Boulegon. « Venez vite, me dit-on, on égorge monsieur Cezanne. » La fenêtre était ouverte, et lorsque j’arrivai en face de la maison, je reconnus les deux voix c’étaient celles de M. Solari et de M. Cezanne. Sachant les contradictions constantes des deux amis, je compris de suite qu’il s’agissait d’une discussion de peinture et non de crime. Je tranquillisai les personnes qui étaient attroupées dans la rue et m’allai coucher. Mon vieux maître me parla souvent de ce Solari, et me montra devant l’Université d’Aix un buste qui ne m’en donna qu’une opinion désavantageuse. C’était une célébrité locale, et par conséquent une médiocrité de province. La petite ville d’Aix d’ailleurs ne regardait point Cezanne autrement que comme un « toqué », et il va de soi que l’École des Beaux-Arts étant là-bas à l’ordre du jour, il n’en pouvait être autrement. Cezanne avait une haine si enracinée contre l’École qu’il avait une façon très spéciale de dire les « Bozards » qui, même à son insu, trahissait tout son mépris. Il suffisait qu’on eût passé par là pour être à ses yeux un crétin indécrottable. Il y avait dans l’esprit de mon vieux maître une méfiance exagérée pour certaines personnes et certains agissements humains qui devait contribuer à accroître sa misanthropie. Il me narra un jour le fait suivant : « J’avais un jardinier que j’employais depuis quelque temps ; il était père de deux filles, et quand il venait arranger mon jardin il me parlait toujours d’elles. Je feignais de m’y intéresser comme je m’intéressais à lui qui me semblait être un brave homme. J’ignorais donc l’âge de ces deux pucelles, je me les imaginais plutôt fort jeunes. Un jour il se présente chez moi planté de deux magnifiques créatures entre dix-huit et vingt ans et me les présente en me disant : « Monsieur Cezanne, voici mes filles. » Je ne sus comment interpréter cette présentation, mais j’ai beaucoup à me méfier des hommes, me sachant faible. Je fouillai dans ma poche pour ouvrir la maison et m’y enfermer, mais par un hasard inexplicable j’avais oublié ma clef à Aix. Ne voulant pas être exposé à jouer un rôle ridicule, je dis alors à ce jardinier : « Allez me chercher la hache dans le hangar au bois. » Il me l’apporta. « Veuillez, lui dis-je, enfoncer de suite cette porte. » Ce qu’il fit en quelques coups. Alors je pénétrai chez moi et je courus m’enfermer dans l’atelier. » Cezanne avait résolu de ne pas finir, comme la plupart des vieillards, dans le dévergondage sensuel. On le savait à son aise et il croyait (à raison ou à tort) que l’on tournait autour de lui pour le séduire et l’exploiter. Comme il vivait seul à Aix, quoique marié, il croyait qu’on en tirait la conclusion qu’il serait facile d’en avoir raison. Il se méfiait beaucoup de lui-même se déclarant faible. Un jour, en sortant de l’église, il me dit : « Avez-vous vu Mme X…, comme elle s’était plantée devant le bénitier, en m’attendant ? Elle avait auprès d’elle ses enfants. C’est une veuve. J’ai compris ce que cela voulait dire, à son regard. » De toutes ces histoires il concluait : « C’est effrayant, la vie ! » En vérité, il en avait aussi peur qu’un moine. A Paris, son seul ami avait été un ouvrier cordonnier : « Ce pauvre homme avait une femme indigne, qui lui faisait des enfants dans tous les coins avec le premier venu. Il les acceptait et il les aimait, sans aucune bassesse de cœur, car il ne tirait rien de ces mœurs de la dame, sauf la raillerie des sots. Il redoublait de travail pour nourrir tout ce monde. Je l’aimais tant qu’en déménageant de la maison qu’il habitait avec moi, je lui ai donné tous mes tableaux. » Sa sœur, Mlle Marie Cezanne, que je n’ai jamais eu l’honneur de saluer, était sa chargée d’affaires ; elle administrait le ménage, donnait l’argent pour la semaine, réglait les notes des fournisseurs. Elle s’acquittait de tout cela avec la plus dévouée affection ; de plus, comme elle était bonne chrétienne, elle avait sur lui une excellente action morale. « J’ai envie de me confesser, me dit Cezanne un soir ; ma sœur me recommande à un jésuite, qui est un homme supérieur. » Il m’en parla longuement et je l’engageai à rentrer dans la pratique de la foi. Il en avait un peu peur, il craignait encore le « grappin ». « Les prêtres pourraient me mettre le grappin dessus. Voilà ce que je ne veux pas. » Je lui persuadai que c’était un préjugé et il en convint. D’ailleurs, il pourrait toujours se rendre libre. Il alla donc voir le père jésuite en question et en revint enchanté. « Ces gens-là sont très intelligents, me dit-il, et ils comprennent tout. » Quelque temps après je crois qu’il reçut le Saint-Sacrement. « Pourquoi ne peignez-vous pas un Christ ? demandai-je à Cezanne, que j’étais heureux de trouver si croyant ? Je n’oserais jamais, me répondit-il. D’abord, cela à été fait mieux que par nous, et puis ce serait trop difficile. »
En vérité, il y trouvait bien des choses à exprimer et cette tâche serait devenue pour lui comme une abstraction à laquelle il ne se sentait pas destiné. Il est mort, je suppose, sans avoir tenté de réaliser cette proposition. J’avoue, pour ma part, qu’un croyant ne devrait pas hésiter à mettre ses pinceaux au service de sa Foi et surtout de son Dieu. Aussi, je ne compris jamais la réponse de Cezanne.
Nous allâmes ensemble au Musée d’Aix voir quelques toiles de Granet et deux ou trois salles de maîtres anciens. Il aimait la peinture de Granet, et il était indulgent à l’excès pour ce peintre plutôt médiocre ; peut-être en raison des jeunes années. Me montrant le Martyre d’une Sainte, par Matteo Preti dit le Calabrais [Aix-en-Provence, musée Granet], il s’extasia : « Voilà comment je rêvais de peindre autrefois. » Cette peinture vigoureuse, espagnole plutôt qu’italienne, lui faisait un excessif plaisir. Nous regardâmes encore des portraits dans la manière de Largillière, des compositions de l’école de Fontainebleau et une tête d’enfant de Greuze, ravissante de finesse.
Mais la date de notre départ d’Aix approchait. Je voyais avec déplaisir décroître les jours qui me restaient à passer auprès de mon vieux maître. N’osant lui demander de poser pour moi, je fixai ses traits, de mémoire, sur une toile, et je fis dans son atelier, la veille de notre mise en route, deux photographies de lui. Lui-même parut ennuyé de notre départ, il fit un dessin de nous, me donna un croquis pour me rappeler la pose que j’aurais dans l’Apothéose de Delacroix (cela pour lui envoyer une nouvelle photographie, car la première était manquée) et il me fit promettre de revenir, pour aller avec lui dans les sapinières du château noir. Il nous mena à la gare et attendit que le train s’ébranlât pour retourner à son travail. En le perdant de vue, nous sentîmes quelques larmes en nos yeux. Le reverrions-nous jamais ! Et dans quelle solitude d’absolu il allait se retrouver maintenant, car personne autour de lui ne le comprenait, et nous étions peut-être, après les siens, les seuls à l’aimer vraiment.
Voici les quelques lettres que je reçus après notre départ et jusqu’en novembre 1904, date à laquelle nous nous remîmes en route pour Naples, sans pouvoir passer par Aix. […]§
Nous résolûmes de quitter Naples par mer et de nous y embarquer pour Marseille, afin d’aller voir Cezanne. Nous en causions souvent et nous avions un vif désir de renouveler une visite, qui pourrait être la dernière, car la maladie semblait l’accabler et surtout chaque été lui devenait insupportable, rapportant des troubles cérébraux qu’il accusait lui-même.
Nous prîmes donc la mer par un bel après-midi de fin mars sur un fort bateau venant de Grèce et portant un millier de passagers. Nous eûmes un beau temps jusqu’au soir, mais comme nous venions de doubler la Corse un violent mistral nous prit à l’avant et nous fit passer une nuit aussi dangereuse qu’épouvantable. Quand nous fûmes en vue de Marseille, il faisait grand soleil, mais le vent soufflait si fort qu’on ne pouvait distinguer que quelques éminences. Tout le reste était englouti par un véritable simoun. Au-dessus de nos têtes les cordages chantaient comme des tuyaux d’orgue. On ne put nous entrer au port et nous débarquâmes à l’Estaque, dans des chaloupes. Le voyage avait été si rude que je dus remettre au lendemain ma visite à Cezanne. Du plus matin je partis et je fus à Aix de bonne heure. J’allai le surprendre à son atelier hors la ville. Il parut heureux de me revoir (je ne l’avais pas averti) et me montra ses derniers travaux. Je vis avec plaisir accrochée dans son atelier une étude de paysage que j’avais faite l’année d’avant de la chambre du bas et représentant la belle vue sur Aix qu’on y avait. Les têtes de mort étaient clouées au mur, abandonnées. Il me montra les femmes nues de l’année précédente, guère plus avancées, malgré un travail obstiné ; plusieurs avaient changé de mouvement, la couleur s’était épaissie sous les couches successives. Il prit des nouvelles des miens, puis me dit : « Paul et ma femme sont ici. Vous allez déjeuner avec eux, n’est-ce pas ? » Il semblait très heureux de me présenter à son fils dont il m’avait toujours fait l’éloge. « Il a tout ce qui me manque, c’est un homme supérieur. » Nous allâmes rue Boulegon. Mme Brémond était affairée à préparer le déjeuner. Je fus présenté à Paul Cezanne fils par son père et à Mme Cezanne. Le repas fut très gai, Cezanne était fort loquace. La vue de son fils lui faisait un grand plaisir ; il s’arrêtait à tout instant à le considérer et il s’écriait : « Paul, tu es un homme de génie ! » Vers une heure de l’après-midi une voiture roula dans la rue endormie de soleil et Mme Brémond vint nous annoncer que c’était le fiacre pour aller « au motif ». « J’étais un peu fatigué, alors j’avais commandé la voiture ; mais puisque vous êtes là, me dit-il, rien ne presse. » Il fit attendre. Puis comme le repas se terminait il donna ordre de renvoyer le cocher, car il avait tout à coup résolu de venir à Marseille voir « le restant de la famille ». On se dirigea vers le tramway, dans lequel, durant deux heures, par une torride chaleur, nous causâmes gaîment. Je fus charmé de l’air radieux de Cezanne, de sa bonne mine et de l’abandon auquel il se livrait. Il parla de Puget : « Je comprends, il y a du mistral dans Puget. C’est lui qui agite le marbre. » C’était le vent qui soufflait ce jour-là qui lui donnait cette idée. « Il y a longtemps que je ne suis pas allé à Marseille, me dit-il, je suis toujours au travail ; mais je veux y aller saluer Mme Bernard. » J’étais très ennuyé qu’il prît cette peine à cause de sa santé. Le voyage pourrait le fatiguer beaucoup ; mais il tenait à le faire. Nous arrivâmes à Marseille assez tard, il baisa la main de ma femme, prit les petits sur ses genoux, puis, comme l’heure était venue de gagner notre train pour Paris, il voulut nous mener jusqu’à la gare. Son fils, aimablement chargé des enfants, et lui veillant à tout, nous atteignîmes nos wagons. Alors un sifflet coupa nos conversations, et je me sentis tout triste. Une dernière poignée de main, et nous partîmes, laissant mon vieux maître et son fils sur le trottoir de la gare de Marseille. Ce fut là notre dernier adieu.
Voici encore les fragments de quelques lettres reçues après ce second voyage à Aix. […]§
Voici environ un an, comme j’étais en train de peindre dans mon atelier de la rue Cortot, à Montmartre, mon ami Louis Lormel entra et me dit : « Cezanne est mort. Je viens de le lire dans le Journal. » Ce ne fut que huit jours après son enterrement que je reçus le billet suivant :
Vous êtes prié d’assister aux obsèques de
PAUL CEZANNE
Décédé à Aix, en Provence, muni des sacrements de notre Sainte Mère l’Église, le 23octobre 1905 [sic], à l’âge de 68 ans.
Je sus, par Charles Guérin, qu’il était tombé en travaillant (ç’avait été, comme le disent ses lettres, son constant désir). Malgré ma peine extrême je fus heureux de constater que mon vieux maître était mort dans la foi ; je crus donc devoir faire dire, par les soins de la Rénovation Esthétique, une messe basse pour le repos de son âme. La plupart de nos collaborateurs y assistaient, et parmi eux le peintre Maurice Denis 3, dont la présence me fit particulièrement plaisir.§
J’ai narré ici tout ce dont je me souviens présentement concernant Paul Cezanne ; le voici disparu d’entre nous, ne laissant qu’une œuvre qu’il accusait sans cesse de ne pas représenter toute sa pensée et que d’autres disent avortée. Mais malgré le jugement trop sévère de mon vieux maître sur lui-même, malgré l’incomplet qu’accusent un peu hâtivement les peintres et la critique, je pense que c’est un monument durable élevé par son travail à sa propre gloire que les dix ou quinze natures-mortes et paysages achevés que nous avons de lui. Il y a là un fonds solide de belles tonalités, de matières à leur place, de qualités locales, une harmonie singulière et un œil bien organisé pour lire les chromatismes, qu’il nommait « sensations colorantes ». Il faut laisser, comme n’ayantpas été mises dans le public par lui, les ébauches. Certes, tout ce qui vient d’un rare artiste comme il le fut est intéressant ; mais on ne saurait le juger entièrement sur des travaux interrompus. Cezanne avait l’exécution fort lente, il y apportait de plus une extrême réflexion. Il n’a jamais donné une touche qui ne fût pas longuement pensée. C’est, malgré l’apparent déséquilibre de ses toiles, la solidité qui les fera durer. Il a su et voulu ce qu’il a fait. Toutefois il faut séparer ses maladresses, ses bizarreries, ses naïvetés parfois grossières de ce qu’il a de meilleur. Chez lui l’extrême distinction de l’œil se cache souvent sous l’apparence vulgaire de la forme ; s’il peint un paysan, il le fait terrible ; mais s’il ne nous séduit pas par la forme, il a le secret de donner souvent à notre rétine des sensations raffinées. Puisqu’il ne s’attachait pas à rendre l’esprit des choses, mais leur charme coloriste. leur matière. Il faut surtout le prendre dans la nature morte. Il avait besoin de temps pour pousser, et il le trouvait devant des crânes, devant des fruits verts ou des fleurs de papier. C’est dans ce genre qu’il a le mieux dit ce qu’il pouvait. Ceci ne veut toutefois pas signifier que ses paysages et ses figures soient à rejeter, car j’en sais de tout à fait rares en leur solide beauté ; mais je crains que là, souvent, on s’aheurte à des parties qu’il n’a pu parfaire faute du temps ou du modèle, faute aussi de sa santé.
Le défaut dont avait le plus à se plaindre Cezanne était celui de sa vue. « Je vois les plans se chevauchant, me disait-il, et parfois les lignes droites me paraissent tomber. » Ces défauts, que je croyais des négligences volontaires, il les accusait comme des faiblesses et des vices de son optique. De là sa préoccupation constante de trouver un moyen de bien voir les valeurs. Il parlait souvent des bésicles et de la visière de Chardin, comme remède ; mais il ne s’en servit jamais.
Il me reste à parler des honteuses imitations faites de ce maître, des difformités commises en son nom, de l’incompréhension totale des intéressés pasticheurs. Ceux qui l’ont compris doivent être loués. Mais combien sont-ils ? Combien sont-ils qui ont consenti à étudier cette œuvre et à y voir autre chose que des anomalies ? C’est ainsi qu’il est devenu de mode de mettre les compotiers de travers, d’imiter des serviettes de bois, de n’avoir point d’aplomb dans un verre et de heurter des pommes plates sur des fonds à fleurs. Les uns n’ont vu en Cezanne que brutalité, ignorance, gaucherie, tons ardoisés, gâchis de pâte, et se sont évertués à ces désastreuses illusions ; les autres n’ont considéré en lui qu’un révolté et ont rêvé de l’être encore davantage ; bref, peu ont vu sa sagesse, sa logique, son harmonie, la douceur de son œil, sa recherche des plans, son relief et son désir de réalisation se rapprochant de la nature, « car il faut de l’imitation et même un peu de trompe-l’œil, me disait-il, cela ne nuit pas si l’art y est. » Il résulterait donc que, si Cezanne avait été compris, nous aurions aujourd’hui moins de croûtes dans les vitrines à la mode qui se réclament de l’art de l’avenir et qui ne sont que les ténèbres du présent, et qu’il y aurait plus d’artistes vrais, humbles, sincères, persuadés de l’immense difficulté de la tâche qu’ils se sont assignée et qui condamne déjà leur indignité. Je crois, pour ma part, qu’il résultera de l’influence de mon vieux maître, si elle parvient à être découverte, un retour vers les Grands d’autrefois, uni à l’amour de la vérité objective, et que sa phrase coutumière s’accomplira : « Il nous faut redevenir des classiques 4 par la nature. » Cezanne est un pont jeté au-dessus de la routine, par lequel l’impressionnisme retourne au Louvre et à la vie profonde.
Septembre 1907.
ÉMILE BERNARD.
1 Voy. Mercure de France, n° 247.
2 Il me parlait aussi beaucoup des frères Lenain.
3 Auteur d’un « Hommage à Cezanne ».
4 Classiques ! Un mot aujourd’hui souvent employé à tort et à travers. Je veux le définir, du moins en ce cas : « Classique signifie ici : qui est en rapport avec la tradition. Ainsi Cezanne disait : « Imaginez Poussin refait entièrement sur nature, voilà le classique que j’entends. » Il ne s’agit pas en effet de terrasser les Romantiques, mais de retrouver ce que les Romantiques eux-mêmes avaient : les règles des grands maîtres. Toutefois l’apport à faire est une plus ample observation de la nature et en quelque sorte de tirer son classicisme d’elle plus que des recettes d’atelier. Car si les lois de l’art sont fécondes, les recettes d’atelier sont meurtrières, et ce n’est qu’au contact de la nature, et par une constante observation de celle-ci, que l’artiste est créateur. »
Rivière Georges, Le Maître Paul Cézanne, H. Floury éditeur, Paris, 1923, 243 pages, p. 196, 222 :
« Paravent. Peint sur les deux faces. Exécuté à Aix pour le cabinet de travail de M. Cezanne père et à la confection duquel Émile Zola a collaboré. [FWN560-R001][…]
Trois têtes de mort. Représentées sur un tapis ; peinture exécutée à Paris, rue Hégésippe-Moreau. [FWN875-R824] »
Provence Marcel, « Cézanne et la jeunesse. La fin d’une légende », Le Mémorial d’Aix, journal politique, commercial, littéraire et mondain, 75e année, n° 87, jeudi 31 octobre 1912, p. 1 :
« Cezanne et la Jeunesse
La Fin d’une Légende
Les journaux de Paris qui ont une chronique artistique, Gil-Blas, Paris-Journal, Comœdia, ont publié l’écho suivant :
« Le 23 octobre, jour anniversaire de la mort de Paul Cezanne, Les Quatre-Dauphins ont déposé sur sa tombe à Aix-en-Provence des lauriers de son atelier des Lauve. »
Si je crois de mon devoir de reprendre cette note ici, ce n’est pas pour tenter du battage pour une revue qui m’est chère : c’est pour mettre fin à une légende tout à fait indigne du caractère artiste et poli de notre ville. Cette légende que j’ai trouvée dans le Mercure de France et nombre de revues d’art prétend que Cezanne sortant dans les rues d’Àix était suivi d’une bande de gamins qui se moquaient de lui et qui, sous l’œil paisible des passants lui lançaient des pierres. M. Émile Bernard, lui-même, qui fut l’ami de Cezanne et de Van Gogh, l’a recueilli dans ses passionnants souvenirs sur Paul Cezanne :
« Dans la rue, dit-il, des gamins se moquaient de lui et lui jetaient des pierres ; je les écartai. Pour ces enfants, l’allure de brigand qu’avait Cezanne était une autorisation au sarcasme. Il devait leur apparaître comme une sorte de « père fouettard ». Je souffris bien souvent, plus tard, des méchancetés que les petits gamins semaient sur son passage et des espiègleries dont il était le but.
Eh bien, non ! M. Bernard, vous ne ferez jamais croire cela. Les allures de père fouettard de Cezanne ne devaient pas plus exciter nos gamins que les tenues bizarres de nombre de ses contemporains aixois ; on m’a parlé d’un certain Emperaire autrement pittoresque et de certains autres dont je tairai les noms et qui eussent bien plus éveillé la malignité de nos bambins que l’inoffensif Cezanne.
Je connais trop nos gamins et leurs parents pour croire à la légende recueillie par vous. D’ailleurs tous ceux qui ont connu Cezanne m’ont affirmé que jamais le pire de nos voyous ne lui lançait un caillou. Écoutez-moi bien, mon cher critique, et avec vous, vos collègues de.la critique d’art ; parisienne, la persécution de Cezanne me fait l’effet de la misère de Fabre ; c’est une légende échafaudée dans les ateliers parisiens comme la misère de Fabre dans les bureaux de certains quotidiens.
C’est pour cela que j’ai participé au geste des jeunes aixois désintéressés allant cueillir dans le glorieux jardin de l’atelier des Lauve, des branches de lauriers et les portant simplement, au jour anniversaire de sa mort, sur la tombe du maître.
Les jeunes gens que nous sommes et qui auraient pu être les gamins d’hier, ont tenu à rendre public ce geste, pour tuer l’odieuse légende.
Déjà un proche ami de mon voisin Sextius avait protesté dans l’excellent almanach défenseur des gloires aixoises, Lou Cadet d’Ais. Maintenant c’est dans la presse de Paris où cette légende vit encore, que nous avons voulu la toucher.
***
Le geste collectif des jeunes aixois, admirateurs de Cezanne, doit marquer la ruine d’une légende en contradiction avec les traditions la vie et l’âme de la cité.
Marcel PROVENCE. »
Bernheim de Villers Gaston [Gaston Bernheim-Jeune], Un ami de Cézanne, éditions Bernheim-Jeune, Paris, 1954, 38 pages, p. 29 :
« Ses dernières années sont les plus douloureuses de sa vie. On était encore sous le coup de l’affaire Dreyfus. Son ami Zola y avait pris la défense de l’innocent accusé. Tout seul, il faisait face à la meute hurlante et déchaînée. À Aix, on savait la position que Zola avait prise et tout le monde là-bas avait mêlé le pauvre peintre à ce procès retentissant.
Ce vieillard sans défense était insulté dans la rue. Il n’osait plus passer sur le Cours Mirabeau de peur d’être hué ou lapidé par les enfants. Le reste de sa famille se tenait à l’écart ; vêtu d’habits râpés, il ne comprenait pas cette haine contre lui. Il en souffrait beaucoup, ce fut pour lui un moment crucial. »
Vivès-Apy Ch., « Pages d’album. Le peintre Aixois Cezanne », Le Mémorial d’Aix, journal politique, artistique et littéraire, 74e année, n° 14, jeudi 16 février 1911, p. 1 :
« Pages d’Album
Le Peintre Aixois Cezanne
Nos lecteurs liront avec intérêt quelques passages d’un article que consacre à notre concitoyen Cezanne, M. Vivès-Apy peintre de talent et critique avisé :
Comment, vous aimez les peintures de Cezanne ? Mais c’est tout bonnement horrible, grotesque et de fort mauvais goût. Généralement votre interlocuteur vous avoue naïvement qu’il n’a jamais vu.de toiles du maître, qu’il ne s’est jamais préoccupé de sa vie, de ses recherches et qu’il n’a jamais songé à aller voir aux portes de notre grande cité, ce que cet homme probe et loyal aimait.
Pour les bourgeois d’Aix, Cezanne passait volontiers pour fou. Il vivait solitaire, tout ardent à son travail, dévotement à son amour de la nature. Il fuyait les méchants, les gens de la ville, les malins, comme il disait ; se renfermait dans ses raisonnements acquis devant l’honnêteté des pierres du ciel et des arbres : il était tout d’une pièce, comme eux.
Assez grand, un peu vouté, avec une barbiche envahissant parfois les joues et une moustache blanche, le front élevé, le crâne chauve, il avait l’aspect d’un vieux soldat assez maltraité par la vie de garnison. Le matin on ne le voyait guère qu’à l’heure du déjeuner, car il était parti dès l’aube pour aller au travail.
L’après-midi, il reprenait le chemin de la banlieue, à pied presque toujours, parfois dans un fiacre.
Le soir, il se couchait avant que la table fut levée, il n’allait jamais dîner en ville, il ne recevait jamais. Depuis longtemps les gens d’Aix s’étaient mis d’accord sur son compte. Cezanne passait pour un fou. Il avait l’air traqué, cherchant les rues les moins passagères, faisant des crochets brusques, pour échapper aux survenants. Les polissons de la ville le connaissaient bien. Ils le poursuivaient, lui jetaient des pierres. Cezanne s’éloignait aussi vite que lui permettait l’enflure de ses vieilles jambes.
Mais son itinéraire, identique tous les jours, de la maison de ville à la maison de campagne, de la maison de campagne à l’atelier, de l’atelier à la maison de ville, le leur livrait.
Très rarement, on le rencontrait dans les rues d’Aix, poudreuses l’été, durcies par le mistral l’hiver et toujours blanches, avec un jeune homme inconnu qui ne ressemblait pas à tout le monde. Parce qu’on savait vaguement que le vieux rentier s’amusait à faire de la peinture, on supposait que le jeune homme était un peintre venu de Marseille pour le voir. Ces jours-là, son allure changeait. Il parlait beaucoup avec de grands gestes, il s’arrêtait en marchant, éclatait en jurons furieux.
Pour les habitants d’Aix, sans doute, les intonations méridionales de sa voix ne s’accentuaient pas davantage, mais son compagnon qui venait, en général de beaucoup plus loin que de Marseille, en recueillait avec attendrissement la musique innocente, et les sonorités qui soulignent la vigueur des épithètes. Quelquefois, on le voyait quitter brusquement le jeune homme et s’enfuir en mâchonnant des mots rageurs… Il avait ainsi de longs silences d’une année, de brusques expansions d’une heure, des sautes d’humeur et d’allure que personne ne comprenait. C’était un vieillard sauvage, candide, irascible et bon. Zola disait de lui : « il est fait d’une seule pièce raide et dure ; sous la main ; rien ne le plie, rien ne peut en arracher une concession.
Il partagea la vie de réprouvés des peintres de son époque qui eurent la hardiesse de revenir aux sources de la beauté du monde sans regarder en arrière et sans consentir à voiler leurs découvertes sous des concessions d’apparence qui eussent assuré leur succès. Refusé chaque année au salon, en compagnie de Pissaro, de Monet, de Silsen [Sisley ?], il fut celui d’entre eux, avec Renoir, qui apportait comme lui dans cette association de malfaiteurs des préoccupations de traditionalisme et de compositions dépassant l’impressionnisme et finissant même par combattre le principe fondamental qui lui donnait son nom, à exciter le plus de rires, d’injures, d’imbéciles plaisanteries.
« Peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser des sensations. » Voilà ce que pouvait Cezanne, et il ne put jamais peindre autrement que sur le motif ; comme les impressionnistes, il était né d’une génération trop inventive pour ne pas éprouver avec eux l’impérieux besoin de redemander au monde sensible tous les prétextes à s’exprimer. Son choix ne s’exerçait jamais sur un grand nombre d’objets pour dégager d’eux le type supérieur d’harmonie dont il désirait l’existence. Il s’emparait d’un objet quelconque, sans nul souci de sa laideur, de sa beauté, et c’est alors que commençait son choix. L’objet prenait un caractère tel d’unité et de force expressive, qu’il s’imposait comme une loi. Du monde interrogé sortait une synthèse où les sommets nus de l’idée frappent l’esprit comme la rime à l’extrémité du vers. Jamais l’ombre d’une anecdote. Pas une concession.
Aucun effort pour intéresser ou plaire. C’était un peintre pur que les faits n’intéressaient pas et qui ne saisissait dans le monde que quelques généralités, l’organisant pour lui selon des harmonies impitoyables. Jamais on n’accepta toute la vie visible avec une si complète indifférence pour la transporter dans la vie de l’esprit avec une si sobre splendeur. Il retrouvait dans les auberges de la campagne aixoise, dans les rues pauvres, chez lui, partout, les rapports d’éternelle gloire que les Vénitiens, ses maîtres, demandaient au ruissellement des velours et des soies brochées dans les palais de marbre et l’espace d’ambre et d’argent qui tremble sur la poitrine des femmes nues.
À Aix, on est un peu revenu, maintenant sur la première opinion et, aujourd’hui, on y prête même quelque talent et quelque probité au maître provençal. À l’étranger, à Paris, Cezanne est compris, admiré, vénéré. Ici, on rit facilement sur tout.
Cet art dépassant les formules de notre éducation a pu surprendre. L’approfondir sincèrement est de l’évolution saine. Cezanne n’était pas plus fou que Monticelli et, comme lui, dans une recherche aussi puissante, aussi personnelle, mais dans un art différent, il restera comme un exemple de génie en compagnie de maîtres anciens.
Ch. Vivès-Apy. »
Mack Gerstle, La Vie de Paul Cézanne, Paris, Gallimard, « nrf », collection « Les contemporains vus de près », 2e série, n° 7, 1938, 362 pages, p. 268 :
« Maxime Conil, le beau-frère de Cézanne, ajoute une autre histoire qui illustre l’excessive timidité du peintre. Il avait une fois retenu un modèle professionnel pour poser dans son atelier à Paris. Comme cette femme avait une longue expérience, elle se déshabilla devant lui sans la moindre honte, mais à mesure qu’elle retirait ses vêtements, Cézanne se sentait de plus en plus gêné. Enfin, le modèle, tout à fait nu, s’assit près de lui et dit : « Monsieur, vous semblez troublé… » ; ce qui ajouta à la confusion de Cézanne. Il essaya de se reprendre et de commencer son tableau, mais en vain ; peu après, il laissait tomber ses pinceaux, disait à la femme de se rhabiller et la renvoyait avec l’ordre de ne pas revenir. »
18 février – 5 mars
Un tableau de Cézanne est présenté à la galerie des Collectionneurs (L. Soullié), Exposition des tableaux par Paul Cirou et quelques autres :
Paysage. 80 x 100 cm, signé. [FWN221-R537 ?].
Hypothèse de Feilchenfeldt Walter, Warman Jayne et Nash David, The Paintings of Paul Cézanne. An online catalogue raisonné, http ://www.cezannecatalogue.com/exhibitions/.
« Concours et expositions. Expositions nouvelles. Paris », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 8, 20 février 1904, p. 68 :
« Exposition de tableaux de M. Paul Cirou, de peintures, céramiques et sculptures de Paul Gauguin, etc., galerie Soullier, 338, rue Saint-Honoré jusqu’au 5 mars. »
20 février – 24 mars
20e Exposition de la Société des Artistes indépendants, aux Serres du Cours-la-Reine, à laquelle Cézanne ne participe pas, mais dont l’influence se fait sentir chez de nombreux artistes.
Marx Roger, « Le Salon des Artistes indépendants », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 9, 27 février 1904, p. 70-72, Cézanne p. 71 :
« Les doctrines de certains d’entre eux ne laissent pas d’offrir des points de rapport avec celles qu’ont professées d’autres maitres : Seurat se rapproche à plusieurs égards de M. Fantin-Latour ; entre Gustave Moreau et M. Paul Cezanne, il y a accord sur le principe de la belle matière comme sur la recherche du ton pour le ton, et tous deux apportent à se réclamer de Poussin la même ferveur. En somme, l’évolution de l’école se poursuit normalement, logiquement, dans un sens déterminé et avec le concours de talents formés dans des milieux très divers.
[…] Plus étendue encore l’action de M. Paul Cezanne prédomine de toute évidence à ce vingtième Salon des Indépendants ; c’est à M. Cezanne qu’il convient d’affilier ceux qui en sont les triomphateurs manifestes : M. Dufrénoy et M. Matisse, M. Marquet et M. Urbain. » […] Certains encore, — MM. Sue, Delannoy, Lanoé, Deborne, Puy, Beaufrère, Deltombe, Perrichou, Boudot-Lamotte, de Blives, — furent attirés par les abréviations et les somptuosités de coloris chères à Cezanne ; »
Morice Charles, « Le XXe Salon des indépendants », Mercure de France, tome L, n° 173, mai 1904, p. 405-419, Cézanne p. 405 :
« N’y sont-ils pas, même les artistes qui se montrent ailleurs, même ceux qui n’exposent nulle part ? Des reflets, votre influence heureuse vous rappellent à toutes les mémoires, Rodin et Carrière, Redon, Degas, Fantin-Latour, et Monet, et Renoir, et Cézanne, — peut-être Cézanne plus notoirement, plus évidemment que tous. »
Guinaudeau B., « Le Salon. Les indépendants », L’Aurore, littéraire, artistique, sociale, 5e année, n° 1302, lundi 13 mai 1904, p. 1-2, citation p. 1 :
« LE SALON
LES INDÉPENDANTS
Sous le patronage et la présidence, en quelque sorte, de Paul Cezanne à qui M. Maurice Denis dédia le bel Hommage que l’on peut voir au Grand Palais, les Artistes indépendants ont organisé, dans les serres de la Ville de Paris, l’une des plus brillantes expositions qu’ils nous aient offertes, depuis dix-sept ans qu’ils existent.
Vollard a envoyé deux superbes pages de Paul Cezanne : un Paysage et une Nature morte, de beaux arbres et de belles verdures, des pommes d’or et de pourpre sur fond bleu. Si l’on y avait joint une de ces rudes figures, si puissantes et si expressives, comme nous en connaissons, nous aurions vu cette fois encore le grand artiste sous tous ses aspects. »
25 février
Durand-Ruel achète le tableau de Cézanne Nature morte, pommes, citron, boite à lait, 5 000 francs, à Egisto Fabbri (stock n° 7605, photographie n° 1847). Il le revendra à Bernheim-Jeune le 30 novembre 1904, pour 3 500 francs.
Archives Durand-Ruel, Paris, livre de stock.
25 février – 29 mars
Neuf tableaux de Cezanne sont exposés à la Libre Esthétique, à Bruxelles :
13. Nature morte ; fruits [Nature morte au compotier, FWN780-R418]
(coll. G. Viau)
14. La Baie de Marseille [FWN193-R531]
(coll. D. Cochin)
15. Nature morte [FWN736-R319]
(coll. P. Gallimard)
16. Idylle antique [FWN967-R870]
(coll. M.[Maurice] Fabre)
17. La Fontaine [FWN215-R566]
(coll. D. Cochin)
18. Rue de village [FWN174-R502]
(coll. P. Gallimard)
19. Assiette de Fruits [FWN781-R419]
(coll. M.[Maurice] Fabre)
20. Vallée du Rhône [FWN124-R391 ?]
(coll. D. Cochin)
21. Pêches [FWN816-TA-R647].
(coll. Mlle Diéterle)
John Rewald émet l’hypothèse que le tableau FWN504-R712 a pu être exposé hors catalogue.
Rewald John, The Paintings of Paul Cézanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman, volume 1 : The Texts, 592 pages, 955 numéros, New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, notice 712 p. 447.
Catalogue d’exposition, nos 13-21.
Revue de presse :
« Petite chronique », L’Art moderne, Bruxelles, 24e année, n° 6, 7 février 1904, p. 46-47, Cézanne p. 46.
« PETITE CHRONIQUE
L’Exposition rétrospective des Peintres impressionnistes qu’ouvrira la Libre Esthétique au Musée de Bruxelles à la fin du mois s’annonce comme devant avoir une importance exceptionnelle. […]
Pissarro, Guillaumin, Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Lautrec, par un choix méthodique de leurs œuvres principales. »
« Échos », Journal des débats politiques et littéraires, 116e année, n° 40, 10 février 1904, p. 2 :
« L’exposition rétrospective des peintres impressionnistes qu’ouvrira la Libre-Esthétique au Musée moderne de Bruxelles, à la fin du mois, s’annonce comme exceptionnelle. De nombreux collectionneurs parisiens ont mis leurs plus belles toiles à la disposition de M. Maus, le directeur. Manet sera représenté par une quinzaine d’œuvres, dont quelques-unes jadis firent scandale : le Linge, la Dame aux Éventails, le Portrait d’Antonin Proust ; Renoir, par une douzaine de tableaux, au nombre desquels : la Loge à l’Opéra, les deux Danses, les Baigneuses, les portraits de Mme Charpentier, J. Samary ; A. Mithouard ; Claude Monet, par vingt paysages résumant l’ensemble de sa production depuis 1875 ; Degas, par des tableaux et des pastels ; Pissaro, Guillaumin, Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, par un choix méthodique de leurs œuvres principales. Les toiles des néo-impressionnistes Signac, Seurat, Luce, Van Rysselberghe, Vuillard, Roussel, Bonnard, Maurice Denis, Guérin, d’Espagnat, compléteront l’historique de ce Salon original. »
M. S., « À la Libre Esthétique », L’Étoile belge, 29 février 1904.
Wéry Léon, « La leçon de l’impressionnisme », L’Idée libre, littéraire, artistique, sociale, Bruxelles, tome VII, février 1904, p. 174-179, Cézanne p. 175, 178 :
« Et n’entendit-on pas même médire du dessin et excuser Cézanne d’en ignorer les premières notions ! […] Et Renoir, donne-t-il aussi raison à Cézanne ?
« L’histoire de l’impressionnisme », La Justice, journal politique du matin, 25e année, n° 63, jeudi 3 mars 1904, p. 3.
« L’Histoire de l’impressionnisme
Grâce au concours dévoué et éminent du plus fin des lettrés-artistes, M. Octave Maus, le cercle « La Libre Esthétique » à organisé un salon où se trouvent assemblés tous les documents de l’Impressionnisme qui en retracent en quelque sorte l’histoire, de Manet à Signac, de Vuillard à Van Rysselberg.
Tons ces cartons, ces toiles, sont curieux à plus d’un titre et témoignent d’une audace que justifie souvent une réelle habileté. Cet impressionnisme manifeste, certes, une recherche d’art qu’on peut ne pas se croire obligé, par snobisme, de goûter, mais qu’il faut louer pour sa hardiesse et sa conviction.
Manet, Monet, Degas, Renoir, Pissaro, Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Cezanne, Guillaumin, Toulouse-Lautrec, Signac, Seurat, Van Rysselberg, Luce, d’Espagnat, Bonnard, Maurice Denis, Guérin, etc.
Cette exposition est copieuse, comme l’on voit, et n’est rien moins qu’une bruyante manifestation de l’art français. »
Lemmen, « Propos d’actualité », L’Art moderne, Bruxelles, 24e année, n° 10, 6 mars 1904, p. 73-75, Cézanne p. 74.
« Et il est curieux que notre pays, qui se targue d’être un foyer d’art, une pépinière d’artistes et qui se prévaut en outre de la gloire ancestrale des grands peintres flamands, se soit laissé distancer dans l’évolution des idées et du goût par des pays d’un passé artistique moins imposant. La Hollande détient d’admirables Cézanne et les impressionnistes français sont actuellement aussi connus et goûtés en Allemagne qu’à Paris. À Berlin, grâce à la clairvoyance de M. von Tschudi, Degas, Cézanne, Manet, Monet et Pissarro figurent à la Galerie nationale. »
« Petite chronique », L’Art moderne, Bruxelles, 4e année, n° 13, 7 mars 1904, p. 106-107, Cézanne p. 106 :
« M. von Tschudi, que nous avons rencontré au Salon, nous a exprimé sa vive admiration pour l’important ensemble de toiles impressionnistes réuni au Musée. C’est, on le sait, grâce à son initiative éclairée que le Musée de Berlin possède des œuvres de Manet, Claude Monet, Pissarro, Degas et Cézanne. »
Mellerio André, « Correspondance de Belgique. Exposition des peintres impressionnistes à la « Libre Esthétique » » ; La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 13, 26 mars 1904, p. 104-105 :
« Cézanne nous donne tantôt des natures mortes opulentes et frustes : Assiette de fruits [FWN781-R419], Pêches [FWN816-TA-R647] ; tantôt des paysages de saine et franche primitivité : La Baie de Marseille [FWN193-R531], Rue de village [FWN174-R502], tandis que Guillaumin établit ses terrains et ses ciels avec une accentuation presque brutale, cependant restant harmonique.
Mornave L., « Chronique artistique. À la Libre Esthétique », L’Idée libre, littéraire, artistique, sociale, Bruxelles, tome VII, mars 1904, p. 218-221, Cézanne p. 219 :
« Quant à Cézanne il porte un nom presque prédestiné qui l’excuse. »
Mellerio André, « Littérature et beaux-arts. Les petites expositions. Exposition des peintres impressionnistes français », Revue universelle, recueil documentaire universel et illustré, n° 108, tome IV, mars 1904, p. 215-216 :
« À la Centennale de 1900, M. Roger Marx, malgré les conditions réglementaires qui le limitaient dans le choix des œuvres, a donné avec une audace consciente et un esprit très renseigné le premier ensemble substantiel et méthodique de l’impressionnisme. C’est ce plan, sur des bases élargies encore, que M. Octave Maus, l’intelligent et avisé directeur de la Libre Esthétique, a repris à Bruxelles, dans les salles du musée Moderne.
Partir de Manet, initiateur. Continuer par Claude Monet, Renoir, Degas et Pissarro, en les entourant de Sisley, Berthe Morisot, Cezanne, Guillaumin, Mary Cassatt, Van Gogh et Gauguin. Puis, leur adjoindre les groupes jeunes qui, soit par filiation réclamée, soit indirectement, se rattachent à l’impressionnisme : les néo-impressionnistes, avec Seurat, Signac, Van Rysselberghe, Luce, H.-E. Cross ; les peintres dits symbolistes, avec Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, K.-X. Roussel. D’autres encore : d’Espagnat et Albert André ; Toulouse-Lautrec, L. Valtat, Ch. Guérin. Chacun de ces artistes est représenté par des œuvres choisies caractéristiquement significatives des faces diverses ainsi que de l’évolution de sa personnalité. »
Guérin Joseph, « III Les arts. L’exposition des peintres impressionnistes au salon de la Libre Esthétique (Bruxelles) », L’Ermitage, 15e année, volume XXIX, n° 4, avril 1904, p. 305-308 ; Cézanne p. 306 :
« de Cézanne, ces natures mortes et ces paysages où le plus jeune des vieux impressionnistes montre qu’il fut un précurseur ; »
Sedeyn Émile, « Expositions », L’Art décoratif, supplément, n° 68, mai 1904.
« La séparation. L’hôtel de M. Denys Cochin », Le Temps, 46e année, n° 16611, vendredi 14 décembre 1906, p. 1- :
« L’hôtel de M. Denys Cochin
Avant de savoir que le pape projetait de mettre à sa disposition l’ancien hôtel de la nonciature, le cardinal Richard avait accepté l’hospitalité que lui offrait M. Denys Cochin, député de Paris, dans son propre domicile.
M. Denys Cochin habite un bel hôtel, rue de Babylone, entre cour et jardin. Le rez-de-chaussée est en ce moment aménagé pour servir d’appartement personnel à l’archevêque de Paris. Celui-ci fera son salon du salon de l’hôtel, vaste pièce aux boiseries blanches, très éclairées par des portes-fenêtres donnant sur le jardin. Cinq autres pièces qui s’ouvrent soit sur ce jardin, soit sur la cour en bordure de la rue de Babylone, formeront un second salon de réception plus petit, un oratoire, une salle à manger, un cabinet de travail et une chambre à coucher : cette dernière pièce est aujourd’hui la bibliothèque de M. Denys Cochin.
Ce rez-de-chaussée est meublé en vieux et pur style. Les tableaux de maîtres y sont nombreux aux murs, Corot et Delacroix voisinent avec Cezanne et Puvis de Chavannes. »
Vers mars
Publication d’un livre de Robert de la Sizeranne, Les Questions esthétiques contemporaines, bienveillant à l’égard de l’esthétique de l’impressionnisme.
de La Sizeranne Robert, « II Le Bilan de l’impressionnisme », Les Questions esthétiques contemporaines, Librairie Hachette, Paris, 1904, 274 pages, p. 51-103, Cézanne p. 85 :
« Inspirés par une idée juste de leur époque, inconsciemment pénétrés du désir de l’idéaliser, servis par des organes très pénétrants et très sensibles, enfin munis d’une retentissante étiquette, les impressionnistes, les Renoir, les Monet, les Pissarro, les Cézanne, les Sisley, pouvaient accomplir dans notre art du xixe siècle un rôle utile. »
Mars
Cézanne et Émile Bernard visitent ensemble le musée d’Aix. Pendant son séjour dans cette ville, ce dernier prend des notes sur Cézanne. Vingt et un ans plus tard, il publiera « Une conversation avec Cézanne », rapportant les propos du peintre.
La veille de son départ, il réalise des photographies du maître dans son atelier, dans l’idée de peindre son portrait.
Bernard Émile, Sur Paul Cézanne, Paris, R. G. Michel, 1925, p. 55.
Bernard Émile, « Paul Cézanne », L’Occident, n° 32, juillet 1904, réédition par Doran P. M., Conversations avec Cézanne, édition critique présentée par P. M. Doran, Paris, Macula, 1978, p. 3.
Bernard Émile, Sur Paul Cézanne, Paris, R. G. Michel, 1925, p. 79-110.
Bernard Émile, « Une conversation avec Cezanne », Mercure de France, n° 551, 1er juin 1921, tome cxliii ; p. 372-397 :
L’état actuel de la peinture est le résultat d’une liberté anarchique
qui glorifie l’individu, quelque faible qu’il soit.
CHARLES BAUDELAIRE
En 1904, au cours d’une de nos promenades dans les environs d’Aix, je dis à Cezanne :
― Que pensez-vous des Maîtres ?
― Ils sont bons. J’allais au Louvre tous les matins lorsque j’étais à Paris ; mais j’ai fini par m’attacher à la nature plus qu’à eux. Il faut se faire une vision.
― Qu’entendez-vous par là ?
― Il faut se faire une optique, il faut voir la nature comme si personne ne l’avait vue avant nous.
― Vous êtes un nouveau Descartes, vous voulez oublier vos prédécesseurs, pour reconstruire le monde en vous-même.
― Je ne sais pas qui je suis. Étant peintre, je dois être un œil original.
― N’en résultera-t-il pas une vision trop personnelle, incompréhensible aux autres hommes ? Car enfin, peindre n’est-ce pas comme parler ? Lorsque je parle, j’emploie la langue dont vous usez ; me comprendriez-vous si je m’en étais fait une nouvelle, inconnue ? C’est avec le langage de tous qu’il faut exprimer des idées nouvelles. Peut-être est-ce le seul moyen de les faire valoir et de les faire admettre.
― J’entends par optique une vision logique, c’est-à-dire sans rien d’absurde.
― Mais sur quoi ferez-vous reposer votre optique, Maître ?
― Sur la nature.
― Qu’entendez-vous par ce mot ? S’agit-il de notre nature ou de la nature elle-même ?
― Il s’agit des deux.
― Vous concevez donc l’art comme une union de l’Univers et de l’individu ?
― Je le conçois comme une aperception personnelle. Je place cette aperception dans la sensation, et je demande à l’intelligence de l’organiser en œuvre.
― Mais de quelles sensations parlez-vous ? De celles de votre sentiment ou de celles de votre rétine ?
― Je pense qu’il ne saurait y avoir de séparation entre elles ; pourtant, étant peintre, je m’attache à la sensation visuelle, avant tout.
― Vous êtes donc, comme Zola, de l’école naturaliste ?
― Je veux être peintre, et je m’appuie sur mon œil pour faire un tableau qui s’adresse à celui-ci.
― Bien ! Mais que reprochez-vous aux Maîtres pour les avoir quittés ? La nature et l’art ne sont-ils point différents ?
― Je voudrais les unir. Je considère que c’est en partant de la nature que l’on doit aboutir à l’art. Le tort des éducations de Musées est de vous maintenir dans des méthodes qui écartent tout à fait de l’observation de la nature, laquelle doit rester le guide.
― Vous avez raison. Mais je crois que vous confondez ici la routine et la tradition, les professeurs et les maîtres. L’Étude de la nature était la base de l’art des anciens. Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc., se sont épuisés en efforts pour lui arracher leurs chefs-d’œuvre. Vous savez combien ils ont passé de temps dans ces terribles recherches qu’ils appelaient la théorie, car, pour eux, l’art ne commençait qu’à l’instant où le peintre, devenant artiste, pouvait se livrer à la création d’ouvrages sortis de sa conception.
― Cela est vrai ; mais c’est une route dangereuse, et toutes ces théories tirées de la nature n’étaient point la nature. On étudiait des sciences sorties d’elle ; mais on ne la regardait point ou fort peu. Aussi l’on aboutissait à une vision toute faite, qui ne se modifiait que selon le plus ou moins d’aptitudes de l’élève.
― Nous sommes vis-à-vis du problème capital : Faut-il peindre ce que nous voyons tel que nous croyons le voir, sans rien de plus, ou recevoir une éducation théorique, semblable à la métrique des poètes, qui nous permette ensuite de faire des ouvrages tirés de nous-mêmes, c’est-à-dire associant la nature à nos conceptions ?
― Je penche pour le premier moyen ; la vision réelle du monde n’a pas encore été écrite ; l’homme s’est trop cherché en tout ce qu’il a fait.
― N’est-il pas l’intelligence ?
― Je me tourne vers l’Intelligence du Pater omnipotens, et je dis : que puis-je de mieux que Lui ? Alors je m’efforce d’oublier nos illustrés devanciers, et je demande à la Création la connaissance d’elle seule.
― Je le vois, vous cherchez l’art dans la nature, et la nature en dehors de vous, dans les spectacles perçus par vos yeux ; c’est un acte de soumission, d’humilité, duquel vous attendez toute vertu.
― Je n’ai point l’habitude de tant raisonner.
― Pour les maîtres dont nous parlions, le spectacle extérieur, accidentel, n’était qu’un appel à leur génie. Ils cherchaient en eux la vérité du monde, la vision de l’Univers ; c’était au fond de leur sentiment, dans la pensée et les idées qu’ils tâchaient d’apercevoir les types de leurs ouvrages ; et chacun d’eux créait ainsi de nouveaux tableaux, de nouvelles images avec les lois de l’art, tirées des lois de la nature.
― Parfait : mais ils ont remplacé la réalité par l’imagination, et par l’abstraction qui l’accompagne. Je vous l’ai dit, je vous le répète, il faut arriver à l’image concrète qui fait le peintre… Il faut avoir une vision.
― Les maîtres que vous vénérez ne s’en étaient-ils point fait une, non pas puisée dans les moyens de l’art, mais dans l’expression de l’idée par la conception ? Entre Léonard de Vinci et n’importe lequel d’entre eux tout n’est-il pas différencié : la couleur, la forme, la composition, le style ? La vraie personnalité, n’est-ce point l’homme conscient, plus que l’homme sensuel ?
― Il faut donner une image consciente de la nature, jusqu’ici on n’a fait que l’homme.
― Peut-il exister une image de la nature qui soit la véritable ? Et comment saurons-nous qu’elle est la véritable ? Chaque peintre n’en élabore-t-il pas une différente de son confrère ? Existe-t-il deux tableaux semblables ? Goya disait : La nature n’a ni couleur ni ligne. Ne sommes-nous point dupes de nos illusions même dans nos sens ? Et puis nos sens eux-mêmes sont-ils assez parfaits, assez sains, pour nous permettre d’entrer en contact, sans erreur aucune, avec ce que vous nommez la nature ?
― Je le sais, il y a eu des philosophes qui ont nié la réalité, des philosophes allemands, pour lesquels tout est illusion, rêve, phénomène. Ce sont des littérateurs.
― Vous niez donc la philosophie ?
― Je nie ce qui est absurde et que vous nommez à tort philosophie ; le peintre n’a pas d’autre tâche que de réaliser une image.
― La vraie philosophie lui dit ce que doit être cette image pour que la raison n’en soit point douteuse. Pascal traitait d’orgueil inutile la prétention de peindre ce que l’homme voit journellement. Avec des couleurs et des pinceaux, on ne saurait le faire aussi parfait que nous l’offre la réalité. Pascal avait raison de condamner cette tâche laborieuse et vaine ; mais la vraie philosophie, celle qui indique à l’homme la route qu’il doit suivre pour trouver la vérité, nous dit que le Beau est dans les idées bien plus que dans les choses, et pour cette raison engage l’intelligence à remonter des choses aux idées et des idées à l’idéal.
― Vous auriez bien fait rire Courbet ! Croyez-moi, tout cela ne vaut pas le mot de Cambronne ; ce sont des rêveries d’universitaires.
― Toute pensée vous semble donc inutile quand il s’agit de peindre ?
― Oui ! Voici un spectacle parfait ; je veux le traduire. Pour y arriver, je m’anéantis en lui, je m’y soumets, j’attends qu’il en sorte ma vérité personnelle. Pourquoi me souviendrais-je des philosophes devant ce grand livre, et des peintres devant ce vaste tableau, le plus beau de tous ? Croyez-moi, avec la nature, il faut redevenir un enfant.
― C’est donc à l’inconscience que vous demanderez votre science
― Ni plus ni moins. Il faut se plier à ce parfait ouvrage. De lui, tout nous vient, par lui, nous existons. Oublions le reste.
― Les primitifs n’ont pas de vision originale ; cependant, ils regardent le présent sans être gênés par un passé. L’originalité n’est qu’une éclosion intérieure, c’est une perle née de la profondeur. Je ne crains pas de vous dire que je crois fermement que c’est dans l’homme, ce creuset, que repose le génie. Notre étroit rapport intime avec le monde visible nous conduit, par l’intelligence, bien au delà de lui ; notre âme immortelle est plus grande que la matière qui l’enserre.
― Je m’en tiens à la Peinture, et je m’étonne que vous alliez chercher si loin. Quant à moi, je veux être un enfant, et je me réjouis de voir, d’entendre, de respirer, d’être une sensibilité extasiée, qui analyse et cherche à se traduire sur la toile.
― Vous vous interdisez donc toute création ?
― Copier la création me suffit. Ceux qui ont cru imaginer se sont abusés eux-mêmes.
― Pourtant : le Jugement Dernier, les Stanze du Vatican, les Noces de Cana, les Allégories de Rubens !
― Eh bien ! oui, un Delacroix peut se permettre cela ; mais quant à nous, il faut nous en tenir à ceci : l’étude du tableau de la nature.
― N’est-ce point se créer une infériorité ? Méconnaître le but de la Peinture ?
― La peinture n’a pour but qu’elle-même. Le peintre peint ; une pomme ou un visage, c’est pour lui prétextes à un jeu de lignes, de couleurs, rien de plus.
― Je reviens à l’opinion de Pascal : Pourquoi refaire ce que Dieu a si bien fait ?
― Pouvons-nous faire mieux que Lui ?
― Évidemment non, en tant que choses vivantes ; mais en tant que choses pensées nous pouvons exprimer un ordre plus conforme à l’esprit qu’il représente. Tout ce que nous voyons dans la nature n’y est plus selon l’ordre premier ; l’homme a tout dérangé. Je prends une fleur à part, et je retrouve l’œuvre du Créateur ; mais dans un parterre arrangé par le mauvais goût d’un jardinier je ne vois plus l’harmonie de cette fleur. Or, ce jardinier est partout, et se nomme l’homme, martyrisant le monde pour son utilité. Regardez cette montagne de Sainte-Victoire, n’est-elle pas une ruine ? C’est-à-dire une image de tous les accidents survenus depuis l’Origine ? Où trouver la nature dans son ensemble divin, alors que le chaos a passé sur elle ? Acceptez donc que l’artiste porte dans son âme un désir de cette harmonie perdue, et tente de la reconstituer par les fragments magnifiques qui viennent frapper ses regards, comme un appel de Dieu à son intelligence.
― Il y a dans la nature deux agents qui travaillent à l’harmonie, c’est la lumière et l’air. La lumière colore, l’air enveloppe.
― Nous ne pouvons pourtant nous résoudre à ne peindre que ce que cette lumière et cet air diluent. Suffit-il d’invoquer leur pouvoir pour accepter de se limiter au jeu des couleurs et des valeurs ? Ne pouvons-nous point suivre ces lois de la nature et les appliquer à nos sites intérieurs ? Admettez-vous qu’un peintre qui fait un portrait ait achevé son tableau quand il a bien peint et bien copié son modèle ?
― Non point, j’entends qu’il l’interprète.
― Comment le fera-t-il s’il ne doit avant tout que peindre, c’est-à-dire le traduire par des lignes et des couleurs qu’il croit voir, sans rien accorder à sa pensée ? Pour aller plus loin et faire de ce portrait une œuvre durable, l’artiste ne doit-il point enfermer dans cette effigie la pensée qu’il ressent et suppose au modèle ? Il ne peint donc pas que des formes, il imite l’âme de son modèle et il est guidé bien plus par l’esprit que par la vue. Eh bien ! le peintre qui ne fait point cela pour tout tableau qui est sous sa main me paraît se fatiguer inutilement. C’est la vie que l’on représente sous le symbole de la matière ; et puis, la peinture ne désincarne-t-elle pas l’être en le dépouillant déjà de tout ce qui est poids, corruption, changement ? Cette opération spirituelle présage ses buts et sa destinée. A ce propos, permettez-moi de vous redire une opinion d’un de nos confrères, Socrate, le sculpteur : « Mais si quelqu’un vient me dire que ce qui fait qu’une chose est belle c’est la vivacité des couleurs, ses formes ou d’autres choses semblables, je laisse toutes ces raisons qui ne font que me troubler, et je m’assure moi-même que rien ne la rend belle que la présence ou la communication de la beauté première, de quelque manière que cette communication se fasse. Car là-dessus je n’affirme rien, sinon que toutes les belles choses ne sont belles que par la présence de la beauté. »
― C’est retourner aux nez droits de David, reprendre l’antique, les classiques nuisibles, Ingres ou Girodet.
― Je ne le crois pas. La beauté n’est point renfermée dans un certain nombre de recettes, mais dans l’idée que s’en fait l’Intelligence. Il faut d’abord la concevoir pour la pouvoir exprimer. Phidias n’a pas reçu des autres la forme qu’il lui a donnée, il y atteignit par des moyens que lui ont enseignés la raison et l’amour. C’est fort ridiculement que l’on pense parvenir au Beau en imitant les canons de la beauté. J’admets qu’ils puissent éclairer sur ses chemins ; mais tant que l’on copiera des formes aveuglément, on ne produira que du mauvais artifice et du désordre. Aussi je ne sais rien de plus trompeur que la routine du faux classique des professeurs.
― Dites et faites ce que vous voudrez, votre Beau absolu est une chimère.
― Je ne le crois pas. Personne ne fut plus platonicien que Léonard, que Raphaël, que Michel-Ange, et c’est eux qui ont précisément atteint, à travers la nature, à la réalisation la plus concrète de l’art. Tout ce qu’ils ont produit était nouveau, en vertu même du mobile qui les guidait, et reste insurpassé, parce que peu d’hommes ont pu s’élever aussi haut, et aucun plus haut qu’eux. Je doute fort que l’Antiquité ait eu un peintre capable de produire un portrait analogue aux leurs ou des compositions aussi sublimes que celles de la Sixtine.§
Cezanne semblait fatigué, je lui proposai l’ombre d’un arbre qui étendait son tapis obscur sur le talus de la route.
Nous nous assîmes.
― Je suis malade du diabète, me dit-il, je ne puis guère discuter. Je sens que je suis possédé par un mal qui m’emportera.
Il s’essuya le front, et reprit :
― Soyez peintre et non pas écrivain ou philosophe ! Moi aussi, j’ai voulu goûter à l’imagination. Delacroix m’entraînait, les maîtres du Louvre m’y poussaient. Ma jeunesse a été remplie de toiles exaltées, où tour à tour je refaisais à ma manière Véronèse, Ribera, Le Caravage, le Calabrèse, Courbet et Delacroix lui-même. J’ai compris lorsque je rencontrai Monet et Pissarro, qui eux s’étaient débarrassés de tout ce bagage, qu’il ne fallait demander au passé que l’enseignement de la Peinture. Ils avaient comme moi l’enthousiasme du grand romantique ; mais au lieu de se laisser entraîner par ses vastes machines, ils ne recherchaient en lui que les bénéfices du coloris d’où devait sortir une nouvelle application de la palette. Pissarro a fait la nature comme personne, quant à Monet, je n’ai jamais rencontré un pareil metteur en place, une facilité si prodigieuse à saisir le vrai… L’imagination, c’est très beau ; mais il faut avoir les reins solides ; moi, au contact des impressionnistes, j’ai compris que je devais redevenir un élève du monde, me refaire étudiant, tout simplement. Je n’ai pas plus imité Pissarro et Monet que les grands du Louvre. J’ai tenté une œuvre à moi, une œuvre sincère, naïve, selon mes moyens et ma vision.
― Vous avez voulu recommencer l’art, comme Descartes avait recommencé la philosophie ; vous avez fait table rase de tout ce qui avait été trouvé avant vous.
― Oui. Je suis le primitif d’un nouvel art. J’aurai, je le sens, des continuateurs.
En disant cela, Cezanne me regardait profondément. Je lui répondis :
― Lorsque j’avais dix-huit ans, au sortir d’une académie où j’étais mal vu pour avoir choisi mes maîtres au Louvre, je rencontrai votre œuvre. Vous aviez alors quelques toiles chez Julien Tanguy, le marchand de couleurs de la rue Clauzel, que l’on a appelé, depuis, familièrement, le père Tanguy 1.
― Un brave homme !
― Je ne vous cache pas qu’aussitôt mes prédilections allèrent à vous. Je vous préférai de suite à tous les peintres de notre génération et aux impressionnistes dont l’art séducteur me semblait une dangereuse sirène. Dès lors, je devins l’élève de vos ouvrages.
― On faisait donc de bien mauvaises choses en ce temps-là ?
― Votre recherche de solidité, de peinture vraie, me passionna, je trouvai injuste que l’on vous méconnût. Je fis tous les efforts possibles pour que l’on vous assignât votre place. C’est alors que j’écrivis la petite notice que vous avait passée Paul Signac, et qui vous fit croire que je n’étais pas un peintre, mais un biographe. Car telle est l’injustice des hommes qu’ils tournent encore contre celui qui la tente la justice qu’il entreprend. Parmi tous ceux qui cherchaient, vous étiez pour moi celui qui avait trouvé.
― Je n’ai jamais pu réaliser. Ah ! si je l’avais pu !… Mais un autre fera peut-être ce à quoi en vain j’ai usé mes forces.
― Vous avez fait la trouée… Je vous dois toute la vérité. Si, en cet instant, je vous avais rencontré, vous auriez, sans nul doute, fait de moi votre disciple. Je l’étais de vos toiles, je l’eusse été de votre esprit ; mais j’avais hâte de tout voir, d’apprendre… et je partis en Italie.
― Vous auriez dû vous renfermer dans la nature.
― Je le sais ; mais ce que je voyais autour de moi, et qui ne s’appuyait que sur elle, me semblait en contradiction avec ce que j’aimais de plus beau. Je l’entendais invoquer par de si bornés écrivains, de si mauvais peintres, que je pris le sentiment que la nature seule ne pouvait suffire à faire œuvre ; que l’artiste qui s’y attache trop perd la raison de son travail ; bref, que ce modèle tout puissant, loin de l’aider, quand il s’y soumet trop volontiers, le subjugue et l’entraîne à la négation de lui-même. L’histoire de l’art, que je lisais au Louvre, dans les salles pleines d’œuvres de tous les siècles, me le montrait sous trois phases : la première mystique, la seconde humaniste, la troisième réaliste. Je me mis à rêver au primitivisme mystique, pour sortir de l’ornière de la phase réaliste, qui semblait alors toucher à son extrême déliquescence, et, sans le vouloir, par un simple effet de ma nature contemplative et religieuse, j’enfantai le symbolisme.
― Il faut réaliser sur la toile l’image sensible ; vous vous égariez.
― Je le devais peut-être au primitivisme de votre œuvre, qui me poussait dans l’amour de la naïveté ; et puis j’avais quelque chose à dire… Donc je partis en Italie, et je vous oubliai.
― Vous fîtes bien.
― Non point que votre art me fût devenu indifférent. J’y pensais souvent, je désirais vous connaître, et j’avais résolu de m’emparer du jour propre à notre rencontre. Cela arriva bien tard, puisque j’ai aujourd’hui trente-six ans et que j’en avais alors dix-huit… 2
Je n’eus pas de peine à comprendre, en voyant les chefs-d’œuvre dont l’Italie est pleine, que nous ne pouvons nous faire au Louvre qu’une imparfaite idée de ce que sont les grands Maîtres. Arrachés des monuments pour lesquels ils furent conçus, dans le jour froid et rare de nos musées, parmi nos salles nues et tristes, où on les aligne comme des soldats, leurs tableaux semblent des défunts respectueusement rangés dans une nécropole. Dans leur pays, parmi l’ensemble harmonieux des villes historiques intactes, sous le soleil, ils s’animent d’une vie singulière et semblent plus existants que nous. A leur approche je sentis la toute-puissance d’un art éternel dont l’origine se perd dans la nuit des temps, et que l’amour invincible du Beau a continué, afin de satisfaire un des besoins les plus impérieux de l’âme humaine. Dès lors, pardonnez-moi, Maître de mon choix, je me rendis indépendant des influences immédiates, je me tournai vers l’Art, comme vous vous êtes tourné vers la nature. Il me parut que c’était l’art qu’il fallait faire revivre parmi nous, après tant de siècles de réalisme, ensevelissant sous leur monotone poussière l’ère sublime des humanistes du XVIe siècle, des Raphaël, des Vinci, des Giorgione, des Bellini, et la période céleste des mystiques du moyen âge.
― Certes, nous ne devons pas nous en tenir à la stricte réalité, au trompe-l’œil. La transposition que fait le peintre, dans une optique à lui, donne à la nature reproduite un intérêt nouveau ; il écrit en peintre ce qui n’est pas encore peint ; il le rend peinture absolument. C’est-à-dire autre chose que la réalité. Ceci, ce n’est plus l’imitation plate.
― Non. Mais une traduction exécutée dans un langage particulier, qui comporte les qualités de l’art mis en jeu.
― Et dont l’agent est le tempérament, le don.
― Votre ami Zola disait que l’art était la nature vue par le tempérament. Vous êtes sans doute de cet avis ?
― La définition me paraît bonne ; mais j’y ajouterai par un tempérament discipliné, qui sait organiser ses sensations.
― Un tempérament qui a ses méthodes propres.
― Et qui se méfie de toutes les autres.
― C’est donc le recommencement de l’art à chaque peintre ?
― Non pas. Il y a sans doute dans la nature des choses que l’on n’a pas encore vues. Si un artiste les découvre, il perce une voie à ses successeurs. Si je n’ai pas tout dit, ils diront le reste.
― Il en serait donc en peinture comme en science, où un savant continue et perfectionne un autre savant. Savez-vous que par une telle conviction vous donnez raison au classique, vous infirmez votre théorie ?
― Nous voyons en science des révolutions de systèmes ; pourquoi n’y en aurait-il pas en peinture ? Une nouvelle vision peut être apportée, continuée, parfaite.
― C’est une recherche qui demande bien du temps, surtout si vous recommencez l’édifice par sa base. Les décadences ont toujours montré un goût, immodéré, pour la nouveauté ; elles ont été la cause de la perte des meilleures traditions.
― Nous devons vivre de notre vie !§
Il y eut une pause, durant laquelle une cigale se mit à chanter dans un champ voisin.
― Peindre, c’est chanter comme cette cigale, me dit Cezanne.
― Je le crois ; mais cette cigale ne fait que du bruit, et l’artiste aspire à l’harmonie ; or, pour la découvrir ne faut-il pas la pressentir et l’aimer ?
― L’étude de l’art est très longue et très mal conduite. Aujourd’hui le peintre doit tout découvrir seul, car il n’y a plus que de très mauvaises écoles, où l’on se fausse, où l’on n’apprend rien. Il faudrait d’abord étudier sur des figures géométriques : le cône, le cube, le cylindre, la sphère. Quand on saurait rendre ces choses dans leurs formes et leurs plans, on saurait peindre.
― Elles sont évidemment contenues dans tout ce que nous voyons, c’en est l’échafaudage invisible. Les anciens avaient mis à la base de l’étude de l’art le géométrique, le géométral et le perspectif.
― Qu’entendaient-ils par là ?
― Le géométrique évalue les masses et détermine les superficies. Le géométral établit les rapports de hauteur, de largeur, de profondeur ; le perspectif écrit les contours selon l’éloignement, par rapport au spectateur. Ces deux derniers sont mathématiques, soumis à des lois invariables 2.
― Cet enseignement était évidemment le meilleur.
― Partant du point, qui est l’origine de toute ligne, après avoir passé par le cercle, les angles, ils aboutissaient à l’étude des superficies, planes, sphériques, concaves, convexes, composées, et à celle des rayons visuels. Peut-on trouver un appui plus positif ?
― C’est ce que j’ai découvert de plus juste dans ma longue carrière ; mais les couleurs ?
― Les peintres grecs les plus célèbres, Apelle, Echion, Mélanthe, Nicomaque, etc., n’auraient, d’après Pline, employé que quatre couleurs, le jaune, le sinople, le blanc et le noir. Pline fait remarquer que de son temps on s’attachait moins à l’art et plus à la matière ; car on prodiguait toutes les couleurs, et le talent avait disparu. Alberti donne quatre couleurs au peintre, plus le blanc et le noir qu’il ne compte que pour la lumière et l’ombre. Léonard de Vinci fait de même. Ces couleurs sont dérivées des éléments : le jaune est le feu, le rouge la terre, l’azur le ciel, le sinople l’eau.
― C’était une palette bien restreinte. Depuis on a connu, par le prisme, la composition de la lumière. Je suis partisan d’une palette étendue, pour l’abréviation des mélanges et les richesses du tableau. La nature nous offre des variétés infinies de nuances.
― La constitution du tableau exigeait trois choses pour les maîtres dont nous parlons : la circonscription ou dessin par les contours, la composition et la distribution des lumières.
― Ils faisaient le tableau ; nous tentons un morceau de nature.
― Enfin, la variété, la convenance et la beauté étaient demandées comme le charme même de l’art cela entraînait l’étude des mouvements, des passions et conduisait à la science exacte de l’anatomie et de l’expression.
― C’était demander beaucoup au peintre.
― Alberti conseillait la nature, il disait que seule, elle mène l’artiste à la supériorité, car il est enclin à des vices et des conventions s’il ne se fie qu’à son propre génie. Mais il exige la science de l’art : que personne, ajoute-t-il, ne mette la main à l’œuvre, s’il n’est de propos délibéré et l’esprit bien éclairé.
― Je vous avoue que j’ai peur de trop de science, que je lui préfère la naïveté.
― Pourquoi rejeter ce qui a tant coûté ? La science n’exclut pas la naïveté, qui est un effet de la sincérité du sentiment, et non un don de l’ignorance. L’âme se fait difficilement une voie à travers la matière, il n’est pas superflu de lui déblayer le chemin à l’avance.
― Si les critiques savaient seulement le quart de tout ce que nous avons dit précédemment, ils écriraient moins de sottises.
― J’ai repris, il n’y a pas longtemps, désireux de le relire, l’Art moderne de Huysmans. J’ai été épouvanté de la sécheresse de ce style gamin qui crie ses opinions sur les toits sans les étayer de quelque bonne raison, ou qui, lorsqu’il se met en peine de les justifier, les présente dans la nudité de leur indigence intellectuelle. La plupart ne dépassent pas l’argument d’un petit boutiquier ignorant de l’art, incapable de goûter à une création, et réclamant toujours la vérité que ses yeux voient.
― C’est comme Zola… Le naturalisme…
― Et quelles opinions sur Puvis de Chavannes, par exemple ! Quel manque de tact, quelle apologie des productions les plus canailles, quel goût outrecuidant de la vulgarité ! La spiritualité était décidément ce qui manquait à ces écrivains. Et comment juger l’œuvre d’art sans elle ?
― Ces critiques n’avaient qu’un objectif, servir la modernité qu’ils poursuivaient eux-mêmes en littérature, en s’étayant des peintres.
― Huysmans à cette époque n’avait que ce critérium : et il nommait ainsi je ne sais quel besoin vicieux de retrouver de la prostitution et de la voyoucratie dans les œuvres peintes. Quant à une recherche comme la vôtre, il la méconnaissait ?
― Zola n’a-t-il pas fait ainsi ?
― Il en va de même de l’histoire de l’art en général. J’ai lu beaucoup d’ouvrages sur la peinture, et je me suis rendu compte que la plupart des écrivains qui ont eu la témérité de s’en mêler n’ont vu dans son déroulement que des écoles, dans lesquelles ils ont piqué, ainsi que des insectes, des séries de peintres qui leur étaient aussi étrangers que les habitants de Mars.
― Le seul critique fut Baudelaire.
― Le point de départ de l’art étant spirituel, ce n’est pas par écoles, mais par aspirations que les peintres doivent être unis. On arriverait ainsi à démontrer que les plus grands ont été ceux dont l’esprit s’est porté le plus haut ; et que, par un accord étroit de la science acquise et de la sublimité des conceptions, ils ont atteint à une cime qui n’a pu être gravie que deux ou trois fois tout au plus, et par des hommes ayant un idéal commun.
― Il serait trop long de vous dire ce que je pense de la critique ; jusqu’ici elle m’a fort maltraité, peut-être qu’un jour elle me couvrira d’éloges aussi sots qu’elle me lapide actuellement d’absurdes méchancetés. Je ne lui en veux pas. Je ne la lis plus. Le peintre doit se renfermer dans son œuvre ; il faut répondre non pas avec des mots, mais avec des tableaux.
― Attendons que quelque toile de vous se vende un bon prix : ce sera le suprême argument pour une société qui ne connaît plus l’art.
― Il serait drôle qu’un jour j’atteignisse les sommes de Bouguereau ou de Meissonier !
― Il n’y a rien d’impossible à cela. Vous enrichirez votre marchand. Ce sera une légitime vengeance vis-à-vis de ceux qui vous ont méconnu, et vos compatriotes vous élèveront une statue, si vous êtes mort, ou vous salueront, chapeau bas, si vous êtes vivant.
― Mes compatriotes sont des culs auprès de moi. Je les méprise tous.
Ici Cezanne eut une expression inénarrable de mépris, et montra le poing à la ville d’Aix.
― Il faut leur pardonner, le premier coupable n’est-ce point le critique parisien ? lui dis-je.
― Vous m’avez parlé du tableau tel que les anciens l’entendaient, je voudrais que nous en discutions encore. Vous savez que je ne suis pas hostile à la composition : je l’admets seulement exécutée sur nature. Que diriez-vous d’un Poussin fait ainsi ?…
― Je n’ose vous répondre, exposez-moi votre idée dans le détail. Je ne doute point que, fait par vous, cela ne soit très nouveau.
Nous nous remîmes en marche ; et Cezanne dit :
― J’ai exécuté souvent, vous le savez, des esquisses de baigneurs et de baigneuses que j’aurais voulu faire en grand et d’après nature ; le manque de modèle m’a obligé à me borner à ces aperçus. Des obstacles se dressaient devant moi ; comme de trouver le lieu où placer la scène, lieu qui ne différerait pas beaucoup de celui que j’avais choisi en idée, comme de réunir plusieurs personnes ensemble, comme de trouver aussi des hommes et des femmes qui voulussent bien se déshabiller et rester immobiles dans les poses que j’avais déterminées. Enfin, aussi je rencontrai l’obstacle du format de la toile à transporter, et les mille difficultés du temps propice ou impropice, de l’endroit où se placer, et du matériel inhérent à l’exécution d’un ouvrage de dimension. Je me suis donc vu forcer d’ajourner mon projet du Poussin entièrement refait sur nature, et non point construit de notes, de dessins et de fragments d’études ; enfin d’un Poussin réel, de plein air, de couleur et de lumière, au lieu d’une de ces œuvres pensées à l’atelier, où tout à la couleur brune du jour rare et de l’absence des reflets du ciel et de la lumière.
― En vérité, je m’étonne qu’un esprit si indépendant que le vôtre soit à la recherche de tant d’asservissements matériels. Vous semblez vouloir traiter le tableau par le système de l’étude ; comme si le tableau n’était point avant tout une œuvre de l’artiste bien plus qu’une œuvre de la nature, quoique celle-ci y soit constamment présente et respectée. L’étude est la raison de la peinture, mais le tableau me semble la raison de l’art. J’ose croire que Poussin refait sur nature serait moins beau que sorti de l’imagination de Poussin. Je le sais, la manière de se servir de la nature est la plus difficile et la plus grave de toutes les questions qui puissent embarrasser un artiste. Je la tranche pourtant comme voici : chacun y prendra ce qui est propre à son appétit. Et puis les temps qui nous précédèrent sont si riches en tentatives diverses qu’il s’y trouve pour l’analyste des persuasions utiles, des conclusions péremptoires. Dans le premier âge, alors que l’idée dominait dans l’homme, nous voyons que les peintres n’avaient pour but que de nous raconter des anecdotes divines ; et ils sacrifiaient le réel au sens de ces « hystoires ». L’essentiel pour eux n’était point l’imitation exacte, mais la représentation de l’idée. Aussi tout l’effort se concentrait-il vers l’expression, et appuyait-on le plus que l’on pouvait sur le sentiment, le caractère et le style ! Dans la seconde période, un respect plus grand de la forme perçue s’est fait jour dans les âmes ; les artistes commencent, à la faveur d’une philosophie moins mystérieuse et toute divine, à vénérer dans la chose vue l’œuvre de Dieu ; l’Esprit est cherché sous l’apparence de la beauté pure. C’est l’ombre du pinceau du Créateur, comme le disait Michel-Ange, que l’on essaie d’apercevoir pour guider son propre pinceau. Le Platonisme, uni étroitement au spiritualisme chrétien, montre la Beauté dans l’univers aux hommes de bon vouloir, les seuls capables de perfection 3. Le réel est étudié avec respect et il ne fait pas obstacle à la spiritualité, car il est regardé par elle, admiré par elle, contemplé par elle, qui cherche en lui le chemin de l’absolu. C’est à l’incrédulité qu’il faut attribuer le caractère décadent de la troisième époque de l’art. Alors on se sert de la nature en ne la considérant plus dans son esprit ; mais en la copiant, en l’admirant pour elle-même. D’abord un certain sentiment règne encore, puis peu à peu, machinalement, paresseusement, sensuellement, l’artiste, dénué de mysticisme, s’égare dans les sentiers de la spéculation, raffine sur le métier et ne dit plus rien de haut ni de grave.
― Comment regarder la nature sans songer à son auteur ? L’artiste doit considérer le monde comme son catéchisme ; il doit s’y soumettre sans discussion. La nature est un dogme. La preuve en est là, sous ses yeux, sous ses sens. Et je pense qu’il ne les a pas reçus pour être trompé.
― Oui, mais l’être humain est un instrument qui se fausse souvent lui-même. N’y a-t-il pas le péché ? Ceci nous entraînerait dans la théologie… J’admets comme vous que la vérité est sous nos yeux, mais le récepteur n’est pas indemne d’accidents. J’en conclus donc que pour avoir une vision droite, il faut avoir un cœur droit, et que pour voir le beau, il faut être bon. Sentir n’est pas tout, il faut penser, trouver la vérité par les choses et au delà des choses.
― Nous retombons dans la philosophie !
― N’est-elle pas le fondement de tout ? Je défie de parler d’art sérieusement sans y aboutir. Mais dites-moi ce que vous pensez de la nouveauté dans l’art ?
― Je ne la comprends qu’appuyée sur la logique et l’observation.
― Il y a dans chaque époque une sorte de charme magique qui émane de la nouveauté et qui trompe les meilleurs ; il est dû à un air de jeunesse, de rajeunissement, dont nous ne pouvons pas plus nous défendre que des influences du printemps de l’année ; mais il est rare qu’il donne les fruits qu’on en espère ; et c’est souvent d’une Atlantide que l’on croyait engloutie que nous arrivent les productions fortifiantes et durables.
― Vous m’avez parlé de la liberté que les anciens prenaient vis-à-vis de la nature pour réaliser leurs tableaux ; je n’ai pas eu le temps d’étudier à fond cette question, qui m’intéresse vivement. Pouvez-vous m’en dire quelque chose
― Rien de plus libre et de plus simple que leur manière de procéder. Nous n’avons pas élargi le domaine de l’art sous ce rapport, nous l’avons plutôt enfermé dans des barrières de plus en plus étroites
Je vous étonnerai peut-être en vous disant que les difficultés que vous rencontrez aujourd’hui quand vous voulez faire un tableau de nu, Michel-Ange les a dû éprouver comme vous. A ces époques de religion, il n’était pas facile de dénuder une femme en dehors de la sienne propre ou de sa maîtresse ; or, celui qui n’avait ni l’une ni l’autre devait éprouver quelque embarras. Michel-Ange se servit donc toujours de dessins faits d’après les hommes pour peindre ses admirables Sibylles. Il a créé ainsi la plus belle femme de l’art dans la Sibylle Libique
Il y a à la bibliothèque du roi, à Turin, une tête de femme de trois-quarts qui n’est autre que celle qui a servi à Léonard de Vinci pour inventer son ange de la Vierge aux Rochers. Je dis inventer, parce que cette tête, qui est presque laide et vulgaire, a été l’origine de la merveille angélique que vous savez
J’avais lu dans un livre de Louis Dolce, qui vivait au temps du Titien, que ce dernier avait souvent utilisé son frère pour faire les corps des femmes de ses tableaux. Je m’en suis assuré au Musée du Vatican dans la grande composition où se voient divers saints, et, parmi eux, un saint Sébastien tout nu. Je n’ai pas eu de peine à reconnaître en lui les jambes et les plus belles parties de la Vénus de la tribune de Florence, que peignit sans doute d’après son frère ce même Titien. La tête et les mains furent peut-être tirées de Violante, la fille de Palma, ou de Lavinia, la propre fille de l’artiste. Il serait trop long, mais édifiant, d’apporter les preuves que ces grands maîtres si personnels, outre les libertés que je vous montre ici, s’en donnaient encore une foule d’autres relativement à ces emprunts qu’ils se croyaient en droit de faire aux artistes antérieurs à eux, voire à ceux de leur époque. On connaît les prédilections de Michel-Ange pour l’Antique, l’étroite imitation qu’en fit Raphaël ; Poussin copiait entièrement des figures, des groupes sur les tombeaux ; on sait la discussion des érudits sur la paternité des tableaux de Giorgione et de Titien, ces deux artistes s’étant passé mutuellement leur génie, et reproduisant dans leurs ouvrages les mêmes figures et les mêmes sites
Dans le Jupiter et Antiope du Louvre, le Titien nous montre, couchée, la Vénus de Giorgione. C’est la même pose du corps, du bras gauche, de la main ; le bras droit a été relevé, la tête a été retournée. Quant à Rembrandt, malgré qu’on l’eût dit ennemi de l’Antique, il n’en a pas moins fait descendre sa Betsabé d’un bas-relief que François Perrier a dessiné à Rome et a publié dans un recueil d’eaux-fortes en 1645. On y retrouve la servante, la femme assise, et jusqu’à la grande draperie qui fait le fond du tableau. Nécessairement, ces emprunts, comme les tableaux faits d’après les dessins tirés du naturel, sont très libres, n’ont jamais le bas caractère d’une impuissante copie
L’art et la nature étaient donc, pour nos grands modèles, des réceptacles d’idées et de formes dont ils se croyaient en droit d’user sans blâme. Le Beau une fois trouvé leur paraissait digne d’être redit par eux, à leur manière. Et Rubens lui-même, ce génie si inventif, s’est plu à refaire les chefs-d’œuvre les plus réputés de son temps comme la Transfiguration, le Jugement dernier, la Communion de saint Jérôme (dont il tira celle de saint François d’Assise, un autre chef-d’œuvre qui égale celui du Dominiquin). Ainsi l’art se nourrit de l’art et forme du nouveau avec ce qui est devenu ancien.
― Je suis tout à fait de l’avis de ceux qui disent : liberté ! mais, pour moi, je crois qu’il nous viendra des peintres plus inattendus de l’étude de la nature seule.
― Permettez-moi d’en douter. Rembrandt, que l’on a souvent cité comme le plus instinctif des peintres, avait passé chez quatre maîtres et possédait une collection nombreuse de tableaux et de gravures. Il n’ignora pas le Titien, dont il avait acquis quelques œuvres, et dont sa peinture s’est incontestablement ressentie. Vous savez qu’il commença par une manière lisse et tout à fait hollandaise.
― Mais quelle merveille ce serait de peindre comme si la peinture n’avait jamais existé !
― Il me semble que c’est une erreur de notre temps de vouloir que chacun fasse de la peinture à son gré, sans fondement. On ne saurait être médecin sans étudier la médecine. Or, il y a une science dans l’art. C’est proprement cette science qui fait l’artiste comme elle fait le docteur. La peinture exécutée ainsi me paraît analogue à une opinion que l’on demanderait à chacun. Il en résulte cet amateurisme qui fait perdre complètement le goût des chefs-d’œuvre. Quelques jolies couleurs tirées d’une palette chimique, quelques arrangements selon le style du jour enchantent facilement une critique, indulgente pour les gens, superficielle et sévère pour les maîtres. On arrive par là à oublier ce qui a été acquis et légué, de générations en générations, par des recherches ardues, longues et géniales. Ainsi les plus grands artistes semblent avoir travaillé pour un autre siècle que le nôtre qui, dans sa suffisance, met sur ses yeux le bandeau de ses niaiseries et se croit au-dessus de tout ce qui a paru avant lui.
― Le véritable artiste est humble, il se défie de la mode de son temps, il vit à part. Il cherche, il ne crie jamais : J’ai trouvé !
― Oui ! mais d’autres le dérobent et le créent pour lui, en essayant de le maintenir dans l’obscurité.
― Il n’importe ! La vraie satisfaction du peintre est de peindre. Il ne cherche pas la gloriole.
― Vous, maître, vous êtes ainsi ; mais ceux qui vous imiteront ne seront pas de même ; ils vous exalteront pour se grandir ; ils formeront dans l’art une nouvelle coalition d’intérêts et peut-être d’erreurs.
― On ne sait jamais qui on enfantera. Bouguereau n’est-il pas né de Raphaël ?
― Et pourtant Raphaël a fait Ingres ; il avait fait Jules Romain ; Titien, et Rubens, et Vélasquez lui doivent quelque chose. Ses portraits n’ont pas été sans influencer jusqu’à Courbet, qui professait publiquement de s’en railler, pour énerver les classiques un peu ennuyeux de son temps.§
Malgré toute la passion qu’il apportait à ce dialogue, Cezanne paraissait un peu las de la longueur qu’il prenait. Je crus bon de garder un moment le silence. Nous marchions dans le plus serein des paysages sous un soleil ardent. De temps à autre, mon vieux maître me désignait un motif, en me disant :
― Ne croyez-vous pas que ceci, rendu comme l’eût fait un ancien, mais dans une vision jusqu’ici inédite, ne formerait point un tableau magnifique ?
Je me faisais muet, éprouvant que le repos de toute contradiction était nécessaire. Je méditais, je sentais de plus en plus les points sur lesquels Cezanne avait raison et ceux sur lesquels il avait tort. Son excessive admiration pour la nature lui montrait en elle le tableau tout fait ; moi-même, je le voyais peint par lui, avec ses empâtements, son style, ses gammes, ses hésitations et ses naïvetés. Mais je pensais que la démonstration de l’erreur de mon vieux maître se ferait de suite, en rapprochant sa tentative sincère, puisée dans la sensation des choses extérieures, d’un tableau de Claude Lorrain, d’un paysage du Titien, ou, plus près de nous, d’une composition élégiaque et mystérieuse de Corot. Je me taisais et nous marchions.
Sans doute Cezanne méditait aussi de son côté, car il s’écria :
― Sachez bien que je ne méprise rien de ce qui a été laissé par nos illustres devanciers. J’ai le Charles Blanc et le Magasin Pittoresque, et je les feuillette souvent. L’accord de l’art et de la nature doit se faire. Vous avez raison de le poursuivre selon vos vues. J’insiste cependant pour que cela ne devienne pas une œuvre d’érudition, mais de sensation.
Je répondis :
Il y a dans l’homme deux raisons, la raison bornée et la raison infinie. La première considère la nature et s’arrête à elle. La seconde la voit, la traverse et y contemple l’idée ; elle regarde au delà. C’est la première raison qui fait l’admiration de notre siècle ; elle est observatrice, elle découvre, elle invente. La seconde, qui fut puissante autrefois et qui nous valut tant de grands hommes, s’attache plus à la profondeur qu’à l’aspect, à l’esprit qu’à la sensation, à la création qu’à l’imitation littérale. Elle découvre aussi, elle invente aussi, et ce qu’elle fait est plus grand et plus beau que tout ce que met au jour la raison bornée, parce qu’elle le tire de son propre fonds du sentiment et de l’âme. Par malheur, et par un effet du goût que les sciences exactes nous ont donné, on ne s’attache plus dans les arts qu’à la raison pratique : on spécule sur les formes, sur les moyens, on renouvelle sans doute des apparences ; mais on perd l’harmonie trouvée par la raison contemplative.
L’art italien a obéi à la raison supérieure, et c’est ce qui l’a fait tour à tour mystique, platonicien, imaginatif. L’art flamand et hollandais ont obéi, après le XVIe siècle, à la raison pratique. Ils avaient été pénétrés si longtemps de la raison contemplative que la flamme de l’esprit brûle encore au bout de leurs pinceaux, transmuant la matière en pierres précieuses, dégageant l’âme et le sentiment des aspects les plus faits pour les voiler ; ensuite tout se perd, ce dernier rayon de poésie intime disparaît, le matérialisme, qui n’est que la raison bornée, envahit les arts ; et ils s’altèrent peu à peu, malgré quelques réactions isolées et brillantes, dernières étoiles d’un ciel obscurci.
― Ce que vous dites là paraît la condamnation de ma propre recherche. Savez-vous que je tiens pour vaines toutes les théories, et que personne ne me mettra le grappin dessus !
Je fus effrayé de cette attitude soudaine de mon vieux maître ; je m’excusai, protestant que je ne disais que ma pensée sans viser à rien de particulier. J’ajoutai :
― Les spéculations de l’art moderne comme celles de la science, dont elles sont un corollaire, reposent toutes sur le monde objectif, sans discernement de sa cause. Il en résulte pour la science l’absence de la vérité générale, pour l’art, l’absence de la Beauté. Plus ces tendances analytiques iront se répandant, plus la science expérimentale matérialisera l’homme, plus l’art s’écartera de sa voie et arrivera à la négation de lui-même. La morale repose sur le principe du Bon, la science sur le principe du Vrai, l’art sur le principe du Beau. Il faut partir de ces principes et non des moyens secondaires. Il faut aller sur la montagne, et se précipiter avec la source dans le fleuve et dans ses mille affluents, parcourir sans crainte, en la fécondant, la terre de l’art, et se jeter dans l’océan de la tradition universelle. Quant à s’arrêter devant un bras d’eau, et ne voir en lui que son court trajet, n’est-ce pas volontairement se murer dans l’aveuglement et l’ignorance ?
Cezanne s’était arrêté, il me regardait avec des yeux terribles où je crus apercevoir quelques larmes.
Alors il se retourna brusquement et j’entendis :
― Je suis vieux… il est trop tard… la vérité est dans la nature, je le prouverai…
Maintenant il s’en allait, me laissant comme un étranger au milieu de la route. Il prit insensiblement un pas pressé.
Je ne savais que faire. Je connaissais l’extrême susceptibilité de mon vieux maître. Habitué à vivre seul, la moindre contradiction le jetait dans des colères qui ressemblaient à de la folie. Je résolus de ne pas insister et de le laisser se retirer ; sans doute la solitude et le chemin dissiperaient son humeur. Pendant que je le regardais s’éloigner, il me semblait que je venais de soutenir l’Art tout entier contre les entêtements d’un seul homme se fermant ses voies par l’absolutisme de sa recherche ; et cette recherche me semblait se borner des barrières les plus singulières et les plus inattendues. Mon vieux maître ne s’obstinait-il pas à un suicide ?
Je le suivais des yeux, regardant sa silhouette faire lentement corps avec le paysage. Il s’agitait énormément, brandissait les bras, montrait la terre, le ciel et lui-même. Avec qui parlait-il ? Tout à coup il se retourna, cria quelque chose, dont il ne me parvint que ces mots : « Sur nature ! »
Puis il disparut au tournant de la route, et je demeurai seul sous le soleil.
Émile Bernard
1 Voir le Mercure de France : Julien Tanguy, dit le Père Tanguy, n° 16-XII 1908.
2 Voir : Esthétique fondamentale. Crès, éditeur.
3 Michel-Ange : Dialogues avec François de Hollande.
4 Voir : Souvenirs sur Paul Cezanne, par Émile Bernard. La Rénovation Esthétique (15, quai Bourbon, Paris). »
2 mars
Vollard met en dépôt à la galerie Bernheim-Jeune treize tableaux de Cézanne, dont un (Le Bassin du Jas de Bouffan, FWN92-R278) est réservé pour la Foire internationale de Saint-Louis, Missouri (« St. Louis World’s Fair »), exposition du centenaire de l’achat de la Louisiane, du 30 avril au 1er décembre 1904, mais il ne sera pas retenu par les organisateurs.
La liste des tableaux figure dans les archives Vollard, avec leur numéro de stock et leur prix :
« Remis au dépôt de MM. Bernheim, 8, rue Lafitte, les tableaux suivants de Cezanne, aux prix suivants :
3451 Portrait de paysan 4 000 frs. [FWN528-R851] 4164 Portrait de Valabrègue 5 500 frs. [FWN399-R094] 4162 Portrait de l’artist par lui-même 3 500 frs. [FWN449-R383] 3518 Nature morte pommes et violettes 3 000 frs. [FWN833-R663] 3491 Maison à Auvers 4 000 frs. [FWN108-R308] 3445 Paysage ancien 2 000 frs. [FWN43-R085] 4166 Nature morte noire avec pain 3 500 frs. [FWN704-R082] 3444 Maison de pendu 4 000 frs, [FWN137-R402] 4165 Portrait de Madame Cézanne dans fauteuil rouge 5 000 frs. [FWN447-R606] 3558 Nature morte, pot vert, pommes, sucrier, serviette etc. 6 000 frs. [FWN807-R635] 4161 Femme en gris 3 000 frs. [FWN485– R683]
4168 Paysage exp. Centenale , jardin de Cézanne [non vendable] 10 000 frs. [FWN92-R278] 4169 gd. tableau de joueurs de cartes [non vendable] 20 000 frs. [FWN681-R706] » Archives Vollard, MS 421 (4,1), p. 56, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux
Vollard Ambroise, Paul Cézanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924, 1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages, p. 146.
Liste citée dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 1 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1898-1901 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 502 pages, p. 520, les auteurs, donnent la date du 11 mars 1904 à la liste et identifient le n° 4169 avec FWN680-R707, le n° 3451 avec FWN542-R943.
Entre mars et mai
Vollard et Bernheim-Jeune commencent à posséder conjointement des œuvres de Cézanne. Dans cette période, Vollard met en dépôt une trentaine de peintures chez Bernheim-Jeune, transactions qui sont détaillées dans leur correspondance. Certaines toiles viennent d’être rentoilées et tendues pour la première fois, sans doute par Charles Chapuis, « rentoilage de tableaux, parquetage et marouflage ».
Archives Vollard, MS 421 (4,1), p. 56, 58 ; Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux et livre de stock A, nos 4175-4180.
Rabinow Rebecca A. et Warman Jayne, « Chronologie », sur CD-Rom dans De Cézanne à Picasso. Chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan Museum of Art, 13 septembre 2006 – 7 janvier 2007, Chicago, The Art Institute of Chicago, 17 février – 12 mai 2007, Paris, musée d’Orsay, 19 juin – 16 septembre 2007, Paris, musée d’Orsay et Réunion des musées nationaux, 2007, p. 208-245, p. 216.
9 mars
Lettre d’Émile Bernard à Paul Fort.
« Sans doute tu ne t’es pas fait transmettre les lettres à ton nom qui sont à la poste restante de Marseille. Je t’ai écrit là toutefois, une première de Naples une seconde d’une brasserie de Marseille même. Ne recevant rien de toi nous avons quitté cette ville désespérant de t’y voir pour aller à Aix auprès de Paul Cézanne. J’y ai loué une chambre et une cuisine pour un mois, c’est-à-dire dorénavant jusqu’au 25 mars. A cette date nous comptons partir pour Tonnerre (Yonne) où j’ai installé mon lieu de résidence en France pour l’avenir (je l’espère du moins). […] Il fait très froid à Aix et la ville n’est point très intéressante, ce pour quoi je ne t’y engage pas trop à y venir. Mais si tu le faisais tu serais le bienvenu. »
Lettre d’Émile Bernard à Paul Fort, Aix-en-Provence, 9 mars 1904 (cachet de la poste) ; Paris, Paris, Fondation Custodia ; Émile Bernard. Les lettres d’un artiste (1884-1941), édition établie par McWilliam Neil, textes recueillis par Lorédana Harscöet-Maire, Neil McWilliam, Bogomila Welsh-Ovcharov, Les Presses du Réel, 2012, 429 lettres, 981 pages, lettre 294 p. 688.
11 mars
Vollard confie en communication à Bernheim-Jeune trois tableaux de Cézanne : une nature morte, Fleurs et Fruits, et deux Sainte-Victoire, pour 6 000, 6 000 et 5 000 francs.
Archives Vollard, MS 421 (4,1) 56, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux.
Avril
Vollard effectue un paiement de 1 000 francs à Cézanne.
Rabinow Rebecca A. et Warman Jayne, « Chronologie », sur CD-Rom dans De Cézanne à Picasso. Chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan Museum of Art, 13 septembre 2006 – 7 janvier 2007, Chicago, The Art Institute of Chicago, 17 février – 12 mai 2007, Paris, musée d’Orsay, 19 juin – 16 septembre 2007, Paris, musée d’Orsay et Réunion des musées nationaux, 2007, p. 208-245, p. 216.
15 avril
Cézanne conseille Émile Bernard :
« Aix en-Provence, 15 avril 1904
Cher Monsieur Bernard,
Quand vous recevrez celle-ci, vous aurez très probablement reçu une lettre venant de Belgique, je crois et à vous adressée rue Boulegon. ― Je suis heureux du témoignage de Bonne sympathie d’art que vous voulez bien m’adresser par le fait de votre lettre. ―
Permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici. Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cone, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un objet, d’un plan, se dirige vers un point central. ― Les lignes parallèles à l’horizon donnent l’étendue, soit une section de la nature ou, si vous aimez mieux, du spectacle que le Pater omnipotens æterne Deus étale devant nos yeux. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. or la nature pour nous ― hommes est plus en profondeur qu’en surface, d’où la nécessité d’introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de Bleutés, pour faire sentir l’air. ―
Permettez-moi de vous dire, que j’ai revu votre étude faite du rez-de-chaussée de l’atelier, elle est bonne, vous n’avez je crois qu’à poursuivre dans cette voie. ― Vous avez l’intelligence de ce qu’il faut faire, et vous arriverez vite à tourner le dos aux Gauguins et [Van] Gogs ―
Veuillez remercie madame Bernard, du bon souvenir qu’elle a bien voulu garder du signataire de cette lettre, un bon baiser de père Goriot aux enfants, tous mes Respects à votre bonne famille. »Lettre de Cézanne à Bernard, datée « Aix-en-Provence, 15 avril 1904 », Londres, The Courtaud Gallery.MS.1932.SC.1.1.1 à 1.1.3
House John, « Cézanne’s Letters to Émile Bernard », catalogue d’exposition The Courtauld Cézannes ; The Courtauld Gallery, Londres, The Courtauld Gallery, 26 juin – 5 octobre 2008, Londres, The Courtauld Gallery en association avec Paul Holberton Publishing, 2008, p. 148-149, reproduit.
Bernard Émile, « Souvenirs sur Paul Cézanne et lettres inédites », Mercure de France, tome n° 69, n° 248, 16 octobre 1907, p. 617-618.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 299-300.
Fin avril – 15 juin
Exposition d’une trentaine d’œuvres de Cézanne à la galerie Paul Cassirer à Berlin : Sonderausstellung Paul Cézanne.
Le catalogue n’a pas été retrouvé, mais un carton mentionne les dates « Mai bis 15. Juni 1904 ».
Sonderausstellung Paul Cézanne, Paul Cassirer Kunstausstellung, Berlin W., Victoriastrasse 35, « Mai bis 15. Juni 1904 ».
En fait, l’exposition était ouverte dès fin avril, d’après l’article de Kunstchronik du 29 avril et la lettre de Lovis Corinth du 23 avril (voir plus bas).
Parmi les œuvres exposées, FWN710-R138, FWN425-R147, FWN634-R237, FWN160-R486, FWN807-R635, FWN833-R663, FWN485-R683, et FWN686-R713 peuvent être identifiés, d’après l’article de Hans Rosenhagen dans Die Kunst.
D’après d’autres articles sur l’exposition, Bernhard Echte et Walter Feilchenfeldt, puis le catalogue en ligne de Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman et David Nash proposent les identifications d’œuvres suivantes (titres d’après ces articles) :
Zwiebel, Eier und Brot [FWN704–R082] Weg zwischen grünen Bäumen [FWN43-R085] Mauer einer Vorortvilla [FWN47-R088] Porträt Valabrègue [FWN399-R094] Mädchenbildnis in Grau, Weiß und lehmigem Braungelb [FWN418-R119] Krug, Flasche und Tassen [FWN710-R138] sans titre [FWN425-R147] Porträt Courbet [Boyer ?] [FWN428-R176 ?] Sonntagnachmittag [FWN634-R237] « Mon Jardin » [FWN92-R278] Schiffauslader [Geschäftsbücher] [FWN104-R293] Haus in Pontoise [FWN108-R308] Selbstporträt [FWN449-R383] Waldbrücke [FWN143-R436] sans titre [FWN160-R486] Blick auf ein Dorf im Grünen [FWN179-R493] Bucht in der Umgebung von Marseille [FWN188-R514] Mme Cézanne auf rotem Sessel [FWN447-R606] Stilleben vor Kommode [FWN807-R635] Äpfel und Kanne mit Blumendekor [FWN833-R663] Mme Cézanne en face [FWN485-R683] Kartenspieler [FWN680-R707] Kartenspieler [FWN686-R713] Korb mit Äpfeln [Geschäftsbücher] [FWN860-R800] Blättergemustertes Tuch und Äpfel [FWN877-R848] Äpfel in weisser Schale Blaue Meeresbucht mit Häusern und Schornsteinen Größere, ganz auf Blau gestimmte Landschaft Landschaft mit breiten Baumkronen und blauem Himmel Bucht in der Umgebung von Marseille Einige größere Landschaften mit bewegtem Terrain Gelbe Häuser an der Küste bei Marseille
Feilchenfeldt Walter, Warman Jayne et Nash David, The Paintings of Paul Cézanne. An online catalogue raisonné, http ://www.cezannecatalogue.com/exhibitions/. Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 520.
Revue de presse :
« Notes d’art. L’art de cour et l’art du ruisseau », Journal des débats politiques et littéraires, 116e année, n° 61, mercredi 2 mars 1904, p. 3.
« NOTES D’ART
L’Art de cour et l’Art de ruisseau
« L’Art, c’est moi ! » Ainsi parle l’empereur Guillaume II d’Allemagne, peintre, musicien, auteur dramatique, etc. Il a dit textuellement, rapporte-t-on : « Un Art qui se met en dehors des bornes que je trace n’est pas un Art ! » Les bornes impériales ! Le Péril jaune, tableau célèbre, montre celles que Guillaume a tracées pour la peinture. Mais Guillaume, en outre, a prononcé devant certaines œuvres modernes, que d’aucuns considèrent comme des chefs-d’œuvre, et, par exemple, devant nos impressionnistes les plus notoires, cette affirmation mémorable, qui est comme un commandement : « C’est de l’Art de ruisseau ».
Malheureusement, 1’« Art de ruisseau » compte en Allemagne une honnête multitude de prosélytes et d’approbateurs. Il est protégé par des personnalités considérables et, tout d’abord, par le duc de Weimar.
Si ouvertement, même, protégé par celui-ci que Guillaume, naguère, à ce que l’on conte, crut lui devoir dépêcher un diplomate pour tenter de le convertir à « l’Art de cour »… Le duc de Weimar envoya gentiment promener l’innocent diplomate, et cela fit un petit scandale fort réjouissant…
L’Art de ruisseau, se sentant assez robuste, n’attendait qu’une bonne occasion de se révolter.
Guillaume la lui offrit sans tarder. Par son ordre, les seuls peintres respectueux des bornes impériales, furent admis à participer à l’Exposition de Saint-Louis…
C’est alors que le Kunstlerbund se leva comme un seul homme.
Le Kunstlerbund c’est une Société nouvelle où s’est réfugié l’Art de ruisseau. C’est, opposée à la très académique Compagnie présidée par le peintre A. de Werner, la réunion de tous les artistes indépendants. Ceux-ci trouvèrent en la personne du comte Harry Kessler, ami personnel, je crois, du duc de Weimar, un défenseur éloquent.
Le comte Harry Kessler publia, dans une Revue berlinoise, Kunst und Kunstler, un article qui eut un retentissement extraordinaire. « Les plus hauts dignitaires de l’État, disait-il entre autres choses, semblent s’être entendus pour anéantir les artistes personnels afin de faire place à ceux de la masse. Il s’agit donc de réagir contre ce mouvement, d’assurer aux artistes de talent toute liberté et de leur permettre de tenir tête à la masse ».
Et, à propos de l’Exposition de Saint-Louis, il ajoutait :
« C’est un procédé assez grossier que d’en avoir fermé la porte aux peintres indépendants d’Allemagne, si l’on réfléchit surtout que dans les collections publiques ou particulières de l’Amérique, dans les musées de Chicago et de Boston, dans les collections Shaw, Vanderbilt, Havemayer, Mme Palmer et autres milliardaires, si l’on réfléchit, dis-je, qu’à côté des maîtres anciens, ce sont des artistes comme Millet, Corot, Delacroix, Puvis de Chavannes, Manet, Monet, Pissarro, Cezanne, qui dominent, bref les artistes qui ont su s’écarter des formules étroites et infécondes imposées par l’enseignement officiel. C’est d’Amérique que nous est venue, vers 1880, la consécration des impressionnistes ; depuis cette époque, en Allemagne, l’importation des tableaux français n’a fait que s’accroître ! Elle atteint aujourd’hui à plus de 4 millions de marks. C’est sans doute pour empêcher ce chiffre de diminuer que nous envoyons à Saint-Louis les Œuvres d’Anton von Werner et de sa suite ! »
Très adroit, le comte Harry Kessler, en terminant, appelait de tous ses vœux une génération future d’hommes politiques qui utiliseraient leur influence pour libérer l’art du joug de l’État, pour lui donner l’indispensable et sainte Liberté.
Et cet article fut adressé à tous les députés du Reichstag.
Spirituelle provocation qui ne manqua pas son but, qui, même, l’atteignit avec une force imprévue. Le Reichstag vit cette séance originale que les Débats ont signalée et dont on s’entretient encore un peu partout.
Ce ne fut pas une petite séance ! Elle dura bien six ou sept heures ! Et elle fut chaude, encore que les partisans de l’Art de cour se soient fait remarquer par leur silence. C’est à peine, en effet, s’il y eut discussion. Quelques réserves, çà et là, à propos de l’impressionnisme. Mais tous les orateurs parlèrent en faveur de la liberté de l’art et des indépendants : M. Spann, du Centre catholique ; le comte Oriola, national libéral ; M. Singer, socialiste ; le docteur Muller, libéral, etc.
Le docteur Muller, après avoir raillé spirituellement le chancelier de Bulow, « cancellarius elegantissimus et amabilis », lequel, consulté sur la situation faite aux indépendants à Saint-Louis, avait répondu « qu’il n’avait pas le temps de s’occuper de pareils détails », le docteur Muller, s’élevant à des considérations plus hautes, déclara :
« Partout l’art évolue dans le même sens. L’Allemagne seule resterait inerte au milieu de ce courant !… Mais qu’a donc produit cette esthétique de cour prussienne ! Des avortements ! Nulle œuvre vraie et sincère… On veut créer un art prussien à la glorification exclusive d’une maison souveraine. L’Art ne peut supporter cela. Nous, Allemands du Sud, nous protestons. À Munich, à Darmstadt, à Stuttgart, à Carlsruhe, à Dresde, à Weimar on ne veut pas de cette esthétique patentée et estampillée du cabinet impérial. »
Ce qui est en jeu, c’est le prestige artistique de l’Allemagne devant les nations. L’étranger ne doit pas croire que nous soyons sans résistance contre un vouloir autocratique. La vie d’un prince d’ailleurs est courte.
» Charles X, roi de France, disait : « Au théâtre je n’ai, comme tout bourgeois de Paris, que ma place au parterre. » Parole vraiment royale plus digne d’un Mécène souverain qu’un Sic voto, sic jubeo ! »
À son tour M. Singer dit :
« Après avoir lu la brochure émanant du Kunstlerbund, tout le monde est convaincu qu’il est temps, de laisser à la nouvelle école toute liberté dans le développement de ses forces et de mettre fin à cette protection d’État qui favorise une coterie…
Une seule personne a pu empêcher que l’art allemand soit représenté d’une façon digne à l’Exposition de Saint-Louis. Tout se concentre dans la volonté d’un seul… « Mes artistes… Mes acteurs ! » Messieurs, cette façon de commander à l’art et de le réglementer est inadmissible ! »
Sur quoi le ministre de l’intérieur est venu observer qu’on ne devait pas faire intervenir dans un pareil débat la personne de l’empereur… Et l’on ne peut qu’admirer l’ingénuité de cette observation.
Telle est cette petite histoire, qui est de l’Histoire.
ÉDOUARD SARRADIN. »
Lettre de Lovis Corinth à Charlotte Corinth, 23 avril 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 495 :
« […] Dienstag, glaube ich ist die Eröffnung [der Secession] […]. Außerdem hat Cassirer eine Ausstellung, die wohl einzig in ihrer Art ist, einen ganzen Saal und eine Vorderstube von Cezanne. Ich möchte haben, daß Du die Sachen siehst. Es ist sehr lehrreich und für das ganze Leben. […] Gestern übrigens ist sie zuerst eröffnet. »
Traduction :
« C’est mardi, je crois, l’ouverture [de l’exposition de la Sécession] […]. De plus, Cassirer a une exposition qui est probablement unique en son genre, une salle entière et un vestibule consacrés à Cezanne. Je voudrais savoir si tu peux la visiter. C’est très instructif et pour toute la vie. […] Hier, d’ailleurs, c’était déjà ouvert. »
« Au jour le jour. Paris à Berlin », Journal des débats politiques et littéraires, 116e année, n° 118, mardi 26 avril 1904, p. 1 :
« Paris à Berlin. M. de Moltke, parent du maréchal défunt, a fait à la Chambre prussienne l’éloge des artistes français. Comme un autre député demandait au ministre d’écarter de la Galerie nationale les ouvrages étrangers, M. de Moltke a blâmé cette étroitesse d’esprit comme nuisible au développement des arts. On sait avec quelle persévérance M. Tschudi enrichit son musée de belles œuvres françaises. Cela ne va point sans opposition, et notamment, dit-on, de la part de l’empereur. Cependant, une de ses acquisitions les plus récentes, l’Âge d’airain, de Rodin, enlève tous les suffrages. Ce bronze est provisoirement placé dans une salle où vient d’être accrochée une grande Entrée à Pékin du maréchal de Waldersee, dont l’auteur est M. Rocholl, « peintre plénipotentiaire » envoyé en Chine « avec mission spéciale » par l’empereur Guillaume II. L’une des œuvres nuit à l’autre, et le peintre plénipotentiaire souffre du voisinage. À côté de son tableau sont exposés deux Goya qui ne le servent pas mieux. Il faut monter à l’étage.supérieur pour retrouver un coin de Paris. Là, on peut admirer d’autres bronzes de Rodin, les bustes de Dalou et de Falguière, et toutes les belles toiles françaises rassemblées par M. Tschudi. Manet et Monet, Degas et Cezanne, Sisley et Pissarro y sont brillamment représentés, comme aussi Daubigny, Diaz, Millet, Courbet, Fantin-Latour. En ce moment, les visiteurs regardent et admirent d’autant plus ces ouvrages, que M. de Moltke vient de leur faire une éclatante réclame. Il faut reconnaître d’ailleurs que le député de province qui a demandé leur expulsion ne voulait point les proscrire, mais seulement les reléguer dans un musée spécial. M. de Moltke a sagement répondu que la comparaison immédiate d’œuvres des diverses écoles ne pouvait qu’être féconde et donner d’utiles enseignements. Il suffit, en effet, d’examiner, après un portrait de M. Fantin-Latour, celui du Général Alvensleben par le fameux directeur de l’Académie, M. Auton de Werner, pour sentir tout ce qui manque à la vieille peinture officielle d’Allemagne. Un pèlerinage au « coin de Paris » peut donc être à la fois un plaisir artistique et une bonne leçon. »
B. [Oscar Bie], « Hier und dort », Berliner Börsen-Courier, n° 191, 29 avril 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 495. Trancrire (traduire)
« Von Gemäldeausstellungen ist zunächst zu erwähnen die Sammlung von Cezanne’s bei Cassirer. Das ist ein ebenso berühmter wie schlechter Impressionist. Sein Farbensinn ist eigen und auf guten Wegen, aber er hat nie verstanden, eine äußere Balance für seine Vorstellungen zu finden. Er ist culturlos. Die Culturlosigkeit Munch’s zum Beispiel ist besser. Sie bringt uns weiter. Sie reizt und regt an. Darum ist Cezanne kaum noch von gegenwärtiger Bedeutung und durch spätere interessantere Anfänger-Naturen zurückgedrängt. Auf eine gute Copie, die der geschickte Spiro im selben Salon von Manet’s berühmter Olympia ausstellt, ist aufmerksam zu machen. »
Traduction :
« Des expositions de peinture, mais tout d’abord parlons de la collection de Cezanne de Cassirer. Voici un peintre tout aussi célèbre, mais le pire des impressionnistes. Son sens de la couleur est intrinsèquement correct, mais il n’a jamais su trouver un équilibre externe pour ses idées. Il est inculte. Le manque de culture de Munch, par exemple, est meilleur. Il nous amène plus loin. Il excite et stimule. Par conséquent, Cezanne est à peine encore repoussé d’importance actuelle et futures natures recrues intéressantes. Sur une bonne copie, délivré par le Spiro habile dans le même salon de la célèbre Olympia de Manet, est d’attirer l’attention. »
« Ausstellungen », Kunstchronik, 29 avril 1904, p. 382.
Rosenhagen Hans, « Von Ausstellungen und Sammlungen », Die Kunst (Kunst für alle), xixe année, cahier 17, 1er juin 1904, p. 401-403. Transcrire = revoir la traduction.
Oeuvres identifiées par Feilchenfeldt Warman Nash : R 147, 237, 635 ?, 663, 683, 713. Trancrire (traduire)« VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN
BERLIN. Je weniger ein Künstler die Wirklichkeit durch die Bilder anderer sieht, um so unverständlicher erscheint er natürlich denen, die sie überhaupt nur aus Bildern kennen. Diese Tatsache erklärt es, warum einer der stärksten Künstler des neunzehnten Jahrhunderts, Paul Cezanne, jahrzehntelang nicht die geringste Anerkennung finden und unbemerkt bleiben konnte. Selbst Zola, dem man gewiß nicht zu großen Respekt vor dem Gewohnten nachsagen kann, war am Ende nicht mehr fähig, dieser voraussetzungslosen Kunst zu folgen. Dem Künstler, dem er in der Gestalt des Claude im l’Oeuvre ein so eigenartiges Denkmal gesetzt, nennt er später einen großen, nicht gereiften Maler. Der Pariser Centennale verdankt man die Wiederentdeckung Cezannes. Seine Arbeiten im Saal der Impressionisten ließen erkennen, wie stark er ist. Manet wirkte neben ihm elegant, Monet dekadent, Sisley süß und Pissarro fast schwach. Man begann seine Größe zu begreifen und, da man seinem Schaffen näher trat, konnte man feststellen, daß er der eigentliche Pfadfinder des Manetschen Kreises gewesen, daß seine Wirkung auf das jüngere Künstlergeschlecht augenblicklich ganz außerordentlich ist und erst im Beginn steht. Eine ganze Reihe moderner Künstler, an deren Spitze sich Vuillard und Bonnard befinden, sind bemüht, seine herbe Kunst dem Publikum mundgerechter, verständlicher zu machen. Nachdem schon wiederholt einzelne Bilder von ihm im Salon Cassirer gezeigt und vom Publikum und vom größten Teil der Kritik entschieden abgelehnt worden waren, mußte einmal der Versuch gemacht werden, durch eine umfassendere Ausstellung die Bedeutung Cezannes den Kunstfreunden darzulegen. Im Salon Paul Cassirer ist nun eine große Kollektion seiner Werke ausgestellt, die einen vollständigen Ueberblick über die Entwicklung des Künstlers gestattet. Die vorgeführten Arbeiten stammen vielfach aus Privatbesitz. Cezanne begann mit Bildern, die ein spanisches Cachet haben, mit schweren, schwärzlichen Farben gemalt und von einer erstaunlichen Plastik sind. Aber schon in diesen ersten Werken kündigt sich in der Fülle der Nuancen ein großer Kolorist, in der Pinselführung und im Anpacken des Stoffs ein kolossales Temperament an. Das Porträt des Schriftstellers Valabrègue, teilweise gespachtelt, hat ein unheimliches Leben im Ausdruck des etwas vorgebeugten Kopfes mit den dunklen Augen, und niemals ist der schwarze Sammet eines Rockes schöner, tiefer und lichtsaugender gemalt worden als hier. Von ähnlicher Qualität sind ein paar aus derselben Zeit — etwa Mitte der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts — stammende Stillleben, in denen die Farben Schwarz, Weiß, Gelb vorherrschen. Etwas später erschienen schon einige Landschaften, in denen die Natur, besonders das Grün der Bäume und Wiesen mit einer verblüffenden Unbefangenheit wiedergegeben ist. Cezannes Koloristik richtet sich zu ihrer vollen Schönheit, ihrem ganzen Reichtum aber zunächst in Stillleben auf. An Blumen und Früchten lernt der Künstler der Natur das Geheimnis ab, eine starke Farbe aus einer Unzahl feiner Töne und Untertöne zu bilden. Seine Aepfel sehen rot, grün, gelb aus. Man meint, die Farbe sei einfach hingestrichen. In Wirklichkeit ist sie aus lauter Nuancen ineinander gemalt, die Einfachheit also nur scheinbar. Dabei ist die sorgsamste Rücksicht aufdas Material genommen. Seit den Holländern des 17. Jahrhunderts ist die Stofflichkeit der Objekte nicht liebevoller zur Darstellung gebracht worden, nur daß die Bilder von Cezanne nicht fein und delikat ausgepinselt, sondern von einer leidenschaftlichen Hand mit Kraft auf die Leinwand geworfen sind. Ein Glanz, eine Pracht der Farbe ist diesen Stillleben eigentümlich, die mit nichts Bekanntem, außer mit der Natur selbst verglichen werden können. Alles ist gesehen und erlebt. Das gilt in noch höherem Maße von den Landschaften, bei denen die Materialität der Farbe mit der fortschreitenden Entwicklung des Künstlers mehr und mehr aufgehoben erscheint. Sieht man in den frühen Naturschilderungen Cezannes die Mauer einer Vorortvilla etwa mit der Liebe gemalt, mit der Rembrandt die verwetterten Züge eines Greisenantlitzes schildert, mit einem Feingefühl ohne gleichen Ton zu Ton gesetzt, so malt er zum Schluß nur noch mit einzelnen Farbenflächen und Luft und einigen Konturen. Die Wirkung ist in allen beiden Fällen erstaunlich ; aber die späten Landschaften des Künstlers übertreffen an Wahrheit des Ausdrucks, an Feinheit der Stimmung, an Fülle und Kraft der Farbe nicht nur alles, was man sonst kennt, sondern auch Cezannes frühere Leistungen. Aber man könnte ebenso leicht den Duft des Veilchens mit Worten schildern, als das Aussehen dieser Bilder nach der farbigen Seite. Ueber nicht wenigen von ihnen lagert eine ungeheure Melancholie ; hier am stärksten vielleicht auf der kleinen Bucht in der Umgebung von Marseille und einigen größeren Landschaften mit bewegtem Terrain. Die Figurenbilder Cezannes üben auf das Publikum die abschreckendste Wirkung aus ; aber je öfter man besonders die Porträts betrachtet, um so schöner werden sie. Mit einem unerhörten Feingefühl ist der Charakter herausgeholt und auf koloristischem Wege eine Stimmung über diese Menschendarstellungen ausgegossen, die sie unvergeßlich macht. Er hat sich selbst gemalt dieser unruhige Geist mit seinem wirren, ergrauenden dunklen Bart, den blitzenden, etwas mißtrauischen Augen, den lebhaft gefärbten Wangen und dem mächtigen, kahlwerdenden Schädel. Ganz wundervoll ist das Bildnis einer blonden, zarten Frau, die, en face, eine Spitzmantille über den Schultern, die Hände im Schoß, ruhig dasitzt. Mit fast einem Nichts von Mitteln ist das Stoffliche der Haut, des Haares, der Kleidung gegeben. Um den Mund herum gibt es direkt ein Grün ; aber es hat keinen anderen Zweck, übt keine andere Wirkung aus, als daß es die zarte Bildung des Gesichts modelliert und die Delikatesse des Teints zur Geltung bringt. Dann sind zwei Bilder da mit kartenspielenden Arbeitern. Welche Beobachtung steckt darin ! Wie sind die sonnengebräunten Gesichter und Hände, die von Regen und Sonne verfärbten Röcke gemalt ! Ein et, eine graues Jacket, eine gelbe Wachstuchdecke sind Wunder der Farbe und Malerei. Alles sieht roh und grob aus und ist doch von einer Feinheit, einer neuen Schönheit, welche diese Bilder über alles Aehnliche erhebt erhebt. Man muß sich bei diesen Arbeiten, bei den Porträts und den Stilleben, über manche Mängel der Zeichnung fortsetzen, Es kommt Cezanne nicht darauf an, unmögliche perspektivische Verkürzungen zu produzieren, die von der oberen Oeffnung eines elfach für Stilleben benutzten grünen Kruges durch Verkürzung gebildete Ellipse viereckig darzustellen oder unmögliche Aufsichten zu geben ; aber man ergißt dergleichen vollkommen über seiner großartigen Malerei. Seine unwahrscheinlichen Flächen haben ein Leben der Farbe, das wahrhaft zauberhaft ist, ohne die Grenzen des Wirklichen zu verletzen. Alles ist umgeben von Luft und Licht. Und nichts ist kleinlich gemacht oder wirkt so. Im Gegenteil : Cezannes Bilder sind dekorativ fest in monumentalem Sinne und bei aller äußerlichen Derbheit ganz hochstehende Geschmacksäußerungen. Seine Farben mögen so stark und leuchtend sein, wie sie wollen — niemals schreien seine Bilder. Er hat hier eine Frühlingslandschaft mit blauer Luft, blauem Wasser, weißem Segel, grünen Wiesen und Bäumen und buntgekleideten Menschen, die phantastisch schlecht gezeichnet sind. Die Aehnlichkeit mit Böcklin ist frappant ; aber der Franzose dem Schweizer Meister an Kultur unendlich überlegen. Daß er trotz dieser Kultur wie ein eben mit reinen, unverbrauchten, unverdorbenen Sinnen aus der Hand des Schöpfers hervorgegangener Mensch wirkt, daß man ihn in allem, in seinem Geschmack, wie in seiner Art, den Pinsel zu führen, als eine « Natur » im Goetheschen Sinne aus dem geringsten seiner Werke empfindet, ist das beste Zeugnis für seine Größe. Und die Zeit, wo diese öße nicht bloß von einem kleinen Kreis anerkannt wird, dürfte näher sein als man heute glaubt.
Hans Rosenhagen »
Traduction :« DES EXPOSITIONS ET COLLECTIONS »
BERLIN. Le moins une réalité artiste à travers des tableaux d’autres regards, le plus incompréhensible, il semble naturel pour eux qu’ils ne connaissent que des tableaux. Cela explique pourquoi l’un des artistes les plus forts du dix-neuvième siècle, Paul Cezanne, n’a pas trouvé depuis des décennies la moindre reconnaissance et pourrait passer inaperçu. Même Zola, qui ne peut certes pas être accusé de trop de respect pour son ami, n’était plus en mesure à la fin de suivre cet art inconditionnel. Pour l’artiste, qui a mis un tel monument particulier dans l’Œuvre sous la forme de Claude, qu’il appelle plus tard un grand peintre non mature. On doit à l’Exposition centennale à Paris la redécouverte de Cezanne. Son œuvre dans la salle des impressionnistes a révélé à quel point il est fort. Manet avait l’air élégant à côté de lui, Monet décadent, Sisley, Pissarro doux et presque faibles. Ils ont commencé à comprendre sa taille et parce que vous s’approcha de son travail, vous pourriez voir qu’il était Scouts réelles du cercle de Manet, que son effet sur la jeune artiste instantanément entre les sexes est tout à fait extraordinaire et est seulement au début. Un certain nombre d’artistes modernes, dirigés par Vuillard et Bonnard se trouvent, se sont engagés à faire de son art austère de faire de l’audience petites bouchées, compréhensible. Après avoir été à plusieurs reprises des images individuelles ont été montré de lui dans le salon Cassirer et rejetée de manière décisive par le public et par la plupart des critiques, une fois l’expérience, l’importance de Cezanne a dû être faite par une exposition plus complète pour expliquer les amateurs d’art. Dans le salon, Paul Cassirer une grande collection de ses œuvres est maintenant sur l’écran, ce qui permet une étude complète de l’évolution de l’artiste. Les mesures effectuées œuvres proviennent souvent de collections privées. Cezanne a débuté avec des tableaux dans la veine espagnole, il a peint avec des couleurs sombres, lourdes et dotées d’une plasticité étonnante. Mais même dans ces premières œuvres, la richesse de leurs nuances annonçait un grand coloriste, et le coup de pinceau, ainsi que la conception, un caractère très personnel. Le portrait de l’écrivain Valabrègue [Portrait d’Antony Valabrègue, R 147], en partie exécuté au couteau à palette, montre une vie incroyable dans l’expression de la tête légèrement penchée vers l’avant, les yeux sombres. Le velours noir de la veste n’a jamais été peint de façon plus belle, plus profonde et plus lumineuse. De qualité similaire sont quelques-uns de la même période — le milieu des années soixante du siècle dernier -— dérivent Still Life, dans lequel les couleurs noires, blanches, jaunes prédominent. Un peu plus tard, déjà publié des paysages où la nature, en particulier le vert des arbres et de prairies avec candeur étonnante est reproduite. Le coloriste de Cezanne dirigé à sa beauté, sa richesse, mais la première fois dans la vie toujours sur. De fleurs et de fruits, l’artiste apprend de la nature le secret pour former une couleur forte d’une multitude de tons et des nuances fines. Ses pommes apparaissent en rouge, vert, jaune. On pense que la couleur a été juste soufflé peint. En réalité, il est peint de couleurs pures dans l’autre, la simplicité n’est qu’apparente. La plus grande attention est prise matériau aufdas. Depuis les Hollandais au xviie siècle, la matérialité des objets n’a pas été soigneusement mis à la représentation, mais seulement que les images de Cezanne pas bien et ausgepinselt délicate, mais jeté par une main passionnée avec vigueur à la toile. Un éclat, une splendeur de la couleur est toujours cette vie particulière à cela. Familier avec rien, sauf avec la nature peut être comparé, même Tout est vu et vécu. Cela s’applique à une plus grande mesure par les paysages dans lesquels la matérialité de la peinture avec le développement progressif de l’artiste apparaît levée de plus en plus. Vu dans les premières descriptions de la nature Cezanne le mur d’une villa de banlieue peint sur de l’amour avec lequel Rembrandt Les caractéristiques météorologiques battus d’un vieillard visage représente, ensemble avec un sens bien sans le même ton de voix, de sorte qu’il ne peint la fin de chaque espace couleur et de l’air et certains contours. L’effet est incroyable dans tous les deux cas ; mais la fin des paysages de l’artiste dépassent la vérité d’expression, d’évaluer l’humeur de plénitude et de puissance de la couleur non seulement tout autre sait, mais aussi d’anciens services Cezanne. Mais vous pouvez tout aussi facilement décrire le parfum de violette avec des mots, comme l’apparition de ces images par le côté coloré. A propos de tout à fait un peu d’entre eux prend en charge une grande mélancolie ; ici probablement sur la petite baie dans la région de Marseille et des paysages plus grandes avec le déplacement du terrain. Les tableaux de figures de pratique Cezanne à l’audience de l’effet abschreckendste ; mais plus vous en particulier en regardant les portraits, plus ils sont beaux. Avec un sens aigu sans précédent de caractère est sorti et versé sur un chemin coloriste humeur sur ces figures humaines, ce qui les rend inoubliables. Il s’est peint cet esprit agité avec son embrouillé, barbe grisonnante sombre, le clignotement, quelque chose des yeux méfiants, les joues aux couleurs vives et le puissant, le crâne chauve lui-même. Très belle est le portrait d’une blonde, femme délicate, de face, un Spitzmantille sur les épaules, les mains sur les genoux, assis tranquillement. Avec près d’un Aucun des ressources matérielles de la peau, les cheveux, les vêtements est donnée. Autour de la bouche, il est directement un vert ; mais il n’a pas d’autre but, exerce d’autre effet que que les modèles informatiques de la formation délicate du visage et apporte la délicatesse de teint à son avantage. Puis, deux images sont là avec les travailleurs carte-jeu. Que l’observation est en elle! Comment sont les visages et les mains bronzées, le décoloré par la pluie et le soleil jupes peints! A et une veste grise, une toile cirée jaune sont des merveilles de couleur et de peinture. Tout semble brut et rugueux, mais est d’une finesse, une nouvelle beauté, qui recueille ces images sur tous les hausses similaires. Vous devez continuer ce travail, avec des portraits et nature morte, sur certaines lacunes du dessin, Il vient Cezanne pas d’importance pour produire un raccourci de perspective impossible, l’ellipse formée par l’ouverture supérieure d’un elfach utilisé pour pichet vert encore la vie en raccourcissant représenter carré ou impossible de donner des supervisions ; mais vous ergißt comme complètement sur son magnifique peinture. Ses surfaces improbables ont une durée de vie de la couleur qui est un véritable enchantement, sans violer les frontières de la réalité. Tout est entouré par de l’air et de la lumière. Et rien n’est fait ou petits actes de cette façon. Au contraire, les tableaux de Cezanne sont décoratifs fermement dans le sens monumental et dans tous les franc-parler externe remarques très haut goût. Ses couleurs peuvent être aussi fort et lumineux comme ils veulent – jamais crier ses photos. Il y a ici un paysage de printemps avec de l’air bleu, de l’eau bleue, des voiles blanches, du gazon, des arbres verts et des gens en costume bariolé, qui sont incroyablement mal dessinés [Les Pêcheurs – Journée de juillet (R 237)]. La ressemblance avec Böcklin est frappante ; mais le Français est infiniment supérieur au champion suisse dans la culture. Malgré la culture, il apparaît comme un homme pur, non corrompu, sorti directement de la main du Créateur. Dans tout, son goût et la manière qu’il a de tenir le pinceau, on sent une « nature », dans le sens que Goethe donne à ce terme, et ce dans la moindre de ses œuvres, ce qui est la meilleure preuve de sa grandeur. Et le temps où celle-ci sera reconnue, non plus seulement par un petit cercle, devrait être plus proche qu’on ne le croit aujourd’hui.
Hans Rosenhagen »
Dr Glaser Curt, « Aus dem Berliner Kunstleben », Hamburgischer Correspondent, n° 203, 1er mai 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 495-498. Trancrire (traduire)
« Im Kunstsalon von Paul Cassirer ist es jetzt noch stiller als sonst. Mag sein, daß es der nahende Sommer mit seinen großen Ausstellungen ist, der schon im voraus das Interesse für die kleineren Veranstaltungen schmälert. Oder drang schon eine Stimme ins Publikum, daß dort Bilder zu sehen sind, die nicht so gar leicht und freiwillig ihren Gehalt hergeben, die anspruchsvoll genug sind, zu verlangen, daß man zu ihnen gehe und wieder und wieder komme, langsam und immer ernster sich hineinzusehen in diese Werke unergründlich tiefer Kunst? Und ist schon jene Parole der Abwehr ausgegeben, welche lautet: nicht beachten?
Aber für alle, die Augen haben, zu sehen, gibt es dort eine von den ganz seltenen, künstlerischen Offenbarungen. Es ist Zolas Freund Paul Cezanne, von dem zum ersten Male hier eine größere Zahl von Bildern zusammengebracht ist. Bis vor kurzem waren es nur ganz wenige in Deutschland, die diesen Namen nur einmal gehört hatten. Noch Muther konnte in seiner « Geschichte der neuen Malerei » und sogar noch in dem Buch, das er nach der Weltausstellung im Jahr 1900 erscheinen ließ, ihn ganz verschweigen. Inzwischen brachten die Wiener Impressionisten-ausstellung und die vorjährige Ausstellung der Berliner Sezession Werke Cezannes, die einen tiefen Eindruck hinterließen. Es war zumal ein Selbstportrait des Künstlers, von dem auch an dieser Stelle die Rede war. Das Bild besaß etwas merkwürdig Eindringliches. Und wer es einmal gesehen, der wird die Züge dieses Mannes nie wieder verlieren. Dabei ist etwas Unfertiges in dem Bilde. Es ist, als wäre nur eben gerade die Untermalung beendet. Aber nicht etwa, als ob der Eindruck des flüchtigen, schnell Gemachten aufkäme. Man empfindet, daß dieser Mann Stunden und Stunden vor der Leinwand stehen konnte und denken und prüfen, ehe er einen einzigen dieser breiten Farbflecke hinsetzte. Er ist der Raffael, der ohne Arme geboren wurde. Er hat den Kopf und die Hand eines derben Handwerkers, nein, eines Bauern, eines Erdarbeiters, denn es ist so gar nichts in ihm, das an Handfertigkeit, an Geschicklichkeit zu erinnern vermöchte. Und in diesen Körper ist eine hohe Künstlerseele gelegt, in diesem breiten, stierennackigen Kopfe, unter diesem runden, kahlen Schädel wohnen zwei Maleraugen. Wenn Kunst nur von Können kommt, dann ist dieser Mann kein Künstler. Aber wenn Kunst mehr bedeutet als das, wenn es der Funke des Göttlichen ist, das Feuer, das Prometheus vom Himmel her den Menschen brachte, dann allerdings gehört Cezanne zu den wenigen Gottbegnadeten.
Soll man seinen Namen in einen der hergebrachten Kästen der Kunsthistorie einordnen, so wird man nicht anders können, als ihn neben Manet und in die Reihe der Impressionisten [zu] setzen. Aber er ist nicht einer unter den anderen, sondern man möchte sagen, daß er wie ein Chronos vor Jupiter, so noch vor Manet, dem Gotte der übrigen, steht. Er hat am intensivsten von allen die Aufgabe neuer Kunst erfaßt, Darstellung von Luft und Licht. In dieser Aufgabe erschöpft sich das Werk seines Lebens. Nicht, daß er eine Lösung gegeben hätte, wie sie jeder der anderen fand, um das einmal Gefundene zu seinem Stile umzubilden. Er hat im Keime jede einzelne dieser mannigfachen Lösungen des schwierigen Problems für sich errungen. Aber niemals befriedigt, stellt ihn sein Genius vor immer neue Fragen. Man könnte einen Pissarro gar nicht mehr ansehen, wenn man von diesen wuchtig schweren Malereien kommt. Und wenn man an die Pissarro-Ausstellung denkt, die vor kurzem hier stand, so fragt man wohl zweifelnd: Wozu diese zahllosen Bilder, wenn der Mann doch nichts zu sagen wußte als einen einzigen Satz. Und selbst Manet erscheint zu glatt und zu virtuos, wenn man Cezanne gesehen hat. Man hat Gelegenheit auch zu diesem Vergleich, denn es hängt da eine recht gute Kopie der berühmten Olympia des Luxembourg. Eugen Spiro ist der Maler des Bildes, und man fragt sich verwundert, wie einer, der so mit schlichter Liebe eines der reinsten Werke der Malerei studiert hat, ganz und gar kritiklos die schlechten Bilder eigener Mache zur Ausstellung bringen kann.
Sollte ich für Cezanne einen Vergleich suchen, so würde ich zuerst an Hans von Marées denken, auch dieser ein Künstler, dem nichts mangelte als das oberflächliche Können, um der Größten einer zu sein, und den doch auch vielleicht gerade dieser Mangel davor bewahrte, sich irgendwo zufrieden zu geben, die Arbeit einzustellen, anstatt immer neue Offenbarungen seinem Genius abzuringen. Oder man könnte an Eduard Munch denken. Aber wenn dieser alles nur auf das psychologische Moment spannt und dann allerdings erstaunlich packende Darstellungen bringt, so ist Cezannes Wollen nur auf rein malerische Werte eingestellt. Was beiden gemeinsam ist, das ist eine gewisse Vereinfachung der Form. Aber wenn das bei Munch ein vorsichtig gewähltes Mittel zur Erreichung eines in aller Bewußtheit gesteckten Zieles ist, wenn es andererseits von Munch Radierungen gibt von peinlicher Sorgfalt und Sauberkeit der Zeichnung, so ist für Cezanne diese Art nichts als die natürliche Grenze seines Könnens. Eine Schwäche also, wenn man will. Um so erstaunlicher aber, wenn noch innerhalb dieser Begrenzung eine große Kunst sich emporzuringen vermag.
Was Cezanne malt, sind die einfachsten Dinge von der Welt: Landschaften, Stillleben, Menschen. Bezeichnend zumal seine Stilleben. Da gibt es immer wieder dieselben Äpfel, ein weißes Tuch, eine graue Tonvase mit grüner Überlaufglasur, die auf vielen Bildern wiederkehrt, oder ein Brot, ein paar Eier. Und wenn er Blumen malt, dann ist es nicht der feine Fliederstrauß Manets, sondern dicke Wiesenblumen. Nur einmal gibt er ein Bild, das literarisch zu umschreiben wäre. Es ist wohl ein Sommertag an der Seine. Und mit ganz wenigen Mitteln ist da eine Farbenpracht hervorgezaubert, wie sie Böcklin nur selten gelang, eine Bewegtheit in den Figuren, die mit wenig derben Strichen hingesetzt sind, wie sie nur Degas mit ganz anderen Mitteln zu geben wußte. Dabei fehlt es nicht an Verzeichnungen in Linie wie in Farbe. Es kommt vor, daß den Dingen ein widersinniger Grad an Materialität gegeben wird. Aber das ist das Menschliche am Kunstwerk, und gerade das oft ein unentbehrlicher Faktor seiner Wirkung. Nicht anders ist es, wenn uns heut endlich Dürer mehr bedeutet als Raffael. Es ist nicht die restlose Vollendung, die mühelose Lösung einer Aufgabe, die uns anzieht, sondern es ist das ganz menschliche Ringen nach immer neuen, immer höheren Zielen, das unser Innerstes mitschwingen macht. […]
Zola hat seine ersten Kritiken « seinem Freunde Paul Cezanne » zugeeignet. Aber nicht von ihm, sondern von Manet ist die Rede. Cezanne selbst heißt ein « unfertiger Künstler ». Vielleicht wird die Geschichte einmal nicht anders urteilen dürfen. Wir heut haben das Glück, Mitlebende zu sein. Und wenn uns die Kunst unserer Zeit im ganzen Umkreis, noch ungesichtet von der Geschichte vorliegt, so wollen wir die Gelegenheit nicht versäumen, den Offenbarungen eines hohen Künstlergeistes willigzufolgen. »Traduction :
« Le salon d’art de Paul Cassirer est encore plus silencieux que d’habitude. Il se peut que ce soit dû à l’approche de l’été, avec ses grandes expositions qui réduisent l’intérêt pour les plus petits événements. Ou déjà pénétré d’une voix à l’auditoire qu’il ya à voir des images qui ne sont pas tellement la lumière et volontairement renoncer à leur contenu, qui sont suffisamment sophistiqués pour exiger que vous allez à eux et à nouveau et revenir, lentement et toujours plus grave pour regarder dans ces œuvres d’art insondable profondeur? Et affiche déjà le slogan de la sortie de la défense, qui est : pas observé?
Mais pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, il est l’un des très rares, des révélations artistiques. Il est l’ami de Zola Paul Cezanne, est réuni par la pour la première fois ici un plus grand nombre de tableaux. Jusqu’à récemment, il y avait très peu en Allemagne qui avaient déjà entendu son nom. Encore Muther était dans son « Histoire de nouvelle peinture» et même dans le livre qu’il avait publié après l’Exposition universelle en 1900, lui cacher entièrement. Pendant ce temps, mettez l’exposition impressionniste Wiener et l’exposition de l’an dernier, des œuvres de Cezanne Sécession de Berlin, qui ont laissé une impression profonde. Il était en particulier un autoportrait de l’artiste, il était question de le bien à ce moment. L’image avait une étrange hantise bits. Et que celui qui une fois vu, va perdre les traits de cet homme jamais. Voici quelque chose d’inachevé dans l’image. Il est comme si juste maintenant terminé la sous-couche. Mais pas, comme si l’impression de l’volatile, aufkäme rapide Made. On sent que cet homme pouvait se tenir des heures et des heures devant l’écran et de penser et de considérer avant de se asseoir une de ces grandes taches de couleur. Il est le Raphaël, qui est né sans bras. Il a la tête et la main d’un de débauche, non, un agriculteur artisan, un terrassier, parce qu’il n’y a absolument rien dans ce qui serait capable de se rappeler des compétences de la main à l’habileté. Et dans ces organismes ont une âme artistique de haut est placé, vivant dans ce vaste tête, cou de taureau, en vertu de cette ronde, tête chauve deux peintres yeux. Quand l’art vient seulement de capacité, alors cet homme est pas un artiste. Mais si l’art est plus que cela, si elle est l’étincelle du Divin, le feu que Prométhée du ciel les gens apportaient, mais alors Cezanne l’un des rares Gottbegnadeten.
Faut-il classer son nom dans l’une des cases traditionnelles de l’histoire de l’art, de sorte que vous aurons pas le choix, mais, comme le mettre à côté de Manet et les rangs des impressionnistes. Mais il est pas un parmi l’autre, mais on peut dire qu’il est comme un Chronos avant Jupiter, donc avant même de Manet, le dieu du reste. Il a saisi la tâche du nouvel art la plus intense de tous, la représentation de l’air et de la lumière. Dans cette tâche, le travail de sa vie épuisée. Non pas qu’il aurait été une solution, comme ils ont pris l’autre à celui trouvé sur remanier ses styles. Il a remporté dans chacun de ces germes de solutions multiples pour le difficile problème de sa propre. Mais jamais satisfait, son génie lui permet toujours de nouvelles questions. On ne pouvait plus regarder un Pissarro, si vous venez de ce puissant peintures lourds. Et quand on pense à l’exposition Pissarro, qui était ici récemment, alors on se demande probablement douteuse : Pourquoi ces innombrables images quand l’homme rien à dire, mais connaissaient comme un seul ensemble. Et même Manet semble lisser et la virtuosité, à en juger par Cezanne. On a l’occasion également de cette comparaison, car il dépend comme une assez bonne copie de la célèbre Olympia de Luxembourg. Eugen Spiro est le peintre de l’image, et vous vous demandez dans la stupéfaction, comme celui qui a étudié de manière avec un simple amour des œuvres les plus pures de la peinture, peut entièrement sans discernement apporter les mauvaises images Faites votre propre exposition.
Devrais-je chercher pour Cezanne une comparaison, je voudrais d’abord penser à Hans von Marées, cela a aussi un artiste qui ne manquait de rien que des compétences superficielles à la plus grande d’être l’un, et pourtant peut-être aussi gardé ce manque avant, lui-même quelque part heureux de donner à cesser le travail, plutôt que de toujours de nouvelles révélations arracher son génie. Ou vous pourriez penser à Edward Munch. Mais si cette toute tendue au seul moment psychologique et puis, cependant, apporte étonnantes représentations de préhension, puis Cezanne voulait mettre uniquement sur des valeurs purement picturales. Ce qui est commun, ceci est une certaine simplification de la moule. Mais si un moyen soigneusement choisis de la réalisation d’un branché toute objectif de sensibilisation est à Munch, si d’autre part des gravures de Munch de soin méticuleux et la propreté du dessin, de sorte est pour Cezanne cette façon rien que la limite naturelle de sa capacité. Une faiblesse, donc si vous voulez. D’autant plus surprenant, cependant, quand un grand art peut être emporzuringen même au sein de cette limitation.
Qu’est-ce que les peintures de Cezanne sont les choses les plus faciles dans le monde : des paysages, des natures mortes, des personnes. Significativement en particulier ses natures mortes. Comme il ya toujours les mêmes pommes, un drap blanc, un vase de poterie grise avec le débordement de glaçure verte qui revient dans de nombreuses photos, ou une miche de pain, des œufs. Et quand il peint des fleurs, alors il est pas l’amende bouquet de lilas Manet, mais épaisses fleurs prairie. Une seule fois, il donne une image qui circonscrire littéraire. Il est probablement un jour d’été sur la Seine. Et avec très peu de moyens d’un flamboiement de couleurs est aussi évoquée comme Böcklin rarement réussi, une émotion dans les caractères qui sont assis à petits coups rudes, comme elle a su donner à tous les autres moyens que Degas. Il ne manque pas de distorsion dans la ligne comme dans la couleur. Il arrive que les choses un degré absurde est donné à la matérialité. Mais qui est le travail de l’homme de l’art, et que ce qui est souvent un facteur indispensable dans son effet. Il est pas différent quand nous avons finalement signifie Dürer aujourd’hui plus que Raffael. Il est pas le reste de la pleine mise en œuvre, la solution facile à un problème qui nous attire, mais il est très humain de la lutte pour de nouveaux objectifs toujours plus élevés, ce qui fait vibrer notre moi intérieur. […]
Zola a ses premiers commentaires, « son ami Paul Cezanne » approprié. Mais pas par lui, mais par Manet est question. Cezanne lui-même est un «artistes inachevés». Peut-être que l’histoire est même pas autorisé à juger autrement. Nous avons aujourd’hui la chance d’être ses contemporains. Et quand nous avons reçu l’art de notre temps dans l’ensemble du district, même de l’histoire n’a pas pu voir, donc nous ne voulons pas rater, volontairement à suivre les révélations d’un esprit élevé artistes l’opportunité. »
Eckroth L., « Berliner Kunst-Cronik », Internationale Revue, 5e année, mai 1904, p. 88 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 498. Trancrire (traduire)
Ungeschicklichkeit, das Primitive, das Unmögliche teuer!
Cezanne’s Kunst ist die reinste, ursprünglichste Vorstellung: er sieht mit den Augen eines Kindes und malt mit der Hand eines Sechzigjährigen. Cezanne kann nicht zeichnen und doch ist seine Zeichnung genial, weil voll unglaublichen Ausdrucks, groß und simpel und dem Gewollten adäquat. Hier ein Stilleben: eine Weinflasche, ein paar Äpfel, ein paar Granaten, das Ganze auf dem weißen, massig gefalteten Tuch, das für ihn so charakteristisch ist. Dann Kartenspieler in einer Landschänke, ungefüge Kerle in blauen Kitteln, die blöden Bauernjungen vor einem weißen, häßlichen Tischchen, kahle Wand dahinter, nur belebt von den paar Tonpfeifen, die in einem kleinen Gestell stecken. »
Traduction :
« Le Salon Paul Cassirer a ajouté à ses toujours excellentes expositions une nouvelle touche de charme. Paul Cezanne est là ! L’ermite d’Aix, celui sans la moindre reconnaissance est restée pendant des décennies qui ne sont pas souvent considérés un tableau, est présenté ici par une vaste exposition de ses œuvres aux amateurs d’art dans son sens proche. Pour Zola, l’ami de jeunesse, il était un grand artiste avorté. Nous sommes tout ce qui pourrait conduire à cette définition, la maladresse apparente, le primitif, le cher impossible !
L’art de Cezanne est la plus pure idée, le plus original : il voit avec les yeux d’un enfant et peint avec une main d’un sexagénaire. Cezanne ne peut pas dessiner, mais son dessin est génial parce que l’expression totalement incroyable, grande et simple, et de la destinée de manière adéquate. Voici une nature morte : une bouteille de vin, quelques pommes, quelques grenades, le tout sur un drap blanc, modérément replié qui lui est si caractéristique. Ensuite, des joueurs de cartes dans une auberge de campagne, des gars maladroits en salopette bleue, un paysan stupide contre un mur blanc, une petite table laide, devant le mur nu, seulement égayé par quelques pipes en terre coincées dans un petit cadre. »
Hermann Georg, « Paul Cezanne », Berliner Zeitung, n° 207, 4 mai 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 499, 501-502. Trancrire (traduire)
« Im Salon Cassirer ist eine bedeutende Anzahl der Arbeiten des seltsamsten unter den französischen Impressionisten vereint, der eine zeichnerische Laküne, offensichtiges Nichtkönnen mit einer einzig gearteten Empfindsamkeit für den Reiz und den Einklang der Farbe verbindet. Cezanne ist unter den heutigen Malern wohl das stärkste Temperament, ja ein Überschuß hiervon trägt die Schuld an den handklaren Unzulänglichkeiten seiner Werke, an den perspektivischen und statischen Fehlern und Unfertigkeiten, die herauszusuchen jedem Beschauer, der Kunst mit dem Zollstock und den Maßen des Nordau’schen Normalmenschen aburteilt, Freude, Genugtuung und Grund zu Gelächter gewährt. Daß aber trotz dieser Unzulänglichkeiten alles, was Cezanne gibt, unerhört ruhig und stark ist, die Sache im Kern erfaßt, nicht losläßt, sich uns einprägt mit glühenden Stempeln — das wird der Philister der Kunst mit dem Verstand und nicht mit den Sinnen erfaßt, nicht begreifen; auch wird er mit dem Gerede von « Schönheit » dir entgegentreten, weil sein Begriff des « Schönen » nur die gröbsten inhaltlichen und formalen Dinge erfaßt, die er hier nicht findet. Er ist eben auf Farbenschönheit und Farbenklang, auf eine starke Suggestion des lebendigen Lebens einfach nicht fähig zu reagieren. Er sieht nicht, mit welch’ einer religiösen Innigkeit und Liebe hier das Sein betrachtet und gebannt ist. Er empfindet nichts von der Frische und dem Farbenduft des Lebens, den diese Werke ausstrahlen. Sie scheinen hart und brutal, aber sie sind der feinsten Intervalle in der Farbe fähig. Sie geben die zartesten Bewegungen der Oberflächen.
Cezanne sucht die Farbe dort, wo sie am köstlichsten ist, in Blumen, aber mehr noch in dem saftigen Fleisch der Früchte. Er liebt den Glanz des Zinns, den Schimmer der bäuerischen Porzellane und Fayencen. Er breitet die Früchte auf einem Damasttuch aus, schlägt Falten, bauscht und knüllt einen Zipfel zusammen, legt irgend einen bunten Fetzen bedruckten Kattuns dazu. Er scheint seine Stilleben hinzumauern, nur mit dem Spachtel die Farben zu verreiben, aber sie sind wunderbar saftig, wie die Natur selbst! Sie überschreien die Natur nicht.
Cezannes Landschaften, die oft weite Blicke oder einen stillen, feinen Ausschnitt geben, wie das Stück dunkles Wasser, über das sich ein Brückenbogen spannt, sind ebenso ungewöhnlich und zeigen eine ebenso starke und innige Vertiefung. Sie weisen unerhörte Schönheiten der Farbe. Jene Gärten, jene Bäume, durchfressen vom Blau des Himmels, und das gleitende Wasser des Stromes vor ihnen, das ist wie ein Sang auf die Erdenschönheit. Graubraune Dächer, die aus einem stumpfen, staubigen Grün hervorsehen, sie bilden miteinander einen feinen, klingenden Accord.
Von den Bildnissen werden die beiden frühen Arbeiten, das eine wohl ein Porträt Courbets, dem Cezanne zuerst nahe stand, und jener Mann in schwarz mit den fleischigen Händen auf allgemeines Verständnis rechnen dürfen durch die frappante Schlagkraft der Individualisierung. Wie auf dem zweiten das Fleisch gemalt ist, so eine rote kräftige Hand herausmodelliert ist, mit der Farbe buerré, gebuttert, wie die Franzosen dieses saftige Hineingehen gewandt bezeichnen — diesem Eindruck kann man sich nicht entziehen.
Einige seiner späteren Bildnisse, so seine Frau im grauen Taffetkleide auf dem stumpfroten Stuhl, erinnern uns an Trübner. Überhaupt stecken in Cezanne alle Keime der Moderne: Hier haben die Neo-impressionisten angesetzt, sagen wir bei einem Mädchenbildnis; diesen Accord von grau, weiß und einem lehmigen Braungelb hat Vuillard aufgenommen. Diese Landschaft mit dem breiten Laubwedel an den Bäumen und dem blauen Himmel gemahnt uns wieder an Trübner; hier fing d’Espagnat an, und in den kräftigen großen Bildern kartenspielender Blaujacken werden wir durch die Kraft der Vereinfachung und durch die Höhe, in die ein so trivialer Vorwurf gehoben ist, an den Norweger Munch erinnert. Man sehe nur einmal, wie in diesen Bildern eine Hand — eine fleischige, derbe Arbeiterhand — auf dem Tisch liegt; man fühlt, daß man Gewalt anwenden müßte, sie weiter zu stoßen, so fest ruht sie auf der Tischplatte. Die Gesichter geben den Ausdruck des Unfreundlichen, Muffigen, und eine gewisse Verdrücktheit und Verschmitztheit, dabei mit schlagender, überzeugender Sicherheit wieder, und doch sind sie auf den ersten Blick herb, hart, wie mit dem Meißel geschlagen.
Cezanne ist ohne Zweifel unter den Impressionisten derjenige, dessen Personlichkeit in ihrem ehrlichen Kampf am meisten fesselt, er ist nicht geschickt oder raffiniert im Sinne eines Degas, nicht geschmackvoll und groß im Sinne eines Manet, nicht Empfinder wie Pissarro, ganz Auge wie ein Monet, Schmeichler den Sinnen wie Renoir und d’Espagnat, er ist schwer, zäh, herb, bäurisch, primitiv, aber er trägt alle Wunder der Schöpfung in sich. »Traduction :
« Au salon Cassirer, un nombre important d’œuvres des plus étranges est rassemblé sous les impressionnistes français, qui combine une lacune graphique, évidente. Non seulement une sorte de sensibilité pour le charme et l’harmonie de la couleur possible. Cezanne est parmi les peintres d’aujourd’hui probablement le tempérament fort, oui son excès est à blâmer pour les insuffisances claires de la main de ses œuvres, à la perspective et les erreurs statiques et sans compétence être récupérées chaque spectateur, l’art avec la règle et les dimensions de Nordau ‘ la aburteilt de gens normaux, accordé la joie, la satisfaction et la raison de rire. Mais que, en dépit de ces lacunes, tout est Cezanne, calme scandaleux et forte est détecté la matière dans le noyau, ne lâche pas, elle-même nous impressionne avec des timbres élogieux ― qui est le philistin de l’art avec l’esprit et ne pas être détectés par les sens, et non pas saisir ; aussi il va confronter avec le discours de la « beauté » vous parce que son concept de «beauté», seule la forme la plus grossière et le contenu des choses sentait qu’il ne peut pas trouver ici. Il n’est tout simplement pas en mesure de répondre à la beauté de la couleur et la tonalité des couleurs, une forte suggestion de vivre la vie. Il ne voit pas avec quelle ferveur et l’amour religieux est considéré comme être et interdit ici. Il ne sent rien de la fraîcheur et le parfum de couleur de la vie, à rayonner œuvres. Ils semblent durs et brutaux, mais ils sont les meilleurs intervalles dans la couleur capable. Entrez les mouvements délicats des surfaces.
Cezanne a étudié la couleur où il est le plus délicieux, de fleurs, mais plus encore dans la chair juteuse du fruit. Il aime le glamour de l’étain, l’éclat de la porcelaine et la faïence paysanne. Il étale les fruits sur une tapisserie, bat rides, poches et se froisse un coin ensemble, crée des lambeaux colorés tout document imprimé calicot il. Il semble soutenir son style de vie, avec une spatule pour frotter les couleurs, mais ils sont merveilleusement juteuse, comme la nature elle-même ! Ne pleure pas sur la nature.
Les paysages de Cezanne, qui donnent souvent des vues larges ou, une coupe fine calme, comme la pièce d’eau sombre, sur lequel couvre un arc, sont à la fois inhabituel et montrent un évidement aussi forte et intime. Ils ont la beauté scandaleuse de la couleur. Ces jardins, les arbres en mangeant le bleu du ciel, et les eaux mouvantes de la rivière en face d’eux, il est comme une chanson sur la beauté de la terre. Toits gris-brun qui émergent d’une terne, vert poussiéreux, ensemble, ils forment un Accord amende à consonance.
Des deux portraits de ses premières œuvres, on devrait probablement un portrait de Courbet, Cezanne était proche de la première, et que l’homme attend en noir avec les mains de viande sur la compréhension générale par l’efficacité remarquable de l’individualisation. Est peint sur le deuxième de la viande, donc une main forte rouge est sculpté, beurré avec la couleur, que les Français appellent tourné en jus ― cette impression ne peut pas échapper.
Certains de ses portraits plus tard, que sa femme en robe de taffetas grise sur la chaise rouge terne, rappelons Trübner. Toujours coincé dans Cezanne tous les germes de la modernité: ici les néo-impressionnistes ont reconnu, au dire d’un portrait d’une jeune fille ; Cet Accord de gris, blanc et limoneux brun a Vuillard inclus. Ce paysage avec de larges feuilles de feuillage sur les arbres et le ciel bleu nous rappelle Trübner ; ici a commencé d’Espagnat, et dans les grandes images finales cartes à jouer Blue Jackets sera par la puissance de la simplicité et par la hauteur à laquelle une accusation si trivial est levé, commémore le Munch norvégienne. Vous voyez qu’une seule fois, comme une main dans ces images – une viande, la main de travail cabinet – est sur la table ; on sent que l’on aurait à utiliser la force pour les pousser plus loin, aussi fort qu’elle repose sur le dessus de table. Les visages donnent l’expression du mauvais temps, humide, et une certaine folie et espièglerie, tandis que de battre, convaincre à nouveau la sécurité, et pourtant ils sont à première vue austère, dur, comme si elle était battue avec un ciseau.
Cezanne est sans aucun doute parmi les impressionnistes celui dont la personnalité captive le plus dans sa lutte honnête, il est apte ou raffiné au sens de Degas, pas de bon goût et grande en termes de Manet, pas important comme Pissarro, tous les yeux comme un Monet, flatteurs les sens comme Renoir et d’Espagnat, il est difficile, dur, rude, grossier, primitif, mais il porte toutes les merveilles de la création en elle-même. »
Norden J. [Julius], « Aus unseren Kunstsalons », Die Gegenwart, 33e année, n° 19, 7 mai 1904, p. 303 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. Trancrire (traduire)
« Paul Cezanne. Das ist die Überraschung, die uns Paul Cassirer bietet. Cezanne ― das ist ein Programm, ein Schlachtruf. Heute. Also sozusagen: retrospectiv. Denn bekanntlich ist der heute 65jährige erst vor ein paar Jahren wieder entdeckt worden. Anläßlich der « Centennale », auf der er den ihm gebührenden Platz erhielt neben Renoir und Manet, Fast möchte man von ihm sagen ― er ist größer als die Beiden. Jedenfalls der überzeugteste Anhänger des Dogmas vom Impressionismus strengster Observanz, der rücksichtsloseste Vorkämpfer. Émile Zola hat ihm vor mehr als 20 Jahren schon ein Denkmal gesetzt. Denn Cezanne, nicht Manet, wie man lange Zeit irrthümlicher Weise annahm, ist das eigentliche Urbild des Claude Lantier im Künstlerroman « L’Œuvre ». Daß man das auch erst so spät erkannte, ist ein Beweis dafür, wie sehr im Verborgenen Cezanne arbeitete und schuf, was übrigens bei ihm gleichbedeutend ist. Und es ging ihm schlecht genug im Leben, wie Claude Lantier. Wenn man jetzt seine Bilder bei Cassirer sieht, könnte man geistreicheln: er lebte von Zwiebeln und Eiern, Früchten und Brod, Cidre und schlechtem, rothem Landwein und er hatte nur Frauen und Mädchen in seinem Umgang, die sich schlecht anzogen. Vielleicht war’s auch wirklich so. Was verschlägt’s für die Kunst? Wie er diese Zwiebeln und Eier, dieses Brod und Obst, diese simplen Flaschen und irdenen Krüge, diese schlecht sitzenden, ärmlichen Kleider und schlichten Frisuren malt ― darauf kommt es an. Und auf der geräuschvollen, bilderwimmelnden Pariser Ausstellung 1900 erkannte man plötzlich, daß in der Lösung dieses « Wie » etwas Meisterliches sich bethätigt, etwas das geradaus schreitet auf’s Ziel los,mit brutaler Consequenz nur der Mittel sich bedienend, die einmal für richtig erkannt wurden. Das Urtheil der Welt? Pah! Nicht einen Sou giebt er dafür. Ja ― schließlich signirt er nicht einmal mehr seine Bilder. Das thut heute weiter nichts. Man erkennt sie jetzt ohne Weiteres an del Structur und an der Farbe, der festgefügten Structur, den oft vielleicht hart wirkenden Localtönen. Denn nicht immer ist Cezanne auch Alles gelungen; nicht immer erreichte er Alles, was er wollte, und auf ein zeichnerisches Vorbeihauen kam es ihm erst recht nicht an. Aber man sehe sich die Köpfe dieser beiden Maurer in der Schenke an: sie leben trotz der einfachsten Ausdrucksmittel. Und wie stehen sie im Ton so überzeugend zur Hinterwand und in der Luft des schmutzigen, düsteren Raumes. Oder das Bild mit den knallrothen, grasgrünen und quittengelben Äpfeln und dem grünen Tonkrug ― ist’s nicht rein malerisch wundervoll erfaßt, wie auch die Frau in der schwarzen Mantille mit den unmöglich sackigen Händen? Und erst das große Männerbildniß, das förmlich aufgemauert ist aus zahllosen pastosen Farbstücken, daß es sich in der Nähe wie Mosaik ausnimmt. Dann einige der Landschaften: wie ist da der Sommerdunst so überzeugend gegeben; z. B. in « Mon jardin » oder in dem größeren, ganz auf Blau gestimmten Bilde, oder in der Spätsommerstimmung an der Seine. Übrigens etwas von « Stilleben » steckt in jedem Bilde Cezannes, ob’s nun eine Landschaft darstellt, oder gar ein Bildniß. Immer überwiegt die farbige Sachlichkeit, erfaßt mit dem Auge eines Malgenies.
Man muß Cassirer für diese Ausstellung vom kunstgeschichtlichen Standpunkt aus Dank wissen: sie füllt eine Lücke aus für den, der sich speciell mit der Geschichte des Impressionismus beschäftigt. »Traduction :
« Paul Cezanne. Voilà la surprise que nous offre Paul Cassirer. Cezanne ― c’est tout un programme, un cri de guerre. Aujourd’hui. Donc, parlons de rétrospective. Parce que nous savons qu’il a été découvert il n’y a que quelques années, le 65 ans à nouveau aujourd’hui. A l’occasion de la « centennale » sur lequel il a été donné la place qui lui revient à côté de Renoir et Manet, est presque tenté de dire de lui ― il est plus grand que les deux. Quoi qu’il en soit, les partisans les plus convaincus du dogme de l’impressionnisme stricte observance, le champion le plus impitoyable. Émile Zola l’a dit il y a plus de 20 ans déjà un monument. Pour Cezanne, Manet pas, comme on l’a cru pendant longtemps à tort, est l’archétype même de Claude Lantier chez l’artiste roman « L’Œuvre ». Cela a été reconnu que, même si tard, est une preuve de combien a été de travailler dans le secret Cezanne et créé ce qui est réellement synonyme avec lui. Et il faisait assez mal dans la vie, tels que Claude Lantier. Maintenant, si vous voyez ses peintures à Cassirer, pourriez-vous reicheln esprit : il a vécu sur les oignons et les œufs, les fruits et le pain, le cidre et les pauvres, un vin de table rouge et il avait seulement les femmes et les filles dans ses rapports, qui ont attiré pauvres. Peut-être il est vrai aussi. Ce qui apporte pour l’art ? Comme il peint ces oignons et les œufs, le pain et les fruits, ces simples bouteilles et pots en terre cuite, ces vêtements usés, mal ajustées et coiffures simples ― qui est ce qui importe. Et sur le bruyant, l’Exposition universelle de Paris en 1900, réalisé soudain que la solution à ce « comment » quelque chose Meisterliches bethätigt être quelque chose de tout droit sur les profits iront de but avec conséquence brutale seulement des moyens à bedienend qui étaient autrefois ajustement reconnus. Le jugement du monde? Pah! Pas un sou il lui donne. Oui ― après tout, il n’a même pas signirt ses peintures. Aujourd’hui ne fait rien. Ils peuvent être reconnus maintenant, sans autres formalités del structure et la couleur, la structure bien établie, les tons locaux souvent difficiles peut-être agissant. Il est pas toujours Cezanne tout réussi; pas toujours, il atteint tout ce qu’il voulait, et à un passé de dessins taillants il semblait ne pas encore plus sur. Mais les chefs des deux maçons dans la taverne vous voir soi : ils vivent en dépit des moyens les plus simples d’expression. Et comme ils sont dans son si convaincante à la paroi arrière et dans l’air de la chambre sombre sale. Ou l’image avec les rouge vif, herbe pommes vertes et jaunes coings et le pot d’argile verte – il est pas purement pittoresque détecte merveilleuse ainsi que la femme au manteau noir avec les mains sackigen impossibles? Et que le grand portrait d’homme qui est formellement soutenu par d’innombrables pièces d’empâtement qu’il exempte près que Mosaic. Alors quelques-uns des paysages : comment est parce que la brume d’été donnée de manière convaincante; z. B. dans « Mon Jardin » ou de la grande, très sensible à l’image bleu, ou dans l’ambiance de fin d’été sur la Seine. Incidemment, certains des « natures mortes » est dans chaque tableau Cezanne, si elle représente maintenant un paysage, ou même une effigie. Toujours emporter sur l’objectivité de couleur, détectée par l’œil d’un génie de ce temps.
Il faut savoir Cassirer pour cette exposition à partir du point historique d’art de vue, grâce à elle comble une lacune, spécialement chez ceux qui ont étudié l’histoire de l’impressionnisme. »
Rosenhagen Hans, « Paul Cezanne. Ausstellung im Salon Paul Cassirer », Der Tag, n° 235, 21 mai 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 509-512. Trancrire (traduire)
« Es scheint eine Unmöglichkeit, einem, der ihn noch nicht lieben gelernt hat, die Bedeutung von Paul Cezanne klar zu machen, oder auch nur ihm auseinanderzusetzen, warum dessen Bilder außerordentliche Kunstwerke sind. Sieht es unter solchen Umständen nicht nach Tollkühnheit aus, ganz Fernstehenden wahrscheinlich machen zu wollen, daß Cezanne einer der stärksten Künstler der Zeit ist? Selbst vor seinen Bildern wird es nur bei sehr wenigen gelingen. Denn der Kunst des französischen Malers fehlt alles Gefällige und Entgegenkommende. Sie ist herb und widerspricht den üblichen Vorstellungen von Schönheit und Vollendung, von Zeichnung und Malerei. Es gibt wenige Menschen, die, zum ersten Male vor ein Cezanne’sches Bild geführt, nicht erschrecken und sofort mehr sehen als offenbare Mängel. Mit einem Worte: Es ist sehr schwer, in ein Verhältnis zu dieser Kunst zu kommen. Wer es wagen will, muß alle vorgefaßten Meinungen zu Hause lassen und die Erfahrungen vergessen, die er vor anderen Bildern gemacht. Der französische Maler gehört nämlich zu den ganz wenigen Künstlern, welche die Kühnheit gehabt haben, der Natur so gegenüberzutreten, als sähen sie sie zum ersten Male, als seien ihnen nicht die Hunderttausende von Wiedergaben anderer bekannt. Man muß ein Kind sein, um so zu handeln, oder muß einen Tropfen von dem Blut der unsterblichen Götter in seinen Adern haben, um die Welt so jenseits aller Gewöhnung zu sehen, fühlen und neu schaffen zu können.
Man weiß von Cezanne beinahe so wenig, als wäre er ein alter Meister, über den es an biographischen Nachrichten fehlt. Man hat ihm noch bis vor kurzem so geringe Beachtung geschenkt, daß der Name des Künstlers selbst in den besten modernen Kunstgeschichten fehlt. Die Pariser Centennale lenkte zuerst die Aufmerksamkeit eines weiteren Kreises auf Cezanne. Im Saale der Impressionisten hingen zwei Landschaften und ein Stilleben von ihm, die ― wenigstens in den Augen der fortgeschrittenen Kunstfreunde ― durch Fülle und Schönheit des Kolorits, neuen Ausdruck und leidenschaftliche Malerei ihre nähere kostbare Umgebung überragte. […] Man kann indessen von einem bestimmten Standpunkt nur von Unvollkommenheiten sprechen, die den Genuß an gewissen Bildern von Cezanne erschweren. Wer allerdings einmal die Absichten des Künstlers begriffen hat, wird sich nicht hindern lassen, dessen Genie auch in Werken zu bewundern, die nach gewöhnlichen Begriffen voll unerträglicher Zeichenfehler sind. Gegen solche sind die Menschen im allgemeinen sonderbarerweise viel empfindlicher als gegen Farbenfehler. Eine etwas verunglückte Linienperspektive, eine verkehrte Aufsicht werden sofort bemerkt, eine absolut falsche Farbenperspektive fällt nur ganz selten auf. Nun darf der Farbensinn aber um nichts geringer eingeschätzt werden als der Formensinn. Er steht vielleicht sogar höher; denn er pflegt sich erst in einem fortgeschritteneren Kulturzustande bemerkbar zu machen. […] Das Wesentliche über Cezanne ist mit dieser Parenthese bereits gesagt: Er ist in erster Reihe Maler, einer von denen, welche die Wirklichkeit ausschließlich unter dem Zeichen der Farben zu fassen und zu deuten suchen.
In Wirklichkeit setzt sich die scheinbar so einfache Farbe Cezannes aus einer unendlichen Fülle von Tönen zusammen wie die Farbe in der Natur. Wir reden von grünen Bäumen, roten Äpfeln, von Fleischfarbe oder von blauen Röcken, als wären das sehr einfache Dinge; aber man sehe nur einmal genau zu, aus wieviel tausend Abstufungen des Grüns sich der Eindruck einer Wiese zusammensetzt, oder wie farbenreich eine einfache graue Mauer ist, und welche ungeheuren Veränderungen sich unter jeglichem Wechsel des Lichts vollziehen. Cezanne setzt also die Lokalfarbe, was sagen will: die allgemeine Farbe einer bestimmten Erscheinung in der Natur aus einer Unzahl feiner Nuancen, kleinen Farbflächen zusammen, die er sorgsam verbindet, so daß anscheinend ein einziger Farbenton herauskommt. Seine Farbe ist also in höchstem Grade intim, dabei ― infolge ihres Nuancenreichtums ― ungemein lebendig und stark; aber ohne die Spur jener Weichlichkeit, die sich bei Abtönungen und Abstufungen sonst leicht einzustellen pflegt. […]
Cezanne hat sich schon in den sechziger Jahren des vergangenen Jahlhunderts nicht genug daran tun können, ganz genau festzustellen, wie sich das Weiß einer Eierschale von dem Weìß eines leinenen Tischtuches unterscheidet, wie anders das Licht von der schwarzen Mähne seines Freundes Valabrègue aufgesogen wird als von dessen schwarzem Samtrock oder wie es sich im grünen Grase und daneben auf grünen Blättern verhält. Und weil er nur solchen Wirkungen nachgeht und aus ihnen den Gegenstand darstellt, fehlt seinen Wiedergaben von Menschen, Früchten, Blumen und Landschaften und allem, was dazu gehört, jeder unangenehme Naturalismus. Sie sind fast absolute Kunst.
Man darf annehmen, daß Cezanne den besten Teil seiner Erfahrungen der Beschäftigung mit dem Stilleben verdankt, und daß ihm die Beobachtung von Früchten, besonders Äpfeln und Orangen, die er gern auf einen weißgedeckten Tisch legt, zu einer Steigerung seiner Farben und schließlich zu einer hellen Malerei genötigt hat. Wie arm sind doch Worte! Man kann wohl sagen, daß der Künstler grüne, gelbe und rote Äpfel und Orangen zu malen liebt; kann man aber damit eine Vorstellung von dem Aussehen Cezanne’scher Stilleben geben? Welche hundert zarteste Abstufungen benutzt sind, um die einzelne Frucht mit all dem Glanz und der Schönheit, die ihr die Natur gab, auf eine Fläche zu bannen? Cezanne zieht eine scheinbar grobe Kontur um den farbigen Fleck, und in fast greifbarer Körperlichkeit liegt da die licblichste Frucht auf einem Tisch oder in einer Schale. Und welcher Aufrichtigkeit und Treue sich der Künstler cler Natur gegenüber befleißigt, geht daraus hervor, daß man Stilleben von ihm kennt, die bis auf ein unbemalt gebliebenes Stück Leinwand mitten in einer Frucht absolut vollendet sind und doch nie fertiggestellt wurden, weil der Künstler behauptet, den Farbenton nicht finden zu können, den das natürliche Objekt an der freigelassenen Stelle gezeigt habe.
Dieses Eingehen auf die letzte Feinheit der Farbe gibt auch den Landschaften des Malers das besondere Gepräge. Sieht man sie neben seinen ziemlich pastos gemalten und durch das Vielfache der farbenprächtigen Stilleben, so haben sie scheinbar etwas Trockenes, Sprödes. Dieser Eindruck resultiert aus dem Vorhandensein vieler Lufttöne, mit denen der Glanz und das Feuer des Grüns gedämpft ist. Hängt eine Cezanne’sche Landschaft aber durch Zufall zwischen Landschaften anderer Maler, so überbietet sie diese nicht sowohl durch Wahrheit des Ausdrucks, als auch durch Kraft und Fülle der Farbe. Nichts hält dagegen stand.
Manet erscheint in dieser Nachbarschaft ein wenig zu elegant, der farbenfreudige Monet müde, der träumerische Sisley süß und Pissarro direkt schwächlich. Von Cezanne’schen Landschaften wird der oberflachliche Betrachter ebenfalls meinen, sie seien mit wenigen Umständen gemacht. Aber auch hier täuscht der Schein. Man braucht nur genauer hinzusehen, um zu begreifen, daß diese wundervollen Steigerungen des Grüns von Gelb zu Blau in der Vegetation, dieser aus einer Unzahl von braunen und grauen und gelben Nuancen zusammengesetzte Ton des Erdbodens, diese feuchten, dunstigen oder trockenen Lüfte, diese verschiedenfarbigen Ziegeloder Schieferdächer nicht einfach hingestrichen sind; daß ein überaus empfindliches Auge, ein heilig glühendes und ach! oft so trauriges Herz die in leidenschaftlicher Erregung bebende Hand geführt haben. Vor diesen Landschaften kann man auch nicht mehr von mangelhafter Zeichnung sprechen, und vielleicht sind die von ihnen mit der größten Meisterschaft auch nach der zeichnerischen Seite gestaltet, die mit wenig mehr als mit Gefühl und Nerven auf die Leinwand gebracht sind.
Man mag unter den Schöpfungen Cezannes sehr viele finden, die voll der ärgerlichsten, weil leicht vermeidlich gewesenen Mängel sind, aber keine, die nicht lebhaft interessierte, sei es durch die Farbe und die Pinselführung, sei es durch das Temperament und die Empfindungsweise des Künstlers. Jedes seiner Bilder bedeutet die Eroberung eines Stückes Schönheit in der Natur, und alle zusammen geben den Eindruck einer Persönlichkeit, die halb ein naives Kind, halb ein großer Weiser, in jedem Falle aber ein idealer Künstler ist, einer von den wenigen, die nie daran gedacht haben, daß sie außerordentliche Kunstwerke schaffen wollten, sondern die in Einfalt und Demut nachgebildet haben, was ihnen schön und selten erschien. Und hat Cezanne auch keine imposanten Galeriebilder produziert, so hat er sich doch unsterbliche Verdienste um die Bereicherung der menschlichen Fähigkeit, zu sehen, und um die Verfeinerung und Erhöhung des Farbengeschmacks erworben. Seine Art, die Wirklichkeit nur allein unter dem Winkel der durch das Licht bewegten Farbe und ohne jede Linie zu sehen und sie, sozusagen, nur aus Farbenflächen darzustellen, hat ihn zu Wirkungen gelangen lassen, die vor ihm nie erreicht worden sind, und in denen der Malerei neue Wege gewiesen werden.
Das volle Maß seiner Verdienste können nur die intelligentesten Maler ermessen, niemals wird das außerordentliche von Cezanne von der großen Menge begriffen werden. Das geht am deutlichsten daraus hervor, daß er, während das Publikum nicht einmal seinen Namen kannte, eine Reihe moderner französischer Maler, von denen nur die schon verstorbenen van Gogh und Gauguin, ferner Vuillard und Bonnard als die bekanntesten genannt seien, das Gold der Cezanne’schen Kunst auszumünzen begonnen haben und mit mehr oder minder großem Erfolg ausgaben. Auch Edvard Munch hat als Maler Cezanne zur Voraussetzung. Man kann die Bedeutung des Künstlers als Anreger also nicht hoch genug einschätzen. Und er lebt noch, dieser einsame Große, dieser stille Weise mit den Kinderaugen, dieser sehnsüchtige Schönheitssucher. Erfolge hat er nie genossen. Die Bewunderung von ein paar Freunden mußte ihn erhalten. Da ist es denn wohl Zeit, ihm Kränze zu reichen, ehe es zu spät ist, und die auf ihn aufmerksam zu machen, die fähig sind, die Kunst eines genialen Malers zu genießen, ohne sich daran zu stoßen, daß er im Alltäglichen manchmal als ein armer Sünder vor ihnen steht und von jedem Narren schlimmer Fehler geziehen werden kann. Die Zukunft wird in Cezannes Werken nur noch seine großen Tugenden sehen. »
Traduction :
« Il semble impossible, à qui n’a pas encore appris à l’aimer, de dire clairement l’importance de Paul Cezanne ou même d’expliquer pourquoi ses tableaux sont des œuvres d’art extraordinaires. Est-il dans de telles circonstances ne pas la témérité d’essayer de faire tous ceux qui sont loin probable que Cezanne l’un des artistes les plus forts de l’époque ? Même avant ses tableaux nous réussirons à très peu. Parce que l’art de peintre français rien manquer agréable et réactif. Il est acidulée et contraire aux notions habituelles de la beauté et de la perfection du dessin et de la peinture. Il ya peu de gens qui, pour la première fois avant un tableau Cezanne’sches, ne pas effrayer, et de voir plus de défauts évidents immédiatement. En un mot : Il est très difficile d’entrer en relation avec cet art. Qui veut oser doit laisser toutes les idées préconçues à la maison et oublier les expériences qu’il a faites devant d’autres images. Le peintre français constitue l’un des rares artistes qui ont eu l’audace de nature à faire face, comme ils l’ont vu pour la première fois, comme ils ne sont pas les centaines de milliers de reproductions d’autre connue. Il faut être un enfant dans le but de le faire, ou doit avoir une goutte du sang des dieux immortels dans ses veines de voir le monde au-delà de l’accoutumance, sentir et d’être en mesure de recréer.
Nous ne savons presque aussi peu de Cezanne, comme si il était un vieux maître, sur les données biographiques absence. Il lui a donné jusqu’à récemment si peu d’attention que le nom de l’artiste est absent, même dans les meilleures histoires de l’art moderne. Le centennale de Paris a d’abord attiré l’attention d’un autre cercle sur Cezanne. Dans la salle des impressionnistes il y avait deux paysages et une nature morte de lui, nouvelle expression et la peinture passionnée dominaient par la plénitude et la beauté de la coloration de leur environnement plus précieux ― au moins dans les yeux des amateurs d’art d’avant-garde. […] On peut, cependant, parler d’un seul point de vue des imperfections qui entravent la jouissance de certaines images de Cezanne particulier. Qui mais une fois compris les intentions de l’artiste, à ne pas arrêter pour admirer le génie dans des œuvres qui sont des concepts ordinaires erreur de caractère pleinement insupportable. Contre ces gens en général sont curieusement plus sensibles que d’erreurs de couleur. Un peu de perspective de la ligne de l’accident, une supervision pervers sont immédiatement remarqué un point de vue des couleurs absolument faux tombe rarement sur. Maintenant, le sens de la couleur, mais peut être évaluée inférieure par rien d’autre que le sens de la forme. Il est peut-être encore plus élevé ; parce qu’il se soucie à se faire sentir seulement à une condition de culture plus avancée. […] L’essence à propos de Cezanne a déjà été dit avec cette parenthèse : Il est dans le premier peintre de la ligne, une recherche de ceux qui saisissent la réalité exclusivement sous le signe de couleurs et d’interpréter.
En réalité, la couleur apparemment simple Cezanne est composée d’une richesse infinie de tons que la couleur dans la nature. Nous parlons d’arbres verts, des pommes rouges, de couleur de chair ou de manteaux bleus, comme si les choses très simples ; mais vous voyez qu’une seule fois exactement, combien de milliers de nuances de vert représentent l’impression d’une prairie, ou comme couleur est un mur gris simple, et quels changements immense lieu en vertu de tout changement de lumière. Ainsi Cezanne est la couleur locale, qui dira : la couleur générale d’un phénomène particulier dans la nature d’une myriade de nuances fines, les petites zones de couleur ensemble, qu’il combine avec soin, de sorte que semble sortir une seule tonalité de couleur. Sa couleur est donc au plus haut degré intime, tandis que ― en raison de leurs nuances de richesse ― extraordinairement vivante et forte ; mais sans la trace de mollesse qui maintient sinon facilement adapter avec des nuances et des gradations. […]
Cezanne a déjà dans les années soixante les dernières Jahlhunderts ne peut pas faire assez parce déterminer exactement comment le blanc d’une coquille d’œuf du blanc d’une nappe en lin est différent, comment différente la lumière de la crinière noire de son ami Valabrègue est absorbé à partir de dont la jupe de velours noir ou comment il se comporte dans l’herbe verte, et à côté de lui sur les feuilles vertes. Et parce qu’il poursuit seulement de tels effets et d’eux est le sujet, manquant ses interprétations de gens, les fruits, les fleurs et les paysages et tout ce qui va avec, tout naturalisme désagréable. Ils sont de l’art presque absolu.
On peut supposer que Cezanne doit la meilleure partie de son expérience avec la nature morte, et que son observation de fruits, en particulier les pommes et les oranges, dont il aimait la pose sur un décor de table blanc, à une augmentation de ses couleurs et enfin à une brillante Peinture a contraint. Comment pauvres sont que des mots! On peut dire que l’artiste aime peindre des pommes et des oranges vertes, jaunes et rouges ; mais on peut ainsi donner une idée de l’apparence Cezanne’scher encore la vie ? Que cents délicate gradations sont utilisés pour, capturer le fruit individu avec toute la splendeur et la beauté qui lui a donné la nature d’une zone? Cezanne dessine un contour en apparence rugueuse autour de la tache de couleur, et la physicalité est presque tangible parce que le fruit licblichste sur une table ou dans un bol. Et quelle sincérité et de la fidélité, l’artiste Cler envers la nature cultive, il est évident du fait que nous savons toujours la vie de celui qui est absolument parfait, sauf une pièce retardé non peinte de linge au milieu d’un fruit et ont jamais été achevée parce que l’artiste affirme le ton de couleur pour ne peut pas trouver l’objet naturel a montré sur le site publié.
Cette réactivité à la finesse finale de la couleur sont aussi les paysages du peintre, le timbre-poste spécial. En regardant cela, en plus de son joli épaisse et peinte par le multiple de la vie colorée encore, ils ont donc apparemment quelque chose de sec, cassant. Cette impression est due à la présence de nombreux tons de l’air avec lequel la brillance et le feu des greens est coupé. Dépend un paysage Cezanne’sche mais par hasard entre les paysages d’autres peintres, de sorte qu’ils ne possèdent pas ces caractéristiques à la fois par la vérité d’expression, ainsi que par la force et la plénitude de la couleur. Rien ne l’arrête l’autre support de main.
Manet semble un peu trop élégant dans ce quartier, l’Monet colorée fatigué de rêve chétif droit douce Sisley et Pissarro. De paysages Cezanne’schen l’observateur superficiel sera également penser qu’ils sont faits avec quelques circonstances. Mais voici apparences trompeuses. Il suffit de regarder de plus près pour réaliser que ces gains magnifique sur le vert du jaune au bleu dans la végétation de cette composés d’une myriade de ton brun et gris et les tons jaunes du sol, cet air humide, sèche ou humide, ces différentes couleurs tuiles ou ardoises des toits ne sont pas juste assis coups ; qu’un œil extrêmement sensible, un brillant sainte et oh! si triste coeur souvent passionnés qui ont conduit à l’émotion frémissante main. En face de ces paysages ne peut plus parler de dessins pauvres, et peut-être l’conçu par eux avec la plus grande maîtrise, même après la page de dessin, qui sont appliqués sur la toile avec un peu plus d’émotion et de nerfs.
On peut dans les créations Cezanne trouver très nombreuses personnes qui plein de défauts ennuyeux car facilement évitables été, mais aucune qui ne sont pas vivement intéressés, que ce soit par la couleur et le pinceau, que ce soit par le tempérament et l’émotion de l’artiste. Chacun de ses tableaux est la conquête d’un morceau de la beauté dans la nature, et tous donnent ainsi l’impression d’une personnalité qui une demi-enfant naïf, demi-un grand sage, en tout cas, est un artiste idéal, l’un des rares qui n’a jamais l’esprit ont pensé qu’ils voulaient créer des œuvres d’art extraordinaires, mais qui ont imité dans la simplicité et l’humilité, ce qui leur paraissait belle et rare. Et Cezanne a également produit aucun galerie images imposantes, il a néanmoins acquis contributions immortelles à l’enrichissement de la capacité humaine à voir, et à améliorer et à accroître le goût de la couleur. Sa façon de voir la réalité seul à l’angle de déplacement à travers la couleur de la lumière et sans aucune ligne et, pour ainsi dire, ne représentent que les surfaces de couleur, qu’il vienne à effets qui ont jamais été atteint avant lui, et dans lequel peinture nouveau motif être rejeté.
La pleine mesure de sa contribution peut apprécier que le peintre le plus intelligent, jamais est l’extraordinaire de Cezanne être compris par la grande quantité. Cela est plus évident du fait que lui, que le public ne connaissait même pas son nom, un certain nombre de peintres français modernes, dont seule la déjà tard Van Gogh et Gauguin, Vuillard et Bonnard également être mentionnés comme le plus célèbre, l’or de Cezanne »‘ de l’art a commencé auszumünzen et les problèmes avec plus ou moins de succès. Edvard Munch a aussi comme peintre Cezanne suppose. On ne peut pas être surestimé l’importance de l’artiste comme un stimulateur sorte. Et il est encore en vie, ce grand solitaire, cette façon calme avec les yeux des enfants, ce mélancoliques demandeurs de beauté. Il n’a jamais connu le succès. L’admiration de quelques amis a dû lui faire. Comme il est parce que probablement temps de lui remettre couronnes, avant qu’il ne soit trop tard, et à attirer l’attention sur elle, qui sont en mesure de profiter de l’art d’un peintre de génie, sans frapper par le fait qu’il comme dans la vie de tous les jours, parfois un pauvre pécheur se tient devant eux et le pire de toute erreur imbécile peuvent être accusés. L’avenir ne voir dans Cezanne travaille ses grandes vertus. »
M. O. [Max Osborn]« Paul Cezanne », National-Zeitung, n° 324, 21 mai 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 512-513. Trancrire (traduire)
« Der Berliner Impressionistensalon Cassirer hat schon vor drei Jahren auch uns Deutsche mit der Arbeit dieses merkwürdigen Künstlers bekannt gemacht. Aber die Kollektion Cezanne’scher Bilder, die er uns damals vorführte, wird bei weitem von der übertroffen, die wir jetzt dort sehen, und die uns in Wahrheit eine ganz neue Welt erschließt. […]
So weit das überhaupt möglich ist, war er traditionslos; in schwerem Ringen eroberte er sich seine neue Naturanschauung, mit zäher Energie bildete er sich, in souveräner Nichtachtung aller Überlieferung, seine Technik. Auch Cezanne mußte sich erst durch die Dunkelheiten der älteren Zeit durcharbeiten, bis er ins Land der hellen Sonne und der vom Licht durchfluteten Luft gelangte. […] Man sieht bei Cassirer einige Proben dieser Frühzeit des Künstlers aus den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Es sind zumeist Stilleben: Brot, Eiern Krüge, die sich leuchtend von schwarzem Grunde abheben, schon frei und durchaus persönlich in der Farbenauffassung, aber doch noch mit einem Faden an das Altmeisterliche geknüpft. Ein Porträt aus dieser älteren Zeit zeigt noch deutlicher, daß in seinem Maler ein Neues und Eigenes gärt und zum Dasein drängt. Es hat etwas seltsam Unfertiges, ja Rohes, aber unter der Oberfläche fühlen wir ein enormes Leben vibrieren; ein geradezu rabiates Malertemperament sucht hier, noch nicht mit vollem Erfolge, alle Fesseln zu sprengen, die ihm weniger die Konvention als die eigene Gebundenheit anlegt. Noch 1868 erscheint eine Landschaft, ein breiter Weg zwischen grünen Bäumen, von schwerer Koloristik belastet.
Dann aber reißt der Schleier mitten entzwei. Das Licht strömt herein, und Cezanne zwingt es sich zu Willen. Es ist kein freies Spielen mit den Dingen der Natur, kein leichtes, lachendes Schaffen aus überströmender Kraft heraus, sondern ernste Arbeit, schweres Sichmühen. […] Bei den Stilleben, in denen Cezanne zuerst sich zu der neuen Art durchgerungen, sind die Spuren dieses Arbeitens nicht verwischt. Manche der Blumen und Früchte, die hier in zwanglosen Gruppen in Schalen und Schüsseln liegen oder lässig über den Tisch gestreut sind, erscheinen wie mit Farbe gemauert. Aber es lebt in diesen Dingen eine Kraft und Ursprünglichkeit, die einzig in ihrer Art ist. Kein Vorbild aus alter oder neuer Zeit, nur die Natur konnte Cezanne so malen lehren, nur ein vollkommen unbefangenes Auge konnte so sehen. Es ist nichts Liebenswürdiges, Entgegenkommendes in dieser Kunst, alles ist unerschütterlicher, grübelnder Ernst, der das Vorbild nicht losläßt, bis er es malerisch überwunden hat. Ich glaube, von keinem anderen modernen Meister kann ein anderer Künstler so viel lernen wie von Cezanne, eben weil man den Werdeprozeß seiner Bilder so klar vor sich sieht. Mehr als alle seine Genossen, mehr als Manet und Monet, als Renoir und Pissarro, als Sisley und Degas, war Cezanne im eigentlichen Sinne ein « Augentier », das alle farbigen Spiele dieser Welt wie mit ungeheueren Saugorganen in sich aufnahm, um sie nach instinktiven Geschmacksgesetzen zu sichten und zu ordnen. Denn auch er hat « Geschmack », wenngleich das bei ihm etwas anderes besagt als sonst zumeist. Von einschmeichelnder Delikatesse ist freilich nichts zu finden, dazu ist er zu robust und zu männlich. […]
Am freiesten und großartigsten aber bekundet sich Cezannes Kunst in den Landschaften, von denen wir jetzt zuerst eine größere Anzahl in Berlin kennen lernen. Auch hier verfolgt man eine Entwicklungslinie. Man sieht eine Straße aus einem kleinen Orte und eine Waldbrücke, die an Courbet erinnern. Man sieht eine figurenreiche Sommerlandschaft mit Wasserspiegeln, einem Segelboot und zahlreichen hell und bunt gekleideten Menschen, in der noch ein letzter Rest vom romantischen Kolorismus Delacroix’ anklingt. Aber dann ― und das sind die wertvollsten Stücke der Ausstellung bei Cassirer ― treffen wir Impressionen von wunderbarem malerischem Zauber, die plötzlich ganz anders anmuten’ In diesen Bildern ist Cezanne über sein Ringen und Kämpfen hinausgelangt. Sie geben das Subtilste von Luftstimmungen, was sich denken läßt, auch jetzt noch nicht mit der schöpferischen Macht Manets, auch nicht mit der tiefen Empfindung Pissarros, aber mit einer malerischen Sicherheit und mit einer Andacht vor der Natur, die den Künstler in die allererste Reihe rückt. Meist ist auch hier der Pfadsucher noch zu erkennen, aus dessen Mund der Hymnus auf die Natur nicht in stürmenden Rhythmen, sondern stockend, oft gar stotternd zu uns dringt. Aber es kommt alles aus dem Grunde einer Künstlerseele. Von Routine ist keine Spur zu finden; um so unmittelbarer und packender ist die Wirkung. Und manchmal schließt sich auch alles wie durch ein Wunder zusammen, so in dem kostbaren Bildchen der schönsten, in dem Bilde einer blauen Bucht mit einer Anzahl Fabriken, deren Schornsteine in den Dunst des schwülen Tages emporragen.
Mit den menschlichen Figuren ist es Cezanne nicht so gut gegangen. Wohl gelang ihm hier und da ein Porträtkopf; namentlich sein eigenes Antlitz hat er oft mit außerordentlicher Kraft festgehalten und mit scharfem Blick für die Züge, die er mit kritischer Objektivität vornahm, charakterisiert. Aber die Gruppenbilder zeigen die Grenzen seiner Kunst. Natürlich ist überall das rein Malerische von Interesse, alles, was sich auch hier an das Auge und den Farbengeschmack wandte, fesselt in hohem Grade. Aber das ewig Menschliche kommt nicht dabei heraus. Bei solchen Werten, die doch schließlich auch ein Stück Natur sind, versagte Cezanne. Und hier, ich kann mir nicht helfen, liegt die Gefahr des ganzen Schulimpressionismus. Zum Lernen herrlich! Zur Bildung des Auges unentbehrlich! Zur Entwicklung der malerischen Technik, zur Entfaltung des subjektiven Sehens hochwillkommen! Aber damit ist es nicht genug, trotz alledem und alledem. Unser Weg führt darüber hinaus, muß darüber hinausführen. Nur nicht hier stehen bleiben; das wäre eine neue Pedanterie. Solche Vorbehalte müssen immer wieder gemacht werden. Erst wenn man das getan hat, hat man das Recht, sich mit einer Ausstellung wie dieser erlesenen Kollektion Cezanne bei Cassirer zu freuen und sich in ihren Genuß zu vertiefen. »
Traduction :
« Le salon impressioniste de Cassirer à Berlin a fait il y a trois ans et nous allemand familiariser avec le travail de cet artiste remarquable. Mais les tableaux de sa collection de Cezanne qu’il nous a montrés que le temps est largement compensés par la que nous voyons là maintenant, et en vérité ouvre un tout nouveau monde. […]
Comme autant que cela est possible, il était traditionslos ; dans de lourds anneaux il a conquis sa nouvelle vision de la nature, avec une énergie tenace, il a formé, dans un mépris souverain pour toute tradition, sa technique. Même Cezanne a dû se rendre au travail à travers l’obscurité des premiers temps, jusqu’à ce qu’il arrive à la terre du soleil lumineux et inondée par l’air léger. […] Il peut être vu à Cassirer quelques échantillons de cette première période de l’artiste à partir des années soixante du siècle dernier. Il ya surtout des natures mortes: pain, œufs cruches qu’ils contrastées lumineux avec un fond noir, déjà libre et tout à fait encore lié personnellement à la vue de la couleur, mais avec un fil de maîtres anciens. Un portrait de cette période antérieure montre encore plus clairement que dans sa peinture un nouveau et spéciaux ferments et demande instamment à l’existence. Il y a quelque chose d’étrangement inachevée, oui Raw, mais sous la surface on sent vibrer énorme la vie ; un peintre de tempérament presque enragé étudié ici, non pas avec un succès complet, de rompre tous les manilles que moins lui est applicable la convention dans sa propre servitude. Même en 1868 chargé apparaît un paysage, un large chemin entre les arbres verts, des propriétés de couleur sévères.
Mais alors, déchire le voile en deux. La lumière se déverse, et Cezanne, elle se force à vouloir. Il est pas un jeu libre avec les choses de la nature, et non pas une, rire création facile de la plénitude du pouvoir, mais un travail sérieux, lourd Sichmühen. […] Dans la vie toujours, dans laquelle la première lutté à travers Cezanne au nouveau type, les traces de ce travail ne sont pas floues. Certains des fleurs et des fruits qui sont ici dans des groupes informels dans des bols et plats ou sont dispersés négligemment sur la table apparaissent comme brique de couleur. Mais il vit dans ces choses une force et l’originalité qui est unique en son genre. Aucun modèle de l’ancienne ou moderne, seule la nature pouvait enseigner la peinture Cezanne sorte, seul un œil complètement impartiale pourrait voir autant. Il n’y a rien aimable, sensible dans cet art, tout est inébranlable, couvant le sérieux qui ne se laisse pas aller le modèle jusqu’à ce qu’il a surmonté pittoresque. Je pense que par d’autres maîtres modernes, un autre artistes apprennent autant que Cezanne, précisément parce qu’il voit si clairement le processus de devenir ses photos en face de lui. Plus que tous ses camarades, plus de Manet et de Monet, Renoir et Pissarro, que Sisley, Degas, Cezanne a été à proprement parler un «animaux visuels », qui, comme avec des éléments d’aspiration immenses ont eu toutes les jeux de couleurs de ce monde en lui-même afin d’instinctive tamiser la loi du goût et de l’ordre. Parce qu’il a aussi « goût », bien autre chose que d’habitude la plupart des Etats avec lui quelque chose. En insinuant délicatesse est certainement rien à voir, il est trop solide et trop masculin. […]
À l’art le plus libre et le plus grand, mais Cezanne manifesté dans le paysage, à partir de laquelle nous apprenons maintenant savons abord un plus grand nombre à Berlin. Encore une fois, nous suivons une ligne de développement. Vous pouvez voir une rue d’une petite place et un pont de bois, rappelle Courbet. On voit un riche paysage estival de figure avec miroirs d’eau, un voilier et de nombreuses personnes brillantes et bariolés dans un dernier reste de résonne colorisme romantique de Delacroix. Mais alors ― et ce sont les pièces les plus précieuses de l’exposition au Cassirer ― nous prenons impressions de merveilleux charme pittoresque qui semblent soudainement très différent »Dans ces tableaux Cezanne est allé au-delà de ses luttes et de batailles. Vous ne donnez pas le plus subtil des humeurs de l’air, ce qui peut être imaginé, même maintenant avec la puissance créatrice de Manet, pas même avec le sentiment profond de Pissarro, mais avec une sécurité et pittoresque avec une vénération pour la nature que l’artiste dans la première rangée débrayé. La plupart de la recherche de voie est toujours aussi visible ici, dont la bouche l’hymne, pénètre souvent à la nature non rythmes tumultueuses, mais hésitant encore bégaiement pour nous. Mais tout cela vient du fond de l’âme d’un artiste. De routine est aucune trace se trouvent ; si immédiate et passionnant est l’effet. Et rejoint parfois miraculeusement tout ensemble, donc dans la petite image précieuse de la plus belle, avec un pic dans l’image d’une baie bleu avec un certain nombre d’usines, dont les cheminées dans la brume de la journée étouffante.
Les figures humaines, il est allé Cezanne pas si bon. Eh bien ici et là, il a réussi une tête de portrait ; à savoir son propre visage, il a souvent eu lieu avec une puissance extraordinaire et avec un œil vif pour les trains, qu’il a assumées avec objectivité critique, caractérisé. Mais les photos de groupe montrent les limites de son art. Bien sûr, tout le purement picturale d’intérêt, tout a tourné bien ici, à l’œil et les couleurs de goût, attire fortement. Mais cela ne vient pas ici pour toujours humain. Avec de telles valeurs, qui sont en fin de compte, mais aussi un morceau de la nature, Cezanne a échoué. Et ici, je ne peux pas l’aider, se trouve le danger de l’ensemble de l’impressionnisme à l’école. Pour en savoir magnifique ! Pour former l’œil indispensable ! Très bon accueil à l’élaboration de la peinture technique, au développement de la vision subjective ! Mais cela ne suffit pas, en dépit de tout et tout ça. Notre chemin mène, par ailleurs, elle enfantera ci-dessus. Il suffit de ne pas arrêter ici ; ce serait une nouvelle pédanterie. Ces réserves doivent être faites encore et encore. Seulement une fois que vous avez fait cela, vous avez le droit de vous réjouir d’une telle exposition exquise de la collection de Cezanne de Cassirer et de vous plonger dans votre plaisir. »
Landau Paul, « Paul Cezanne », Die Nation, 21e année, n° 35, 28 mai 1904, p. 555-556 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 514-517. Trancrire (traduire)
« Nur langsam und allmählich ist dem Genie Paul Cezannes ein später und spärlicher Ruhm heraufgestiegen. Bei uns gilt der alte Meister, der Jugendfreund Zolas, wohl gar für einen von den allerneusten, der unerhörte Farbenklänge und grellste Lichthelligkeiten darböte, und so war es nun an der Zeit, daß uns bei Cassirer eine größere Anzahl seiner Bilder gezeigt wurde. Wer etwa einen Neo-Impressionisten erwartet hatte, der fand nichts weiter als einen großen Maler.
Das Reinmalerische, die Schönheit, Wucht und Breite der Farbe, die richtige Sicherheit des Aussprechens ist bei Cezanne in einem so hohen Maße vorhanden wie etwa nur bei Rubens oder von den Modernen bei Trübner. Machtvoll und schwer läßt er die Töne seiner Palette aus-tönen, seine Farben strömen daher mit einer gesättigten Kraft, sie haben jenes innerliche und heiße Leuchten, den unvergeßlichen Widerschein einer großen Seele. Die Welt ist dem Maler eine wundervoll gestimmte Harmonie von Farbenmassen, in seine Hände sind hineingelegt die einzelnen Teile dieser bunten Allheit, und was das Auge in Fülle aufgetrunken, das fließt nun auf die Leinwand mit dem gleichen rätselvollen Einklang und in der geschlossenen Ganzheit des Geschauten.
In seinen Stilleben vor allem hat er all die farbige Schönheit der Natur aufgefangen und aus den toten Dingen schreit ein vielstimmiges Leben. Diese Eier, diese Äpfel, dieses weiße Tuch, sie sind gesättigt mit dem Glanz und Reichtum der ganzen Natur; die Äpfel leuchten und glühen wie Paradieseshoffnungen, wie Verführungen und Verheißungen der alten ewigen Erde. Diese kräftigen, lässig hingebreiteten Tücher mit den warmen schwarzen Schatten, dem leise bläulichen Glanz haben Licht und Leben in sich aufgesogen. Alles, was die Holländer an Stilleben dargeboten ― und sie haben allmählich nach langen und plumpen Versuchen in Bildern Willem Kalfs und van Bayerens das Höchste geleistet ― war doch die geschmäcklerische Freude an einem schönen Garteneckchen, einem Winkel der Natur, eingeengt in seiner Kleinlichkeit und Behaglichkeit. Ganz ins einzelne verliebt, malten sie mit schmunzelndem Appetit und gärtnerischer Züchterfreude ihr Frühstück und ihre Blumen. Cezanne hat selbst in seine Stilleben etwas von seiner großen naturnahen allfühlenden Sinnlichkeit gelegt und in der unerbittlich zwingenden, geschlossen großen Farbenwirkung gar mancher von ihnen liegt eine heroische Geste, etwas Pathetisches, das auch die minutiösen Schilderungen Zolas manchmal so erschütternd belebt.
Ein köstliches Gefühl für die Seele des Stofflichen und ein höchster Feinsinn im Zusammenstimmen der Farbenakkorde ― das macht diese ein wenig massig und schwer gemalten Bilder so schön. Auf einem dunkelgrünen Fond, der durch blaue, lila, grauliche Lichter ruhiger und indifferent gemacht wird, hebt sich ein großes, blättergemustertes Tuch mit dunklen Tönen heroisch und gebietend hervor; rote Äpfel stechen grell heraus, und doch sind auch sie eingeordnet, und ihre unruhigen Blicke sind gedämpft und ernsthaft gemacht durch ein kaltes Fahlgelb, ein mattes Weiß. Manchmal hat er eine Flut andrängender Farbenflecke, ein Konzert vieler einzelner Klänge gegeben. Dann wieder schafft er ganz kalte, fast farblose Verbindungen, Farbenskalen, die eintönig zwischen einem erdigen Schwarz und einem grellen Weiß dahergleiten und nur in einem dumpfen Grün ausruhen. So sind in einem tiefschwarzen Fond ein Tuch ganz vorn, dann Eier, Gläser, ein dunkelbraunrotes Brot hineinkomponiert. Alles Weiße ist gedämpft durch schwarze, über das Tuch hinfahrende Schatten, und wie um das Gleichgewicht der Farbenwerte zu erhalten, nimmt vorn ein schwarzes Messer den Grundton auf und bändigt die helleren Valeurs des Tuches und des Brotes, daß auch sie eingefügt sind in die große richtige Ordnung.
Immer wieder hat er Äpfel gemalt, bald hell in einer weißen Schüssel, durch ein luftiges Blau belebt; bald tief verkrochen und eingebettet in die schweren Falten des Tuches, von dunkelblauen Schatten umfangen; bald in großer Zahl massig, in schwerer Fülle fast erdrückend, dann sparsam und apart, spärlich geordnet auf einem Tisch, dazu eine blumenverzierte Kanne und dickbauchiges grünes oder blaßblaues Geschirr. Bald sind diese Äpfel gegen eine helle Tapete mit ganz wenigem Dekor gesehen; bald blickt aus dem Hintergrund ein warmbrauner Schrank, dessen Schlösser und Beschläge wunderbar gemalt sind.
Und auch die Farbenstimmung der Früchte ist stets eine andere: Sie glühen wohl dunkelleuchtend in einem satten Tone auf; oder ganz vom Licht abgeblendet schimmert ein helles Grün zu einem matten Weiß; einem blaßblauen Fond geben hell- und dunkelbraune Schatten einen stillen und ernsthaften Charakter. Vor allem aber sind die weißen Tücher, in denen ein paar schwärzliche Reflexe aufzucken, mit einem Schwelgen in vollen, breiten Wirkungen, mit einer vollströmenden machtvollen Farbe gemalt. Dieses Fortissimo der Farbenwirkung, dieses starke Ausklingenlassen der Akkorde ist die bezeichnende Note in Cezannes Persönlichkeit.
Darum können ihm Blumen nicht so gut gelingen wie Manet. Während Manet einzelne feinstenglige, schlanke Blumenwesen mit allem zarten Duft umgibt, packt er einen vollen Strauß in eine Vase und gerät wieder in die unruhige Buntheit der alten Holländer.
Es sind überhaupt Manet und Cezanne, so eng sie historisch auch zusammengehören und so verwandt auch die ruhige, altmeisterliche Wirkung ihrer Bilder heute ist, zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten, von denen Manet die reichere und feiner gebaute, Cezanne die einheitlichere und kraftvollere ist. Bei Manet fühlen wir, seitdem das Gewaltsame des Neuen nun völlig verblichen ist, eine feine und stille Anmut, einen sanften und zarten Geschmack, eine heiter spielende Geschmeidigkeit. Cezanne ist eine schwerblütigere, dunklere und heroische Natur; eine melancholische Innigkeit, ein gewaltiges und fast plumpes Umfassen der Welt liegt in seinen Bildern ausgedrückt. Er ist ein Einsamer, zu dem die tote Natur viel lauter redet als die Menschen, den die Dinge mit tausend Augen ansehen, daß er sich hineinwühlen muß in diese fragenden und rätselvollen Blicke. Seine starke Sinnlichkeit ist hingegeben und angeschlossen an alles Stoffliche, was ihn umgibt; aber die schweren Körper hat er lebendig gemacht in all ihrer Massigkeit und lastenden Schwere.
Daher konnte er wie keiner die Psychologie des Arbeiters geben, der niedergedrückt von der Erdenmühe nie Seelenleichtigkeit erlangt, und an diesen geistig toten Menschen, deren Hände mit stumpfsinniger Inbrunst die Karten halten, leben nicht die Gesichter, sondern die Linien ihres Schicksals und Lebens sind ausgedrückt, in den Kleidern, in diesen breit hingestrichenen Farbenflächen, in einem weiten blauen Kittel, einer roten Kravatte, einer schwarzen Hose. Etwas Ehrwürdiges geht von diesen plumpen, schlecht fallenden Gewändern aus und etwas Rührendes zugleich.
Frauen hat Cezanne nicht malen können; er gibt nur Farbenstimmungen; die feine behutsame Hand fehlte ihm für dies delikate Geschäft. Dagegen hat er in Männerporträts seine große, mächtige Seele gespiegelt. Da sitzt ein Mann in einem schwarzen Rock und helleren Hosen. Rücksichtslos und gewaltsam sind die riesig hohe Stirn, die starke Nase mit den rötlichen Reflexen, das Struppig-Wirre des Bartes herausmodelliert. Schwer ruhen die großen Hände auf den Knien. Aber diese ganze mächtige Gestalt ist von einer kolossalen Lebenswahrheit und einer düsteren Wucht.
So im dunklen Sinnen, schwer aus Träumen sich hebend, ist Cezanne auch durch die Landschaft gewandert. In seinen Bildern ist nichts von dem flirrenden Leben, der zitternden Lebendigkeit der Impressionisten. Still spiegeln sich seine Häuser im Wasser, dunkle Laubgänge neigen sich über einen ruhig fließenden Bach. Eingenistet in ein zartes Braungrün schauen schwarz-weiße Giebel hervor. An einem abgedämpften Himmel ziehen weißliche Wolken daher. Eine majestätisch ernste Wirkung geht von den alten Bäumen, den ruhig starken Farben aus.
Ein menschenleerer Weg mit schwarzer, schwerer Erde führt tief und endlos das Auge in ein Bild hinein, das ganz fern eine melancholische Hügellinie abschließt. Die dunklen Massen der Bäume neigen sich pathetisch schwermütig über diese verlassene Einsamkeit. Breit und langsam sind die Farben geflossen, mit einer Innigkeit und Wärme stehen sie da, daß aus ihnen die stumme Sprache eines stillen, tiefen Menschen und eines großen Malers zu uns dringt.
In solchen Bildern liegt die Kunst Cezannes beschlossen. Er ist keine fortreißende und aufregende Erscheinung, und es war nur zu natürlich, daß seine unaufdringliche und schlichte Kunst nicht jene Revolutionen hervorrief wie die Manets. Aber er trug seine Welt in sich und machte die unsere reicher. Wer sich erst recht tief hineingesehen hat in seine Bilder, der kann nicht mehr von ihnen gehen, ohne von nun an auch in der Natur eine reichere Schönheit, eine größere Farbenfülle zu erblicken. »
Traduction :
« Seulement est lentement et progressivement au génie de Paul Cezanne viennent plus tard et clairsemée renommée. Avec nous, le vieux maître, l’ami d’enfance de Zola applique, probablement darböte même pour un tout dernier de ceux qui couleurs inouïes de sons et de la luminosité de la lumière éclatante, et il était maintenant temps qu’un grand nombre de ses tableaux nous a montré à Cassirer. Qui a eu attend autour d’un néo-impressionniste, qui était rien de plus qu’un grand peintre.
La pure beauté picturale, la puissance et la largeur de la couleur, la bonne sécurité de prononcer existe à Cezanne à un si haut degré que seulement environ Rubens ou des modernes dans Trübner. Puissant et difficile, il rend les tons de sa palette de tons, de sorte que ses couleurs coulent avec une puissance saturé, ils ont ce que les lumières intérieures et chaudes, la réflexion inoubliable d’une grande âme. Le monde est le peintre une harmonie merveilleusement à l’écoute des masses de couleurs, dans ses mains sont mis en elle, les différentes parties de cet ensemble coloré, et ce qui se boire l’œil de la richesse qui coule maintenant sur la toile avec la même harmonie énigmatique et dans la totalité de fermeture de la vue.
Dans ses natures mortes de tout ce qu’il a recueilli toute la beauté de la nature et coloré des choses mortes hurle un chœur de vie. Ces œufs, les pommes, ce drap blanc saturé avec la splendeur et la richesse de l’ensemble de la nature ; les pommes brillent et brillent comme des espoirs de paradis que les tentations et les promesses de la vieille terre éternelle. Cette forte, occasionnels exécutés serviettes de calcul avec des ombres noires chaudes, l’éclat bleuté silencieuse ont absorbé la lumière et la vie en elle-même. Tout ce que les Néerlandais ont offert à la nature morte ― et ils ont progressivement atteint le plus haut pour les tentatives longues et maladroites en images Willem Kalf et van Bayerens ― encore les goûts de plaisir générique dans un beau coin de jardin, un coin de nature, concentrées dans sa petitesse et de confort, Complètement en amour détaillé, ils ont peint avec schmunzelndem appétit et horticulteurs enchantent leur petit-déjeuner et de leurs fleurs. Cezanne lui-même a implanté quelque chose allfühlenden de sa grande sensualité naturelle dans ses natures mortes et à l’impératif implacable, fermé couleurs principales effet plus d’un d’entre eux est un geste héroïque, un peu pathétique qui anime même les portraits minutieux Zola parfois si pénible.
Un délicieux sentiment de l’âme de la matière et une subtilité la plus élevée ainsi que les voix de cordes de couleur ― ce qui rend ces images un peu encombrants et lourds peint si belle. Sur un fond vert foncé, qui est fait calme et indifférente par bleu, pourpre, lumières grisâtres, il y a un grand, laisse tissu à motifs avec des tons sombres souligne héroïque et commandant ; pommes rouges ressortent brillamment, et pourtant, ils sont également classés, et leurs regards inquiets sont soumis et pris au sérieux par un froid jaune pâle, un blanc mat. Parfois, il ya eu une inondation andrä taches de couleurs entre les sexes, un concert de nombreux sons individuels. Là encore, il crée, composés presque incolores très froides, les échelles de couleurs, donc diaporama monotone entre un noir et un blanc terreux aveuglante et de repos que dans un vert terne. Donc un tissu œufs, des lunettes, un pain rouge brun foncé sont dans un fond noir profond à la pointe, puis dans la composition. Tous Blanc est amorti par le noir, hinfahrende plus l’ombre de tissu, et comment obtenir l’équilibre des valeurs de couleur, l’avant prend un couteau noir de la racine vers et retient le Valeurs plus léger de la toile et le pain qu’ils sont eux aussi inclus dans la grande le bon ordre.
Encore et encore, il a peint des pommes, bientôt la lumière relancé dans un bol blanc, avec un endroit aéré bleu ; Dès glissée profonde et intégrée dans les plis lourds de tissu, enveloppés par l’ombre bleu foncé ; bientôt en grand nombre modérément, en abondance lourde presque écrasante, puis avec parcimonie et en dehors, peu disposés sur une table, à un pot de fleurs décorés et plats bleu vert pâle ou bulbeuses graisse. Bientôt, ces pommes sont vues contre un fond d’écran lumineux avec très peu de décor ; semble bientôt dans les coulisses, une armoire brun chaud dont serrures et ferrures sont merveilleusement peint.
Par conséquent, il ne peuvent pas fleurir ainsi que réussir Manet. Alors que Manet seule feinstenglige, fleur mince essence entoure avec tout parfum délicat, il emballe un bouquet complet dans un vase et revient dans la variété agités des vieux maîtres hollandais.
Il n’y a jamais Manet et Cezanne, si étroitement qu’ils appartiennent aussi ensemble historiquement et donc aussi utilisés les calmes, anciens maîtres de votre photo est aujourd’hui, deux personnalités complètement différentes, dont Manet plus riche et plus fine construits, Cezanne qui est plus cohérente et plus puissant. Dans Manet nous nous sentons, depuis la violente de la nouvelle est maintenant complètement fanée, une amende et charme tranquille, une saveur douce et délicate, un jeu souplesse gaie. Cezanne est un rêveur, plus sombre et la nature héroïque ; une tendresse mélancolique, une étreinte immense et presque maladroite le monde est exprimée dans ses peintures. Il est un solitaire, dont la nature morte parle beaucoup plus fort que les gens, les choses à regarder des milliers d’yeux qu’il doit creuser dans ce questionnement et regards énigmatiques. Sa forte sensibilité est consacré et attaché à tout ce matériel qui l’entoure ; mais il a été rendu vivant sous toutes ses lourdeur corps lourds massivité et oppressives.
Par conséquent, il ne pouvait que rien donner la psychologie du travailleur, la dépression de l’effort de la terre jamais atteint âme facilité, et ces gens spirituellement morts détiennent leurs mains avec ferveur terne les cartes, vivent pas les visages, mais les lignes de leur propre destin et la vie sont exprimés, dans les vêtements, dans ce large charnière souligné surfaces de couleur, dans une large tunique bleue, une cravate rouge, pantalon noir. Quelque chose de produit Révérends de cette maladroits, robes mal couvertes et quelque chose de touchant dans le même temps.
Les femmes ne peuvent pas peinture a Cezanne ; il ne donne que des humeurs de couleurs ; la main douce amende manquait pour cette entreprise délicate. Toutefois, il a reflété sa grande, grande âme chez les hommes portraits. Un homme assis dans une jupe noire et un pantalon brillants. Impitoyablement et violemment, l’énorme front haut, le nez puissant avec des teintes rougeâtres, la barbe hirsute sont taillé. Lourd reste les grandes mains sur ses genoux. Mais tout cela figure puissante est d’une vérité colossale de la vie et une force obscure.
Ainsi, dans les sens sombres, disque de rêves soulèvement, Cezanne a bien déplacé à travers la campagne. Dans ses peintures il n’y a rien de la vie chatoyante, la vitalité frémissante des impressionnistes. Pourtant, ses maisons se reflètent dans l’eau, arcades sombres ont tendance sur un cours d’eau paisible. Niché dans un vert brun délicate regarder dehors pignon noir et blanc. Par conséquent, sur un ciel sourdine tirant nuages blanchâtres. Un effet majestueux grave est basée sur les vieux arbres, les couleurs calmes fortes.
Une route déserte avec du noir, la terre lourde conduit profond et sans fin que l’œil dans une image qui complète très éloignée d’une ligne de colline mélancolie. La masse sombre des arbres ont tendance à la mélancolie pathétique sur cette solitude déserte. Larges et longues les couleurs coulaient, avec une intimité et la chaleur qu’ils se tiennent là, qui les a fait pénétrer le langage muet d’un silencieux, les gens profondes et un grand peintre de nous.
Dans ces images, l’art de Cezanne est décidé. Il n’a pas continué rage et le phénomène passionnant, et il était naturel que son art discret et simple pas ces révolutions évoqué comme Manet. Mais il portait son monde et a fait la richesse de notre. Quiconque a regardé dans particulièrement profonde dans ses tableaux, qui ne peut plus marcher par eux sans voir une beauté riche, une plus grande abondance de couleurs maintenant aussi dans la nature. »
Pastor Willy, « Kunstausstellungen », Tägliche Rundschau, n° 128, 3 juin 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 514. Trancrire (traduire)
« Cassirer wird Historiker. Einen um den anderen älteren Maler führt er in seinen Ausstellungen vor, von dem die Impressionisten heute lernten. Bis Goya ist er schon zurückgegangen, und wenn er eines Tages zur Besichtigung einer Sammlung von Velasquez-Bildern einladen wollte, würde das kaum überraschen. Diesmal hat er Paul Cezanne ausgestellt. Er ist zur Zeit der Allermodernste. Also merke man sich den Namen gut, und einige Schlagwörter dazu. Wer sich genauer unterrichten will, findet Material in einer dreibändigen « Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst », die soeben Meier-Gräfe herausgegeben hat (bei Hofmann in Stuttgart; wir kommen auf dieses Buch, in dem der Geschmack der internationalen Kunsthändler einen ungemein beredten Advokaten findet, demnächst zurück.) In der vorjährigen Sezessionsausstellung hingen einige Cezanne’sche Bilder. Das Urteil, das ich damals abzugeben hatte, könnte ich nach der Ausstellung bei Cassirer ausführlicher begründen, aber nicht ändern. Als Schriftsteller würde Cezanne einer von denen sein, die ihren Stil überbürden mit Beiwörtern, deren jedes einzelne treffsicher in der Charakteristik ist, die aber nicht zusammengehen und die das Hauptwort ersticken. Und als Schauspieler würde Cezanne deklamieren, wie jene Ganzmodernen, die naturwahr zu sein wähnen, wenn sie Vokale schlucken und Konsonanten zischen. Zola soll bei seinem Künstler-roman an Cezanne, nicht an Manet gedacht haben. Aber vielleicht kommt auch für die hitzigsten Bewunderer Cezannes einmal der Tag, da es ihnen ergeht wie Zola in später Stunde: « Ich wache auf und bebe. Und wahrhaftig, das ist es, wofür ich mich geschlagen habe? Für diese Hellmalerei, diese Reflexe, diese Dekomposition des Lichts? Mein Gott, war ich verrückt? Das ist ja ganz häßlich, das flößt mir ja Abscheu ein! »
Noch zwei ältere Maler werden vorgeführt: Hirth du Frênes und Theodor Alt. Beide aus der Leiblschule. Hirth du Frênes wundert man sich in dieser Umgebung zu finden. Er bleibt nicht bei der Skizze stehen, er sucht auch gegenständlich zu unterhalten und ist durchaus keiner von denen, die in Ölfarben nur fachsimpeln. ― Bei Theodor Alt findet man den gewissenhaften und malerischen Leibl wieder. Sind es die schweren, dunklen Töne seiner Modellierung, die wieder auf ihn aufmerksam machen? Seine intimsten Reize sind gleichwohl nicht die der Farbe, sondern seine Begabung, Seelenschilderungen in einem Gesichtsausdruck, einem Auge zu geben. Mag er auch da nur streng sachliche Modellberichte geben: er hat sich die Modelle doch gewählt. ― »
Traduction :
« Cassirer est historien. Il présente dans ses expositions tel ou tel peintre ancien, dont les impressionnistes ont appris aujourd’hui. Jusqu’à Goya, il est déjà tombé, et s’il voulait inviter un jour à visiter une collection de tableaux de Velasquez, ce ne serait pas une surprise. Cette fois, il a exposé Paul Cezanne. Il est actuellement le plus haut. Alors réalisez que vous regardez le nom du bien, et quelques balises pour. Toute personne qui veut enseigner précision trouver du matériel dans un trois volumes « Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst », que vient de publier Meier-Graefe (chez Hofmann à Stuttgart, nous arrivons à ce livre, dans lequel la saveur du marchand d’art international trouve un avocat extrêmement éloquent, bientôt de retour.) Dans l’exposition de la sécession de l’an dernier étaient accrochés quelques tableaux de Cezanne. Le jugement, qui je devais verser à ce moment, je ne pouvais expliquer plus en détail, mais ne change pas après l’exposition à Cassirer. En tant qu’écrivain, Cezanne serait un de ceux qui surcharger leur style d’épithètes, échouent chaque individu est dans la caractéristique, mais pas aller de pair et étouffer le substantif. Et comme un acteur déclamait, comme ces toutes-modernes, qui imaginent d’être fidèle à la nature quand ils avalent voyelles et des consonnes sifflantes Cezanne. Zola est dans son stade-romaine à Cezanne, ne pas avoir la pensée de Manet. Mais vient peut-être aussi pour l’admirateur le plus chauffée de Cezanne une fois par jour quand ils en sortent comme Zola tard dans la nuit: «Je me réveille et bebe. Et en effet, voilà ce que je me suis battu ? Pour cette peinture de lumière, ces réflexions, cette décomposition de la lumière? Mon Dieu, j’étais fou ? Cela est très laid, qui me remplit avec tant une abomination ! »
Deux peintres anciens sont présentés : Hirth du Frênes et Theodor Alt. Tous deux de l’école de Leibl. Hirth du Frênes une merveille trouvée dans cet environnement. Il ne se limite pas à l’esquisse, il a également étudié objectivement pour divertir et est tout à fait pas partie de ceux qui parlent seul magasin dans les peintures à l’huile. ― Lorsque Theodor Old on retrouve à nouveau le Leibl consciencieux et pittoresque. Est-ce les tons sombres, lourds de sa modélisation, qui attirent l’attention sur lui ? Ses charmes les plus intimes ne sont néanmoins pas la couleur, mais son talent, les représentations de l’âme dans une expression pour donner un œil. Il peut aussi donner des rapports de modèle en tant que strictement factuelles : il a encore choisi les modèles. ― »
H. [Emil Heilbut], « Chronik », Kunst und Künstler, 2e année, n° 9, juin 1904, p. 378 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 514.
« Bei Cassirer findet eine Ausstellung des schwer verständlichen, herrlichen, gewaltigen Künstlers Cezanne statt. »
Traduction :
« Chez Cassirer se tient une exposition difficile, magnifique et puissante de l’artiste Cezanne. »
Meier-Graefe Julius, « Pariser Ausstellungen », Kunst und Künstler, cahier 9, juin 1904, p. 378-379.
Dr. Von Oettingen W., « Aus den Berliner Kunstsalons », Der Tag, n° 273, 14 juin 1904 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. 519. Trancrire (traduire)
« Im Sommer, wenn die großen Kunstausstellungen blühen, pflegen die Salons sich zu schließen oder wenigstens bis zum Beginn des Herbstlebens unauffällig zu vegetieren. Berlin, das längst zu jeder Jahreszeit jede Blume darbietet, scheint aber auch auf diesem Gebiete keine Ruhe zulassen zu wollen; wir sind im Juni, wir haben die Große Berliner und die Sezession, wir sahen seit Oktober, ach, so vieles ― dennoch kündigen, vielleicht mit Rücksicht auf den Strom der Reisenden, die meisten unserer Aussteller noch einmal allerlei Neues an, und zwar Sammlungen, die Anspruch auf dankbare Augen erheben dürfen und zerstreuten, übermüdeten Blicken nicht ausgesetzt werden sollten. […]
Bei Cassirer geben noch immer Cezannes Unbegreiflichkeiten denen Rätsel auf, die noch immer nicht vermögen, sich in die labyrinthischen Gänge seltsam forschender, experimentierender, tief einsamer Künstler ohne weiteres mithinein-zufinden und das eigene, zwar vermutlich flachere, aber doch eben eigene Gefühl dabei ganz zu verleugnen. Desto leichter wird es dem Harmlosen im Künstlerhause gemacht. »
Traduction :
« En été, quand les grandes expositions d’art fleurissent, maintenir les salons de fermer ou de végéter au moins jusqu’au début de la vie de l’automne banale. Berlin, chaque saison présente chaque fleur longtemps, mais semble vouloir l’admettre, même dans ce domaine pas de repos; nous sommes en juin, nous avons le Grand Berlin et la sécession, nous avons vu en octobre, ah, tellement ― encore résilions, peut-être en tenant compte de la circulation des voyageurs, la plupart de nos exposants une fois toutes sortes de nouveau à, à savoir la collecte, peuvent prétendre les yeux reconnaissants et dispersés, les yeux surmenés ne devraient pas être exposés. […]
Chez Cassirer encore donner Cezanne incompréhensibilités ces énigmes qui ne sont toujours pas en mesure, à refuser dans les couloirs labyrinthiques étrange curieux, d’expérimenter, artiste profondément solitaire facilement mithinein-zufinden et le sien, sans doute plus plate, mais juste propre sentiment à propos de cet ensemble. Le plus facile il sera fait l’inoffensive la maison de l’artiste. »
« Bildende Kunst », Sozialistische Monatshefte, 8e année, n° 7, juillet 1904, p. 581 ; cité dans Echte Bernhard, Feilchenfeldt Walter, avec la participation de Cordioli Petra, Kunstsalon Cassirer, tome 2 « « Das beste aus aller Welt zeigen ». Die Ausstellungen 1901-1905 », Wädenswil (Suisse), Nimbus, Kunst und Bücher, 2011, 747 pages, p. . Trancrire (traduire)
« Was schon eine Zeitlang zu erwarten war, da die vereinzelt in Berlin auftauchenden Bilder des Cezanne mit so viel Enthusiasmus begrüßt wurden, das ist nun richtig eingetreten: wir erhielten durch den Salon Cassirer einen Überblick über das Lebenswerk dieses unfertig gebliebenen Impressionisten, dieses Manet ohne Manets Können. Seit er vor vier Jahren in der Pariser Jahrhundertausstellung entdeckt wurde, hat sich, wie man hört, an der Seine die Begeisterung für seine Kunst stark abgekühlt. Und wohl mit Recht. Sehen wir zu: Ein für manche Nuancen der Hellfarbigkeit wohl empfängliches Auge, dem besonders die kühlen Töne aus der Wirklichkeit entgegenscheinen. Ausgesprochene Vorliebe für die Zusammenstellung jener reichlichen Weiß-Blau mit der Verbindung Rot-Gelb. Daher die häufigen Wiederholungen von Früchtestilleben auf einem Tafeltuch, dessen Schatten das Blau hergeben müssen. Also auch hier gibt es zwei Schwerpuncte, die an den Grenzen der Farbscala gesucht werden, wie so oft in der modernen Malerei. Ein differenzierterer Colorismus wird dadurch zu leicht in die Flucht geschlagen. Ausnahmsweise hat Cezanne auch die hellen Farben durch dunkle stumpfe Töne eingeschlossen, doch scheint es, daß mit den Jahren auch bei ihm das Helle immer mehr Ausdehnung gewinnt. Was Form und Linie betrifft, so ist sie in den frühen Bildern schwer und stockend, um sich immer mehr zu verflüchtigen. Es scheint dies nicht zu geschehen, um den Eindruck zu erzielen, als sähe man aus weiter Ferne auf die Dinge, sondern auch um der Notwendigkeit einiger Präcision zu entgehen, die dieser Hand immer eine Mühsal war. Nicht selten finden sich sogar sehr auffallende Begrenzungen der Farbenflächen, aber nur ein Ungefähr, das sich an die Gesetze der Perspective keineswegs bindet. Die aufrecht stehenden Dinge sieht man selten senkrecht, Kreisrundungen in der Verkürzung hängen nach dieser oder jener Seite über und sind an der Stelle, wo sie sich in Ellipsenform umbiegen sollten, immer zu breit. Tischkanten laufen nicht gerade, ein Tuch, das über den Plattenrand herunterhängen soll, laßt durch seine Falten nichts von der Umbiegungsstelle erraten, Figuren, Möbel und sonstige Dinge sind ohne bestimmtes Verhältnis zum Raum gelassen. In der Landschaft, in der sich oft Tonschönheiten und eine schwebende Luftigkeit der Massen einschmeicheln, ist der Mangel an Orientierung noch entschiedener. Besonders die Wasser breiten sich nie zur Fläche aus, weil die Spiegelungen, selbst wo es sich um geringe Farbenunterschiede handelt, zu sehr als Einzelheiten auftreten. Begreiflicherweise wird dieses mangelnde Form- und Raumverständnis am empfindlichsten bei der Darstellung von Köpfen und Figuren, wo Klarheit der Modellierung am wünschenswertesten wäre. Kurz, die deutsche Kunst wird mit dieser Erscheinung nicht viel anfangen können. »
Traduction :
« Ce qui devait être attendu pour un certain temps, que les tableaux de façon sporadique à Berlin émergents de Cezanne ont été accueillis avec tant d’enthousiasme, qui est maintenant entré correctement : nous avons reçu par le salon Cassirer un aperçu du travail de la vie de ce inachevé restait impressionnistes, cette Manet sans Manet Pouvoir. Depuis qu’il a été découvert il y a quatre ans à l’Exposition universelle de Paris, a, comme vous pouvez l’entendre, grandement refroidi dans son enthousiasme pour son art. Et probablement à juste titre. Voyons : Un bien réceptif à certaines nuances de couleur des yeux la lumière, en particulier les sons fraîches de la réalité contraire semblent. Préférence pour la compilation de ceux blanc-bleu abondante avec la combinaison rouge-jaune. D’où la répétition fréquente de nature morte sur une nappe dont les ombres avoir à donner le bleu. Donc, ici aussi il ya deux foyers qui sont recherchées aux frontières de l’échelle de couleurs, comme si souvent dans la peinture moderne. Un Colorismus plus variée est ainsi facilement en déroute. Exceptionnellement Cezanne a également les couleurs vives fermés par des tons ternes sombres, mais il semble qu’au fil des ans la Lumière gagner mesure aussi avec lui. Comme pour la forme et la ligne, il est donc difficile et hésitante afin d’évaporer plus en plus dans les premières images. Il semble que ce soit ne se produise pas en vue d’atteindre l’impression que vous voulez voir de loin à des choses, mais aussi à la nécessité d’une certaine précision, pour éviter que cette main a toujours eu des difficultés. Assez souvent, il y a même des limitations très frappants de zones de couleur, mais seulement environ, qui se lie aux lois de la perspective par aucun moyen.
Les choses verticaux On voit rarement les courbes verticales circulaires dans le raccourcissement pendent tel ou tel cours et sont au point où ils doivent être pliés en forme elliptique, toujours trop large. bords de table ne vont pas droit, un chiffon qui est accroché sur le bord de la plaque, laissent deviner son plis rien de la Umbiegungsstelle, la statuaire, des meubles et d’autres choses sont laissées sans relation spécifique à l’espace. Dans la campagne, dans les bonnes grâces de la souvent les beautés naturelles et légèreté flottante des masses, manque d’orientation est encore plus décisive. En particulier, l’eau ne propage sur le visage, parce que les reflets, même quand il vient à de petites différences de couleur se produisent le plus de détails. Naturellement, cela est un manque de compréhension de la forme et de l’espace le plus sensible dans la représentation de têtes et de chiffres, où la clarté de la modélisation serait plus souhaitable. En bref, l’art allemand ne peut pas faire grand-chose à ce phénomène. »
29 avril
Cézanne remercie Jean Royère, ami de Joachim Gasquet, pour l’envoi de ses Poèmes eurythmiques.
« Aix, 29 Avril 1904.
Cher Monsieur,
J’ai reçu la semaine dernière votre envoi des poëmes Eurythmiques.
Pour vous bien remercier de cette gracieuse attention j’ai voulu pénétrer aussitot cette acuité de vision, qui les rend si distincts. Malheureusement l’âge avancé auquel je suis parvenu, me rend difficile l’abord de formules d’art nouvelles.
Je n’étais donc pas préparé à goûter de prime abord toute la saveur de vos rythmes colorés. Voilà en deux mots l’explication du retard apporté à ma réponse.
Veuillez agréer, cher monsieur, l’assurance de toute ma sympathie d’art,
P. Cezanne »Lettre de Cézanne à Royère, datée « Aix, 29 Avril 1904 » ; Czwiklitzer Christophe, Lettres autographes de peintres et sculpteurs. De Handschrift der maler und bildhauer, avant-propos de Jean Cassou, Bâle, éditions Art – C.C., 1976, 521 pages, reproduit.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 309.
Royère Jean, Eurythmies, Paris, Librairie Léon Vanier, Éditeur A. Messein Succr, 1904, 72 pages.
Royère Jean, « Un Aixois, Joachim Gasquet (Souvenirs d’enfance) », Le Mémorial d’Aix, journal politique, commercial, littéraire et mondain, 92e année, n° 50, dimanche 15 décembre 1929, p. 4 :
« Les petits voyous de la ville, cependant, nous respectaient, car j’étais alors terriblement batailleur, et il n’aurait pas fait bon me jeter des pierres, comme on le faisait à Cezanne…
Sitôt bachelier, Gasquet fonda des revues : La Syrinx, puis Les Mois dorés, enfin Le Pays de France, où il oubliait des vers panthéistes. Je les lisais, mais n’y collaborais pas. Je préparais, alors, l’École normale au lycée de Lyon. C’est en août 1892 ― je venais d’être reçu à la licence de lettres ― que je fis, chez Gasquet, la connaissance de Cezanne. J’ai raconté cette scène dans La Phalange. Cezanne, qui avait été autrefois, à Paris, l’ami de mon père et de mon oncle, fit sur moi une impression extraordinaire, l’homme tout autant que ses tableaux… Je peux dire qu’il me révéla la peinture. C’est peut-être Cezanne qui m’a rendu poète et m’a donné l’envie de quintessencier en vers des paysages. Il m’a inculqué aussi la passion de l’art. Cezanne avait comme admirateur aixois le peintre Louis Leydet, le plus cher de mes amis d’enfance, et Gasquet. En dehors d’eux et peut-être d’un on deux autres, tout le monde jugeait Cezanne grotesque. Zola lui-même l’avait renié… A Paris, cependant, il avait des admirateurs qui mirent Vollard sur sa piste.
C’est Gasquet qui a découvert Cezanne à Aix et c’est Cezanne qui a refroidi mon admiration pour Gasquet, car il y a une véritable antinomie entre le lyrisme de Gasquet et la peinture de Cezanne, et rien ne prouve mieux la largeur d’esprit de Gasquet, son intelligence esthétique, que la sincérité nonobstant cette opposition, de son admiration pour Cezanne. Gasquet avait au plus haut point la faculté de s’extasier et d’adultérer ce qu’il admirait. »
Printemps (?)
Roger Marx espère faire accepter une toile de Cézanne par le jury de l’Exposition universelle de Saint Louis (États-Unis) et obtenir, à cette occasion, l’octroi de la Légion d’honneur au peintre par le ministère du Commerce et de l’Industrie. Vollard propose Mon jardin, qui avait figuré à la Centennale, mais la toile est refusée.
Mirbeau Octave, « L’art, l’institut et l’État », La Revue, 15 avril 1905 :
« L’État fait pire, encore. Chaque jour, il laisse s’accomplir de véritables crimes artistiques, et, mieux, il les approuve, et les sanctionne. Récemment, il approuva, sanctionna, les impudentes décisions d’un jury, composé de membres de l’Institut, lequel osa refuser, pour l’exposition de Saint-Louis, un tableau de Cezanne qui, d’ailleurs, quatre années auparavant, grâce à un pieux subterfuge de M. Roger Marx, avait figuré à l’Exposition centennale de 1900… Un tableau de Cezanne, le peintre des peintres, refusé par ces infimes et insolents barbouilleurs !… Cezanne, l’expression la plus haute, la plus pure, la plus noblement émouvante, la plus extraordinaire, la plus peintre de notre art français d’aujourd’hui !… Cezanne âme naïve et somptueuse, tourmentée du besoin déchirant de la perfection, ouvrier inflexible et ingénu comme un Primitif artiste, savant, imaginatif et splendide comme un Michel-Ange, un Giorgione, un Véronèse, un Rubens, un Delacroix !… Cezanne, prodigieux renouveleur d’idéal, inventeur logique d’harmonies par tout ce qu’il a senti et réalisé d’impressions nouvelles, devant la lumière… Cezanne, qui, avec un peu de bleu du ciel, un rien de vert d’une branche, un bout de terrain, reconstitue l’âme même d’un pays ; qui, avec quelques humbles pommes posées ça et là sur la blancheur d’une nappe, avec un pichet vernissé avec une petite plante fleurie dans un pot de terre brune, évoque aux yeux éblouis, toutes les richesses grasses, toute la souplesse fluide, nombreuse, de la couleur… avec ses compositions, tout le rythme héroïque, constructeur de la forme en mouvement… Cezanne, le premier qui ait pétri ses noirs profonds, et ses blancs radieux avec tous les reflets de la lumière et du soleil… Cezanne admiré, vénéré, l’influence la plus féconde, la plus profonde, la source merveilleuse où vient s’abreuver de leçons enchantées, toute une jeune, toute une intéressante génération d’artistes supérieurs !… Cezanne, enfin, excuse et rachat, à lui seul, de toutes les médiocrités agressives, de toutes les platitudes humiliées, au nom de quoi on le sacrifie !… Qui osera jamais croire à tant de barbarie ?…
Lorsqu’un de ces peintres — les seuls qui maintiennent intacte la réputation artistique de la France – organise, de loin en loin, une exposition ; lorsque Claude Monet montre au public ses Cathédrales, ses Vétheuil, sa Tamise, ses Nymphéas ; »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 146, p. 186-187 :
« Peu après, en 1904, un inspecteur des Beaux-Arts, M. Roger Marx, n’ignorant pas le désir de Cezanne d’avoir la croix, mais se rendant bien compte qu’il n’y avait rien à espérer du côté du Ministère des Beaux-Arts, tenta de le faire décorer par le Ministère du Commerce et de l’Industrie, à l’occasion de l’Exposition Universelle de Saint-Louis.
Mais, avant d’aller à Saint-Louis, il fallait passer par le jury. Le protecteur de Cezanne, désireux d’écarter tout prétexte au refus du tableau qui serait proposé, me recommanda de chercher dans son œuvre la toile la plus « raisonnable ». Je proposai Mon Jardin [Le Bassin du Jas de Bouffan, FWN92-R278], qui avait figuré à la Centennale lors de l’Exposition Universelle de 1900. Nouvel obstacle : les membres du jury qui étaient « de la partie » — et c’était la grande majorité — se rappelaient avec amertume qu’à cette même Exposition Universelle de 1900, l’organisateur de la Centennale, le même Roger Marx, avait reçu trois toiles de Cezanne, tandis que des artistes aussi indiscutables que Cabanel ou Bouguereau n’avaient eu chacun qu’un seul tableau. Aussi, cela va sans dire, l’envoi de Cezanne fut-il refusé par acclamation. »
12 mai
Cézanne déclare à Émile Bernard que le talent de Redon lui plaît et qu’il est de cœur avec lui dans son admiration pour Delacroix, dont il rêve de réaliser une apothéose. Il met en garde le jeune peintre contre « l’esprit littérateur, qui fait si souvent le peintre s’écarter de sa vraie voie ― l’étude concrète de la nature ― pour se perdre trop longtemps dans des spéculations intangibles ». Il le remercie pour l’envoi de son livre, La Décadence du beau, et lui donne l’autorisation d’envoyer à Vollard la photographie qu’il a prise de Cézanne dans son atelier, assis devant une grande composition de baigneuses (Les Grandes Baigneuses, FWN980-R856).
« Aix, 12 Mai 1904.
Mon cher Bernard,
Mon assiduité au travail et mon âge avancé vous expliqueront assez le retard que j’ai apporté à vous répondre.
Vous m’entretenez d’ailleurs de choses si variées dans votre dernière lettre, toutes cependant se rattachant à l’art, que je ne puis la suivre dans tout son développement.
Je vous l’ai dit déjà, le talent de Redon me plait beaucoup 1 et je suis avec de cœur avec lui pour sentir et admirer Delacroix. Je ne sais si ma précaire santé, me permettra de réaliser jamais mon rêve de faire son apothéose 2.
Je procède très lentement. La nature s’offrant à moi très ― complexe, et les progrès à faire sont incessants. Il faut bien voir son modèle et sentir très ― juste ; et encore s’exprimer avec distinction et force.
Le goût est le meilleur juge. Il est rare. L’art ne s’adresse qu’à un nombre excessivement restreint d’individus. ―
L’artiste doit dédaigner l’opinion qui ne repose pas sur l’observation intelligente du caractère. Il doit redouter l’esprit littérateur, qui fait si souvent le peintre s’écarter de sa vraie vraie voie, l’étude concrète de la nature, pour se perdre trop longtemps dans des spéculations intangibles. ―
Le Louvre est un bon livre à consulter, mais ce ne doit être encore qu’un intermédiaire. L’étude réelle et prodigieuse à entreprendre c’est la diversité du tableau de la nature.
Je vous remercie beaucoup de l’envoi de votre livre 3 ; j’attends de pouvoir le lire à tête reposée.
Vous pouvez envoyer à Vollard, si vous le jugez bon, ce qu’il vous a demandé. ―
Veuillez faire agréer à Madame Bernard mes salutations Respectueuses, à Antoine et Irène un baiser de père nouricier,
cordialement à vous,
Paul Cezanne »
- Bernard vénérait Odilon Redon (1840-1916), qu’il connaissait depuis environ 1889 et avec lequel il correspondait. Lorsqu’un journaliste lui demanda en 1891 quels étaient les artistes qu’il admirait le plus, Bernard avait répondu : « Parmi les contemporains je n’admire que Cézanne et Redon. »
- Il n’existe que des esquisses pour cette Apothéose de Delacroix que Cézanne voulait peindre et dans laquelle il avait prévu une place importante pour Victor Chocquet. Au verso d’une aquarelle inspirée de Delacroix, Bernard a trouvé ces vers de Cézanne :« Voici la jeune femme aux fesses rebondies.
Comme elle étale bien au milieu des prairies
Son corps souple, splendide épanouissement ;
La couleuvre n’a pas de souplesse plus grande,
Et le soleil qui luit darde complaisamment
Quelques rayons dorés sur cette belle viande. »- Il s’agissait probablement d’une collection d’articles de Bernard, Réflexions d’un témoin de la Décadence du Beau, Le Caire, 1902, 218 pages.
Lettre de Cézanne à Bernard, datée « Aix, 12 Mai 1904 », Londres, The Courtauld Gallery.
House John, « Cézanne’s Letters to Émile Bernard », catalogue d’exposition The Courtauld Cézannes ; The Courtauld Gallery, Londres, The Courtauld Gallery, 26 juin – 5 octobre 2008, Londres, The Courtauld Gallery en association avec Paul Holberton Publishing, 2008, p. 150-151, reproduit.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 301-302.
Bernard Émile, Sur Paul Cézanne, Paris, R. G. Michel, 1925, p. 43-44, 58, note 1.
Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 54-59 :
« Jusqu’à sa mort, et depuis cette époque, d’où date la première esquisse toute inspirée de Rubens, constamment il travailla à une immense toile, vingt fois lâchée, vingt fois reprise, lacérée, brûlée, détruite, recommencée, et dont le dernier état appartient à la collection Pellerin [Les Grandes Baigneuses, R 857]. J’en ai vu jadis une réplique splendide, presque achevée, au haut de l’escalier du Jas de Bouffan. Elle resta là trois mois, puis Cezanne la retourna contre le mur, puis elle disparut. Il ne voulait pas qu’on lui en parlât, même lorsqu’elle rayonnait en plein soleil et qu’on était obligé de passer devant elle pour pénétrer dans son atelier, sous les mansardes. Qu’est-elle devenue ? Le sujet qui le hantait ainsi, c’était un bain de femmes sous des arbres, dans un pré. Il en a fait une trentaine de petites ébauches, au moins, dont deux ou trois toiles très fines, très poussées, une multitude de dessins, des aquarelles, des albums de croquis qui ne quittaient pas le tiroir de sa commode, dans sa chambre, ou de sa table, dans son atelier.
« ― Ce sera mon tableau, disait-il parfois, ce que je laisserai… Mais le centre ? Je ne puis trouver le centre… Autour de quoi, dites, les grouper toutes ? Ah ! l’arabesque de Poussin. Il la connaissait dans les coins, celui-là. Dans les Bacchanales de Londres, dans la Flore du Louvre, où commence, où finit la ligne des corps et du paysage… Ça ne fait qu’un. Il n’y a pas de centre. Moi, je voudrais comme un trou, un regard de lumière, un soleil invisible qui guette tous mes corps, les baigne, les caresse, les intensifie… au milieu. »
Et il déchirait un croquis.
« ― Ce n’est pas ça… Et puis, allez faire poser ça, en plein air… J’ai bien essayé, lorsque les soldats se baignent, d’aller le long de l’Arc voir les contrastes, les tons de la chair sur les verts… Mais c’est autre chose, ça ne me donne rien, ça ne peut rien me donner pour mes bonnes femmes… Tenez, sacré nom ! comme celle-ci a l’air hommasse… Ça me reste dans l’œil, ces piou-pious. »
Et montrant le poing aux tendres chairs bleutées de son ébauche et, par-delà leur éblouissement, peut-être à toutes les femelles du monde :
« ― Ah ! les sacrées garces ! les sacrées garces ! »
La grande toile du Bain de la collection Pellerin est restée inachevée. Quinze nudités de femmes y rayonnent et l’animent. Sous de hauts arbres, aux troncs lisses et fins, se rencontrant dans le ciel en ogives et formant comme un arceau mouvant de végétale cathédrale ouvert sur un tendre paysage d’Île-de-France, au bord d’une rivière lente, les femmes vont se baigner. Une déjà, cheveux flottants, la tête en arrière, s’abandonne au courant. D’autres s’élancent. Elles forment deux groupes, huit d’un côté, six de l’autre, unies toutes par la blancheur d’un linge avec lequel trois d’entre elles jouent sur la rive, par celle qui nage, au centre même de la composition, et plus loin, sur une prairie, devant un château, par un homme qui les regarde. Est-ce là ce regard du soleil dont parlait Cezanne et qu’il s’est décidé à humaniser, à rendre moins symbolique, mais plus vivant ? En tout cas, c’est lui qui concentre toute la scène, lui et l’arceau des troncs, le vitrail voûté des branches, le linge du premier plan. L’eau est profonde, l’herbage chatoie. Le clair paysage français est pur comme un vers de Racine. C’est un après-midi d’été léger… Les femmes d’abord paraissent disproportionnées, épaisses, carrées, les deux qui courent, comme taillées dans un bas-relief égyptien. On approche, on regarde longuement. Elles sont fines, allongées, divines, sœurs des nymphes de Jean Goujon, filles subtiles des naïves Saisons du Jas. Une s’en va, avec un geste de gamine étourdie qu’on poursuit, on ne voit pas ses jambes, mais la main, les doigts serrés de danseuse cambodgienne, on la sent sauter, pubère et ravie, à travers les vertes tiges qui la frôlent. Une autre, calme, olympienne, appuyée à un arbre, songe, les yeux perdus. Une, étendue, contente, apaisée, s’est installée, les coudes dans l’herbe, pour contempler ses amies dans l’eau ; et ses seins opulents, ses fesses massives et dures, ses bruns cheveux prennent un bain de lumière, frissonnent, mouillés de brise bleue, comme un rêve tendu dans une chair de soie. Les deux qui s’invitent, en se montrant la nageuse, tressaillent déjà des caresses de l’eau. À gauche, dans le même groupe, la plus grande, d’un immense pas de guerrière, écarte les autres. Elle s’élance. Elle est la force, la jeunesse, la santé. Parallèle, un peu courbée, au jet séveux d’un arbre, elle est elle-même comme un arbre qui marche, une plante humaine, toute prête à l’amour. Et derrière elle, abandonnée, celle qui s’endort soupire la traîtrise et le charme de l’herbe où ondule une fièvre fleurie. Mais les deux plus belles, je crois, sont celles qui, accroupies, royales, magnifiques, tendent le linge à leur sœur agenouillée et balancent de leurs bras déployés une courbe mallarméenne que soulignent d’un rayon plus plein, d’une ferveur plus riche, l’arc charnu de leurs hanches, les blonds cheveux de l’une, à la tête de naine sur un corps de déesse, la robuste épaule de l’autre, à la face pensive sous des cheveux trop lourds. Une grâce les enveloppe toutes, une joie, une fierté… Il est émouvant que tant de doutes, de tourments, de fureurs se soient puérilisés en tant de tendresse, d’amabilité et de paix. Plus rien dans ces jeux virgiliens, cette fête innocente, ces danses végétales, ne brûle de l’âme crispée, des sanglots de Cezanne. Cet Éden d’ondes païennes, de chairs mélodieuses, de tendres arbres et de bleues nudités, ne parle que de force et d’équilibre. De loin, d’en bas, un grand souffle affolé semble sortir d’une tragique orgie et vous brûle au visage ; on monte l’escalier, il n’y a plus là d’autre mysticisme que celui du bonheur dans la pleine santé.
Mais rien, pas même ces flambées sensuelles, cet étourdissement charnel devant la femme, cet amour de l’amour, ne tint jamais longtemps devant la seule passion véritable de Cezanne. Il n’adora vraiment que la peinture. Comme Flaubert, jamais satisfait devant la page achevée et oubliant toutes choses pour elle, une volonté absolue, une sorte de sainteté le cloîtrait devant sa toile, le séparait de tout. Même hors de l’atelier, plus rien n’existait que l’œuvre en train. Toutes ses pensées, ses sensations l’y ramenaient. C’était comme un état sentimental, qu’on ne peut comparer qu’à cette rêverie diffuse qui accompagne partout les amoureux. Rien ne l’intéressait que son art, ou du point de vue de son art. Partout, dans la rue, à table, au café, il s’arrêtait de parler ou d’écouter, clignait des yeux, regardait, notait une ombre, suivait un geste, une ligne, un trait, clichait un contraste, s’emparait du monde, le détournait dans sa mémoire, le comparait à sa besogne de la veille, le ruminait vers son labeur du lendemain. Son travail l’habitait. Il ne pouvait supporter qu’on y attentât. Toutes ses souffrances, que d’autres taxèrent de manies, avaient leur source là. Vers la fin de sa vie, il regrettait de ne pas être moine comme l’Angelico, pour pouvoir, son existence réglée une fois pour toutes, coupée seulement par de frugaux repas et les beaux repos des offices, sans préoccupations, sans soucis, peindre du lever au coucher du soleil, méditer dans sa cellule, n’être jamais dérangé de sa méditation, ni détourné de son effort. Tout un côté farouche de son caractère tint à la peur constante qu’il avait des indifférents qui, n’ayant rien à faire, viennent perdre le temps des autres. Il les fuyait comme la peste, s’étant plusieurs fois, dans sa naïveté expansive d’artiste, laissé aller à ces désagrégeantes sympathies. Il était très bon, et il lui était extrêmement pénible de faire quelque peine, même à des inconnus. On le venait voir, une grande colère le prenait d’abord à l’idée de l’heure qu’il allait gâcher, mais sa naturelle bonté reprenait le dessus. Il se maîtrisait, et une divine timidité le faisait accueillir alors celui à qui de prime élan il n’avait pu brutalement fermer sa porte. Car, orgueilleux d’esprit, il était humble de cœur. Les hommes lui apparaissaient prodigieusement compliqués, et l’effort où il s’épuisait, eux partis, pour essayer de démonter leurs rouages, de lire en eux, de déchiffrer leurs pensées et leur but, autant de minutes volées pour lui au travail, à la peinture. Il s’enfermait, ne voulait voir personne. Et ce ne fut pas seulement misanthropique manie de vieillard. En pleine jeunesse il était ainsi déjà. Il se terrait, ne voulait durant des semaines laisser entrer âme qui vive dans son atelier, fuyait toute connaissance nouvelle. »
26 mai
Il donne son accord de principe à Émile Bernard pour la publication d’un article destiné à L’Occident, tout en remarquant : « Les causeries sur l’art sont presque inutiles. »
« Aix, 26 Mai 1904.
Mon cher Bernard
J’approuve assez les idées que vous allez développer dans votre prochain article destiné à l’Occident. Mais j’en reviens toujours à ceci : Le peintre doit se consacrer entièrement à l’étude de la nature, et tâcher de produire des tableaux, qui soient un enseignement. Les causeries sur l’art sont presque inutiles. Le travail, qui fait réaliser un progrès dans son propre métier est un dédomagement suffisant de ne pas être compris des imbéciles.
Le littérateur s’exprime avec des abstractions, tandis que le peintre concrète au moyen du dessin et de la couleur ses sensations, ses perceptions. ― On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins [mot rayé non lu] maître de son modèle, et surtout de ses moyens d’expression. Pénétrer ce qu’on a devant soi, et persévérer à s’exprimer le plus logiquement possible.
Veuillez faire agréer mes salutations Respectueuses à Madame Bernard, une bonne poignée de main à Vous, et souvenir aux enfants.
Pictor P. Cezanne »Lettre de Cézanne à Bernard (signée « Pictor P. Cézanne »), datée « Aix, 26 Mai 1904 », Londres, The Courtauld Gallery. MS.1932.SC.1.3.1 à 1.3.3
House John, « Cézanne’s Letters to Émile Bernard », catalogue d’exposition The Courtauld Cézannes ; The Courtauld Gallery, Londres, The Courtauld Gallery, 26 juin – 5 octobre 2008, Londres, The Courtauld Gallery en association avec Paul Holberton Publishing, 2008, p. 152-153, reproduit.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 302.
Mai
Gabriel Mourey, le directeur des Arts de la vie, prend l’initiative d’une souscription pour acheter Le Penseur de Rodin et l’offrir à l’État pour l’ériger à Paris. Vollard indique que Cézanne participe à la souscription car Rodin, dans une lettre publique, aurait déploré qu’il n’y ait que des souscripteurs dreyfusards. Le don de Cézanne est de 40 francs, par l’intermédiaire de Geffroy.
Vollard Ambroise, Paul Cézanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 115.
Lettre de Cézanne à Geffroy, [1904] ; Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 307.
Les Arts de la vie, nos 6-11, juin-novembre 1904.
Mirbeau Octave, Correspondance avec Auguste Renoir, éd. présentée et annotée par Pierre Michel et Jean-François Nivet, Tusson (Charente), éd. du Lérot, 1988, p. 221, note 5.
Voir Le Normand-Romain Antoinette (commissaire général), 1898 : le Balzac de Rodin, catalogue d’exposition, Paris, musée Rodin, 16 juin – 13 septembre 1998, Paris, musée Rodin, 1998, 463 pages, Cézanne p. 187.
1er-18 juin
Première exposition de Matisse à la galerie Vollard.
Catalogue d’exposition.
27 juin
Cézanne se plaint de nouveau des « troubles cérébraux qui m’empêchent d’évoluer librement ». Son fils et probablement Hortense sont à Paris, 16, rue Duperré. Ce dernier assiste à une soirée dansante donnée par Vollard où sont invités « toute la jeune école […] Maurice Denis, Vuillard, etc. […] Joachim Gasquet ». Cézanne désapprouve ce genre de manifestation. Il conseille à Émile Bernard de « travailler beaucoup ».
Paul Cézanne fils a loué une maison à Fontainebleau.
Il écrit à Émile Bernard :
« Aix, 27 juin 1904.
Mon cher Bernard,
J’ai bien reçu votre honorée du., que j’ai laissée à la campagne. si j’ai tardé à y répondre, c’est que je me trouve sous le coup de troubles ― cérébraux, qui m’empêchent d’évoluer librement. Je demeure sous le coup de sensations, et malgré mon âge vissé à la vissé à la peinture.
Le temps est beau, j’en profite pour travailler, il faudrait faire dix bonnes, les vendre cher, puisque les amateurs spéculent dessus. ―
Hier est arrivée ici une lettre adressée à mon fils, que madame Brémond a conjecturé être de vous, je la lui est fait adresser rue Duperré, 16, Paris, IXe arrond. ―
Il paraît que Vollard, il y a quelques jours, a donné une soirée dansante, où on a beaucoup boustifaillé, — toute la jeune école s’y trouvait, paraît-il. Maurice Denis, Vuillard, etc., Paul et Joachim Gasquet s’y sont rencontrés. Je crois que le mieux est de travailler beaucoup. Vous êtes jeunes, réalisez et vendez. ―
Vous vous rappelez le beau pastel de Chardin, armé d’une paire de besicles, une visière faisant auvent. ― C’est un roublard ce peintre. Avez-vous pas remarqué, qu’en faisant chevaucher sur son nez un léger plan transversal d’arête, les valeurs s’établissent mieux à la vue. Vérifiez ce fait, et vous me direz, si je me trompe. ―
Bien cordialement à vous, et veuillez faire agréer mes Respects par madame Bernard, et un bon souvenir à Antoine et Irène.
Paul Cezanne
Il m’a semblé que Paul m’a écrit qu’ils [Paul et Hortense] ont loué quelque chose à Fontainebleau pour y passer un couple de mois ―.
Il faut que je vous dise que vu les grandes chaleurs, je me fais monter à déjeuner à la campagne. »Lettre de Cézanne à Bernard, datée « Aix, 27 juin 1904 », Londres, The Courtauld Gallery.MS.1932.SC.1.4.1 à 1.4.3
House John, « Cézanne’s Letters to Émile Bernard », catalogue d’exposition The Courtauld Cézannes ; The Courtauld Gallery, Londres, The Courtauld Gallery, 26 juin – 5 octobre 2008, Londres, The Courtauld Gallery en association avec Paul Holberton Publishing, 2008, p. 154-155, reproduit.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 303-304. Supposition de la présence d’Hortense Cézanne au 16, rue Duperré, d’après la lettre de Cézanne du 25 juillet 1906.
Juillet
« Chronique de la curiosité » ; L’Art et les artistes, tome III, n° 16, juillet 1906 ; p. xviii-xvix.
« Quant à M. Paul Chevallier, ses principales adjudications sont les suivantes : […] un Cézanne, La Maison abandonnée, à la vente Blot. 6 000 fr. ; […]
L’engouement va de même aux œuvres modernes les plus outrancières, et des Cézanne se sont vendus au prix d’un Van Loo ; »
7 juillet
Auguste Pellerin achète sept tableaux de Cézanne à Bernheim-Jeune.
N° d’inventaire Bernheim-Jeune Titre et dimensions Provenance Titre et référence Rewald 13618 Joueurs de cartes, 97 x 130 cm Vollard LesJoueurs de cartes (FWN685-R710) 13620 Femme à la cafetière, 130 x 97 cm Vollard Femme la cafetière (FWN514-R781) 13621 Femme en rouge assise sous draperie, 115 x 89 cm Vollard Madame Cézanne au fauteuil jaune (FWN493-R655) 13623 Femme en gris sur fond gris, 92 x 73 cm Vollard Portrait de madame Cézanne (FWN485–R683) 13625 Femme accoudée sur un tapis, 92 x 73 cm Vollard Jeune Italienne accoudée (FWN534-R812) 13629 Portrait de l’artiste nu-tête, 55 x 46,5 cm Vollard Portrait de Paul Cézanne (FWN517-R876) 13630 Portrait de femme Vollard Portrait de madame Cézanne (FWN479-R583) Archives Bernheim-Jeune.
Rewald John, The Paintings of Paul Cézanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman, volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 507, p. 340.
Rivière Georges, Le Maître Paul Cézanne, H. Floury éditeur, Paris, 1923, 243 pages, p. 221 :
« Jeune Italienne accoudée. [FWN534-R812] Fille de l’Italien dont le portrait date de 1893 [non identifié]. Cette toile a été peinte rue Gabrielle, à Montmartre. »
8 juillet
D’après le livre de stock B de Vollard, il achète à Gabet une toile de Cézanne pour 80 francs, n° 4177, « Peintre dans la campagne », 24 x 34 cm (Un peintre au travail (Justin Gabet ?), FWN631-R233).
Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute.
25 juillet
L’article d’Émile Bernard « Paul Cézanne » paraît dans L’Occident.
Cézanne, qui a reçu la revue, le remercie. Il recommande au jeune peintre de regarder surtout les Vénitiens et les Espagnols, qu’il considère comme les plus grands.
« Aix, 25 juillet 1904.
Mon cher Bernard,
J’ai reçu la Revue Occidentale. ― Je ne puis que vous remercier de ce que vous avez écrit sur mon compte. ―
Je regrette que nous ne puissions être côte à côte, parce que je ne veux pas avoir raison théoriquement, mais sur nature. Ingres, malgré son estyle (prononciation aixoise, et ses admirateurs, n’est qu’un très-petit peintre. Les plus grands, vous les connaissez mieux que moi, les Vénitiens et les Espagnols. ― Pour les progrès à réaliser il n’y a que la nature, et l’œil s’éduque à son contact. Il devient concentrique à force de regarder et de travailler. Je veux dire que dans une orange une pomme, une boule une tête, il y a un point culminant, et ce point est toujours, pris sur — le plus rapproché de notre œil, malgré le terrible effet, lumière et ombre. ― sensations colorantes les bords des objets fuient vers un centre placé à notre horizon, avec un petit tempérament on peut être très-peintre. On peut faire des choses bien sans être très-harmoniste, ni coloriste. Il suffit d’avoir un sens d’art — Et c’est sans doute l’horreur du bourgeois, ce sens là. ― Donc les instituts, les pensions, les honneurs ne peuvent être faits que pour les crétins, les farceurs et les droles. Ne soyez pas critique d’art, faites de la peinture. C’est là le salut. ― Je vous serre cordialement la main, votre vieux camarade.
P. Cezanne.
tous mes Respects à Madame Bernard, un bon souvenir aux enfants. »Lettre de Cézanne à Bernard, datée « Aix, 25 juillet 1904 », Londres, The Courtauld Gallery.MS.1932.SC.1.5.1 à 1.5.3
House John, « Cézanne’s Letters to Émile Bernard », catalogue d’exposition The Courtauld Cézannes ; The Courtauld Gallery, Londres, The Courtauld Gallery, 26 juin – 5 octobre 2008, Londres, The Courtauld Gallery en association avec Paul Holberton Publishing, 2008, p. 156-157, reproduit.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 304.
Bernard Émile, « Paul Cézanne », L’Occident, n° 32, juillet 1904, p. 17-30 ; extraits repris dans « Préceptes de Cezanne », L’Art moderne, 25e année, n° 33, 13 août 1905, p. 265 (citation) ; réédition par Doran P. M., Conversations avec Cézanne, édition critique présentée par P. M. Doran, Paris, Macula, 1978, p. 30-42.
« PAUL CEZANNE
Frenhofer est un homme passionné pour notre art qui voit plus haut et plus loin que les autres peintres.
Balzac (Le chef-d’œuvre inconnu).
Il y aura vingt années bientôt que de jeunes peintres, dont aujourd’hui Paris se préoccupe, se rendaient en pieux pèlerinage en une petite et sombre boutique de la rue Clauzel. Arrivés là, ils demandaient à un vieillard armoricain au socratique visage, des tableaux de Paul Cezanne. Malgré les murs de l’endroit tapissés de rutilantes toiles, ils ne se trouvaient satisfaits que lorsque, sur une chaise disposant son dos en chevalet, les études requises par leur désir d’art leur enseignaient la voie à suivre. Religieusement ils consultaient ces pages d’un livre écrivant la nature et une esthétique contemporaine, comme tels feuillets d’un dogme, dont le révélateur à eux inconnu s’affirmait pourtant souverain. Puis, de là, ils retournaient, en maints admiratifs discours, à leurs propres toiles et pinceaux, pris du besoin qu’avaient les paralytiques de marcher lorsque soudain le Sauveur avait miraculé pour leur bon vouloir. Ainsi naquit, d’œuvres quasiment ravies à leur auteur qui certes, les jugeant non conformes à sa vision ne les eût jamais laissé aller hors son logis, une école picturale que d’autres, ambitieux trop ou pas artistes assez, étiquetèrent de noms faux, dévoyèrent vers la fantaisie et la surface.
Et pourtant que profitable eût pu être la révélation, si elle avait été entièrement aimée et connue !
Un louable effort de personnalité doit différencier les peintres, mais cet effort, qu’il soit profond et non extérieur ; qu’il puise aux sources saines les ondes de sa vitalité jouvente. De cette préoccupation de personnalité, maladive, disons le mot, naît toute déliquescence, faute de ce soin. Nous assistons annuellement, hélas ! au décortiquement des jeunes troncs prévus de branchages virils. Nous voici à la retombée des feuilles, à un automne de monotonie. Toute sève vainement se perd à l’approche d’un trop précoce hiver. Un à un s’éteignent les soleils, la lumière du temps s’en va, déclinante, et de nos maîtres, après Manet, après Puvis, Cezanne seul reste.
Monet, œil de lumière qui ouvrit les portes de la peinture sur l’infini du ciel, de la mer et des plaines a fait une grande œuvre qu’il serait ingrat de méconnaître. Ni Corot, ni Millet ne sortirent d’un art de musée, leur supériorité incontestable perpétue glorieusement les écoles de Claude Gellée et du Corrège. Monet regarda résolument la nature et la vit en peintre.
Quand Manet admira Monet, il créa ce symbole : les maîtres d’autrefois (que sa palette représentait, que son œuvre vénérait), reconnaissant dans un élève du soleil, orné du sens artistique le plus délicat, un parent, un frère. Alors que les faux classiques, c’est-à-dire les mauvais peintres, repoussaient un découvreur apportant la vision la plus radieuse et la plus neuve, un classique au sens précis de ce mot se trouva là, qui démentit, au nom des ancêtres, cet acte de lâche repoussement, et qui tendit sa main et son admiration, comme un chaînon s’ouvre afin de rattacher à soi celui qui le suit. Et l’influence de Claude Monet a été immense, de quelque manière qu’on la regarde. Le tort de ses élèves fut de ne la pas comprendre dans son principe, de s’en tenir au pastiche pur ; de ses critiques de la limiter ; de ses admirateurs d’y tout circonscrire. Il sied d’en proclamer le bénéfice, d’y voir l’observation s’y allier au don le meilleur, bref d’en reconnaître l’emprise sur toute la peinture de ces vingt dernières années, non seulement en France, mais dans le monde. A ce point de vue la victoire de Claude Monet a été complète, elle a renversé l’École des Beaux-Arts ; et elle partit d’un lieu si simple : du petit bateau atelier avec lequel il côtoyait la Seine, et dont Manet nous a laissé, en une magistrale pochade, un souvenir. Loin l’idée enfantine que l’art ancien soit surpassé ! Les meilleurs peintres, se dénomment-ils Courbet, Manet ou Monet, ne peuvent faire oublier les Michel-Ange, les Raphaël, les Léonard, les Titien, les Giorgione, les Tintoret, les Véronèse, les Rubens ; ils ne feront même pas trembler les petits maîtres français, flamands ou hollandais ; ils n’effaceront pas les primitifs ; et là n’est pas leur ambition. Ce ne sont point des anarchistes qui veulent recommencer le monde et le faire dater à eux ; nés très doués, ils se sont dit : « la peinture contemporaine est viciée, l’Art après avoir erré dans les musées a vécu de formules académiques ; pourtant les Maîtres, que nous connaissons mieux que personne, que nous admirons plus que tous, n’ont rien de ces dogmes froids, lourds et sans vie ; c’est donc qu’ils ont puisé leur classicisme à la nature… Retournons à la nature ! » Et ces bons nourrissons ont collé leurs lèvres aux pis multiples et pleins de lait de la déesse, et voici qu’après avoir travaillé comme des ouvriers, dans des villages et des provinces reculés ou proches : en Normandie, en Oise, en Provence, dans la Creuse ou le long de la Seine, de l’Océan, de la Méditerranée, ils ont approfondi ce qu’ils avaient le désir de faire, ils se sont différenciés. Au contact de la Création ils sont devenus créateurs.
Ils ont épuré la vision de leur œil et la logique de leur esprit, c’est pourquoi le travail qu’ils ont accompli a été excellent, et, malgré sa simple apparence documentaire, est d’une capitale importance.
Paul Cezanne ne fut pas le premier à entrer dans cette voie, il se plaît à reconnaître que c’est à Monet et à Pissarro, qu’il doit de s’être dégagé de l’influence trop prépondérante des musées, pour se ranger sous celle de la Nature. Malgré ces voisinages, son œuvre ne s’en ressent pas. Seulement, de gigantesques qu’elles auraient été avec plaisir, les toiles primitivement sombres et rudes de Cezanne, descendirent à des proportions restreintes ; exigence du travail sur nature. Le maître délaisse l’atelier, va matin et soir au motif, suit le travail de l’air sur les formes et les localités’, analyse, cherche, trouve. Bientôt ce n’est plus Pissarro qui le conseille, c’est lui qui agit sur l’évolution picturale de ce dernier. Il n’adopta donc pas la manière de travailler de Monet ou de Pissarro ; il resta ce qu’il était, c’est-à-dire peintre, avec un œil qui se clarifie, qui s’éduque, s’exalte devant le ciel et les monts, devant les choses et les êtres. Il se refait, selon son expression, une optique, car la sienne a été oblitérée, entraînée par une illimitée passion vers trop d’images, de gravures, de tableaux. Il a voulu trop voir ; son insatiable désir de beauté lui a fait trop compulser le multiforme tome de l’Art ; désormais, il éprouve qu’il se faut restreindre, s’enfermer dans une conception et un idéal esthétique ; aussi, s’il va au Louvre, s’il contemple longuement devant Véronèse, c’est pour, cette fois, en décortiquer l’apparence, en scruter les lois : il y apprend les contrastes, les oppositions tonales, y distille son goût, l’anoblit, l’élève. S’il va revoir Delacroix, c’est pour suivre en lui l’épanouissement de l’effet dans la sensation colorée ; car, affirme-t-il : Delacroix fut un imaginatif et un sensitif de colorations, don le plus puissant et le plus rare ; en effet l’artiste possède parfois un cerveau et pas d’œil, parfois un œil et pas de cerveau ; et aussitôt Cezanne cite Manet comme exemple : une nature de peintre, une intelligence d’artiste, mais un sensitif de colorations médiocres.
C’était à Auvers, près de Pissarro, après avoir peint sous l’empire de Courbet de grandes et puissantes toiles, que Cezanne s’était retiré, pour se dégager de toute influence, devant la Nature ; et c’est à Auvers qu’il commence la création stupéfiante de l’art sincère et si naïvement savant qu’il nous a depuis montré.
Il est aussi difficile, aujourd’hui que les toiles du maître sont dispersées dans des collections privées, de parler de l’ensemble de son œuvre, qu’il l’était autrefois, alors qu’il ne laissait rien sortir de son atelier et vivait dans la solitude ; c’est donc bien plus de son apport personnel, de son esthétique, de sa vision, de ses tendances que l’on peut disserter.
Dès le jour que Paul Cezanne se mit en face de la nature avec le parti pris de tout oublier, il commença ces découvertes, qui désormais répandues par l’imitation superficielle, ont eu sur la compréhension contemporaine le définitif d’une révolution.
Mais tout cela se fit à son insu, car insoucieux de gloriole, de réputation, de succès, insatisfait de lui-même, le peintre s’était enfoncé dans l’absolu de son art sans plus rien vouloir entendre du dehors, poursuivant l’approfondissement occulte de son analyse, donnant avec lenteur, réflexion et puissance les coups de bêche qui devaient un jour rencontrer le filon merveilleux d’où surgirait toute splendeur.Telle est sa méthode de travail : d’abord une soumission complète au modèle ; avec soin, rétablissement de la mise en place, la recherche des galbes, les relations de proportions ; puis, à très méditatives séances, l’exaltation des sensations colorantes, l’élévation de la forme vers une conception décorative ; de la couleur vers le plus chantant diapason. Ainsi plus l’artiste travaille, plus son ouvrage s’éloigne de l’objectif, plus il se distance de l’opacité du modèle lui servant de point de départ, plus il entre dans la peinture nue, sans autre but qu’elle-même ; plus il abstrait son tableau, plus il le simplifie avec ampleur, après l’avoir enfanté étroit, conforme, hésitant.
Peu à peu l’œuvre a grandi, est parvenue au résultat d’une conception pure. Dans cette marche attentive et patiente toute partie est menée de front, accompagne les autres, et l’on peut dire que chaque jour une vision plus exaspérée vient se superposer à celle de la veille, jusqu’à ce que l’artiste, lassé, sente fondre ses ailes à l’approche du soleil, c’est-à-dire abandonne au point le plus haut où il a pu l’élever son travail ; en sorte que s’il avait pris autant de toiles qu’il a passé de séances, il résulterait de son analyse une somme de visions ascendantes, graduellement vivantes, chantantes, abstraites, harmonieuses, dont la plus surnature serait la plus définitive ; mais en ne prenant qu’une seule toile pour cette lente et fervente élaboration, Paul Cezanne nous démontre que l’analyse n’est pas son but, qu’elle n’est que son moyen, qu’il se sert d’elle comme de piédestal et qu’il ne tient qu’à la synthèse destructive et concluante. Cette méthode de travail qui est sienne, il la préconise comme la seule juste, la seule devant mener à un résultat sérieux, et condamne sans merci tout parti pris de simplification qui ne passe pas par la soumission à la Nature, par l’analyse réfléchie et progressive. Si un peintre se satisfait de peu, c’est que, selon Paul Cezanne, sa vision est médiocre, son tempérament de mince valeur.
Léonard de Vinci a émis une idée semblable dans son traité de la peinture, quand il a dit : « Le peintre à qui rien ne semble douteux ne profite guère en son étude. Quand l’ouvrage passe la portée du jugement de l’ouvrier, celui qui travaille s’avance peu ; mais lorsque le jugement surpasse l’ouvrage, cet ouvrage va toujours de plus en plus se perfectionnant si la diversité ne l’en empêche. »
Ce ne sera donc pas par la patience, mais par l’amour, qui donne la vue et le désir d’approfondir, que le peintre arrivera à la possession de lui-même et à la perfection de son art. Il faut qu’il dégage de la Nature une image qui sera à proprement parler la sienne ; et c’est seulement par l’analyse, s’il a la force de la pousser jusqu’au bout, qu’il se signifiera définitivement, abstraitement.
Les synthèses expressives de Cezanne sont de minutieuses et soumises études. Prenant la nature comme point d’appui, il se conforme aux phénomènes et les transcrit lentement, attentivement, jusqu’à ce qu’il ait découvert les lois qui les produisent. Alors, avec logique, il s’en empare, et achève son travail par une imposante et vivante synthèse. Sa conclusion, d’accord avec sa nature méridionale et expansive, est décorative ; c’est-à-dire libre et exaltée.
Mme de Staël écrit dans son livre sur l’Allemagne : « les Français considèrent les objets extérieurs comme le mobile de toutes les idées, et les Allemands les idées comme le mobile de toutes les impressions ». Paul Cezanne justifie cette opinion de Mme de Staël sur les Français, mais il sait aller jusqu’à une profondeur d’art qui n’est pas commune à nos contemporains. En bon traditionniste, il soutient que la Nature est notre point d’appui, qu’il ne faut rien tirer que d’elle seule, toutefois en se donnant la liberté d’improviser avec ce que nous lui empruntons…
Ce qu’il faut d’abord au peintre, selon Cezanne, c’est une optique personnelle, laquelle optique ne se peut obtenir qu’au contact obstiné de la vision de l’univers.
Certes il faut avoir fréquenté le Louvre, les musées, cela afin de se rendre compte de l’élévation de la Nature jusqu’à l’art. « Le Louvre est un bon livre à consulter, mais ce ne doit être encore qu’un intermédiaire ; l’étude réelle et prodigieuse à entreprendre c’est la diversité du tableau de la Nature 1. »
Sans la vision d’art, la copie de la Nature deviendrait une sottise, cela est évident ; mais il faut craindre de limiter son invention à des répétitions ou des pastiches, de perdre pied dans des abstractions ou des redites ; il faut se maintenir sur le terrain de l’analyse et de l’observation, oublier les œuvres faites pour en créer d’imprévues, tirées du sein de l’ouvrage de Dieu.
Paul Cezanne considère qu’il est deux plastiques, l’une sculpturale ou linéaire, l’autre décorative ou coloriste. Ce qu’il nomme la plastique sculpturale serait amplement signifié par le type de la Vénus de Milo. Ce qu’il nomme plastique décorative se rattache à Michel-Ange, à Rubens. L’une de ces plastiques, servile, l’autre, libre ; l’une dans laquelle le contour l’emporte, l’autre dans laquelle domine la saillie, la couleur et la fougue. Ingres est de la première, Delacroix est de la seconde.Voici quelques opinions de Paul Cezanne :
Ingres est un classique nuisible, et en général tous ceux qui, niant la nature ou la copiant de parti pris, cherchent le style dans l’imitation des Grecs et des Romains.
L’art gothique est essentiellement vivifiant, il est de notre race.
Lisons la nature ; réalisons nos sensations dans une esthétique personnelle et traditionnelle à la fois. Le plus fort sera celui qui aura vu le plus à fond et qui réalisera pleinement, comme les grands vénitiens.
Peindre d’après nature ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser ses sensations.
Dans le peintre il y a deux choses : l’œil et le cerveau, tous deux doivent s’entre-aider : il faut travailler à leur développement mutuel ; à l’œil par la vision sur nature, au cerveau par la logique des sensations organisées, qui donne les moyens d’expression.
Lire la nature, c’est la voir sous le voile de l’interprétation par taches colorées se succédant selon une loi d’harmonie. Ces grandes teintes s’analysent ainsi par les modulations. Peindre c’est enregistrer ses sensations colorées.
Il n’y a pas de ligne, il n’y a pas de modelé, il n’y a que des contrastes. Ces contrastes, ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnent, c’est la sensation colorée. Du rapport exact des tons résulte le modelé. Quand ils sont harmonieusement juxtaposés et qu’ils y sont tous, le tableau se modèle tout seul.
On ne devrait pas dire modeler, on devrait dire moduler.
L’ombre est une couleur comme la lumière, mais elle est moins brillante ; lumière et ombre ne sont qu’un rapport de deux tons.
Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Il faut s’apprendre à peindre sur ces figures simples, on pourra ensuite faire tout ce qu’on voudra.
Le dessin et la couleur ne sont point distincts ; au fur et à mesure que l’on peint ou dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Les contrastes et les rapports de tous, voilà le secret du dessin et du modelé.
L’effet constitue le tableau, il l’unifie et le concentre ; c’est sur l’existence d’une tache dominante qu’il faut l’établir.
Il faut être ouvrier dans son art. Savoir de bonne heure sa méthode de réalisation. Être peintre par les qualités mêmes de la peinture. Se servir de matériaux grossiers.
Il faut redevenir classique par la nature c’est-à-dire la sensation.
Tout se résume en ceci : avoir des sensations et lire la Nature.
A notre époque il n’y a plus de vrais peintres. Monet a donné une vision. Renoir a fait la femme de Paris. Pissarro a été très près de la nature. Ce qui suit ne compte pas, ne se composant que de farceurs qui ne sentent rien, qui font des acrobaties… Delacroix, Courbet, Manet ont fait des tableaux.
Travailler sans souci de personne, et devenir fort tel est le but de l’artiste, le reste ne vaut même pas le mot de Cambronne.
L’artiste doit dédaigner l’opinion qui ne repose pas sur l’observation intelligente du caractère. Il doit redouter l’esprit littéraire, qui fait si souvent le peintre s’écarter de la vraie voie : l’étude concrète de la nature, pour se rendre trop longtemps dans des spéculations intangibles.
Le peintre doit se consacrer entièrement à l’étude de la nature et tâcher de produire des tableaux qui soient un enseignement. Les causeries sur l’art sont presque inutiles. Le travail qui fait réaliser un progrès dans son propre métier est un dédommagement suffisant à l’incompréhension des imbéciles. Le littérateur s’exprime avec des abstractions tandis que le peintre concrète, au moyen du dessin et de la couleur, ses sensations, ses perceptions.
On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins maître de son modèle, et surtout de ses moyens d’expression. Pénétrer ce qu’on a devant soi, et persévérer à s’exprimer le plus logiquement possible.Tel est Cezanne, telle est sa leçon d’art. Comme on le voit, il se différencie essentiellement de l’impressionnisme, dont il dérive, mais dans lequel il ne put pas emprisonner sa nature. Loin d’être un spontané, Cezanne est un réfléchi, son génie est un éclair en profondeur. Il résulte donc que son tempérament très peintre l’a conduit à des créations décoratives nouvelles, à des synthèses inattendues ; et ces synthèses ont été en vérité le plus grand progrès jailli des aperceptions modernes ; car elles ont terrassé la routine des écoles, maintenu la tradition et condamné la fantaisie hâtive des excellents artistes dont j’ai parlé. En somme, Cezanne, par le fondé de ses œuvres, s’est prouvé le seul maître sur lequel l’art futur pourrait greffer sa fruition. Combien peu appréciées pourtant furent ses découvertes ! Considérées à tort par les uns, à cause de leur inachevé, comme des recherches sans aboutissement ; par les autres comme des étrangetés sans avenir, dues à l’unique fantaisie d’un artiste maladif ; par lui-même, devant qui un idéal d’absolu se dressait, comme mauvaises plutôt que bonnes, sans doute de dépit de s’y voir trahi (il en détruisit un grand nombre, n’en montra aucune) telle qu’elles sont, elles constituent cependant le plus bel effort vers une renaissance picturale et coloriste que, depuis Delacroix, la France ait pu voir.
Je ne crains pas d’affirmer que Cezanne est un peintre à tempérament mystique, et que c’est à tort, qu’on l’a toujours rangé dans la déplorable école inaugurée par M. Zola, qui, en dépit de ses blasphèmes contre la nature, s’était octroyé hyperboliquement le titre de naturaliste. Je dis que Cezanne est un peintre à tempérament mystique en raison de sa vision purement abstraite et esthétique des choses. Là, où d’autres se préoccupent, pour se traduire, de créer un sujet, lui se contente de quelques harmonies de lignes et de tonalités prises sur des objets quelconques, sans se soucier de ces objets en eux-mêmes ; ainsi d’un musicien, qui dédaigneux de broder sur un livret, se satisferait à plaquer des suites d’accords dont la nature exquise nous plongerait infailliblement dans un au-delà d’art inaccessible à ses habiles confrères. Cezanne est un mystique précisément par ce dédain de tout sujet, par l’absence de vision matérielle, par un goût qu’avouent ses paysages, ses natures mortes, ses portraits, le plus noble et le plus haut : le style. Et la nature même de son style confirme ce que je disais par une qualité de candeur et de grâce tout giottesque, montrent les choses dans l’essentiel de leur beauté. Prenez telle peinture du maître, elle est dans sa science et sa qualité vraiment superlatives, une leçon d’interprétation sensitive et sentimentale. Par une prise de contact, non avec notre instinct grossier, avide d’imitation, mais avec la partie contemplative de notre être, émue seulement par la mystérieuse influence des harmonies éparses dans ce monde, elle éveille le retour des sensations les plus rares éprouvées sur le divin modèle. Un mystique seul considère ainsi la beauté qui revêt le monde, plutôt qu’il ne s’emprisonne dans la matérialité de ce même monde, c’est dire qu’il est le seul à bien voir. Le vulgaire les regarde sans doute tout autrement, d’où la différence et l’inversion. Plus l’homme s’est éloigné des mystagogies, plus à coup sûr il a perdu cette pénétration dans le domaine de la splendeur et du sentiment, plus il s’est incliné vers la réalité extérieur. L’art, qui fut d’abord le langage des aspirations divines, est devenu peu à peu, à travers les siècles, comme cet homme même, factice et fourbe ; désormais il ne cherche plus à insérer dans son tissu une expression particulière de l’âme ou de la pensée, ne se plaît plus même à la beauté pure, mais se satisfait d’imitations. Il en résulte la triste catastrophe photographique que nous inflige journellement l’École des Beaux-Arts et qui obstrue à fond notre compréhension esthétique. D’autre part les vains mots d’humanité, de vitalité, de réalité, empruntés au vocabulaire d’une politique insane, et répétés à foison par des critiques patentés, achèvent de persuader à une race animalisée, que l’art progresse par l’imitation. Ces préjugés joints à d’autres qui s’élèvent de toutes parts, soit du sein d’une école officielle, soit des cénacles de jeunes gens avides de gloriole, périront tous, misérablement, anéantis avec les fronts qui les abritent. Il faut avouer sans ambages qu’en fait de peinture l’obstruction est assez générale. La démocratie montante ne sera point ― tout le présage ― la salvatrice des rares cerveaux qui conservent en serre, par cette hyémale époque, les fleurs d’un printemps possible. Habile à déformer, elle aura sans doute assez de bateleurs et de charlatans pour détourner l’attention vers les déliquescences qui lui sont chères, déliquescences sans charmes, anémiques, ignorantes et d’une assez dégoûtante barbarie.
Ainsi parmi les peintres qui sont grands, Paul Cezanne se peut placer comme un mystique, car c’est la leçon d’art qu’il nous donne, il voit les choses non pas par elles-mêmes, mais par leur rapport direct avec la peinture, c’est-à-dire avec l’expression concrète de leur beauté. Il est un contemplatif, il regarde esthétiquement, non objectivement ; il s’exprime par la sensibilité c’est-à-dire par la perception instinctive et sentimentale des rapports et des accords. Et puisque ainsi son œuvre confine à la musique, on peut répéter irréfragablement qu’il est un mystique, ce dernier moyen étant le suprême, celui du ciel. Tout art qui se musicalise est en chemin de son absolue perfection. Dans le langage il devient poésie, dans la peinture il devient beauté.
Ce mot de beauté, prononcé à propos de l’œuvre de Paul Cezanne, demande qu’on s’en explique. Je voudrais en ce cas qu’il soit entendu ainsi : « l’expansion absolue de l’art employé ». Certainement, dans ses portraits, par exemple, le maître peintre ne s’est guère soucié de choisir un modèle. Il a travaillé d’après la première personne de bonne volonté qui se trouvait auprès de lui, sa femme, son fils, et plus souvent des gens du peuple, un terrassier ou une laitière, de préférence à un gandin ou à quelque civilisé qu’il abhorre pour ses goûts corrompus et sa fausseté mondaine.
Ici il ne s’agit plus, bien entendu, de chercher la beauté en dehors des moyens mêmes de la peinture ; les lignes, les valeurs, le coloris, la pâte, le style, la présentation, le caractère. Nous sommes loin assurément d’une beauté convenue ou matérielle, et l’œuvre ne sera belle pour nous qu’autant que nous posséderons la sensibilité très élevée, capable de nous faire perdre de vue la chose représentée pour jouir artistement. « Il faut bien voir son modèle, sentir très juste, et encore s’exprimer avec distinction et force. Le goût est le meilleur juge. Il est rare. L’art ne s’adresse qu’à un nombre excessivement restreint d’individus. » Ce sont les propres paroles du maître, corroborées par son œuvre ; elles expriment ses préoccupations. Le goût est le sens spécial (si peu et si mal cultivé, hélas !) auquel seul il s’adresse.De la tradition, le maître se plaît à se recommander, il connaît le Louvre mieux que nul peintre, il a même trop, selon lui, regardé les vieux tableaux. Ce qu’il croit qu’on doit demander aux anciens, c’est leur façon classique et sérieuse de logiquement organiser son œuvre. La nature intervenant dans le travail de l’artiste, animera ce que la raison laisserait mort, il recommande surtout de partir de la Nature.
Théoriste, on doit l’être certes, pour entrer en possession de soi et mener à bien son ouvrage ; mais il faut l’être de ses sensations et non seulement de ses moyens. La sensation exige que les moyens soient constamment transformés, recréés, pour l’exprimer dans son intensité. Il ne faut donc pas tenter de faire entrer la sensation dans un moyen préétabli, mais mettre son génie inventif d’expressions au service de la sensation. D’une part ce serait l’école des Beaux-Arts, qui ramène tout à un moule uniforme ; tandis que de l’autre c’est le renouvellement constant. Organiser ses sensations, voici donc le premier précepte de la doctrine de Cezanne, doctrine non point sensualiste, mais sensitive. L’artiste gagnera alors en logique sans perdre en expression ; il pourra être imprévu tout en restant classique par la Nature.
A bien considérer cette doctrine, elle apparaît la plus saine, la meilleure, la plus méconnue ; elle entre en directe opposition avec ce que les officiels ont imposé et avec tout ce que les créateurs de genres (soit impressionnisme, symbolisme, divisionnisme, etc.) ont toujours tenté. Ceux-là offraient des méthodes routinières, ceux-ci des conventions scientifiques ou personnelles ; aucun d’eux une marche de conduite sûre, sauvegardant l’étude approfondie et le respect de la Nature. Certes, c’était bien commode de trouver des recettes pour devenir autre chose que pompier ; et l’école des Beaux-Arts est actuellement plus avancée dans cette route que les plus révolutionnaires des peintres d’autrefois ; mais aucun de ses élèves ne s’est rendu compte qu’il n’est qu’une doctrine d’art valable, celle qui dit au peintre : « Sens la Nature, organise tes perceptions, exprime-moi profondément et avec ordre, c’est-à-dire classiquement. »
A une heure où nous sommes débordés de gâcheurs de toile, de subtils faiseurs, depuis M. Carrière qui croit bon de se réclamer de Vélasquez, jusqu’aux dupeurs qui prétendent créer un art nouveau, la leçon de Paul Cezanne surgit comme une rédemption possible pour la peinture française.Ce grand artiste est un humble, il a compris l’ignorance et l’obstruction dévolues à ses contemporains ; il a donc clos sa porte pour se plonger dans l’absolu. Uniquement possédé par l’amour de peindre, dont sa vie subit la ténacité tyrannique et bienfaisante, il considère que le travail est une jouissance suffisante en soi pour ne point désirer l’approbation ou l’éloge. Il déteste l’esprit littéraire qui fit tant d’intrusions malsaines dans la peinture et en a défiguré la plus simple compréhension. Il ne connaît que sa toile, sa palette, ses couleurs, et certes il n’aurait jamais laissé sortir de son atelier la moindre étude, si des amateurs intelligents, mais rares, n’en avaient emporté, presque à son insu. Depuis, M. Ambroise Vollard, le sympathique expert de la rue Laffitte, a satisfait à nos désirs de connaître plus complètement l’œuvre de Cezanne, il y travaille encore de son mieux 2.
Quoique pense d’elle le maître, trop sévère pour lui-même, elle domine toute la production contemporaine, elle s’impose par la saveur et l’originalité de sa vision, la beauté de sa matière, la richesse de son coloris, son caractère sérieux et durable, son ampleur décorative. Elle nous attire par sa croyance et sa saine doctrine, elle nous persuade de l’évidente vérité qu’elle annonce, et dans la dégénérescence actuelle s’offre à nous comme une oasis salutaire. Se rattachant par sa sensibilité raffinée à l’art gothique, elle est moderne, elle est neuve, elle est française, elle est géniale. Retiré des peintres, des mondains, des intrigants et des cabotins de notre misérable siècle, Cezanne ne laisse approcher de lui que le moins d’individus possible. L’école de la vie lui fut assez ingrate pour qu’il craigne l’intrusion. L’exemple qu’il nous donne est donc double, il est d’un homme en plus qu’il est d’un maître. Une vie simple, régulière, toute distribuée aux heures du jour pour le travail, un œil sans cesse en éveil, un esprit toujours en contemplation, voilà Paul Cezanne. Sa peinture franche, naïve, honnête, précise, dit son génie d’artiste ; son existence retirée des vanités, des glorioles, dit sa bonté et son humilité d’homme. Ce qu’il espère, c’est prouver par son œuvre qu’il est sincère et qu’il travaille au meilleur art. Bien des gloires contemporaines, orgueilleuses et stupides, tomberont, lorsque la sienne se lèvera ; alors comme chrétien et comme artiste, il assistera à la réalisation de ces paroles du Magnificat : « Les puissants seront déposés et les humbles seront exaltés. »
1 Ce sont les propres paroles de Cezanne.
2 M. Vollard prépare diligemment un catalogue illustré de l’œuvre de Cezanne. »
27 juillet
Dernière lettre de Cézanne à Joachim Gasquet :
« Aix, 27 juillet 1904.
Mon cher Gasquet,
Je ne saurais vous dire combien je suis touché de votre excellent souvenir. Secouant ma torpeur, je sors de.ma coquille et vais faire tous mes efforts pour me rendre à votre invitation.
Je suis allé au [Cercle ?] Musical pour avoir les renseignements par mon ami, votre père, au sujet du voyage à entreprendre. Je vous prie de lui dire de me donner quelques indications sur les heures du départ des trains et sur le point de rendez-vous que nous pourrions prendre pour nous retrouver.
Bien cordialement à vous et tous mes respects à votre famille.
Paul Cezanne
J’ai lu l’exposition que la Provence nouvelle a faite de votre belle œuvre 1. »
- Il ne paraît pas exclu que pendant la visite que le peintre a finalement faite à « Font Laure », deux ans avant sa mort, il y ait eu quelque malentendu entre les deux hommes. On sait seulement que leur amitié s’est terminée, à une date inconnue. Les lettres de Cézanne à Aurenche avaient déjà montré certaines réserves à l’égard du poète. Dans le livre que Gasquet consacrera quelque quinze ans plus tard au peintre, il ne parlera ni du froid qu’il y eut entre eux ni de cette visite à Éguilles.
Lettre de Cézanne à J. Gasquet, 27 juillet 1904 ; Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 305-306.
R. M. : « Revue des revues. Revues allemandes. L’art français en Allemagne », L’Art et les artistes, tome III, septembre 1906 ; p. xxxi.
« L’ART FRANÇAIS EN ALLEMAGNE. — Exposition au Kaiser Friedrich-Museum de Posen, d’œuvres de Cézanne, Pissaro (les quatre saisons, avenue de l’Opéra), Monet (Tamise, le phare du Havre). Sisley (Louveciennes, Seine), Renoir (Fontenay). Courbet et van Gogh. »
21 août
Redon écrit à Bonger :
« Avez-vous vu son étude [d’Émile Bernard] sur Cézanne ? des paroles recueillies fort intéressantes. Il alla le voir à Aix. Me conta lui-même l’accueil qu’il en a reçu. Bernard est toujours superbe, actif, bouillant, zélé comme un apôtre. ».
Lettre de Redon, Paris, à A. Bonger, 21 août 1904 ; Lévy Suzy (édition établie par), Lettres inédites d’Odilon Redon à Bonger, Jourdain, Viñes…, avant-propos de Michel Guiomar, Paris, Librairie José Corti, 1987, 295 pages, lettre 29 p. 101.
24 août
Un collectionneur allemand de Wiesbaden, le baron Kurt von Mutzenbecher, achète à Vollard deux Cézanne, un Daumier, un Gauguin, un Maillol, deux Seurat et un Valtat, pour un total de 6 210 francs.
Registre commercial de Vollard, janvier 1904 – 31 décembre 1904, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,10), p. 21-22, 29.
Rabinow Rebecca A. et Warman Jayne, « Chronologie », sur CD-Rom dans De Cézanne à Picasso. Chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan Museum of Art, 13 septembre 2006 – 7 janvier 2007, Chicago, The Art Institute of Chicago, 17 février – 12 mai 2007, Paris, musée d’Orsay, 19 juin – 16 septembre 2007, Paris, musée d’Orsay et Réunion des musées nationaux, 2007, p. 208-245, p. 216.
Début septembre
Matisse écrit à Marquet :
« Serais-tu assez gentil pour vouloir bien m’acheter le n° de juillet 1904 de la revue L’Occident. Les bureaux sont situés 17 rue Ebl et le n° coûte 1 frs. Tu me l’enverrais par la poste comme imprimé le plus tôt possible. Je dois le remettre à Signac en remplacement du même numéro qu’il m’a prêté et que j’ai tâché d’encre. Dans ce numéro se trouve la doctrine de Cézanne écrite par Bernard, celui-ci rapporte souvent les propres paroles de Cézanne : « organiser ses sensations », « moduler », et non « modeler ». Tu pourras couper le n° pour le lire. C’est très intéressant. »
Matisse-Marquet, correspondance, 1898-1947, Lausanne, La Bibliothèque des arts, 2008, textes rassemblé et annotés par Claudine Grammont, 195 pages, p. 36.
Septembre
Le fils de Cézanne et Hortense ont loué un pavillon à Fontainebleau, au n° 8, rue de la Coudre. Ils adressent des cartes postales à Marthe Conil depuis Melun et Fontainebleau (information communiquée par Philippe Cezanne).
22 septembre
L’inventaire de la succession et de la communauté de Pissarro, tant mobilière qu’immobilière, est dressé par Me Teissier (il sera enregistré à Mâcon le 22 septembre 1904).
Vingt et une œuvres de Cézanne y sont inscrites, dont des tableaux d’Auvers, Pontoise, Osny, Bercy, Nymphes et Satyres, Don Quichotte, les Lutteuses, deux autoportraits, et cinq paysages à l’aquarelle. L’inventaire est probablement incomplet.
Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 5, « 1899-1903 », Saint-Ouen-l’Aumône, éditions du Valhermeil, 1991, 465 pages, p. 391.
Une lettre de Rodolphe Pissarro, non datée, à l’un de ses frères reprend le titre et le numéro de quinze de ces œuvres (ou quatorze, puisqu’il y a deux n° 28), avec des propositions de prix, pour lesquelles Mirbeau se propose de trouver un acheteur.
« Mon vieux,
Voici la liste des tableaux que Mirbeau demande pour les vendre :
Cezanne
n° 13 Nature morte 10 000 n° 11 Bouquet de fleurs 5 000 n° 25 La Halle aux vins 12 000 n° 18 Portrait de femme ? n° 15 Effet de neige 3 000 n° 24 Paysage à l’Hermitage n° 26 Sous-bois à Osny 8 000 n° 21 Paysage de banlieue 8 000 n° 27 Chaumière à Auvers 5 000 n° 28 Portrait de Cézanne 5 000 n° 28 Petit Portrait de Cézanne ? n° 20 La Sente du Chou 4 000 n° 29 Femme nue 800 n° 30 Aquarelle 1 000 n° 31 Aquarelle 1 000 Van Gogh n° 8 Portrait de Tanguy 6 000 n° 183 Portrait de Cézanne par papa 10 000 Qu’est-ce que tu penses de cela et des prix ? Je ferai mon possible pour aller te porter tes cadres demain matin si je ne me lève pas trop tard. Je te la serre.
Rodo
Mardi »Lettre de Rodo[lphe] Pissarro à l’un de ses frères (Georges ? archives familiales), non datée, [vers novembre 1904] ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 5, « 1899-1903 », Saint-Ouen-l’Aumône, éditions du Valhermeil, 1991, 465 pages, p. 392.
Mirbeau, dans une lettre à Julie Pissarro, vers le 10 décembre 1904, donnera la liste et les prix des quinze œuvres de Cézanne qu’il a pu vendre. Il lui en reste six à vendre, dont deux aquarelles.
« Chère madame,
Voici la liste des tableaux de Cezanne, vendus :
Don Quichotte 5 000 Les Lutteuses 5 000 Paysage à Pontoise 5 000 Marseille 8 000 Paysage avec maison 4 000 Autre paysage avec maison 3 000 Bercy 14 000 Nature morte 15 000 Fleurs 7 000 Tête de femme 6 000 Le Jardin de l’Hermitage 5 000 Le Pêcheur à la ligne 4 000 La Neige 3 000 donnés pour compléter le lot : Homme nu Femme nue Van Gogh 2 000 Restent à vendre Grand Portrait de Cézanne par lui-même Petit Portrait de Cézanne par lui-même Portrait de Cézanne par Pissarro rendu Sous-bois à Osny rendu Nymphes et satyres — rendu Deux aquarelles vendues à 32 Je ne vais pas avoir le temps de vendre ces tableaux avant mon départ ; mais je préparerai cette vente, de là-bas, et à mon retour, j’espère bien arriver à ce que les 100 000 francs soient dépassés.
Je n’oublie pas, non plus, les tableaux de votre mari. Et je tâcherai de faire un coup, comme on dit, car je me sens l’âme d’un marchand pour les autres… »Lettre de Mirbeau à madame Pissarro, sans date, Pontoise, archives du musée Pissarro.
Mirbeau Octave : Correspondance avec Camille Pissarro, édition établie, présentée et annotée par Pierre Michel et Jean-François Nivet, Tusson, Charente, Du Lérot Editeur, 1990, 219 pages, p. 170-171, reproduction en fac-similé p. 168-169.
Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 5, « 1899-1903 », Saint-Ouen-l’Aumône, éditions du Valhermeil, 1991, 465 pages, p. 393-394.
24 septembre
Cézanne propose à Philippe Solari de poser le dimanche suivant pour le buste en terre grandeur nature que le sculpteur réalise directement d’après modèle.
« [Aix] vendredi 24 septembre.
Mon cher Solari,
Je désirerais faire une séance dimanche matin. Accepterais-tu de venir déjeuner chez Madame Berne à onze heures ? De là nous monterions chez toi — vois si cette combinaison peut t’aller, sinon je tâcherai d’aller te rejoindre en m’informant ; bien à toi
P. Cezanne. »Lettre de Cézanne à P. Solari ; 24 septembre [1904], Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 306.
Mack Gerstle, La Vie de Paul Cézanne, Paris, Gallimard, « nrf », collection « Les contemporains vus de près », 2e série, n° 7, 1938, 362 pages, p. 45-46 :
« Les deux bustes de Cezanne par Solari qui sont reproduits dans le présent ouvrage sont de 1904 ou 1905, le peintre et le sculpteur ayant tous deux alors soixante-cinq ans environ. Le plus grand, en plâtre blanc, est, je crois, la seule effigie de Cezanne modelée directement (Planche 2). D’après Paul Cezanne, fils, c’est une excellente ressemblance de son père, peu de temps avant sa mort. […] Un inconnu entra un jour par hasard dans l’atelier de Solari, quand Cezanne posait, et s’attarda un moment à regarder travailler le sculpteur. Cezanne, aussitôt, leva la séance et sortit furieux de la pièce ; pendant plusieurs semaines il refusa de venir. […]
L’autre buste, plus petit, en terre cuite, fut modelé de souvenir ; c’est une tentative pour fixer une impression fugitive (Planche 3). Solari venait de passer plusieurs heures avec Cezanne à parler d’art — ou plutôt à écouter parler Cezanne, car le petit sculpteur se contentait généralement d’un rôle passif dans ces discussions. A la fin, Cezanne était devenu étrangement rêveur et pensif, avec un regard lointain. Solari, très ému par l’exaltation de son vieil ami, regagna vite son atelier pour fixer dans l’argile l’expression exceptionnellement spirituelle du visage de Cezanne, pour modeler, comme il dit, « un Cezanne rêveur ». »
Bernex Jules, Le Feu, 1906. À voir.
« À l’ultime séance, le sculpteur, pour mettre les dernières touches, sortit un lorgnon de sa poche et l’ajusta sur son nez. Comment ? hurla Cézanne, tu mets des verres sur tes yeux pour regarder la nature ? Je ne poserai jamais plus pour quelqu’un qui ne peut pas me voir à l’œil nu ! »
Giniès Louis, « Une curieuse figure aixoise. Le menuisier H. Cauvet », Le Feu, juillet 1932, p. 143-144. À voir. Extrait cité dans Journal des débats politiques et littéraires, 144e année, n° 248, mardi 6 septembre 1932, p. 2 :
« Cauvet parlait aussi beaucoup de Cezanne. C’est dans son atelier que Solari entreprit un buste du maître qui venait fort bien. À la dernière séance, le sculpteur, pour mettre les dernières touches, sortit un lorgnon de sa poche et l’ajusta sur son nez : Comment ? hurla Cezanne en bondissant, tu mets des verres sur tes yeux pour regarder la nature ? Je ne poserai plus pour quelqu’un qui ne peut pas me voir à l’œil nu ! » Et c’est ainsi que l’œuvre demeura inachevée.
Cezanne, que les peintres aixois n’aimaient pas et à l’hostilité desquels il dut d’être exclu du musée, leur rendait largement ce mépris. Il y en avait un, pourtant, — que je ne nommerai pas — qui l’écoutait avec déférence. Un jour ce dernier l’entraîna dans son atelier pour lui montrer ses œuvres : « C’est un traquenard, déclara Cezanne en lui tournant le dos, dès qu’il y eut jeté un coup d’œil. Comment oser écouter mes paroles et peindre comme cela. » Et oncques il ne consentit à le revoir.
Cependant, me disait encore Cauvet, Cezanne admirait un Aixois et l’enviait même de peindre — jugeait-il — beaucoup mieux que lui : c’était Ravaisou. Il s’extasiait devant l’atmosphère de ses paysages rudes et sobres ; il s’enrageait de voir les plans se détacher, frémissants et aérés : « Comment fais-tu, bon Dieu ! Comment fais-tu ? »murmurait-il. »
3 octobre
Vollard expédie plusieurs toiles de Cézanne à Cassirer.
Lettre de Vollard à Cassirer, 3 octobre 1904 ; archives Vollard, MS 421 (4,1) 78, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux.
12 octobre
D’après le livre de stock B de Vollard, Bernheim-Jeune lui achète une toile de Cézanne pour 35 500 francs, n° 4253, « Nature morte ; fruits sur une table, au fond une draperie », 73 x 92 cm (Nature morte, rideau à fruits et fruits, R 935).
Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute.
15 octobre – 15 novembre
À la deuxième exposition du Salon d’automne, au Grand Palais, à Paris, la salle IX est entièrement consacrée à l’œuvre de Cézanne : trente et un tableaux et deux dessins, ainsi que trois panneaux de photos d’œuvres de la collection Vollard, prises par Druet. L’artiste figure au catalogue dans la liste des membres fondateurs du Salon.
Les tableaux exposés sont identifiés d’après des photographies de leur accrochage et d’après les titres.
D’après une photographie de la salle, le tableau R 553 a été exposé.
D’après la description de Blanche, le tableau Boîte à lait et pommes (R 426) a été exposé.
« Salle Paul Cézanne
- Le fumeur. [FWN56-R757]
- La dame au chapeau vert. [FWN484-R700]
- Portrait de Mme C… [FWN487-R607]
- Tête de vieillard. [R 97]
- Portrait de l’auteur par lui-même avec chapeau. [FWN451-R415]
- Portrait de l’auteur par lui-même, nu-tête. [FWN449-R383]
- La montagne de Sainte-Victoire. [FWN127-R398]
- La maison blanche. [FWN95-R273]
- La dame à l’éventail. [FWN447-R606]
- Portrait d’homme. [FWN528-R851]
- Nature morte.
- La maison du pendu (paysage). [FWN137-R402]
- Fleurs dans un pot vert. [FWN827-R721]
- Géraniums dans un pot blanc. [FWN735-TA-R318, n’apparaît pas sur une photographie de la salle]
- L’aqueduc. [FWN265-R695]
- Paysage. [FWN108-R308 ou FWN242-R605]
(App. à M. VolIard).
(App. à M. Blot).
- Le mardi-gras. [FWN668-R618]
20, Nature morte. [FWN576-TA-R329]
- Nature morte. [FWN742-R348]
- Les petites maisons d’Auvergne. [FWN82-R220]
- Portrait de M. Choquet. [FWN439-R296]
(App. à MM. Durand, Ruel et fils).
- Un cadre contenant neuf photographies.
- Paysage. [FWN108-R308 ou FWN242-R605]
- Le port de Marseille. [FWN190-R515]
- Baigneurs. [FWN947-R665]
- Baigneuses. [FWN923-R360]
- Baigneurs. [FWN936-R449]
- Nature morte.
- Nature morte.
(App. à M. Vollard). »
« CÉZANNE (Paul), né à Aix-en-Provence.
- — Un cadre contenant : neuf photographies.
- — Un cadre contenant : neuf photographies.
- — Un cadre contenant : neuf photographies.
(Les originaux appartiennent à M. Vollard.) »
Cézanne, catalogue d’exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 25 septembre 1995 – 7 janvier 1996, Londres, Tate Gallery, 8 février – 28 avril 1996, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, 26 mai – 18 août 1996, Paris, Réunion des musées nationaux, 1996, 226 numéros, 599 pages, p. 564-565.
Société du Salon d’automne. Catalogue de peinture, dessin, sculpture, gravure, architecture et art décoratif exposés au Grand Palais des Champs-Elysées, du 15 octobre au 15 novembre 1904, Evreux, Ch. Hérissey, imprimeur, salle Paul Cézanne, œuvres de Cézanne nos 1-31, p. 106-107, photographies d’œuvres de Paul Cézanne appartenant à M. Vollard, nos 2045-2047, p. 190.
Marx Roger, « Littérature et beaux-arts. Le Salon d’automne (15 octobre – 15 novembre 1904) », Revue universelle, recueil documentaire universel et illustré, tome V, octobre 1904, n° 123, p. 641-646, Cézanne p. 642.
Cinq photographies de la salle Cézanne au Salon d’automne de 1904 ; Paris, musée d’Orsay, archives Vollard.
Le tableau n° 12, « La Maison du pendu (paysage) » (FWN137-R402), ne représente en fait pas la « maison du pendu » (FWN81-R202), mais une autre. Il se trouve que Cézanne et van Gogh — coïncidence — ont peint à Auvers les deux mêmes maisons contiguës, à dix-sept ans d’écart : le premier, dans le tableau intitulé aujourd’hui La Maison du père Lacroix (FWN77-R201), daté « 73 » et signé ; le second, en 1890, dans son tableau Maisons à Auvers (F759).
Photographie des lieux par Reidemeister Leopold, Auf den Spuren der Maler der Ile de France, Berlin, 1963, p. 62 et 165. Photographie des lieux par Mothe Alain, Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise, p. 68.
Ces mêmes maisons apparaissent dans les œuvres suivantes : de Van Gogh, Vue d’Auvers (vignes et maisons) (F762), plus lointaines, et dans Les Chaumes du Gré à Chaponval (F780), vues de l’arrière.
Mothe Alain, Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise, Paris, éditions du Valhermeil, 1987, 223 pages, p. 68, 70 et 128-129.
De Van Gogh, ajoutons : Les Chaumières (F750), Paysage boisé (F1640) ; de Cézanne, Auvers, vue panoramique (FWN83-R221), les maisons étant situées en bas à droite, vues d’un point haut de la rue des Meulières, vers les façades arrière. Leurs adresses actuelles, respectivement pour la chaumière et pour la maison du père Lacroix, couverte de tuiles, sont 7 et 9, rue du Gré.
Par une récurrence étonnante, ces rapprochements entre œuvres de Cézanne et de Van Gogh nous ont permis d’identifier le lieu d’exécution de Maison dans les arbres, Auvers-sur-Oise (FWN137-R402). Sa chaumière apparaît dans la partie gauche de la Maison du père Lacroix (R 201) : preuve que la toile est bien d’Auvers.
Mothe Alain, « Cézanne à Auvers-sur-Oise », dans Cézanne à Auvers-sur-Oise, éditions du Valhermeil, Saint-Ouen-l’Aumône, 2006, 143 pages, p. 21-58, p. 41.
En effet, sur le tableau de Cézanne FWN137-R402, on reconnaît — elle figure dans les autres œuvres citées — la chaumière aux chaumes ondulants, l’une des deux cheminées, celle en pignon étant cachée par la frondaison d’un arbre, la vigne encadrant une porte à rez-de-chaussée, le mur de clôture en pierres et son ressaut caractéristique, à l’arrière un autre mur en retour : l’ensemble ferme une petite cour devant les bâtiments. Certes, la façade de la maison du père Lacroix semble omise dans le prolongement de celle de la chaumière. Cela s’explique par le fait qu’elles ne sont pas toutes les deux dans le même alignement, mais obliques. Sur le tableau de Cézanne, une mince bande claire s’élève jusqu’au-dessus des chaumes, ce qui constitue la façade de la maison arrière, vue en biais, et la partie de son pignon au-delà des chaumes. Le fond du paysage s’arrête sur la colline qui domine tout du long Auvers.
Il ne s’agit donc pas de la maison du Pendu, titre sous lequel l’œuvre fut exposée au Salon d’automne de 1904, sans doute d’après Vollard, ni de la maison qu’évoque Lionello Venturi dans son catalogue, sans doute d’après Paul Gachet : « Cette maison, détruite aujourd’hui, se trouvait devant la maison Murer. »
Venturi Lionello, Cézanne, son art, son œuvre, 1936, Paris, Paul Rosenberg, éditeur, 1936, tome I, « Texte », 408 pages, notice 148, p. 99.
La maison du père Lacroix n’a guère changé depuis Cézanne ; la « chaumière », elle, a été beaucoup remaniée : façades rehaussées consécutivement à la suppression des chaumes. A constater que Cézanne effectue des transformations selon ses choix d’artiste, dans le traitement des toitures. Dans Auvers, Vue panoramique, les deux couvertures, aux tonalités violettes, paraissent d’ardoise au lieu de chaume et de tuile, et les deux cheminées de la chaumière sont représentées, mais non celles de la maison en tuiles. Dans la Maison du père Lacroix, il traite cette fois les tuiles en rouge et omet les cheminées.
Pour Maison dans les arbres (Auvers), Cézanne a renforcé l’effet de hauteur du bâtiment, en le regardant d’un point de vue légèrement surélevé, en le rehaussant par le mur de clôture à l’avant-plan, en l’encadrant par les lignes verticales des arbres. Ainsi, la chaumière paraît bien plus monumentale que nature, d’autant qu’on la découvre dans l’ouverture des arbres.
Revue de presse :
Vauxcelles Louis, « Le problème du Salon d’automne », Gil Blas, 26e année, n° 9109, jeudi 15 septembre 1904, p. 1.
« Autre attraction : une salle Cézanne. Cet isolé, farouche précurseur de Van Gogh et de Gauguin, est un être de légende ; on ne connaît guère son aspect que par le portrait de Pissarro ; visage rude, broussailleux ; casquette de drap sombre, le torse enveloppé dans une limousine de roulier. Et ce Cézanne, rugueux et gauche, est un maître. Si Renoir est le Boucher de l’école impressionniste, Cézanne en est le Chardin. Il est le peintre des pommes, rondes et odorantes ; et aussi des herbages veloutés et denses. »
Péladan [Joséphin], « Le Salon d’automne », La Revue hebdomadaire, 13e année, n° 44, 1er octobre 1904, p. 446-456, Cezanne p. 447, 448, 455-456.
« M. Cezannes depuis longtemps poursuit une élaboration tranquille, dans la tranquille ville d’Aix, de paysages sans air, de figures polynésiennes et de natures mortes vantées. Ce peintre, au dire de tous, possède les qualités les plus rares de l’homme privé doux et rêveur, et cherchant sa joie dans des représentations sommaires qui satisfont beaucoup de gens. Ce que M. Cezannes voit avec l’œil de l’esprit, je ne le discute pas j’ai entendu des commentaires attendris sur ces informités. Mon idéalisme ne s’élève pas jusqu’à saisir des intentions aussi subtiles mes yeux ne perçoivent que les réalisations et je ne vois ici que de l’impuissance technique un métier incomplet.
[…] Le jury qui a pu refuser de pareilles toiles est un jury de farceurs très cyniques. Renoir sait peindre et très bien peindre ; et, précisément parce qu’il sait, pourquoi le mêle-t-on aux impressionnistes qui sont littéralement ceux qui ne savent pas ? Quel rapport entre la Baigneuse, si délicate d’expression, si soutenue de coloration, et les gaucheries veules de M. Cezannes et les farces de palette d’un Manet ? […]
Il se produit un curieux phénomène. Le peintre oublie les maîtres et, selon son expression, regarde la vie. Le critique, au contraire, s’entoure de chefs-d’œuvre, et a chez lui une Pinacothèque formée d’épreuves de Braun. « Vous fréquentez trop rue Louis-le-Grand », me- disait un des exposants en manière de conclusion à une dispute sur M. Cezannes. Qu’est-ce qu’un art qui souffre tant de l’étude des chefs-d’œuvre et de la connaissance des maîtres ? »
Desiez Eugène, « Au Salon d’automne », Gil Blas, 26e année, n° 9126, dimanche 2 octobre 1904, p. 1 :
« Et Cezanne, le paysagiste fantôme, insoupçonné du public, idolâtré des amateurs, ce Cezanne peu soucieux de gloriole et d’argent, qui abandonnait au pied des chênes, en forêt, les études de plein air dont il n’était pas content ! Vous verrez ses nus, ses natures mortes. Il y a là de quoi désoler Charles Cottet lui-même… »
« Le Salon d’automne », Le Petit Journal, 42e année, n° 15267, vendredi 14 octobre 1904 ; p. 3.
« Enfin, pour en finir avec les salles particulières, disons qu’il en est une consacrée à M. Paul Cezanne, et n’ajoutons rien. »
Thiébault-Sisson, « Le Salon d’automne au Grand-Palais », Le Petit Temps, vendredi 14 octobre 1904, p. 1-2.
« Et c’est la famine, en effet, pour beaucoup. Quatre ou cinq ans seulement avant qu’une de ses toiles dépassât quarante mille francs dans une vente, un maître impressionniste, Sisley, mourait dans la misère. Et combien, parmi les vivants, d’hommes notoires végètent de même stoïquement. Cezanne, qui est le père, à lui seul, d’une génération ardente de jeunes, qui exerce sur eux, par l’exemple, hors de France et en France, une généreuse et féconde influence et qui restaure par eux le sens aboli de la forme, qui renouvelle par eux le paysage. […]
On y voit, en tête de chaque groupe, mais à part, et représenté par un ensemble de ses œuvres, l’artiste Odilon Redon, Renoir ou Cezanne qui lui donna naissance sans le vouloir. […]SALLE IX
L’abondante exposition de Cezanne.Ne pas la voir avant d’avoir étudié dans la grande travée de la salle III, un important tableau de nature morte (étoffes et fruits) dont le sens décoratif est superbe et que revêt une moelleuse harmonie de gris bleutés, de verts profonds et de blancs doux. C’est un pur chef-d’œuvre dont la place, un jour, sera au Louvre et qu’il faut étudier, à moins d’être initié, avant de se hasarder à l’examen de la salle. Car Cezanne est un grand artiste et le précurseur qui a révélé à beaucoup la façon de comprendre un paysage — à la manière, en somme, de Corot — et d’établir par l’entente des volumes, une forme.
Mais ce précurseur est un grand incomplet qu’une infirmité de vision a rendu depuis longtemps incapable de voir autrement que de guingois les lignes droites. Et ceci, parfois, prête à rire. Il faut s’émerveiller, au contraire, qu’un tel homme et si mal partagé, ait pu caractériser en reliefs si savoureux les êtres et les objets que sa rétine ne lui présentait que par morceaux, et traduire en notations si moelleuses, la couleur. »
Valensol, « Le Salon d’automne. L’exposition de fin d’année au Grand Palais – Le capharnaüm de l’art moderne – De l’excellent, du mauvais et du pire » ; Le Petit Parisien, 29e année, n° 10213, vendredi 14 octobre 1904, p. 2 :
« Nous voilà maintenant dans la salle IX, où M. Paul Cézanne étale copieusement les productions de son pinceau. Tout cela est évidemment de la peinture, mais relève d’une esthétique qu’il est difficile de faire accepter par tous. Cet artiste est sincère, il a de fervents admirateurs sans doute qu’il pourrait faire autre chose. Il préfère répandre des couleurs sur une toile et les y étaler ensuite avec un peigne ou une brosse à dents. Cela fait des paysages, des marines, des natures mortes, des portraits. au hasard, au petit bonheur, et le procédé rappelle un peu ces dessins que les écoliers exécutent en écrasant des têtes de mouches dans le pli d’une feuille de papier. Néanmoins, il est entendu, dans certains milieux, que M. Paul Cézanne a beaucoup de talent. Nous n’y contredirons point. »
Babin Gustave, « Le Salon d’automne », L’Écho de Paris, 21e année, n° 7436, vendredi 14 octobre 1904, p. 1 ; repris en partie dans « Nouvelles locales », Le Mémorial d’Aix, journal politique, artistique et littéraire, 67e année, n° 87, jeudi 27 octobre 1904, p. 2 :
« M. Paul Cezanne
Elles ignorent bien plus encore l’hôte de la salle voisine, M. Paul Cezanne. Et que va-t-il en sortir, grands dieux ! de cette première rencontre ?
Je ne suis point des fanatiques de ce peintre incertain, énigmatique et troublant. Certes, j’avais apprécié hautement, comme quiconque est amoureux de la peinture grasse, opulente, généreuse, ces fruits savoureux, pleins de sucs, qu’il s’est complu à brosser et dont certains pourraient tenir auprès des plus vigoureux morceaux de toile peinte qui soient par le monde. Mais je ne fus frappé de la grâce qu’au milieu de la royale collection du comte Isaac de Camondo, devant une de ces maisons abandonnées, hantées, marquées, comme la tragique maison Usher, d’on ne sait quel signe fatal qui fait le passant s’écarter de leur ombre, et dont le premier, et tout seul, il a su traduire, consciemment ou non, l’inquiétant mystère. Vous verrez, au Salon d’automne, deux ou trois de ces maisons. Vous y verrez des fruits vermeils, des fruits acides, quelques portraits gauches, et devant lesquels, pourtant, on ne saurait demeurer indifférent, d’autres paysages titubants, inachevés et attirants cependant par la délicate et maladive harmonie de leurs verdures, et quelques pages de premier intérêt. Je souhaiterais que, dédaigneux des lazzis faciles, des quolibets malveillants ou bêtes, vous regardiez tout cela avec sympathie, vous efforçant de bonne foi de comprendre. Et je serais heureux que vous vous laissiez séduire par la sincérité évidente dont certaines maladresses sont la preuve même ; par l’attendrissante ingénuité de certaines touches.
[…] Salle III―.
[…] Enfin, aux murs de la tant jolie salle s’enlèvent de discrètes impressions de Fumées par M. Francis Jourdain ; des Cezannes ;
[…] Salle IX. ― La salle IX est à M. Paul Cezanne, la salle X à M. Puvis de Chavannes. »
Alexandre Arsène, « Le Salon d’automne », Le Figaro, 50e année, 3e série, n° 288, vendredi 14 octobre 1904, p. 3 :
« Une salle encore où l’on est à même de connaître la rude et gauche et souvent grande manière de Paul Cezanne […] »
M. de Fourcaud L., « Le Salon d’automne », Le Gaulois, 39e année, 3e série, n° 9862, vendredi 14 octobre 1904, p. 1-2, Cezanne p. 2 :
« La seconde [salle] nous montre quelques figures, des paysages et des natures-mortes de M. Paul Cezanne, qui fut un des primitifs de l’impressionnisme.
[…] ― Ce que l’on peut apprécier dans l’art sommaire de M. Cezanne, c’est, en certains paysages, la franchise d’un pinceau procédant par larges touches et jetant ses tons simples presque en à-plat. ― »
Fouquier Marcel, (ou Fourquier Maurice), « Le Salon d’automne », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 13e année, n° 4397, vendredi 14 octobre 1904, p. 5 :
« Dans une autre salle on a groupé nombre de toiles de M. Cezanne, paysages, portraits, scènes mythologiques, natures mortes. M. Cezanne est tenu en grande admiration par quelques-uns. Naguère M. Maurice Denis, moderne Giotto, l’a représenté dans un cercle d’amis, et il a. intitulé ce morceau, qui cause quelque surprise, Hommage à Cezanne. On ne saurait contester à cet artiste — les dates sont là — d’avoir été un des apôtres de l’école impressionniste. Une sincérité rude et agressive s’atteste en certaines de ses œuvres, et d’abord en son portait peint par lui-même. Mais ce qui distingue, à première vue, la peinture de M. Cezanne, c’est la gaucherie du dessin et la lourdeur des coloris. Ses natures mortes, qu’on a beaucoup vantées, sont d’un rendu brutal et d’un effet terne. On a prédit qu’un jour elles iraient au Louvre, tenir compagnie â Chardin. Cet heureux temps n’est pas prochain. »
Morot F.-George, « Le Salon d’automne », La Presse, 71e année, nouvelle série, n° 4520, vendredi 14 octobre 1904, p. 1-2, Cezanne p. 2 :
« Je n’aime guère M. Delaunay, et j’avoue, à ma grande honte, n’être pas mûr encore pour les Maurice Denis et les Cezanne. Evidemment, il serait injuste de nier qu’ils possèdent de réelles qualités de coloristes, et qu’ils soient personnels. Mais que d’enfantillages inutiles, que de malencontreuses hardiesses, que de tâtonnements d’une banalité vulgaire ! »
Bettex de, « Le Salon d’automne », La République française, 14 octobre 1904, p. ?. A voir.
« Je laisserai les admirateurs de Cezanne prononcer l’éloge de cette méthode, qui se résume à esquisser par plans des têtes faites pour charmer les jeunes spectateurs du théâtre de Guignol.
Il fallait être Goya pour peindre avec de la boue. »
New York Herald Tribune, 14 octobre 1904, p. ?. A voir.
« Cezanne a inventé une nature morte : des pommes ternies dans des compotiers mal équilibrés. On affirme qu’il reconstitue Chardin ; en tout cas, il aura imposé à la jeunesse l’emblématique petite poire pas mûre.,. »
Geffroy Gustave, « Au Salon d’automne par Gustave Geffroy », L’Humanité, journal socialiste quotidien, mercredi 14 octobre 1904, 1re année, n° 180, p. 1-2, Cezanne p. 2 :
« Au Salon d’Automne par GUSTAVE GEFFROY
C’est aujourd’hui, au Grand Palais, le vernissage du Salon d’Automne, et il se trouve que ce Salon peu visible l’an dernier, dans le sous-sol du Petit Palais, honni par la Délégation de la Société nationale, menace de ne pas être accueilli l’an prochain au Grand Palais, il se trouve, dis-je, que ce Salon va triompher aujourd’hui, obtenir gain de cause auprès de tous.
Il va triompher avec tranquillité, il va devenir le « Salon » mieux que ses deux aînés, mieux que la Société nationale qui a voulu le traiter en mauvais sujet, le mettre en pénitence et en interdit. La raison de cette réussite certaine du Salon d’Automne est bien simple. Ses organisateurs ont simplement fait œuvre historique, marqué l’évolution de la peinture depuis vingt-cinq ans. Il leur a suffi, pour cela, d’ouvrir leurs salles à quelques œuvres des hommes d’hier dont se réclament les jeunes hommes d’aujourd’hui.
***
On a, cette fois, choisi Renoir et Cezanne parmi les initiateurs, comme on aurait- pu choisir Édouard Manet et Claude Monet, On a fait une place à Puvis de Chavannes. On a invité Carrière qui a accepté, et qui a même pris l’initiative de la pétition aux délégués de la Société nationale. On a rassemblé des œuvres nombreuses de Toulouse-Lautrec. Odilon, Redon et Guillaumin sont aussi présents. […]
On verra la tradition dans les œuvres de Renoir, de Cezanne, par exemple, on n’y verra pas la mise en œuvre de l’enseignement, des préceptes, des routines de l’art officiel. La tradition qu’ils suivent, comme Puvis de Chavannes, comme Carrière, comme Toulouse-Lautrec, comme Vuillard, est la tradition de l’art libre. Chacun a sa personnalité, sa manière de dessiner, de peindre, sa forme, sa vision, sa préférence, mais chacun de ceux qui viennent d’être nommés et des jeunes hommes qui les suivent est épris de ce que la vie offre à sa contemplation et à sa réflexion. Les peintures, les sculptures, les dessins exposés au Grand Palais témoignent avec un accent émouvant de cette recherche et de cette admiration de toutes les expressions de l’univers. C’est la grande leçon que peuvent donner les artistes : révéler les secrets visibles de l’existence, apprendre à voir, à comprendre, à aimer. »
Vauxcelles Louis, « Le Salon d’automne par Louis Vauxcelles », Gil Blas, 26e année, n° 9138, vendredi 14 octobre 1904, p. 1 :
« Renoir, tout à l’heure, nous fera penser à Boucher, et Cezanne à Chardin ; Chavannes prolonge la survivance parmi nous de Nicolas Poussin. […]
***
CEZANNE
Quel est ce barbare, interrogeront les gens paisibles, candides, habitués à la peinture sage et avantageuse de M. Gabriel Ferrier ? Hé oui, c’est un barbare, un primitif, un artisan gothique, gauche, incomplet, inharmonieux, brutal. Il vit seul, loin, en Provence. Paris l’ignore. Il fut l’ami de Zola qui le portraictura dans son Claude Lantier, de l’Œuvre.
Il a chéri la vie et cherché la vérité « de toute la passion de ses rétines malades ». Il a horreur des habiletés faciles. Certes, il y a chez lui des absences de l’atmosphère, de la fluidité par laquelle les plans doivent s’espacer et les lointains se voir à distance ; les formes gauchissent parfois, les proportions ne sont pas justes ; il y a de chaotiques déséquilibres, des maisons pochardes et des bonshommes de guingois, mais le précurseur possède une loyauté fruste qui a servi a maint imitateur. Ses rapports osés pour la première fois, ses valeurs audacieuses dont la crudité surprend, sont un enseignement considérable pour les jeunes impressionnistes. Un portrait d’homme s’offre à nos yeux salle IV, d’une robustesse étonnante de construction. Et, sur des nappes d’un blanc crémeux, parmi les poteries vernissées, les gobelets d’étain et les fiasques [deux mots non lus], voici les pommes, les fameuses pommes de Cezanne, vertes, rouges, rondes, fraîches et pesantes, « maçonnées avec une truelle, rebroussées par des roulis de pouce », dit Huysmans.
***
SALLE IX
Cezanne
Voir plus haut — Nota bene : Cezanne a soixante-trois ans. MM. Chaumié et Henry Marcel n’ont-ils pas, au fond de quelque tiroir ministériel, deux centimètres de ruban rouge qu’on pourrait offrir à ce débutant ? »
Vauxcelles Louis, « Le Salon d’automne. Le vernissage », Gil Blas, 26e année, n° 9139, samedi 15 octobre 1904, p. 1.
« LE SALON D’AUTOMNE
Par LOUIS VAUXCELLES
LE VERNISSAGE
Ce vernissage-là — les amis de la maison s’en doutaient un peu — ne devait pas être la banale et fade chambrée traditionnelle où snobs et peintres mondains se congratulent, où les femmes du monde lancent des chapeaux, et les grands couturiers, des femmes du monde. Il y avait de la bataille dans l’air, et — outre la poudre de riz — de la poudre. Voyez-vous Jean Béraud et Frantz Jourdain se rencontrant face à face ? Carolus et Carrière ? Supposez la « Délégation » — la fameuse Délégation de la Nationale — avec tous ses Courtois, ses Rixens et ses Dubufe, venant escalader la forteresse de l’art jeune et libre ! Eh ! bien ! qu’on se rassure. Le plan de Carolus-Kouropatkine a complètement échoué. Tout s’est passé en escarmouches sournoises d’avant le Vernissage, et hier, l’infirmerie du Grand Palais n’a point utilisé sa charpie, les prescripteurs étant restés au coin de leur feu. N’empêche que les papotages allaient bon train. On potine, on dénigre, on déchire. On s’écrase à la salle des Renoir et des Lautrec, et des Cezanne. « — Tout ça, dit un grinchu, profitera aux marchands de tableaux, au père Durand, aux Bernheim, à Vollard. » — » — Possible, réplique un voisin philosophe, mais ne vaut-il pas mieux que les marchands s’enrichissent en vendant des Renoir qu’en écoulant des Maignan ?
[…] Je disais tout à l’heure qu’il n’y avait pas de snobs. Pardon, il y en a, et ils sont tous à la salle Cezanne. Ils n’y comprennent rien, au fond ils n’aiment pas çà ; cet art de primitif, qui peignait en ignorant les trouvailles de ses prédécesseurs, les choque et les suffoque, mais il faut être dans le train. Cezanne, le douloureux Claude Lantier, de l’Œuvre, est à la mode. S’il ne vivait très loin de nous, là-bas, dans sa bastide d’Aix en Provence, on se l’arracherait cet hiver à Paris. Non, voyez-vous Cezanne dans le monde, avec sa limousine, sa houppelande, sa casquette de roulier, sa pipe au bec, et sa barbe hirsute, tel que l’a peinturluré, jadis, son ami Camille Pissaro ?
[…] Les curieux veulent voir le portrait de Cezanne, par lui-même, le portrait de Chavannes, par Desboutin ; l’Arthur Fontaine, de Carrière ; la Jeanne Samary, de Renoir et Félix Fenéon souriant mystiquement à la Goulue, de Toulouse-Lautrec. »
A. M., « Le Salon d’automne », La Lanterne, 27e année, n° 10037, samedi 15 octobre 1904, p. 2 :
« La salle suivante est consacrée à Cezanne, dont le nom, aux temps héroïques du réalisme, servit de prétexte à de si chaudes batailles. Hélas ! je crains bien que cette exposition ne mette fin à la querelle, en démontrant de façon péremptoire que Cezanne n’était qu’un lamentable raté. Peut-être avait-il des idées, mais il était bien incapable de les exprimer. Il semble avoir ignoré même les premiers éléments de son métier. Devant ces toiles mal dessinées et mal peintes, on se prend à se demander comment elles ont pu mériter l’honneur d’être discutées. »
« Le Salon d’automne », Le Matin, 21e année, n° 7538, samedi 15 octobre 1904, p. 2 :
« LE SALON D’AUTOMNE
La journée du vernissage — Élégante assistance — L’exposition des « jeunes » — Pas de catalogue ! — Un succès.
Il serait oiseux d’encore discuter le plus ou moins d’utilité du troisième Salon. S’il n’a point révélé aux foules des génies inconnus en est-il tant que cela ? — tout au moins a-t-il permis à de nombreux « jeunes » de talent de voisiner avec des maîtres et de soumettre à la critique des œuvres sincères, sinon parfaites, et c’est là, semble-t-il, un appréciable résultat.
Artistes et profanes ont, par leur présence
nombreuse, encouragé cette automnale exposition.
Par les vastes et hauts vestibules du Grand-Palais, où, çà et là, se meurent des chrysanthèmes en des massifs de plantes vertes, une foule moutonne, cependant que, dans les grandes salles froides et claires du premier étage, la compacte cohue des vernissages s’entasse. Mondaines, hommes de lettres, théâtreuses, artistes, modèles, braves bourgeois qui veulent se donner des airs connaisseurs, et critiques graves qui prennent un masque imperturbable et gourmé se coudoient et se heurtent. Certaines personnes blâment, d’autres louent, mais toutes gémissent :
« — Que c’est ennuyeux de n’avoir point de catalogue !
» On ne trouve rien de ce que l’on veut voir ! »
Pourtant, l’on découvre, sans trop de difficulté, les toiles des maîtres qui tinrent à rehausser l’éclat de cette manifestation de jeunes. Voici les Puvis de Chavannes, harmonieux et purs, extatiques Madeleines et Enfants prodigues hâves et douloureux ; les Toulouse-Lautrec, étranges et inquiétants ; les Renoir, éblouissants et lumineux ; les Cezanne, personnels et complexes. On stationne, on compare, on discute, et, sans hâte, l’on va à la recherche « des choses bien ». Il y en a beaucoup. »
« Petites expositions », L’Éclair, 15 octobre 1904. A voir
« J’ai peine à comprendre la salle consacrée aux peintures du peintre Cezanne à côté d’une salle consacrée à des œuvres du maître vénéré Puvis de Chavannes. Mettre sur le même pied, comme attractions, dans une exposition, deux personnalités si différentes l’une de l’autre (je suis poli), cela n’est pas de l’éclectisme, c’est du manque de tact. »
A. M., « Le Salon d’automne », La Lanterne, 27e année, n° 10037, samedi 15 octobre 1904, p. 2 :
« La salle suivante est consacrée à Cezanne, dont le nom, aux temps héroïques du réalisme, servit de prétexte à de si chaudes batailles. Hélas ! je crains bien que cette exposition ne mette fin à la querelle, en démontrant de façon péremptoire que Cezanne n’était qu’un lamentable raté. Peut-être avait-il des idées, mais il était bien incapable de les exprimer. Il semble avoir ignoré même les premiers éléments de son métier. Devant ces toiles mal dessinées et mal peintes, on se prend à se demander comment elles ont pu mériter l’honneur d’être discutées. »
Rictor Léon, « Le Salon d’automne », Le Rappel, n° 12636, samedi 15 octobre 1904, 23 vendémiaire an 113, p. 1-2, Cezanne p. 1 :
« Voici un Salon de tendances. Salon d’avant-garde, il est rétrospectif, il permet, par la sélection de l’œuvre d’un peintre, par la multiplicité des toiles du même homme groupées sur le même panneau, d’apprécier son œuvre entière et son tempérament.
L’histoire de l’art peut y gagner. On a parlé de petites chapelles, de coteries. Possible, mais je n’en ai cure. Voici une salle Puvis de Chavannes, une salle Eugène Carrière, une consacrée à Paul Cezanne, une à Renoir, à Toulouse-Lautrec, une à Odilon Redon.
[…] Paul Cezanne ? Un matérialiste, un réaliste, hors de tout mysticisme. Provençal, il voit noir. La vie n’est pas toujours ensoleillée. Il me rappelle toutefois qu’il n’en était pas ainsi, voici vingt ans, de paysages des Camargue et d’Aix incandescents, des bastidons incendiaires et d’eaux bleues. On retrouve trace de ses anciennes amours. Des portraits des baigneuses et quelques scènes de genre ont l’empreinte définitive et expliquent mieux le peintre qu’une longue biographie. »
Pip [Gustave Kann], « Carnet de Paris. Le Salon d’automne », La Nouvelle Revue, 25e année, tome xxx, 15 octobre 1904, p. 569-573, Cezanne p. 572 :
« Moins grand qu’il ne l’eut voulu, le Salon d’automne offre de belles choses. Le pauvre Lautrec y a une sorte de rétrospective, où vont apparaître ses profils durs et cruels, attirants tout de même par le charme saignant des lèvres, ce Montmartre qu’il évoqua si différent de celui de Steinlen ou de Guiguet, ce Montmartre enragé, pervers, Montmartre de bar, Montmartre anglicisé, old whisky et old England ; aussi Cezanne rayonnera dans toute une salle, ce novateur, puissant, bizarre, violent, toujours inédit, toujours varié, et Renoir y aura sa belle salle. »
Ponsonailhe Charles, « Le Salon d’automne en 1904 », Revue illustrée, 19e année, n° 21, 15 octobre 1904, 6 pages, n. p.
« La salle à gauche de M. Puvis de Chavannes est attribuée à M. Cezanne, qui, paraît-il, l’écrase. J’étais en train d’admirer innocemment des dessertes, des pommes aux tons vigoureux et superbes, des portraits sincères, dont le meilleur est celui du peintre lui-même, vieillard chenu, chauve, sympathique, convaincu, — lorsqu’un de mes amis très initié me voulut bien montrer que j’avais l’optique d’un clerc de notaire. Ce qui est merveilleux, c’est dans une ou deux esquisses de composition antique le volume geométral des bras, des jambes ; un volume plein d’imagination, m’affirmait l’adepte. M. Cezanne par là continue Phidias. Un portrait d’homme quelconque (que je croyais être celui d’un gazier endimanché), le rattache au Poussin. Pour moi, je veux bien, mais je manque d’éducation de l’œil. »
Reproduction sur la même page de R 329, sous la légende : « CÉZANE (Paul). — Pommes et gâteaux. »
« Salon d’automne », La Justice, journal politique du matin, 25e année, dimanche 16 octobre 1904, p. 3 :
« SALON D’AUTOMNE
L’annonce du Salon d’automne, depuis des mois, a fait beaucoup parler les artistes |et le public lui-même. Certains sceptiques refusaient de croire à sa réussite, mais les habiles organisateurs, loin de se laisser rebuter par les malencontreux pronostics, préparaient activement leur manifestation. De l’avis de tous ceux qui assistaient au vernissage, l’arrangement du Salon et son éclat imprévu lui permet de prédire un succès mérité auprès des vrais amateurs d’art.
Pour être plus sûrs encore de l’agrément du public, les promoteurs ont mêlé aux nombreux envois qui leur ont été faits, des œuvres de maîtres incontestés, comme le grand Puvis de Chavannes, ou d’artistes dont les noms sont déjà célèbres comme : Carrière, Renoir, Odilon Redon, Cezanne, etc.
Auprès de ceux-là qui ont déjà leur public assuré, sont venus se grouper une foule de peintres et de sculpteurs jeunes ou déjà connus parmi lesquels nous en désignerons quelques-uns à nos lecteurs au cours de la rapide promenade que nous ferons à travers les salles :
SALLE IX
Une collection entière d’œuvres entières de Paul Cezanne qui fut un précurseur dont la manière outrée se reconnaît dans un grand nombre d’exposants de ce Salon. »
« Nouvelles locales. Un peintre aixois au Salon », Le Mémorial d’Aix, journal politique, artistique et littéraire, 67e année, n° 84, dimanche 16 octobre 1904, p. 2 :
« Un peintre aixois au Salon.
Nous apprenons avec plaisir qu’un de nos compatriotes, M. Cezanne, obtient en ce moment un très gros succès au Salon d’automne, organisé par MM. Eugène Carrière et Frantz Jourdain.
Les exposants de ce Salon sont venus de tous les points de l’horizon pictural et leur exposition forme dans sa totalité, avec des ensembles de Puvis de Chavannes. Odilon Redon, Renoir, Lautrec, Cezanne, une manifestation des plus curieuses. C’est, en somme, surtout un intéressant effort de l’Impressionnisme assagi.
Nous félicitons notre compatriote, M. Cezanne, pour les éloges si mérités que lui prodiguent en ce moment les critiques d’art français et étrangers. Nous en reparlerons à nos lecteurs. »
C. I. B., « Topics in Paris. The special features of the Autumn Salon », New York Tribune, 17 octobre 1904. A voir
Le Senne Camille, « Salon d’automne », L’Événement, 18 octobre 1904. A voir
« Cezanne donne l’impression d’un ouvrier puissamment doué mais de vision trouble, d’exécution non pas gauche, mais gauchie par quelque infirmité manuelle. »
Geffroy Gustave, « Le Salon d’automne par Gustave Geffroy. Puvis de Chavannes — Paul Cezanne — Renoir — Eugène Carrière — Odilon Redon — H. de Toulouse-Lautrec », L’Humanité, journal socialiste quotidien, 1re année, n° 186, jeudi 20 octobre 1904, p. 1-2.
« Le Salon d’Automne par Gustave Geffroy
II
Puvis de Chavannes. — Paul Cezanne. — Renoir. — Eugène Carrière. — Odilon Redon. — H. de Toulouse-Lautrec.
J’ai dit que le Salon d’Automne allait marquer dans l’histoire des Salons pour avoir relié l’art d’aujourd’hui à l’art d’hier, l’art des jeunes à l’art des aînés. Il comprend, en effet, des expositions, dans des salles spéciales, de Puvis de Chavannes, Paul Cezanne, Renoir, Toulouse-Lautrec, Odilon Redon, Eugène Carrière.
[…]
Paul Cezanne se montrera subitement ici, pour beaucoup, comme l’un des grands initiateurs de la peinture moderne. Cette réunion de ses œuvres est admirable par la variété et par la force. Grandes figures d’hommes et de femmes, esquisses de baigneurs et de baigneuses, paysages, arbres, maisons, champs, tableaux de fleurs et de fruits, tout est d’un peintre qui n’obéit à aucune préoccupation de tableau, d’arrangements, de composition, lorsqu’il est en face des choses. C’est le reproche qui lui est fait, et il est sans doute juste. Mais si l’on voit ce qui est ainsi perdu par Cezanne, il faut voir aussi ce qu’il gagne ; ou plutôt ce que nous gagnons. Nous gagnons la peinture la plus extraordinaire, la plus riche, 1a plus miraculeusement vraie et belle. On ne peut regarder sans une admiration étonnée un paysage tel que la Montagne de Sainte-Victoire, ou le portrait de Cezanne par lui-même, ou simplement une étude de fleurs comme celle des tulipes rouges, ou ce. magnifique tableau de pommes et de gâteaux sur un fond vert.
Il est nécessaire ; aussi, pour comprendre et goûter Cezanne, non seulement de voir le rapport entre ses œuvres et la réalité, mais encore de bien vouloir admettre que toutes ses œuvres sont comme les fragments d’œuvres plus considérables, et que l’artiste peint le plus petit morceau d’une manière large, vivement colorée, comme s’il peignait une muraille ou un plafond. Ces toiles ne sont pas de la formule des tableaux de chevalet, et d’ailleurs, tout le groupe des peintres auquel Cezanne appartient se réclame de cette même vision grande et profonde des choses. De même, les paysages de Monet sont plus grands que leurs formats par la force du métier, l’ampleur du modèle. Aussi, encore aujourd’hui, cette peinture n’est pas considérée comme terminée par tous ceux qui la regardent, alors qu’elle, est approfondie et parachevée autant que peinture peut l’être. On ne veut pas voir que chaque indication est essentielle, représentative, et que c’est ici tout juste l’opposé de l’art qui détaille et durcit les aspects des choses. »
Lecomte Georges, « L’heure qui passe. Paroles de femme », L’Humanité, journal socialiste quotidien, 1re année, n° 186, jeudi 20 octobre 1904, p. 1 :
« L’Heure qui passe
PAROLES DE FEMME
Le bon sens est si peu la chose du monde la mieux partagée que c’est un régal presque rarissime d’entendre propos frappés à son coin. Et, dans sa simplicité, il a une telle vertu que, à lui seul, il enseigne justice, altruisme, générosité.
Ainsi, l’autre jour, au Salon d’Automne où elle ne se rassasiait pas d’admirer les glorieux vétérans de l’Impressionnisme, Renoir, Cezanne, Guillaumin, et les jeunes maîtres qui triomphent à leurs côtés, d’Espagnat et Vuillard, etc., l’énigmatique et spirituelle étrangère qui, sous le titre de Journal de Sonia, vient de nous donner un recueil d’observation si pénétrante sur la vie française, m’a charmé une fois de plus par le bouquet de sages paroles qu’elle voulut bien m’offrir. »
Renard Jules, Le Journal de Jules Renard (1902-1905), Paris, François Bernouard, 1927, pages 707-1001, p. 908.
« 21 octobre[1904] : Au Salon d’Automne. Des Carrière, des Renoir, des Cezanne, des Lautrec. Carrière, bien, mais un peu trop malin.
La majesté dans le vice, de Lautrec.
Cezanne barbare. Il faudrait avoir aimé pas mal de croûtes célèbres avant d’aimer ce charpentier de la couleur. […]
* La belle vie de Cezanne, toute dans un village du Midi. Il n’est même pas venu à son exposition d’automne. Il voudrait bien être décoré.
C’est ça qu’ils veulent, les pauvres vieux peintres dont la vie fut admirable, et qui voient enfin, près de mourir, les marchands de tableaux s’enrichir avec leurs œuvres.
Renoir, vieux et décoré, disait :
— Hé ! Hé ! oui, on baisse le nez, on voit ce rouge, et, ma foi ! on redresse la tête.
* Vollard, le marchand de tableaux, dit :
— J’en veux à mon père de ne m’avoir rien appris d’artiste. Je ne peux pas causer avec une jolie femme dans la rue sans me faire l’effet d’un goug[j]at. »
Boissard, « Le Salon d’automne », Le Monde illustré, 22 octobre 1904. A voir
« Expression d’art telle qu’elle pourrait émaner de quelque artiste malgache… »
Benedict Lélia, « Chronique des Beaux-arts. Le Salon d’automne », L’Encyclopédie contemporaine, 25 octobre 1904, p. 135.
« M. Cezanne, avec sa peinture heurtée et son dessin problématique, reste un peintre que nous ne saurons jamais comprendre et les enthousiasmes qu’il a suscités dans la nouvelle école demeureront toujours pour nous une énigme. »
« Le Salon d’automne », La Justice, journal politique du matin, 25e année, n° 306, lundi 31 octobre 1904, p. 2 :
« Cependant, où l’improvisation de M. Frantz-Jourdain et de ses collaborateurs nous semble dépasser la mesure, (si l’enthousiasme de la première heure, celui des néophytes à genoux devant la personnalité de celui qu’on a nommé le Précurseur, à genoux, le front contre terre, ― donc ils ne pouvaient voir ― ne leur a pas encore dessillé les yeux), c’est d’avoir dévolu une salle entière à Cezanne, et ce qui est froidement déconcertant, c’est que le Salon où triomphe ce génie incompris voisine avec celui de Puvis de Chavannes. L’ironie est sanglante : certes l’éclectisme en art est le critérium nécessaire d’un goût sûr et délicat ― comme le libéralisme, dans les opinions et les idées politiques doit être la qualité dominante d’un esprit généreux, et le Président, créateur du Salon d’Automne, M. Frantz-Jourdain, ne nous contredira pas et partagera aisément notre manière de voir en politique comme en art.
N’est-ce pas Puvis de Chavanne qui a donné cette définition de l’artiste ? « La technique d’un peintre n’est autre chose que son tempérament ». Donc il était intéressant de réunir et de connaître ces « tempéraments » si divers des artistes ; dès lors cette interprétation de l’opinion du grand artiste lyonnais ― sous l’égide de qui cette Exposition s’est ouverte ― amenait insensiblement, semblait-il, à devoir faire même ouverture aux fantaisies les plus échevelées, les plus ahurissantes, et aux productions magistrales, séduisantes de couleurs ou de formes ou intimement troublantes. Cette conception esthétique de ce Salon, éminemment indépendant, permettra peut-être à des « jeunes » hardis, mais puissamment doués, de s’affirmer et de révéler des talents inconnus. Voilà la vraie raison d’être de ce Salon, et nous applaudirions des deux mains à cette innovation si libérale, si nous pouvions admettre que place doit être faite en même temps à des œuvres inutiles, nuisibles même à la fortune de cette naissante société, à qui nous pouvons assurer longue vie, si désormais on élimine ce qui n’est aucunement de l’art. « Les intentions de l’artiste, s’il est sain d’esprit, relèvent du simple bon sens. » Ces paroles sont celles mêmes du Maître, qui viennent à la suite de la citation faite plus haut.
Heureusement pour l’essor attendu de quelques-uns, inconnus hier, d’excellents artistes, quelques-uns déjà des maîtres incontestés, classiques de l’impressionnisme assagi, dont nous avons maintes fois parlé, sont venus en nombre rehausser l’éclat de cette manifestation attrayante quand même. »
Les Arts de la vie, nos 6-11, juin-octobre 1904.
Schmidt Karl Eugen, « Der Pariser Herbstsalon », Kunstchronik, 1904-1905, n° 4, 4 novembre 1904, p. 54-58.
Marx Roger, « Littérature et beaux-arts. Le Salon d’automne (15 octobre – 15 novembre 1904) », Revue universelle, recueil documentaire universel et illustré, tome V, octobre 1904, n° 123, p. 641-646, Cézanne p. 642, 646 :
« L’influence de Paul Cezanne a agi de façon décisive, prédominante presque, sur l’orientation des talents nouveaux, et il est passé chef d’école à son insu. Les artistes, les amateurs ont pu s’informer aux vitrines de Vollard ; mais quelle idée pouvaient concevoir de Cezanne ceux qui n’avaient gardé qu’une vague souvenance des tableaux entrevus aux expositions centennales de 1889 et de 1900 ? Aussi la réunion de trente-trois de ses ouvrages prenait-elle le sens et la portée d’une révélation ; elle a familiarisé avec le fier génie de ce maître peintre ; elle a suggéré l’explication de la tendance actuelle à rechercher la belle matière et le ton lumineux ; elle a établi ce que vaut la passion innée de la couleur quand elle est servie par un métier mâle, ennemi de la ruse et de l’artifice.
[…] Les organisateurs de l’exposition, en quête de progrès, se sont persuadés d’adjoindre aux départements qui forment l’ordinaire des Salons une section de photographie ; les travaux qui la composent offrent, pour la plupart, des reproductions attrayantes de sculptures de Rodin par MM. Haveis et Coles, de tableaux de Cezanne ou de peintres nouveaux par M. Druet. Le nombre des photographies d’après la nature est trop restreint pour autoriser à apprécier aujourd’hui l’opportunité de l’innovation, et à décider s’il convient d’en proposer ou non le maintien ; cependant, en ce qui les concerne, si l’expérience doit se renouveler, il y aurait plutôt avantage à grouper ces épreuves qu’à les égarer à l’aventure, parmi les tableaux, sous prétexte qu’elles donnent, par un truquage habile, l’illusion d’œuvres originales. »
Sarradin Édouard, « Visites au Salon d’automne II », Journal des Débats politiques et littéraires, 116e année, n° 307, vendredi 4 novembre 1904, p. 2-3, Cézanne p. 2-3 :
« Le « grand public » passe à peu près indifférent devant ces toiles, comme d’ailleurs, il faut bien l’avouer, devant celles de Puvis de Chavannes. Toulouse-Lautrec le scandalise un peu. Mais, quand il pénètre dans la salle où sont les Cezanne, il s’indigne, à moins qu’il n’éclate de rire…
Je ne saurais prendre aujourd’hui la défense de Cezanne. Je regrette qu’on n’ait point cherché dans son œuvre des morceaux moins agressifs. Il semble vraiment qu’on se soit ingénié à réunir ici ce qui pouvait le mieux déconcerter les gens et les mettre en fuite. L’impression est vraiment pénible de tous ces portraits maladroitement ébauchés, et qui sont comme le témoignage d’une fatale impuissance. Cette exhibition fait un tort considérable à un homme qui, s’il n’est point certainement un « chef d’école » comme certains le voudraient, a du moins signé quelques natures mortes et paysages où l’on peut, en dépit de la maladresse d’exécution, apprécier des dons naïfs d’observateur et de coloriste, une réelle robustesse de pinceau, et l’originalité d’une vision curieusement simplificatrice. »
Bouyer Raymond, « Le procès de l’art moderne au Salon d’automne », Revue bleue, revue politique et littéraire, 5e série, tome II, n° 19, 5 novembre 1904, p. 601-605, Cezanne p. 603, 604-605 :
« Il semble donc qu’une nouveauté se dessine : en 1904, le Luxembourg, au printemps, puis le Salon d’automne inaugure un État dans l’État, dans des salles spéciales : au Grand-Palais, voici Puvis de Chavannes qui ressuscite à côté de Cezanne, Toulouse-Lautrec en prolongement de Renoir ; enfin, Odilon Redon fraternise avec les disciples de ce Gustave Moreau qui ne cesse d’illuminer ses cauchemars comme un vitrail intérieur ! […]
Mais Cezanne ? Ah ! Cezanne ! Heureux les pauvres d’esprit, car le ciel de l’art est à eux ! S’il n’est pas redevenu tout à fait barbare à force de progrès, l’avenir se divertira mélancoliquement de notre encens dithyrambique autour de cette trinité pseudo-primitive : Cezanne, Gauguin, Van Gogh ; Cezanne en est le père, un père, qu’en dépit de sa barbe d’aïeul je n’ose croire éternel… Puvis de Chavannes incorrect et chétif ? Mais notre Puvis a l’aplomb d’un Raphaël en train de passer cardinal auprès de ce moine mendiant de la palette ! Les modérés consentent à découvrir des « trous » dans sa bure ; mais les fanatiques s’écrient : Hors de Cezanne plus de salut ! Ils le déclarent poussinesque et chardinesque à la fois, car le saint cultive en même temps le portrait, le paysage et la nature morte, étageant des pommes sur une nappe de zinc ou plantant des tulipes empourprées dans un grès bancal. Quelle matière, mes amis, et quelle naïveté ! Le joli service que des apôtres rendent au Maître, c’est de faire apparaître sa simplicité terriblement prétentieuse et ses dons précurseurs de toute synthèse cruellement incomplets. Et je gage que le bonhomme, quoique méridional, doit s’avouer fort embarrassé de l’hommage inattendu de nos peintres lettrés ! Comme Manet, que dis-je, mieux que Manet, plus héroïquement, il a si bien oublié le métier qu’il ne sait plus sa langue ; et vous le comparez au Normand Nicolas Poussin qui s’enorgueillissait de n’avoir rien « négligé » ? Peintre français quand même, par le terre à terre de ses sujets, qui ne sut jamais, cependant, soutenir une ligne ni nuancer un ton ! Mais, en vérité, corrompus que nous sommes, pourquoi composer, dessiner et peindre ? Pourquoi chercher à savoir quand il est si voluptueux de sentir ? Pourquoi parler d’éducation, d’instruction, d’érudition, puisque l’art est immédiat, impulsif, aphone et dément comme un sauvage ? Pourquoi Cezanne, en particulier, se donnerait-il le mal infructueux de caler une table ou de rendre viable un visage ? Il a du génie.
III
Tel est, du moins, l’évangile nouveau des jeunes feutres mous groupés par Maurice Denis dans son récent Hommage à Cezanne ; je crois que les néo-traditionnaires étaient nu-tête, mais je maintiens mon lapsus : la peinture a ses Debussystes. Et ne trouvez pas, décidément, que nous abusons du génie ? Trop d’artistes, dorénavant : vous m’entendez bien ? Car l’œuvre d’art disparaît sous l’inondation des notes d’art, favorisées par l’indulgence des salonniers et par l’épidémie des salons. Du talent, fi donc ! Du génie, tout de suite ! Le moindre barbouilleur se veut original, et les originaux nous ont rendu sur le tard un mauvais service : autant de crépuscules pris pour des aurores ! Notre faute collective est d’exalter l’insuffisance : les seuls défauts de nos maîtres nous ont paru savoureux. L’art français a subi l’individualisme après l’école, l’impressionnisme après l’académisme, les simplistes après les calligraphes : tiraillé toujours et manichéen. De Manet en Cezanne, de Puvis en Maurice Denis, de Gustave Moreau en Redon, la pente est glissante et nous confondons aujourd’hui l’orthographe avec le poncif. Le résultat ? C’est d’inspirer à Jacques Blanche le trop spirituel regret de n’avoir point fait partie des normaliens de la Villa Médicis ! Autre danger…
Puvis de Chavannes était trop loin, c’est-à-dire trop haut, Renoir est trop près de nous pour troubler nos yeux ; mais Lautrec et Redon bouleversent l’âme, pendant que Cezanne et les Cézanniens sont en train de ruiner la forme : mysticisme ou déformation, choisissez ! El nombre d’exaltés les accouplent.
Nous avons ému de belles âmes en insinuant que le regretté Gustave Moreau fut involontairement, comme César Franck, le plus dangereux des professeurs, lui le maître si libéral et si grand ! Son génie même, moins entraînant, pourtant, que celui de Richard Wagner, n’intervint pas sans répandre une contagion de surmenage ou de snobisme ; et sa grandeur même fut redoutable. Mais c’est moins Moreau que Cezanne qui souffla le trouble en son atelier. Et comment expliquer cette bizarre alliance ? Par la libéralité du professeur, généreusement ouvert à toute nouveauté. Nombreux et variés au Salon d’automne, ses fidèles apportent un frappant exemple ; et Redon, Lautrec ou Cezanne ont agité leurs aspirations : voyez Georges Desvallières, ce loyal, de la pure lignée du portrait français ! Comme il se partage entre un beau calme et l’outrance ! Voyez René Piot, ce peintre étonnamment doué des aquarelles vives et des esquisses purpurines ! Voyez Georges Rouault, ce poète des menus paysages de style, et qui s’enivre d’ombre ! Les meilleurs accommodent à la sauce baudelairienne leurs souvenirs persistants du Quattrocento ; tous semblent peindre pour les littérateurs qui lisent entre les lignes : qu’ils se méfient des vieux maîtres macabres ou des Primitifs extravagants et de la rhétorique d’énergumène de Léon Bloy !
Je me pris à songer près de ce corps vendu
A la triste beauté dont mon désir se prive,
dit René Piot d’après Baudelaire : à sa place, je n’hésiterais plus à célébrer souvent cette Égérie prudhonienne qu’il évoque si classique parmi tant de perversités ! Peintre et sculpteur, Henri Matisse est plus cézannien que Cezanne ; et Bréal se gâte, alors que Raoul du Gardier demeure exquis à contempler sur les plages la nacre heureuse des reflets. Les Corot d’Italie ont inspiré Camoin et Marquet : c’est de bon augure ! Et Charles Guérin commence à se ressaisir. Une lueur toute française renaît du chaos moderne : voici Vuillard, intimiste et décorateur, déjà convalescent en 1903 et qui manifeste, en 1904, un vibrant effort ; moins amorphe et toujours plaisant, on dirait qu’il veut bannir le neurasthénique et l’invertébré ; son œil de peintre semble se dégager des placages trop japonais et de nos canevas de tapissier byzantin ; ses fleurs vermillon et sa nature morte lie-de-vin sur un broché d’azur qui vient d’une marquise gardent leur saveur d’esquisse en accentuant l’écriture.
Aphasie, amnésie, ataxie : diathèse dont souffre l’art d’à présent ! Mais nos enfants dépravés seraient-ils un peu las de jouer au Monticelli boueux ? Et nos statuaires troublés par Rodin, tout comme le Debussysme est né du Franckisme ? Dernier romantique et Delacroix de la glaise, Rodin les pousse au génie : il tourmente Hoetger. Mais, loin des folles impressions de Rosso, regardez l’admirable Apprenti de Roger-Bloche, un novateur conscient et savant qui précise la beauté de la souffrance ; ses plagiaires seuls nous font peur… Enfin, le bel exemple inattendu, fourni par Carrière en son magistral portrait d’Arthur Fontaine ! Père et fille y composent un groupe à la fois chaste et mystérieux comme le plus subtil des sentiments, l’amour paternel, amour quand même et fierté d’auteur, désir inconscient qui s’est réfugié dans l’âme ! Et la matière ondoyante, le souple modelé de la blanche robe en vague et des jeunes cheveux, victoire d’un Velazquez monochrome !
Auprès de ce Carrière d’exception, je reste en pleine atmosphère d’art moderne, aussi loin des exigences d’un idéal esthétique que des vulgarités d’un métier bourgeois : je me sens donc mieux à l’aise pour instruire le procès de notre art, pour discuter l’atmosphère et la tache, éternellement vaincues par l’inimitable nature, pour malmener la crise du Monticellisme et du Cézannisme, pour invoquer contre la France de l’ignorance érigée en dogme imprévu la France des paysages du Poussin, des portraits de David et des crayons d’Ingres ! Le poncif nouveau de la rue Laffitte est encore plus malsain que le poncif sénile de la rue Bonaparte : partout l’impression marchande ou la note expéditive, et la tyrannie de la sensation, qu’elle sabre le document au plein soleil des rues ou le cauchemar dans l’ombre des nuits ; partout la brosse insouciante d’un fa presto, tandis que la moindre partition veut des années d’efforts ! La peinture abuse de notre patience : entre les hystériques et les estropiés, je ne choisis pas ; je les écarte. Et je sais bien que nous prêchons dans un désert : la critique raisonnable ne ressemble-t-elle pas à Cordélia méconnue par le roi Lear que la folie menace ? On me dit : mais l’infirme Cezanne atteste précisément un regain de la tradition… « Enfin Malherbe vint ! » — Je ne m’en doutais guère et j’avais la candeur de croire que Malherbe savait sa langue autant que Poussin savait son art ! Depuis Delacroix, les coloristes nous grisent. Or, la couleur enveloppe la ligne comme la nature contient la pensée qui la domine : exaltons la forme ; elle seule demeure et fait vivre ; la couleur est une volupté romantique, la ligne une vertu classique : le pauvre Lautrec, ce dessinateur, n’en pratiquait point d’autre… Il lui sera beaucoup pardonné pour l’avoir aimée. Le savoir seul engendre l’indépendance : et serait-ce un déshonneur vraiment que de rapprendre à parler français ?
Raymond Bouyer »
Fontainas André, « Le Salon d’automne (suite et fin », L’Art moderne, Bruxelles, 24e année, n° 45, 6 novembre 1904, p. 359-361, Cezanne p. 360 :
« Cezanne qui, pas plus que Lautrec, ne recule devant les déformations prétendues que la sincérité de son œil lui impose en dépit de formules étroites, d’habitudes établies et d’exclusions systématiques, peint, nécessairement larges et puissants comme s’il entreprenait une vaste décoration murale, des portraits mûrs, rudes, vigoureux, des paysages profonds, des natures mortes. Non qu’il ne sache enlever, de l’encolure d’un pot vert, la gracilité souple de longues tiges comme celles des tulipes, ou y disposer la fraîcheur trouble de pétales de giroflées, ou faire respirer, paisible et vibrant, l’air qui emplit la plaine éclatante au repos et s’allège au pied de la montagne de Sainte-Victoire, mais on a l’impression, en sa présence, qu’il ne trouve jamais sa figure ou le motif qu’il traite assez construit, assez établi dans sa masse et sa carrure, et il y revient encore, il en détermine de plus en plus la structure, il en accuse le relief. Il est impossible de citer, sinon sans choix, les trente morceaux qu’il expose. »
Norval, Le Clairon, 13 novembre 1904. A voir
« Paul Cezanne, déconcertant, par de fâcheuses incohérences de dessin et d’indéniables qualités de peinture. »
Le Gay, « Notes d’art. Le Salon d’automne », L’Univers et le monde, n° 13387, lundi 14 novembre 1904, p. 3-4, Cézanne p. 4 :
« Les esquisses et dessins si distingués de Puvis de Chavannes ont dans la salle à côté un repoussoir du dernier grotesque. Les œuvres de Paul Cezanne qui y sont rassemblées sont ce qu’on peut rêver de plus abracadabrant ; c’est faux, c’est brutal, c’est fou. Je le dis bien bas, car il est fort dangereux d’émettre une telle opinion en public ; le malheureux en sait quelque chose, qui fut, lors de la visite présidentielle, passé à tabac pour n’avoir pas montré un suffisant enthousiasme devant ce musée des horreurs ! »
Cordonnier Émile, « Le Salon d’automne », La Grande Revue, tome XXXII, 15 novembre 1904, p. 435-442. A voir
De Brahm Alcanter, « Art. Salon d’automne », La Critique, 10e année, n° 220, 5-20 novembre 1904, p. 76-79, Cezanne p. 77 :
« Dans une autre salle, triomphe Cezanne, ce disciple des Pissaro et des Monet, dont la palette aux tons frustes, intéresse même par ses heurts violents. Tel portrait de Cezanne, tel paysage à peine ébauché, laissent supposer ce que serait un tel artiste s’il avait eu la force de volonté nécessaire à parachever son œuvre. »
Hamel Maurice, « Le Salon d’automne », Les Arts, n° 35, novembre 1904, p. 34-35.
Horus, La Revue libre, novembre 1904. A voir.
« Une regrettable erreur du catalogue place le peintre Cezanne avant Puvis, sous un dérisoire prétexte alphabétique. »
Marx Roger, « Le Salon d’automne », Gazette des beaux-arts, 570e livraison, 3e période, tome XXXIIe, 1er décembre 1904, p. 458-474, Cézanne p. 462-464 :
« M. Paul Cezanne est, entre les fondateurs de l’impressionnisme, celui qui est demeuré le plus fidèle à Courbet ; il resta dans le groupe un isolé à la façon de M. Degas ; sa peinture n’offre avec celle de ses anciens compagnons de lutte aucun de ces traits communs si fréquents entre M. Monet et Sisley, entre M. Renoir et Berthe Morizot, entre Pissarro et Seurat ; il n’aspire guère à l’éclaircissement de la palette, s’inquiète peu des irisations de la lumière et n’utilise pas la décomposition du ton qu’il veut, au rebours, franc, posé librement et par simples à-plats. Les visiteurs des Primitifs français l’apparentaient naguère à l’auteur de la Pietà d’Avignon, tant le métier est chez lui ingénu ; son culte pour Poussin ne fait pas doute, et il aime aussi Daumier, si l’on en juge d’après la linéature de ses académies, où la recherche du caractère exagère délibérément les saillies du contour ; s’agit-il de figures de portraits, ils seront modelés en pleine pâte dans la lumière du ton pur ; l’ampleur de pratique habituelle à Courbet s’accompagne, dans les paysages, de la recherche de nuances tantôt profondes, tantôt délicates et qui font souvenir des anciens Corot d’Italie ; par-dessus tout, les natures-mortes excellent à fournir le mesure de M. Paul Cezanne ; il confère aux fruits, au : fleurs, aux objets usuels une réalité, un relief extra ordinaire ; ici les dons du coloriste arrivent à une telle intensité d’expression que la peinture semble n’avoir jamais mieux manifesté la puissance d’animation du génie humain.
De M. Cezanne est venu le penchant, aujourd’hui si répandu, à exprimer pleinement la beauté, la vie de la matière, et le Salon d’automne n’échoue pas à montrer comment MM. Pierre Laprade, Deborne, Boudot-Lamotte savent le satisfaire. »
Reproduction du tableau de Cezanne « L’Aqueduc », FWN265-R695, p. 463.
Le Roi Lear, « Au fil des jours », Gil Blas, 5e année, n° 9188, vendredi 2 décembre 1904, p. 1 :
« Le Salon d’Automne — Il y a eu un Salon d’Automne ; il a eu un admirable succès. En le visitant, on oubliait qu’on était dans un Salon ; il n’y a pas de plus bel éloge à en faire ; on voyait une salle de Carrière, une autre de Puvis de Chavannes, une de Renoir, une de Cezanne, une de Toulouse-Lautrec, une de Vuillard, etc. Et l’on s’étonnait que l’on ait pu réunir dans une Société des talents si individualistes. Car les Sociétés, on le sait, ne sont faites que pour assurer le triomphe de la médiocrité.
Pour rester dans le domaine des arts, les deux Salons dits des Champs-Élysées et du Champ-de-Mars nous l’ont bien fait voir. La Société fondatrice du Salon d’Automne allait-elle échapper à cette règle fatale ? Non, à peine née, elle va se hâter de suivre les errements de ses aînées. Elle avait invité Renoir et Cezanne. Lorsqu’il s’agit, une fois le Salon fermé, de nommer des membres sociétaires, Renoir et Cezanne, le croirait-on, n’ont pu réunir que quelques voix.
Est-ce que MM. Buffet, Wery, Gropeano et d’autres, pour ne pas les nommer, s’imaginent que c’est pour eux que nous allons au Salon d’Automne ? »
Solrac, « Réflexions sur le Salon d’automne », L’Occident, 6 décembre 1904.
Vauxcelles Louis, « Le Schisme au Salon d’automne », Gil Blas, 26e année, n° 9205, 21 décembre 1904.
Mauclair Camille, « La peinture et la sculpture au Salon d’automne », L’Art décoratif, décembre 1904, p. 222-230 :
« Et que dire de cet ensemble de M. Cezanne ? L’impression générale du coloris est assez forte : bleus chauds, plaisantes notes rouges. Une perception juste de l’atmosphère de Provence. Mais quelle matière hideuse, sur cette toile d’emballage ! Quelle fausseté de valeurs, souvent, et quels tons discordants ! Une enseigne de baraque de foire, vue au soleil, est parfois amusante ; mais dans un cadre c’est innommable — et j’y pense ici devant certains petits tableaux de nus qui semblent avoir été faits en haine de la chair, de la grâce, de la lumière, de l’amour, par un imagier baroque et féroce. Ces hachures figurant des feuillages, ces coupes de fruits dont on ne voit qu’un bord horizontal alors que tout est sur un plan incliné, ces serviettes douteuses où roulent les pommes, les célèbres pommes de M. Cezanne, ces ignobles papiers peints d’auberge qu’il donne pour fond à ses natures-mortes et dont il copie gravement les dessins, quels surprenants témoignages d’un goût inconscient pour le laid et le grossier ! Jamais l’épithète de « commun » ne s’appliquera mieux qu’à cette peinture pour logement d’ouvrier. Le plus curieux des natures-mortes de ce peintre, c’est la virulence de leurs tons dans l’absence totale de lumière. »
Blanche J.-E., « Notes sur le Salon d’automne », Mercure de France, tome LII, n° 180, décembre 1904, p. 672-690, Cézanne p. 676, 678-680, 690 :
« Voici le Salon d’Automne où triomphent impressionnistes et néo-impressionnistes se réclamant surtout de Cezanne ; le président d’honneur est Eugène Carrière. […]
Voici donc ces horribles murs lie-de-vin, cette lumière blafarde de maison vide dont on ouvre les volets au premier soleil d’avril. Je connais ce sépulcre où j’ai reposé si souvent : l’œuvre de Paul Cezanne y éclate, un peu attristée par le lieu, mais passionnante et contagieuse. J’y conduis M. de Tschudi, le directeur du musée moderne à Berlin (qui prépare une section française toute dédiée à l’impressionnisme), et je lui demande si quelqu’un qui n’a pas fait de peinture peut sincèrement être touché par Cezanne. Il me répond qu’il en jouit, physiquement, comme d’un gâteau ou de la polyphonie wagnérienne. C’est ainsi qu’en effet je le goûte ; mais ces Allemands sont déroutants, que l’académisme sentimental d’un Böklin ravit en extase, alors que la « Stimmung » si pathétique d’un Carrière semble inexpressive à toute critique passionnée pour Cezanne.
§
À considérer les infortunés sur qui s’est exercée son influence, on dirait que bien peu d’entre eux aient vu au-delà des faiblesses de Cezanne ; en effet, comment atteindre à Ses qualités d’un coloriste si raffiné que sa gamme semble ne pouvoir être fournie par les habituelles ressources de la couleur à l’huile ?
Ce sont des pâturages de ce vert profond et léger à la fois, doux et parfumé comme le miel, vitrifié, translucide et pourtant opaque, champs dangereux où seul, peut-être, Gauguin sut brouter une nourriture assimilable, avant de moins robustes qui y contractèrent l’actinomicose. Observons cette jeunesse élevée au Louvre par Gustave Moreau, et qui va se promener comme en escapade, dans ces campagnes à l’atmosphère paludéenne, et cueillir des fleurs vénéneuses sous des ciels grelottants d’aurores provençales.
Harmonies de bleu-gris et de lie-de-vin ; rouges veinés de glaïeul ou de porphyre, gorgonzola ; bleus des vases de la foire, jaunes de la boutique à treize sous, rose et vert de pastèques ; pistache, violet de pois de senteur, ponceau de dahlias mats ; toutes ces aigreurs soutenues par des bruns, indéfinissables de n’être jamais dus à des ocres, mais une poussière solidifiée de toutes les herbes de la Saint-Jean !
Cezanne montre ici trois ou quatre de ses plus purs chefs-d’œuvre : le compotier de pommes, sur fond vert, solide comme un laque de Coromandel [n° 20, FWN576-TA-R329] ; la boîte à lait avec ses verts et ses rouges inouïs, juxtaposés au papier de tenture beige et mauve, avec la plus subtile audace [FWN771-R426] ; le paysage à la maison blanche, dans l’ouate des vergers aux petits arbrisseaux si noblement dessinés, qui s’élancent frissonnants dans un ciel incertain de tout premier printemps… [n° 8, FWN95-R273] Au milieu d’un royal panneau, c’est le portrait du maître, dont la forme ne souffre pas trop du constant sacrifice à la recherche du ton pur, effarouche moins que certains autres visages d’étude, décidément trop peu construits [FWN449-R383]. Voici encore ces tartes et ces madeleines en or et en sucre d’orge, un ravissement de l’œil, une gourmandise succulente [R 329] ; enfin ces scènes de baignades antiques, corps bleus et roses, dans un décor d’imagerie populaire, qui rappellent l’allongement contorsionné du Gréco [FWN923-R360, FWN936-R449, FWN944-R553 et FWN947-R665]. […]
M. Frantz Jourdain dispose sur des buffets publics les sucres filés et les sorbets empoisonnés de Renoir et de Cezanne, à l’usage de tous. Nous verrons dans les galeries voisines ce qu’en assimile l’organisme contemporain. Qu’est-ce que la littérature va prendre de ces triturations de palettes et des jus maléfiques réduits pour son usage personnel, sur le petit fourneau de son atelier, par le mystérieux solitaire de l’Estaque ? Quels pièges vous tendez, monsieur Jourdain, sans le savoir, aux « jeunes talents individuels » ? […]
Ce Salon d’Automne nous montre un raccourci de ce que les trente dernières années ont produit de plus intéressant dans l’ordre le plus recherché et le plus fermé pour un public simple et naïf. À côté d’hommes de génie comme Puvis de Chavannes, Cezanne, Renoir, et de grand talent comme Alphonse Legros et tant d’autres, c’est toute une pléiade de jeunes gens très distingués — mais cet art officiel de demain n’est-il pas, souvent, éloigné de la « Vie », de la vie moderne surtout, et ne semble-t-il pas apprêté pour un petit cercle de byzantins ?
J.-E. BLANCHE. »
Guérin Joseph, « III Les arts. Le Salon d’automne », L’Ermitage, 15e année, volume XXXI, n° 12, décembre 1904, p. 309-314, Cezanne p. 310 :
« Grâce à cette méthode, Cezanne et Renoir ont eu pour la première fois dans un Salon, une place correspondante à celle que, depuis longtemps, ils tiennent dans l’opinion de quelques amateurs éclairés. C’est une rude leçon que la salle Cezanne vient ainsi de donner aux observateurs. Elle contenait de ces paysages provençaux si synthétiques et si vrais, si lumineux et si colorés, où la plupart des gens, qui, croyez-moi, n’ont jamais vu clair, ne reconnaissent pas la nature. Avec cela des portraits, des nus, des compositions, des natures mortes, construits toujours comme par la main d’un charpentier fruste et consciencieux, admirables de style et de solidité. Certes le choix du sujet pour Cezanne est secondaire. C’est sans doute que sa personnalité lui suffit. »
« Chronique parisienne. Au Salon d’automne », Bibliothèque universelle et revue suisse, Lausanne, 109e année, tome XXXVI, décembre 1904, p. 607-615, p. 613-614 :
« L’art si élevé de Puvis de Chavannes occupe les quatre murs d’une salle, où ses « manières » successives composent un ensemble d’une belle unité. Contiguë à celle-ci, voici la salle Paul Cezanne, peintre d’une sincérité puérile et d’une technique douteuse, qui vit en sauvage en Provence et s’est trouvé être baroque à point pour que la critique d’avant-garde, suivie de la foule des snobs, s’attribuât le mérite de découvrir en lui le nouveau Manet qu’il nous faut. Je vous recommande sa Dame au chapeau vert [FWN484-R700], dont les yeux n’ont pas de regard, et son Portrait de Mme C… [FWN487-R607], qui est un pur barbouillage d’enfant. »
Mauclair Camille, « La peinture et la sculpture au Salon d’automne », L’Art décoratif, décembre 1904, p. 222-230.
Holzamer Wilhelm, « Der Herbstsalon 1904 », Kunst und Künstler, décembre 1904, p. 177-178.
Reymondi, « À propos du Salon d’automne de Paris », L’Idée libre, littéraire, artistique, sociale, tome VIII, décembre 1904, p. 691-696, Cézanne p. 694 :
« Cezanne possède un vrai tempérament de peintre. Ses Natures mortes surtout, d’une belle matière, sont solidement traitées. En outre, il a, dans ses scènes mythologiques, un sens intéressant de la composition, et certaines de ses figures, comme Son portrait par lui-même, ont l’heureuse naïveté des bonshommes que les enfants tracent sur les murs. Son art est exempt des préjugés enseignés dans les écoles, préjugés dont beaucoup de peintres ont eu tant de peine à se libérer.
Cezanne est un simple et un sincère. Toutefois on éprouve une tristesse devant cet ensemble de toiles représentant l’effort de toute une existence, quand on vient de quitter la salle où sont groupées quelques-unes des pages immortelles de Puvis.
Les artistes contemporains n’oublieront pas l’influence de Cezanne sur la peinture de son temps et sa gloire d’avoir été un des premiers défenseurs de Manet. Et c’est à ces titres seuls que son nom restera dans l’histoire de la peinture française au XIXe siècle… »
Jean-Pascal, Le Salon d’automne en 1904, Paris, Société parisienne d’éditions artistiques, 1904, 22 pages. A voir
« Cezanne doit sa réputation à Émile Zola. »
« Art News from the Old World », Brush and Pencil, Chicago et New York, volume 15, n° 1, janvier 1905, p. 9-10, p. 9 :
« The sixty pictures by Paul Cezanne, who also had a room of his own, aroused, as usual, bitter criticism as well as admiration. Many of those who have finally accepted Renoir still consider Cezanne’s pictures with disfavor. »
Traduction :
« Les soixante tableaux de Paul Cezanne, à qui une salle entière aussi était consacrée, ont suscité, comme d’habitude, la critique amère aussi bien que l’admiration. Beaucoup de ceux qui ont finalement accepté Renoir considèrent encore défavorablement les tableaux de Cezanne. »
Vauxcelles Louis, « Cézanne », Gil Blas, 27e année, n° 9290, samedi 18 mars 1905, p. 1.
Autres références
Blanche Jacques-Émile, Propos de Peintre, 2e série, Dates, précédé d’une réponse à la Préface de M. Marcel Proust au De David à Degas, Paris, Émile-Paul frères, éditeurs, 1921, 323 pages, p. 273-285.
« Rétrospective Cezanne. [1904]
Et encore nos horribles murs lie-de-vin, cette lumière blafarde de maison vide dont on ouvre les volets au premier soleil d’avril ! Je connais ce sépulcre où j’ai reposé si souvent : l’œuvre de Paul Cezanne y semble un peu attristée par le lieu. Herr Tschudi, le directeur du musée moderne à Berlin (qui prépare une section française toute dédiée à l’impressionnisme), auquel je demande si quelqu’un qui n’a pas fait de peinture peut, comme nous, être touché par Cezanne, me répond qu’il en « jouit, comme d’un gâteau ou de la polyphonie wagnérienne ». Ces Allemands sont déroutants, que l’académisme sentimental d’un Boecklin met en extase, alors que la « Stimmung » si humaine d’un Carrière leur semble inexpressive… mais Cezanne !… À considérer les peintures de ces Germains sur qui s’est exercée son influence, on dirait que bien peu d’entre eux aient vu au delà des apparences de Cezanne ; ils parlent néanmoins de couleur raffinée, de construction, de synthèse.
Harmonies de bleu-gris et de lie-de-vin ; rouges veinés, de glaïeuls ou de porphyre, de nougat ; bleus des vases de la foire, jaunes de la boutique aux macarons, rose et vert de pastèques ; pistache, violets de pois-de-senteur, ponceau de dahlias mats ; toutes ces couleurs soutenues par des bruns, qu’on ne trouve plus sur la palette des impressionnistes. De la pâtisserie pour les Berlinois ?
De Cezanne ici : le compotier de pommes, sur fond vert, peut-être sa plus majestueuse nature morte [n° 20, R 329] ; la boîte à lait, avec ses verts et ses rouges sourds, juxtaposés au papier de tenture beige et mauve [R 426] ; des fruits en onyx, des pommes ; le paysage à la maison blanche, dans l’ouate des vergers aux petits arbrisseaux si naïvement dessinés, qui, tout bleus, frissonnent dans un ciel malade d’avril [n° 8, R 273] : mais surtout et au milieu d’un royal panneau, c’est le portrait du maître, dont la forme ne souffre pas trop d’un constant sacrifice à la recherche du ton pur, en souffre moins que certains autres visages d’étude, trop péniblement construits. Voici encore des tartes et des madeleines en or et en sucre d’orge, des pains provençaux, une gourmandise succulente ; enfin, ces scènes de baignades antiques, corps bleus et roses, dans un décor de faïence d’Urbino, qui rappellent l’allongement contorsionné du Gréco. »
Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 187.
« Cette même année 1904, le Salon d’Automne consacra à Cezanne une salle. Puvis de Chavannes avait aussi la sienne. À ce propos, un journal déplora que les exposants fussent désignés, dans le catalogue, par ordre alphabétique, de telle sorte que le nom de Cezanne se trouvât précéder celui de Puvis de Chavannes. On voit que la presse était restée aussi hostile qu’aux premiers jours mais Cezanne n’en était pas moins recherché des amateurs et désormais « arrivé », dans le sens que l’on donne généralement à ce mot. »
Jourdain Frantz, Le Salon d’automne, avec la collaboration de Robert Rey, Paris, Les Arts et le livre, collection « L’art et la vie », 1926, 93 pages de texte, reproductions n. p., p. 50-51 :
« Une nouvelle section est créée qui comporte trente envois : la section de photographie. […] On voit figurer dans cette section trois cadres contenant chacun neuf photographies d’après Cezanne.
L’hommage rendu l’année précédente à Paul Gauguin avait déjà soulevé un vif mouvement de curiosité.
Cette année le Salon va honorer particulièrement des artistes encore vivants, fort admirés par une minorité avertie, mais encore très méconnus par le grand public.
Le Comité organise une salle Paul Cezanne.
Elle comporte trente et un cadres. Vingt-six Cezanne ont été prêtés par M. Vollard ; deux par M. Blot ; cinq par M. Durand-Ruel.
On y voit la Maison du Pendu, deux portraits de Cezanne par lui-même, le portrait de M. Choquet. »
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, à voir.
Octobre
En octobre 1904, Leo et Gertrude achètent à Vollard deux tableaux de Baigneurs de Cézanne (numéros de stock 4363 et 4364), dont FWN952-R749.
Matisse, Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein, catalogue d’exposition, San Francisco Museum of Modern Art, 21 mai – 6 septembre 2011, Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, Paris, 3 octobre 2011 – 16 janvier 2012, New York, The Metropolitan Museum of Art, 21 février – 3 juin 2012, Paris éditions de la RMN Grand Palais, 2011, 456 pages, p. 173.
Octobre-novembre
Exposition d’œuvres impressionnistes à la galerie Emil Richter à Dresde, comprenant au moins une œuvre de Cézanne.
Kunstsalon Emil Richter, Dresden, 10 novembre 1904. Rewald John, Cézanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 270.
11 octobre (?)
Lettre de Cézanne à Gaston Bernheim-Jeune.
« Aix, 11 octobre 1904.
Cher Monsieur,
Ma réponse est tardive[i], l’état précaire de ma santé est sans doute une excuse qui vous semblera suffisante.
Je suis très touché des marques d’estime et des termes élogieux de votre lettre.
Je ne demande pas mieux que de répondre favorablement à votre désir, si tout cela doit se borner pour moi à vous faire l’exposition de mes théories et de vous expliquer le but constant que j’ai cherché à atteindre toute ma vie[iii].
Veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression de ma sympathie d’artiste.
P. Cezanne.
a Aix 11 8 [?]1904[ii] »
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages
[i] Note de Jean-Claude Lebensztejn :« l’état précaire de ma santé est sans doute une excuse qui vous semblera suffisante », (ajoutés par Rewald, ces) mots … ne se trouvent pas dans l’autographe conservé au MLM. Peut-être celui-ci (la version du Musée des Lettres et Manuscrits reproduite ci-dessus) est-il un brouillon ; l’écriture en est, en effet, précaire, et la ponctuation manque.
[ii] Note de Jean-Claude Lebensztejn : cette répétition manque dans la version du MLM. Indication du mois peu lisible.
[iii] Note de Rewald : …Le marchand s’était cette fois adressé à Cézanne en tant qu’artiste et ce dernier était prêt à le recevoir tant qu’il ne s’agissait pas de faire une “infidélité” à Vollard.
20 octobre
Denys Cochin échange à Vollard Le Buffet (FWN746-R338) et un paysage de roches et d’arbres (65 x 81 cm) (R 797) comntre une autre nature morte décrite comme « Pommes, serviette et vase. 73 x 92 ».
Rewald John, The Paintings of Paul Cézanne : A Catalogue raisonné, volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, 1996, 592 pages, notice 338, p. 228.
D’après le livre de stock B de Vollard, il achète à Cochin une toile de Cézanne pour 1 000 francs, n° 3773, « Paysage ; rochers et arbres », 65 x 81 cm (La Carrière de Bibémus, FWN306-R797).
Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute.
28 octobre
Léo et Gertrude Stein achètent sept tableaux à Vollard : deux Cézanne, Groupe de baigneurs (FWN953-R753) et Baigneurs (FWN962-R861), deux Gauguin, deux Renoir et un Maurice Denis. Le lot leur coûte 8 000 francs.
Les œuvres de Cézanne apparaissent sur des photographies de leur appartement, 27, rue de Fleurus, prises vers 1906.
Registre commercial de Vollard, janvier 1904 – 31 décembre 1904, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,10), p. 30, 32 et livre de stock B de Vollard, vers juin 1904 – vers décembre 1907, MS 421 (4,5) nos 4363, 4364.
Rabinow Rebecca A. et Warman Jayne, « Chronologie », sur CD-Rom dans De Cézanne à Picasso. Chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan Museum of Art, 13 septembre 2006 – 7 janvier 2007, Chicago, The Art Institute of Chicago, 17 février – 12 mai 2007, Paris, musée d’Orsay, 19 juin – 16 septembre 2007, Paris, musée d’Orsay et Réunion des musées nationaux, 2007, p. 208-245, p. 216.
Matisse, Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein, catalogue d’exposition, San Francisco Museum of Modern Art, 21 mai – 6 septembre 2011, Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, Paris, 3 octobre 2011 – 16 janvier 2012, New York, The Metropolitan Museum of Art, 21 février – 3 juin 2012, Paris éditions de la RMN Grand Palais, 2011, 456 pages, p. 486, photographies figures 59 et 62, p. 149, 151.
Rewald John, The Paintings of Paul Cézanne : A Catalogue raisonné, volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, 1996, 592 pages, notice 753, p. 460.
Stein Gertrude, The Autobiography of Alice B. Stoklas, New York, Harcourt, Brace & Company, 1933, 311 pages, réédition, New York, Vintage House, 1961, 252 pages, p. 32. Stein Gertrude, Autobiographie d’Alice Toklas, Paris, Gallimard, collection « L’imaginaire », 1980, 264 pages, p. 39 :
« They began to take an interest in Cezanne nudes and they finally bought two tiny canvases of nude groups. They found a very very small Manet painted in black and white with Forain in the foreground and bought it, they found two tiny little Renoirs. They frequently bought in twos because one of them usually liked one more than the other one did, and so the year wore on. »
Traduction :
« Ils commencèrent à s’intéresser aux nus de Cezanne et enfin ils achetèrent deux petits groupes de nus par Cezanne [Groupe de baigneurs (R 753) et Baigneurs (R 861)]. Ils trouvèrent un tout petit Monet, peint en noir et blanc avec Forain au premier plan et ils l’achetèrent, ils dénichèrent aussi deux minuscules Renoir. Souvent ils achetaient les tableaux par deux, car d’ordinaire le frère et la sœur avaient des préférences différentes. Ainsi s’écoula l’année. »
Novembre
Gasquet, venu quelques semaines à Paris, écrit à sa femme à propos d’aquarelles et de tableaux qu’il a fait estimer. Il indique : « Je vais faire l’affaire […]. Il [Vollard] m’offre 1 000 francs du Van Gogh et 20 000 des tableaux de Cézanne ». Quelques jours plus tard, il lui confirme : « Vollard m’a offert vingt mille francs de mes trois Cézanne en bloc ».
Cette proposition de vente à Vollard, ou à d’autres marchands, que Cézanne a dû apprendre immédiatement, est probablement une des raisons de la rupture avec Gasquet.
Lettres de Joachim Gasquet à sa femme Marie, novembre 1904 ; Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, fonds patrimonial Joachim Gasquet, MS 1875 (1741, 2).
Colrat Jean, Cézanne : joindre les mains errantes de la nature, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2013, 518 pages, p. 55.
Jaloux Edmond, Les Saisons littéraires 1896-1903, Fribourg, éditions de la Librairie de l’Université, 1942, 342 pages, p. 76 :
« On m’a dit que Cézanne rompit avec Gasquet, parce que celui-ci, qui avait acheté quelques-uns des plus beaux tableaux du vieux maître, en avait vendu un ou deux, à une époque où il se trouvait à court d’argent. Mais peut-être est-ce un simple potin. Gasquet lui-même n’aimait pas à s’expliquer sur sa rupture avec Cézanne. »
11 novembre
Paul Cézanne fils remercie Vollard du mandat de 2 000 francs qu’il a envoyé. Il ajoute : « Mon père est enchanté du succès obtenu par le Salon d’Automne et il doit vous remercier beaucoup des soins que vous avez apportés à son exposition. » Il demande à Vollard d’envoyer à son père des photographies « des quatre faces de la salle qu’on a bien voulu lui consacrer. » Parmi les documents du fonds Vollard entrés par arrêté de dation du 16 octobre 1989 au musée d’Orsay se trouvent cinq clichés montrant les murs de la salle consacrés à Cézanne au Salon d’automne. Vingt-sept tableaux sur les trente et un annoncés dans le catalogue sont reconnaissables sur ces vues, ainsi que deux dessins. Au-dessus des tableaux sont présentées dans trois cadres des photographies de tableaux de Cézanne non exposés.
Cézanne travaille à une toile de Baigneuses, au portrait d’un vieux braconnier et à des paysages. Il réalise aussi des aquarelles.
« Aix, le 11 novembre 1904.
Cher Monsieur Vollard
Je vous accuse un peu tardivement réception de votre mandat-carte de deux mille francs ; et je vous envoie inclus sous ce pli deux de vos signatures. Mon père est enchanté du succès obtenu par le Salon d’Automne et il doit vous remercier beaucoup des soins que vous avez apportés à son exposition. Il sera très heureux de recevoir les quatre faces de la salle qu’on a bien voulu lui consacrer. J’attends le premier envoi de photographies que vous devez bientôt me faire. Je les classerai de mon mieux avec l’indication de l’époque, du lieu et de la nature des tableaux représentés, ainsi que vous le souhaitez. Mon retour à Paris s’effectuera dans les premiers jours de décembre. C’est donc à cette date que je pourrais vous remettre le résultat de ce petit travail.
Mon père est toujours animé de la même ardeur pour son art, comme vous pouvez le supposer. La toile des Baigneuses fait encore du progrès. Le portrait d’un vieux braconnier qui lui sert de modèle vient bien. Il a commencé trois ou quatre paysages qu’il se propose de continuer l’année prochaine. Il fait aussi un peu d’aquarelle. Le temps le favorise, car il fait très beau.
Mon père et ma mère vous envoient leurs meilleures amitiés.
Agréez, mon cher Monsieur Vollard, l’expression de mes sentiments tout cordiaux.
Paul Cezanne f. »Lettre de Paul Cézanne fils à Vollard, 11 novembre 1904 ; archives de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, MS 421 (2,2), p. 63-64 bis ; citée par Venturi Lionello, « Giunte a Cézanne », Venturi Lionello, « Giunte a Cézanne », Commentari, rivista di critica e storia dell’arte, 2e année, fascicule n° 1, janvier-mars 1951, p. 47-50, p. 49.
Cahn Isabelle, « Chronologie », Cézanne, catalogue d’exposition, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 25 septembre 1995 – 7 janvier 1996, Londres, Tate Gallery, 8 février – 28 avril 1996, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, 26 mai – 18 août 1996, Cézanne, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1995, 226 numéros, 599 pages, reproduction des cinq photographies p. 564-565.
Perruchot Henri, La Vie de Cézanne, Paris, librairie Hachette, 432 pages, 1956, 432, note 1 p. 395 :
« Une commerçante de vins et liqueurs de la place des Trois-Ormeaux demandait à Mme Brémond : « Comment va Monsieur ? — Heu, pas bien ! — Peint-il, monsieur ? — Oh ! des horreurs ! Je descends de la campagne pour brûler des tas de femmes nuses. Je ne peux laisser ça pour la famille. Que diraient les gens ? — Mais il y en a peut-être de bien. — Des horreurs ! (Témoignage en partie inédit, de Mlle E. Décanis, fille de la commerçante.)
11 novembre
Kessler échange avec Vollard un paysage de Cézanne contre un autre de l’artiste, Le Viaduc à l’Estaque (FWN151-R439), évalué à 3 500 francs. Il lui achète aussi un autre tableau de Cézanne, Bosquet au Jas de Bouffan (FWN88-R267), une aquarelle et une gravure de Gauguin, ainsi qu’une aquarelle de Jongkind, pour un total de 5 500 francs.
Registre commercial de Vollard, janvier 1904 – 31 décembre 1904, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,10), p. 33-34, et livre de stock B de Vollard, vers juin 1904 – vers décembre 1907, MS 421 (4,5) nos 3407, 3804, 3570 et 4306.
Rabinow Rebecca A. et Warman Jayne, « Chronologie », sur CD-Rom dans De Cézanne à Picasso. Chefs-d’œuvre de la galerie Vollard, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan Museum of Art, 13 septembre 2006 – 7 janvier 2007, Chicago, The Art Institute of Chicago, 17 février – 12 mai 2007, Paris, musée d’Orsay, 19 juin – 16 septembre 2007, Paris, musée d’Orsay et Réunion des musées nationaux, 2007, p. 208-245, Livre de stock B, n° 3407, 3804, 3570, 4306 ; A V, MS 421 (4,10) ; p. 33-34 ; p. 217.
27 novembre
Lettre de Camoin à Matisse :
« Suis allé voir le père Cezanne : c’était un dimanche à midi et demi je sonne à sa porte. Il était déjà sur le motif. Donc déjà une leçon avant de l’avoir vu.
Je le retrouve à sa campagne écrasant du vert Véronèse sur sa palette ; il s’avance en me criant du plus loin qu’il me voit : « Mais il n’y a que la théorie ! Mais Véronèse c’est cela ! la théorie ! » Ah ! comme nous avons ri ! à nous trousser, comme parfois entre nous avec Marquet. Les bons moments quoi !
Je lui parlais de Bernard et de ses révélations : « Oui il m’a envoyé ça, c’est un bon garçon, j’aurais voulu l’obliger à travailler sur nature, mais je n’avais pas les moyens de le prendre à ma charge. Vous, vous avez la sonorité de vous conduire tout seul, et comme je me confondais et non écoutez un peu, nous sommes deux peintres eh bien nous pouvons nous parler simplement mais croyez-moi il n’y a que la théorie, voyez Delacroix, et il s’emballe sur Delacroix à combien juste raison n’est-ce pas ! sur la barque de Dante ! sur une photo de Sardanapale ! Quel sensitif il est lui Cezanne, ainsi voyez, il faut faire des tableaux, composer comme l’ont fait les maîtres, non pas comme les impressionnistes qui découpent un morceau de nature au hasard. Mettre les personnages. Voyez Lorrain. » Mais je n’étais pas encore assez dans une période de travail pour pouvoir causer autrement que de choses générales et je lui fais remarquer que notre conversation part sur des motifs bien lointains, Napoléon, le tzar, par exemple. « Écoutez un peu, c’est comme ça que se passe l’existence. » Là-dessus je l’ai quitté car il était l’heure des vêpres. Il m’a dit de lui écrire mon adresse et qu’il viendrait me voir ici, mais comme je constate qu’il faut changer deux fois de trains pour venir d’Aix aux Martigues, je préférerais y aller moi-même et vais lui écrire. »Lettre de Charles Camoin à Matisse, datée « Hôtel des Lions, Martigues (Bouches-du-Rhône), 2 décembre [1904], Correspondance entre Charles Camoin et Henri Matisse (lettres présentées et annotées par Claudine Grammont), Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1997, 231 pages, p. 15.
Bien plus tard, Camoin écrira aussi à Matisse :
« Tu sais que, lorsque j’ai connu Cézanne, je le trouvais toujours absolument seul, bien qu’il eût femme et enfant, et je n’ai jamais mangé chez lui de si bonne soupe à l’oignon en si charmante compagnie. C’est curieux que la vie des artistes, malgré leur bonne volonté à faire comme tout le monde, soit rarement conforme à la normale. »
Lettre de Charles Camoin à Matisse, « Route des Canoubiers, Saint-Tropez, Var [juillet 1941] ; Correspondance entre Charles Camoin et Henri Matisse (lettres présentées et annotées par Claudine Grammont), Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1997, 231 pages, p. 157.
30 novembre
Dans une lettre à Théodore Duret, Mary Cassatt se réjouit du succès de Cézanne au Salon d’automne.
« Mesnil Beaufresne
30 novembre
Cher Monsieur,
En réponse à votre lettre, je n’ai pas l’intention de vendre ma nature morte de Cezanne, mais je sais que les Pissarro ont une peinture de fleurs par lui [Les Deux vases de fleurs (R 313) ?] qu’ils entendaient vendre s’ils trouvaient un amateur. Mme Pissarro m’a dit qu’il allait y avoir une vente au printemps de tout ce que son mari a laissé, mais je sais que, dans l’intervalle, si elle trouve quelqu’un prêt à payer le prix demandé elle accepterait. Elle dispose également de plusieurs paysages de Cezanne avec qui je ne suis pas familière.
Je vois que les Cezanne ont eu un grand succès au Salon d’Automne — il était temps — »Lettre de Mary Cassatt à Duret, 30 novembre [1904] (traduite de l’anglais, original en français) ; Paris, Fondation Custodia, Paris ; Mowl Mathews Nancy, Cassatt and her Circle, Selected Letters, Abbeville Press, Publishers, New York, 1984, p. 295.
2 décembre
Camoin relate dans une lettre à Matisse sa récente visite à Cézanne.
Correspondance entre Charles Camoin et Henri Matisse (lettres présentées et annotées par Claudine Grammont), Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1997, 231 pages, p. 14-17.
5 décembre
En réponse à Julie Pissarro qui lui demande des renseignements sur la cote des tableaux contemporains, Monet répond :
« Ce que j’ai pu constater d’autre part c’est l’emballement général pour les Cézanne que vous pourriez céder en tenant bien vos prix. »
Lettre de Monet à J. Pissarro, 5 décembre 1904 ; Wildenstein Daniel, Monet. Vie et œuvre, Lausanne Paris, Bibliothèque des arts, tome IV, 1985, n° 1749, p. 367.
Fin de l’année, avant le 9 décembre
Le peintre et illustrateur Hermann-René-Georges Paul, dit Hermann-Paul (1864-1940) vient à Aix y rencontrer Cézanne, qui le reçoit et accepte même de poser pour quelques croquis. À son retour à Paris, Hermann-Paul peindra son portrait d’après les croquis rapportés.
La date est suggérée par un article de Francis Jourdain.
Vauxcelles Louis, « Cézanne », Gil Blas, 27e année, n° 9290, samedi 18 mars 1905, p. 1.
Jourdain Francis, Cézanne, collection « Palettes », Les éditions Braun & Cie, Paris, 1950, 32 pages de texte, en français, anglais et allemand, p. 8-12.
de Beucken Jean, Un portrait de Cézanne, Paris, « nrf », Gallimard, 1955, 341 pages, p. 315-316, 340 :
« Un dessinateur qui faisait aussi de la peinture, Hermann Paul, grand admirateur de Cezanne, était venu à Aix tout exprès pour le rencontrer. Le vieux peintre le reçut bien, et lui résuma ses théories habituelles : « Tout est sphérique et cylindrique », etc. Comme Hermann Paul était lié avec Mirbeau, il le questionna : « Vous connaissez ce Monsieur Mirbeau ? », feignant de ne pas le connaître personnellement, et il semblait mettre en doute l’influence d’un homme qui n’avait pas su le faire décorer. Sur Gasquet, il ne cachait plus ses sentiments : « Ce petit poète qui se prend pour Victor Hugo. »
Cezanne lui demanda de poser, et Hermann Paul connut quelques-unes de ces séances où, fixé par l’œil perçant du vieux peintre, on n’osait bouger. Mais l’œuvre fut bientôt abandonnée. Hermann Paul le vit aussi travailler à une tête, s’acharnant sur l’oreille, qui finit par devenir monstrueuse : on ne voyait plus qu’elle ; et la toile disparut. Lui-même prenait en cachette des croquis de Cezanne, et ces croquis servirent à une grande toile dont le peintre ignora l’existence : un Cezanne, palette en main, pantalons invraisemblables, et chaussons. C’est sans doute le portrait le plus cruel, mais le plus exact qui demeure (du moins d’après Mme Marie Gasquet. Gasquet et Hermann Paul s’étant brouillés, Gasquet écrivit que ce portrait avait la ressemblance de l’envie). Cette œuvre se trouve au musée d’Aix.
Hermann Paul était venu à Aix avec Pauline Ménard-Dorian, qui devait devenir sa femme. Le vieux peintre, le dessinateur et cette élégante jeune parisienne se trouvant ensemble au café, un Aixois n’y tenant plus de curiosité lui dit aimablement : « Vous avez de la compagnie, monsieur Cezanne. » Et Cezanne, avec une ironie nasillarde : « Tiens ! Vous me reconnaissez aujourd’hui. » Pauline Ménard-Dorian ayant manifesté le désir de posséder une des toiles de Cezanne, Hermann Paul en demanda le prix ; le peintre, soudain méfiant, répondit brusquement qu’il n’avait aucune raison de lui faire un cadeau. Hermann Paul, d’une fierté susceptible, se froissa… Mais quelque temps après, quand ils furent rentrés à Paris, Cezanne leur envoya un mot gentil. […]
Je remercie ici les témoins de la vie de Cezanne. D’abord une pensée affectueuse à la mémoire d’Hermann Paul, ce grand dessinateur encore méconnu, qui me parla souvent du peintre qu’il admirait tant. »
9 décembre
Cézanne invite Camoin, qui est à Martigues, à venir travailler sur le motif avec lui. Il lui demande de se rendre directement à son atelier, où il a pris l’habitude depuis l’été de se faire porter son déjeuner à 11 heures, avant de partir travailler sur le motif l’après-midi jusqu’à 5 heures quand le temps le permet. Il le met en garde contre l’influence des autres peintres. Francis Jourdain accompagne Camoin à Aix.
« Aix, 9 Xbre 1904
Mon cher Camoin,
J’ai reçu votre bonne lettre datée des Martigues. Venez quand il vous plaira ; vous me trouverez toujours au travail ; vous viendrez au motif avec moi, s’il vous plaît. Dites-moi le jour de votre arrivée, car si vous venez à l’atelier de la montée des Lauves, je ferai apporter le déjeuner pour deux. — Je mange à onze heures et de là je pars pour le motif, à moins de pluie. J’ai un dépôt de bagages à 20 minutes de chez moi. ― Je
La lecture du modèle, et sa réalisation est quelquefois très-lente à venir pour l’artiste. — Quelque soit le maître que vous préfériez, ce ne doit être pour vous, qu’une orientation. Sans cela, vous ne seriez qu’un pasticheur. Avec un sentiment de la nature, quelqu’il soit, et quelques dons heureux ― et vous en avez, vous devez arriver à vous dégager ; les conseils, la méthode d’un autre ne doivent pas vous faire changer votre manière de sentir. Subiriez-vous momentanément l’influence d’un plus ancien que vous, croyez bien que du moment que vous ressentez, votre émotion propre, finira toujours par émerger et conquérir sa place au soleil, ― prendre le dessus, confiance ― c’est une bonne méthode de construction, qu’il vous faut arriver à posséder. Le dessin n’est que la configuration de ce que vous voyez. —
Michel-Ange est un constructeur, et Raphaël un artiste, qui si grand qu’il soit, est toujours bridé par le modèle. ―
Quand il veut devenir réfléchisseur il tombe audessous de son grand rival. —
Bien cordialement à vous,
P. Cezanne »Lettre de Cézanne à Camoin, datée « Aix, 9 Xbre 1904 » ; fonds Vollard, microfilm conservé à la documentation du musée d’Orsay.
Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cézanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 64-65.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 307.
Bernard Émile, Sur Paul Cézanne, Paris, R. G. Michel, 1925, p. 20
Jourdain Francis, Cezanne, collection « Palettes », Les éditions Braun & Cie, Paris, 1950, 32 pages de texte, en français, anglais et allemand, p. 8-12 ( repris par Doran P. M., Conversations avec Cézanne, édition critique présentée par P. M. Doran, Paris, Macula, 1978, p. 82.)
Voir Jourdain Francis, « À propos d’un peintre difficile : Cezanne », Art de France, n° 5, 1946, p. 3-12.« J’appartiens, quant à moi, à la génération qui eut à découvrir Cezanne ; je ne prétends bien entendu pas que sa gloire doive quoi que ce soit à notre perspicacité ; je veux seulement dire que, vers 1894, l’œuvre de Cezanne était matériellement invisible. De fréquentes visites à la Galerie Durand-Ruel nous avaient rendu familière l’œuvre de Renoir, de Monet, de Degas, de Pissarro et de Sisley ; nous accompagnions déjà de notre ferveur enthousiaste les premiers pas, chez Le Barc de Boutteville, de Bonnard, de Toulouse-Lautrec et de leurs amis, mais, ni là, ni ici, on ne voyait jamais le moindre tableau de ce Cezanne qui avait dès longtemps renoncé à exposer et dont nos aînés prononçaient le nom avec une déférence assez mal avertie. Ils discutaient beaucoup plus volontiers les théories de Gauguin, nouveau Messie dont Paul Sérusier et Maurice Denis s’étaient faits les apôtres.
Si l’on était fort peu et mal renseigné sur les « idées » de Cezanne (ce qui n’empêchait pas de lui en prêter un certain nombre), on ignorait généralement la peinture qu’elles avaient engendrée. Léon-Paul Fargue et moi étions très fiers d’avoir, en retournant les toiles entassées chez le père Tanguy, découvert un paysage à la gravité duquel, il en faut convenir, nous étions beaucoup moins sensibles qu’à l’éloquence frénétique et exaltante du cher Van Gogh, le fol dont les « lichens de soleil et les morves d’azur » embrasaient la minuscule échoppe de la rue Clauzel. Nous avions été conduits là par Émile Bernard qui, — fâché avec Gauguin, et un peu jaloux de l’importance accordée aux recherches de celui qu’il disait avoir initié, — était sans doute le seul à sentir combien cette importance paraîtrait excessive, lorsque justice serait enfin rendue à l’oublié d’Aix.
Bernard fut aussi un des rares qui aient eu la curiosité d’approcher Cezanne. Il a raconté, de façon attachante, son séjour auprès du solitaire génial qui était aussi un vieux marguiller fantasque ; deux ans avant la mort de Cezanne, il m’a été donné de constater la véracité du portrait tracé en ces quelques pages, par Bernard.
Charles Camoin, rencontré à Marseille m’avait proposé de l’accompagner le lendemain à Aix, où il avait naguère fait son service militaire, et où il ne retournait jamais sans rendre visite à l’étrange artiste chez lequel il avait alors osé se présenter, dont il était devenu le respectueux ami, bien que Cezanne passât déjà pour un vieil original irritable, aux lubies déconcertantes.
Jamais je n’avais imaginé que je pourrais quelque jour voir ce Cezanne auquel la légende avait donné tous les caractères d’un personnage mythique. J’acceptai l’offre de Camoin avec une émotion qui s’accrut fort lorsque, derrière la porte à laquelle mon camarade avait sonné, j’entendis le crissement du gravier sous les pas lents d’un vieillard fatigué. La porte s’ouvrit. Je vis Cezanne ! Je vis l’œuf luisant de son crâne, à l’arrière duquel quelques mèches grises traînaient sur le col râpé d’un veston taché. Je vis les savates, le pantalon tire-bouchonné, la ridicule petite cravate mince nouée sur une chemise blanche — pas très blanche — dont le plastron empesé, sans boutons, s’ouvrait sur une poitrine velue. La méfiance qui souillait le magnifique regard, se dissipa en reconnaissant le visage — mi-Gille mi-Faune — de Camoin. L’accueil fut cordial. Nous pénétrâmes dans le pavillon où Cezanne ne venait que pour travailler et où régnait un indescriptible désordre, le tuyau d’un antique clysopompe rampant jusqu’à la tête de mort qui, posée sur un tapis fallacieusement oriental, constituait le motif d’une nature-morte.
En prévoyant que nous trouverions, sur deux chevalets, les deux tableaux qu’il y avait vus un an auparavant, Camoin ne s’était pas trompé. Il constata seulement que ce Portrait d’un jardinier et ces Baigneuses paraissaient plutôt moins faits que lors de sa précédente visite. Cezanne nous montra aussi deux ou trois toiles à peine esquissées ; l’une était, nous dit-il, le portrait que Monsieur Armand, « Vous connaissez, Monsieur Armand ? Il est très connu à Paris. Il est venu à Aix faire mon portrait. Ça me gênait de poser. Alors j’avais commencé le sien ». Nous comprîmes qu’il s’agissait de notre camarade Hermann Paul, à qui l’ébauche abandonnée ne ressemblait pas du tout. Cezanne s’excusa de n’être au courant de rien, vivant avec les souvenirs de sa jeunesse, passée aux côtés de Zola. Il commenta avec une exubérante gaîté, une lithographie de Daumier épinglée au mur ; il se tapait les cuisses, riait aux larmes, comme s’il voyait cette image pour la première fois. Il ouvrit un affreux album acheté jadis à Paris dans un kiosque des boulevards, Le Nu au Musée du Louvre, une quinzaine de reproductions hideusement infidèles. Il fallait une imagination peu ordinaire pour retrouver la moindre trace des chefs-d’œuvre aimés, dans ces horreurs grossièrement enluminées. Cezanne s’extasiait, gesticulait, devenait lyrique, manifestement ravi de rompre le silence auquel l’obligeait sa solitude.
Je l’écoutais respectueusement, tout disposé à tenir pour définitives et immortelles les paroles que j’avais le rare privilège d’entendre. Si subjugués que nous fussions, Camoin et moi, nous dûmes convenir, dans le tramway qui nous ramenait à Marseille, que la plus évidente vertu des propos de Cezanne, n’était pas la cohérence. Après nous avoir confié avec un sourire gentiment malicieux : « L’impressionnisme, il n’en faut plus, c’est de la blague », il entreprit de celui qu’il appelait « le grand Pissarro », un éloge dithyrambique, non pas parce qu’il se serait écarté de l’impressionnisme, mais tout au contraire parce qu’il en était à son avis, le véritable maître. À Claude Monet, il reprochait surtout d’avoir essayé de jeter sa fille dans les bras de son fils, à lui, Cezanne. Ce soupçon que, je crois, rien n’a jamais justifié était, parait-il, une de ses obsessions. Sa méfiance avait un caractère un peu morbide. Devant ses Baigneuses, il nous expliqua qu’en raison de la surveillance occulte dont, catholique pratiquant, il était cependant l’objet de la part des Jésuites, il avait depuis longtemps renoncé à faire déshabiller un modèle dans son atelier. « D’ailleurs, ajouta-t-il en se frappant le front, la peinture… c’est là dedans ! ». Je fus assez surpris de l’entendre dire qu’une de ses préoccupations les plus constantes, avait été de rendre sensible la distance réelle entre l’œil et l’objet. Cela ne nous parut pas très compatible avec l’affirmation — réitérée devant nous — qu’il avait toujours essayé de vivifier le Poussin devant la nature. Il nous confia avoir cent fois véhiculé devant le même motif tout un encombrant matériel et la toile, que, découragé, il lui arrivait d’abandonner au pied d’un arbre ; nous ne pouvions oublier que, d’autre part, il lui était arrivé de passer des semaines et des semaines à copier telle niaise vignette du Magasin Pittoresque. Les voies du génie sont-elles donc impénétrables ? Sans doute Cezanne ne fut-il jamais absolument conscient du moment où, soucieux d’objectivité, il entrait cependant en plein arbitraire, ni peut-être même du combat que se livraient en lui le naturaliste et l’imaginatif ; mais assurément il fut un de ceux qui cherchèrent avec la plus pathétique angoisse, cet équilibre entre l’instinct et la raison que c’est le propre du génie de réaliser.
[…] « Je veux dire, précise Cezanne, que dans une orange, une pomme, une boule, une tête, il y a un point culminant, et ce point est toujours — malgré le terrible effet : lumière-ombre, sensations colorantes — le plus rapproché de notre œil, les bords des objets fuient vers un centre placé à notre horizon ». Cette démonstration, Cezanne la résuma, je crois, beaucoup plus clairement lorsque, prié de me dire quelle étude il conseillait à un jeune peintre, il me répondit sans hésiter : « Copier le tuyau de son poêle ». Il considérait comme essentiel de bien observer la modulation grâce à quoi la réalité de la forme peut être exprimée par la reconstitution de ce jeu : point lumineux, dégradé, demi-teinte, ombre, reflet. Le tuyau du poêle n’était pas, pour Cezanne, le cylindre du géomètre, mais un objet cylindrique en tôle, sorti des mains du ferblantier. »
Jourdain Francis, « Cézanne, sa solitude et son tourment », La Pensée, revue du rationalisme moderne, arts, sciences, philosophie, n° 70, novembre-décembre 1956, p. 43-50, p. 43, 48 :
« Lorsque, en 1905, je lui suis présenté à Aix par mon ami le peintre Charles Camoin, il me dit —. très naturellement, sans hargne ni ressentiment — qu’il est sous la surveillance constante des Jésuites, que ceux-ci l’épient à travers les vitres de l’atelier où il lui est par conséquent impossible de faire poser un modèle nu. […]
Comme je demandais à Cezanne quel genre d’études il conseillait à un jeune peintre : « Copier le tuyau de son poêle », me répondit-il. Il tenait pour essentiel de bien savoir comment la lumière joue sur une forme, comment cette forme peut être exprimée par la reconstitution de ce jeu : point lumineux, dégradé, demi-teinte, ombre, reflet. Le tuyau de poêle n’était pas, pour Cezanne, le cylindre du mathématicien (c’est-à-dire une vue de l’esprit), mais un objet en tôle sorti des mains du ferblantier. »
10 décembre
Dans un article de la Revue bleue, Raymond Bouyer admire le style du livre Obermann, d’Étienne Pivert de Senacour, publié cent ans auparavant, pour mieux critiquer celui de Cézanne.
Bouyer Raymond, « Le centenaire oublié d’Obermann », Revue bleue, revue politique et littéraire, 5e série, tome II, n° 24, 10 décembre 1904, p. 765-768, Cézanne p. 768 :
« Voilà, certes, un rare paysagiste ! En face de la nature, il aurait pu dire, comme Jean-Jacques aux pieds de Mme d’Houdetot : « Je fus sublime. » Vous sentez, lecteurs de 1904, par où son âme automnale se rapprocherait de la nôtre et de notre effort, pour résumer largement, après tant de détails oiseux ! Faut-il encore le proposer en exemple ? Le lyrisme, le sien, ne se commande point ; mais faisons lire sa prose à nos décadents assez fous pour traiter en demi dieu l’infirme ou l’informe Cézanne. Si l’âme supérieure crée son art comme la fonction crée l’organe, la forme importe, à son tour : l’âme inspirée ne peut rien sans elle ; c’est le style qui sauve l’idée périssable et qui fait resplendir le sentiment éternel. La nature l’emporte en coloris sur les peintures les plus vives ; mais une ligne d’Obermann — ou de Poussin révèle comment l’art peut surpasser la nature. »
11 décembre
Cézanne se dit prêt à recevoir la visite de Gaston Bernheim-Jeune, qui, cette fois, s’est adressé à lui en tant qu’artiste, dont le pseudonyme est Gaston Bernheim de Villers, et non en tant que marchand.
« Aix, 11 Xbre, 1904.
Cher Monsieur,
Ma réponse est tardive Je suis très touché des marques d’attention et des termes élogieux de votre lettre
Je ne demande pas mieux que de répondre favorablement à votre désir, si tout cela doit se borner pour moi à vous faire l’exposition de mes toiles et théories d’art et de vous expliquer le but constant que j’ai cherché à atteindre toute ma vie
Veuillez agréer cher Monsieur l’expression de ma sympathie d’artiste
P Cezanne
a Aix 11 X 1904 »Lettre de Cézanne à Gaston Bernheim-Jeune, datée « 11 Xbre 1904 » et « Aix 11 X 1904 » ; coll. privée, Paris, musée des Lettres et Manuscrits.
Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cézanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 66.
Une autre version de cette lettre existe, légèrement différente, dont l’enveloppe oblitérée est conservée :
« Aix, 11 Xbre, 1904.
Cher Monsieur,
Ma réponse est tardive, l’état précaire de ma santé est sans doute une excuse, qui vous semblera suffisante. ―
Je suis très touché des marques d’estime et des termes élogieux de votre lettre. ―
Je ne demande pas mieux que de répondre favorablement à votre désir, si tout cela doit se borner pour moi à vous faire l’exposition de mes théories d’art et de vous expliquer le but constant que j’ai cherché à atteindre toute ma vie.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression de ma sympathie d’artiste.
P Cezanne ».Sur l’enveloppe :
« Monsieur
Gaston Bernheim,
1, rue Scribe,
Paris »Lettre de Cézanne à G. Bernheim-Jeune, datée « Aix, 11 Xbre, 1904 » ; Cézanne, textes d’Octave Mirbeau, Th. Duret, Léon Werth et Frantz Jourdain, Paris, Bernheim-Jeune éditeurs, 1914, 75 pages, 59 planches, lettre reproduite entre planches 9 et 10.
Bernheim de Villers Gaston, Un ami de Cézanne, Éditions Bernheim-Jeune, Paris, 1954, 38 pages, lettre reproduite p. 20-21.
Dauberville Henry, La Bataille de l’impressionnisme, suivi de Dauberville Jean, En encadrant le siècle, Paris, J. et H. Bernheim-Jeune, 1967, 598 pages, p. 227-241.
Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, lettre et enveloppe reproduites p. 237-239.
15 décembre
Cézanne est cité dans un article d’Adolf Hölzel, qui reproduit l’un de ses paysages, FWN100-R310, « Ùber Künstlerische Ausdrucksmittel und deren Verhältnis zu Natur und Bild » (« Les moyens d’expression artistiques et leurs relations avec la nature et l’image »).
Hölzel Adolfi, « Über künstlerische Ausdrucksmittel und deren Verhältnis zu Natur und Bild », Die Kunst, cahier 6, 15 décembre 1904, p. 121-142, R 310 reproduit p. 136.
16 décembre
Leo Stein et sa sœur Gertrude achètent à Vollard un grand portrait de Cézanne, Madame Cézanne à l’éventail (FWN447-R606), pour un prix élevé de 8 000 francs. Vollard l’avait prêté à la rétrospective du Salon d’automne.
Stein Gertrude, The Autobiography of Alice B. Stoklas, New York, Harcourt, Brace & Company, 1933, 311 pages, réédition, New York, Vintage House, 1961, 252 pages, p. 33-34. Stein Gertrude, Autobiographie d’Alice Toklas, Paris, Gallimard, collection « L’imaginaire », 1980, 264 pages, p. 40-41.
« Before the winter was over, having gone so far Gertrude Stein and her brother decided to go further, they decided to buy a big Cezanne and then they would stop. After that they would be reasonable. They convinced their elder brother that this last outlay was necessary, and it was necessary as will soon be evident. They told Vollard that they wanted to buy a Cezanne portrait. In those days practically no big Cezanne portraits had been sold. Vollard owned almost all of them. He was enormously pleased with this decision. They now were introduced into the room above the steps behind the partition where Gertrude Stein had been sure the old charwoman painted the Cezannes and there they spent days deciding which portrait they would have. There were about eight to choose from and the decision was difficult. They had often to go and refresh themselves with honey cakes at Fouquet’s. Finally they narrowed the choice down to two, a portrait of a man and a portrait of a woman, but this time they could not afford to buy twos and finally they chose the portrait of the woman.
Vollard said of course ordinarily a portrait of a woman always is more expensive than a portrait of a man but, said he looking at the picture very carefully, I suppose with Cezanne it does not make any difference. They put it in a cab and they went home with it. It was this picture that Alfy Maurer used to explain was finished and that you could tell that it was finished because it had a frame.
It was an important purchase because in looking and looking at this picture Gertrude Stein wrote Three Lives.
She had begun not long before as an exercise in literature to translate Flaubert’s Trois Contes and then she had this Cezanne and she looked at it and under its stimulus she wrote Three Lives. »
Traduction :
« Avant la fin de l’hiver Gertrude Stein et son frère, emportés par leur bel élan, décidèrent d’aller jusqu’au bout. Ils décidèrent d’acheter un grand Cezanne. Ensuite ce serait fini. Ensuite ils seraient raisonnables. Ils convainquirent leur frère aîné que cette dernière extravagance était nécessaire, et cela était nécessaire en effet, comme on le verra bientôt clairement. Ils dirent à Vollard qu’ils voulaient acheter un portrait par Cezanne. À cette époque pratiquement aucun grand portrait de Cezanne n’avait été vendu. Vollard les possédait presque tous. Il fut tout à fait ravi de cette décision. Et il les fit pénétrer dans la pièce du premier, celle où l’on montait par l’escalier dérobé, et où Gertrude Stein avait affirmé que les vieilles femmes de charge se réunissaient pour peindre des Cezanne. Là ils passèrent des jours à discuter et à choisir le portrait de Cezanne qu’ils achèteraient. Il y en avait une huitaine environ parmi lesquels on pouvait choisir, et le choix était difficile. Il leur fallait souvent sortir et se réconforter chez Fouquet en mangeant des gâteaux au miel. Enfin ils n’hésitaient plus qu’entre deux toiles, un portrait d’homme et un portrait de femme, mais cette fois ils ne pouvaient point s’offrir le luxe d’acheter les deux et enfin ils choisirent le portrait de femme [Madame Cezanne à l’éventail (FWN447-R606]. Vollard disait : « Bien entendu, d’ordinaire, un portrait de femme coûte toujours plus cher qu’un portrait d’homme, mais, ajoutait-il en considérant la toile avec beaucoup d’attention, je suppose qu’avec Cezanne ça n’a pas d’importance ». Ils le chargèrent dans une voiture et ils l’emportèrent chez eux. C’est ce tableau qui faisait dire à Alfy Maurer que l’on pouvait affirmer qu’il était fini, entièrement fini, parce qu’il avait un cadre.
Cet achat eut de l’importance, parce que Gertrude Stein ne cessa de regarder le tableau tandis qu’elle écrivait Three Lives (Trois Vies).
Elle avait commencé peu de temps auparavant, comme un exercice de littérature, une traduction des Trois Contes de Flaubert. Puis elle avait acheté le Cezanne et elle s’était mise à le regarder, et, stimulée par cette contemplation, elle avait écrit Three Lives. »
Stein Leo, Appreciation : Painting, Poetry and Prose, New York, Crown Publishers, 1947, 215 pages, p. 195 :
« One day at the Autumn Salon I had picked out some pictures to buy—a Bonnard, a Vuillard and something else—but when I came to the office it was closed. So I went to lunch, intending to finish the affair later. But while eating, I got an idea that was thrilling : to buy a big Cezanne figure, instead of a lot of little pictures. Vollard was enthusiastic, and wanted us to have the largest possible range of choice. He would say, « Wait, I can get some other ones to show you, » and so for several weeks we toddled over to the Rue Lafitte again and again. It was difficult to make a choice, because all these pictures are fragmentary and unfinished, and each has in it good and bad. One had to compromise, unless one was rich enough to buy half a dozen of them and have the pictures supplement each other. »
Traduction :
« Un jour, au Salon d’Automne, j’ai choisi quelques tableaux à acheter ― un Bonnard, un Vuillard et une autre chose ― mais, quand je suis arrivé au bureau, il était fermé. Je suis donc allé déjeuner avec l’intention de conclure l’affaire plus tard. Mais tout en mangeant, j’ai eu une idée qui s’est avérée fabuleuse : acheter une grande figure de Cezanne [R 606], plutôt qu’un grand nombre de petits tableaux. Vollard était enthousiaste, et voulait que nous ayons le plus large choix possible. Il disait : « Attendez, je peux en obtenir quelques autres pour vous montrer », et ainsi pendant plusieurs semaines, nous déambulâmes rue Laffitte, encore et encore. Il était difficile de faire un choix, car tous ces tableaux sont fragmentaires et inachevés, et chacun a en lui du bon et du mauvais. Il fallait faire des compromis, à moins d’être assez riche pour acheter une demi-douzaine d’entre eux pour avoir des tableaux qui se complètent mutuellement. »Matisse, Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein, catalogue d’exposition, San Francisco Museum of Modern Art, 21 mai – 6 septembre 2011, Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, Paris, 3 octobre 2011 – 16 janvier 2012, New York, The Metropolitan Museum of Art, 21 février – 3 juin 2012, Paris éditions de la RMN Grand Palais, 2011, 456 pages, p. 288.
Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 154 :
« Quand j’évoque ces temps anciens, je revois, chez les Stein, aux murs de l’appartement, des Matisse, des Picasso, et de Cézanne, un portrait de Mme Cézanne en gris dans un fauteuil rouge [R 606]. Cette toile m’avait appartenu et je l’avais prêtée à une rétrospective du Maître d’Aix organisée au Salon d’Automne de 1905 [1904, en fait]. Comme j’allais fréquemment à cette exposition, il m’arrivait d’apercevoir les Stein, les deux frères et leur sœur, assis sur une banquette en face de ce portrait. Ils le contemplaient silencieusement, jusqu’au jour où, le Salon ayant fermé, M. Léo Stein vint m’apporter le prix de la toile. Il était accompagné de Mlle Stein : « Maintenant, dit celle-ci, le tableau est à nous. » On aurait dit que le frère et la sœur venaient d’acquitter la rançon d’un être cher. »
23 décembre
Cézanne approuve Émile Bernard, qui se trouve à Naples, dans son admiration pour Tintoret, « le plus vaillant des Vénitiens ». Sa femme et son fils sont à Paris.
« Aix, 23 Xbre 1904
Mon cher Bernard,
J’ai reçu votre bonne lettre datée de Naples. Je ne m’étendrai pas avec vous en des considérations esthétiques. Oui j’approuve votre admiration pour le plus vaillant des Vénitiens, nous célébrons Tintoret. Votre besoin de trouver un point d’appui moral, intellectuel dans des œuvres qu’on ne surpassera pas assurément, vous met sur le perpétuel qui vive, sur la recherche incessante des moyens entreperçus qui vous conduiront sûrement à sentir sur nature vos moyens d’expression, et le jour où vous les tiendrez, soyez convaincu, que vous retrouverez sans effort et sur nature les moyens employés par les quatre ou cinq grands de Venise,
― Voici sans conteste possible — je suis très-affirmatif —, une sensation optique se produit dans notre organe visuel, qui nous fait classer par lumière, demi-ton ou quart de ton les plans représentés par des sensations colorantes. La lumière n’existe donc pas pour le peintre. Tant que forcément vous allez du Noir au Blanc, la première de ces abstractions étant comme un point d’appui autant pour l’œil que pour le cerveau, nous pataugeons nous n’arrivons pas à avoir notre maîtrise à nous posséder. Pendant cette période temps (je me répète un peu forcément, nous allons vers les admirables œuvres que nous ont transmises les âges, où nous trouvons un reconfort un soutien, comme le fait la planche pour le baigneur. ― Tout ce que vous me dites dans votre lettre est bien vrai. ―
Je suis heureux d’apprendre que Madame Bernard, vous et les enfants allez bien. Ma femme et mon fils sont à Paris en ce moment. Nous nous retrouverons, j’espère bientôt. ― Je souhaite répondre autant que possible aux points principaux de votre bonne lettre, et je vous prie de vouloir bien faire agréer mes souvenirs respectueux à Madame Bernard, un bon baiser à Antoine, à Irène, et vous mon cher confrère, en vous souhaitant un bon an nouveau, je vous serre cordialement la main.
P. Cezanne »Lettre de Cézanne à Bernard, datée « Aix, 23 Xbre 1904 », Londres, The Courtauld Gallery.MS.1932.SC.1.6.1 à 1.6.4
House John, « Cézanne’s Letters to Émile Bernard », catalogue d’exposition The Courtauld Cézannes ; The Courtauld Gallery, Londres, The Courtauld Gallery, 26 juin – 5 octobre 2008, Londres, The Courtauld Gallery en association avec Paul Holberton Publishing, 2008, p. 158-159, reproduit ; Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 308-309.
Le fils de Cézanne enverra une carte postale de Paris à Marthe Conil en janvier 1905 (information communiquée par Philippe Cezanne).
Décembre
Gaston Bernheim et Auguste Pellerin, en proposant d’« offrir vingt-cinq mille francs pour les ouvrières tuberculeuses, si l’État accepte de placer les Baigneurs au Louvre », sous réserve d’usufruit, remettent à l’ordre du jour la campagne pour que le reliquat du legs Caillebotte ― trente-huit tableaux, dont deux Cézanne, sur soixante-huit ― soit enfin accepté par l’État et entre au musée du Luxembourg.
Vauxcelles Louis, « L’impressionnisme au Luxembourg », Gil Blas, 5e année, n° 9187, 3 décembre 1904, p. 1 :
« L’impressionnisme au Luxembourg
Une lettre de M. Gaston Bernheim, l’expert et amateur réputé, et une offre de M. Auguste Pellerin, de qui la collection est célèbre — les plus beaux Manets sont en sa galerie ! — vient de remettre à l’ordre du jour l’éternelle question du legs Caillebotte. Vous vous rappelez les imprécations, les jurons, les anathèmes d’antan, lorsque les dispositions testamentaires de Gustave Caillebotte furent connues du public. De la critique officielle, et de l’Institut, un assourdissant concert de hurlements béotiens s’éleva. Caillebotte qui, sa vie durant, avait soutenu, protégé, défendu ses camarades impressionnistes, léguait à l’État sa collection de leurs œuvres, ainsi d’ailleurs qu’une collection d’œuvres de peintres anciens, en stipulant que les deux legs devaient être inséparables. L’État fit la grimace. Feu M. Gérôme fulmina. Un groupe d’académiciens, professeurs à l’École des Beaux-Arts, menaça le ministre de démission. « Il est indigne de nous, s’écriaient-ils, de continuer l’enseignement traditionnel d’un art, que ces iconoclastes viennent démolir. » Le ministre eut l’esprit de résister à ces injonctions. « Le devoir de l’État, répliqua-t-il, est d’accueillir impartialement les ouvrages représentant tous les mouvements d’art, et de se cantonner dans la neutralité artistique ». Les académiciens, calmés, se turent. Le legs ne fut pas refusé, parce que le conservateur du musée du Luxembourg et quelques membres du Comité consultatif des musées nationaux savaient par bonheur que nul ne pourra supprimer de l’histoire de l’art français les noms d’Édouard Manet, Degas, Claude Monet, Pissaro, Renoir, Sisley, Berthe Morissot ! Une dernière protestation se fit ouïr, écho tardif et ridicule de la fameuse pétition anonyme adressée au ministre par les membres de l’Institut. Elle émanait d’un sénateur inamovible, inamoviblement réfractaire, nommé Hervé de Saisy qui escalada la tribune du Sénat pour dire en sanglotant « que le musée du Luxembourg, jusqu’alors vierge de toute compromission (sic) serait flétri, pollué, déshonoré, par cette invasion d’œuvres d’un caractère extrêmement équivoque ». Rien n’y fit. Et la donation Caillebotte fut acceptée. Je m’excuse de rappeler ce débat que nul n’a oublié parmi ceux qui s’intéressent aux destinées de l’art français, mais il est des causes qu’on ne saurait trop plaider. Gustave Caillebotte n’ignorait pas les colères que sa généreuse offrande allait déchaîner. Aussi, prévoyant un mauvais accueil, et dans la crainte que les toiles de ses amis ne fussent roulées, reléguées en de poussiéreux premiers ou exilées en de lointaines provinces, le donateur spécifia-t-il que si le don n’était pas reçu comme il devait l’être, c’est-à-dire tout entier, il n’y avait qu’à attendre des jours meilleurs ; un codicille précisait cette disposition : « Mes héritiers devront, y était-il dit en substance, représenter plus tard à l’État ma collection, et non point la morceler. »
Finalement, on transigea. Trente-huit toiles sur soixante-huit furent prises. L’installation en est toujours défectueuse, la salle, petite et mal éclairée, a l’aspect d’un couloir, les cadres se touchent, les toiles sont mal disposées ; il est quasi impossible de les voir avec le recul que nécessite le procédé de la dissociation des tons, et la mesquinerie de l’opposition fut telle que, les toiles ayant été livrées sans cadres, le musée, dit-on, fut obligé d’en emprunter aux réserves du Louvre parce qu’on refusait les crédits nécessaires pour en acquérir. Elle ne représente pas l’école impressionniste dans tout son éclat, parce que les œuvres qui la composent avaient été achetées par Caillebotte à une époque où ses amis étaient loin d’être parvenus à l’épanouissement. de leurs qualités. Mais on y trouve le Moulin de la Galette, un des chefs-d’œuvre de Renoir, sept beaux pastels de Degas, quelques Monets de grand style ; Sisley et Pissarro n’y sont guère à leur avantage, et il est regrettable que Manet ne figure là qu’avec deux œuvres, le Balcon, étude en noir de sa première manière, et la fameuse Olympia, pauvre courtisane parisienne, au corps fluet, et singulier tableau, dont l’importance est surtout historique.
Telle est, résumée à grands traits, l’affaire du legs Caillebotte. De tous ces impressionnistes horrifiques, celui qui effarait le plus, c’était Cezanne, il faut bien le dire, et c’était lui surtout qu’on tâchait d’exclure du sanctuaire. Aussi, lorsqu’une transaction s’établit entre le ministère et les héritiers Caillebotte, ces derniers exigèrent-ils que, si l’État ne prenait pas tout, du moins, chacun des peintres de la nouvelle école fût représenté par une œuvre ; de la sorte, nul ne serait exclu du Luxembourg. Et, c’est ainsi que le musée possède deux des Cezannes — les moins importants — que l’auteur des Raboteurs de parquet comptait léguer à son pays.
Nous voici en 1904. L’impressionnisme a cause gagnée. Le Salon d’Automne a consacré la maîtrise d’Auguste Renoir. Le Déjeuner des Canotiers, la Terrasse, le portrait de Jeanne Samary sont enfin reconnus comme dignes de rejoindre, au Louvre, les plus voluptueux Bouchers et les Chardins les plus délicats. Cezanne aussi, le primitif, le barbare, est consacré par l’enthousiasme d’une jeunesse ardente, et ses défenseurs de la première heure sont enfin compris. La loyauté fruste, la construction puissante de ses paysages, la sûre audace des rapports et des valeurs, est appréciée. Dubufe et Béraud se taisent. On se répète que les plus fins amateurs de Paris et de l’étranger couvrent d’or ses toiles révolutionnaires ; le comte de Camondo possède la Maison du Pendu ; M. Bernheim, le Pont et l’extraordinaire Portrait de M. Choquet ; M. Eugène Blot, la Maison abandonnée ; Degas, Monet, Renoir, saluent Cezanne comme un chef. En outre, le Luxembourg ouvre ses portes à l’amer satiriste Henri de Toulouse-Lautrec, et s’honore en accrochant à sa cimaise cent cinquante lithographies. La direction des Beaux-Arts favorise les tendances modernistes. Le moment semble donc opportun pour reprendre la campagne d’autrefois, et puisque sur les quatre Cezannes offerts par Gustave Caillebotte, l’État en a jadis dédaigné deux, qu’il se hâte aujourd’hui de réparer ses erreurs, qu’il accepte les deux au trois Cezannes, et avec eux le reliquat de la collection. M. Pellerin a eu l’ingénieuse pensée d’offrir vingt-cinq mille francs pour les ouvrières tuberculeuses, si l’État accepte de placer les Baigneurs au Louvre, à la condition que. sa vie durant, M. Pellerin jouisse de ce tableau de Cezanne, qu’on déposerait en sa galerie. J’ai cru qu’il serait intéressant de demander au seul survivant des frères Caillebotte, possesseur actuel des tableaux refusés il y a quinze ans, et au maître Renoir, qui fut l’exécuteur testamentaire de Gustave Caillebotte, où en était la question, et ce qu’ils pensaient de l’initiative de M. Pellerin. M. Caillebotte frère que j’ai vu en son luxueux appartement de la rue Scribe, m’a paru un peu surpris du bruit mené autour de cette affaire. « Les choses s’arrangeront toutes seules, m’a-t-il assuré. M. Bénédite ne demande qu’à voir entrer en son musée les toiles qui me restent. Elles y entreront. Mais pas tout de suite, car elles ne sont pas ici, mais en Bretagne, au Pornic. » Ce sont deux ou trois Pissarros, deux ou trois Monets, la Partie de crochet, de Manet ; les Fleurs et les Baigneurs, de Cezanne. M. Caillebotte est un homme tenace et paisible. « Tout marchera ! » nous promet-il. J’en accepte l’augure. Puisque M. Caillebotte consent à se dessaisir de ces tableaux, et que M. Bénédite les attend avec impatience, ne désespérons point.
En quittant M. Caillebotte, je me suis rendu dans cette curieuse et pittoresque maison, située tout en haut de Montmartre, rue Caulaincourt, où demeure aussi Alexandre Steinlen, et où Renoir travaille, loin des vaines agitations de la Cité. L’admirable artiste est à son atelier, assis dans son fauteuil à roulette, enveloppé dans sa houppelande, fumant sa pipe en bois. Il achève une Femme couchée qui est un éblouissement. Jamais il n’a fait plus lumineux, plus fort, plus serré et plus vrai. Le modèle est là, superbe créature dont le peignoir dissimule à peine des appas jordaenesques. Renoir ne peint plus, désormais, que des femmes couchées, car il ne peut lever le bras droit en travaillant ; la paralysie ankylose son épaule ; ses doigts sont noueux et maigres ; il est vieux, débile, et malade, mais sa volonté et son amour de la peinture défient le mal physique ; Renoir souffre, mais l’oublie. Son art lui a valu durant quarante années la haine, l’envie et l’incompréhension. N’importe ! il ne vit que pour cet art, et quand ce grand vieillard, aux prunelles fixes, à la barbe blanche, s’éteindra — le plus tard possible ! — il mourra la palette à la main.
D’une voix très nette, il m’a confirmé les déclarations optimistes de M. Caillebotte. « M. Bénédite est bien disposé en faveur de ceux qu’on a nommés les impressionnistes. Le reliquat de la donation n’attend plus qu’un signe pour revenir du Pornic à la rue de Vaugirard. La vérité finit toujours par avoir raison. » Et l’illustre vieillard, souriant et mélancolique, se remit à peindre.
La Société des Amis du Luxembourg, qui compte les plus ardents défenseurs de l’école moderne, ne pourra-t-elle de son côté agir efficacement auprès des autorités ? Des hommes comme M. Édouard Delpeuch ou Ollivier Sainsère, comme M. Chéramy, comme Théodore Duret, Georges Lecomte, Eugène Blot, sont capables de réaliser les tâches les plus ardues. Ils vont, me dit-on, acheter et donner à notre musée un Lautrec. Crions-leur bravo ! et souhaitons d’ailleurs qu’ils choisissent dans l’œuvre magistrale de ce peintre une toile significative, telle par exemple, l’inoubliable Bal du Moulin-Rouge. Souhaitons aussi que ces généreux pionniers de l’art indépendant fassent triompher Cezanne au Luxembourg ― Cezanne qui n’est pas chevalier de la Légion d’honneur ! Il paraît que l’année 1906 ne s’achèvera pas sans que le musée du Luxembourg ait été transformé et agrandi. On veut lui donner deux fois et demi plus de superficie, et le surélever d’un étage, où seront abrités les objets d’art, médailles et dessins. Les salles du rez-de-chaussée seront, dès lors, réservées aux seuls arts plastiques. Fort bien. Mais, l’œuvre ne sera définitive que si l’on assainit ce musée qu’il ne suffit pas d’élargir. Qu’on balaye sans remords ces Bouguereau, ces Roybet, ces Ferrier, ces Lefebvre, ces Maignan, stériles propagateurs de la convention italianisante et des formules routinières de la rue Bonaparte. De l’air ! Ouvrez toutes grandes les portes à ceux — réalistes et idéalistes — que leurs contemporains ingrats ou aveugles auront compris trop tard, mais dont les noms seront demain la juste gloire de l’école française.
Louis Vauxcelles »
Courant de l’année
Julius Meier-Graefe publie, à Stuttgart, son livre Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst, qui contient un chapitre sur Cézanne.
Meier-Graefe Julius, « Cezanne und sein kreis », Entwickelungsgeschichte der modernen Kunst, 3 volumes, tome I « Vergleichende betrachtung der Bildenden Künste, als beitrag zu einer neuen Aesthetik », Verlag Jul. Hoffmann, Stuttgart, 1904, 400 pages, Cezanne volume 1 p. 162-175. Dans volume 3, reproduction de R 121 planche 62, R 164 planche 62, R 2745 planche 63, R 325 planche 64, R 237 planche 65.
Édition en anglais Meier-Graefe Julius, Modern Art, Being a Contribution to a New System of Aesthetics, 2 volumes, (traduction Florence Simmonds et George W. Chrystal), Londres, William Heinemann, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1908, volume I 326 pages, volume II 325 pages, Cezanne volume I p. 266-276.« CEZANNE UND SEIN KREIS
PAUL CEZANNE
Cezanne war in dem Kreise der Ecole de Batignolles, der sich um Manet gebildet hat, der Revolutionär. Wohlverstanden gilt hier als wesentlichstes Prinzip dieser Leute nicht ihre Koloristik — diese war bei allen verschieden — sondern ihre Flachmalerei. Darin übertraf Cezanne sogar den Führer. Es muß angenommen werden, daß in allen Werdezeiten die Sache, um die sich die Anstrengung dreht, gleichzeitig individuell emporgärt, und der Führer wird der, der die beste Stimme hat. Cezanne eignete sich dazu gar nicht. Er war eine ganz verschlossene Natur ; von der jungen Generation hat ihn nie jemand gesehen ; die Künstler, die ihm alles verdanken, haben nie ein Wort mit ihm gewechselt. Zuweilen zweifelt man, ob er überhaupt gelebt hat. Seitdem er bei dem Dr. Gachet war, hat er, soviel ich weiß, kaum je wieder den Süden Frankreichs verlassen. Er soll in Aix wohnen. Gachet schildert ihn als den vollkommenen Gegensatz von van Gogh, ohne jede Fähigkeit über seine Absichten zu sprechen, ganz unbewujßt, ein Bündel von Instinkten, das er ängstlich vermied, zu zerteilen.
Die Konsequenz war bei ihm also eine reine Sinnensache, er gab das was er konnte und wollte. Nicht ein Atom mehr ; in äujßerlichen Dingen nicht mal das. Es hat zuweilen nicht zu der Deckung geringfügiger weißer Stellen gelangt, die heute die Verzweiflung der ehrlichen Besitzer machen ; — die anderen malen sie zu. Aber dieses Äußerliche ist nicht mehr oder weniger als das ausgefranste Eckchen an einer schönen alten Tapisserie. Zuweilen ist auch die ganze Tapisserie um die letzte Deckschicht gekommen. Und auch das läßt man sich gefallen, weil das Gewebe immer wunderbar ist, auch wo es nur ein paar Fäden zeigt
Cezannes Wesen war geeignet, unbekannt zu bleiben. Es fiel ihm wie Guys und van Gogh nicht ein, seine Bilder zu signieren, er gab kein Lebenszeichen von sich, nur Bilder, und die mußte man ihm entreißen. Es ist daher kein Wunder, daß er ein alter Mann wurde, bevor einem winzigen Teil seiner Landsleute einfiel, ihn zu beachten. Seit ein paar Jahren erst fängt er an, auf den Kunstmarkt zu zählen. Er verdankt es wie van Gogh dem kleinen Laden von Vollard in der Rue Laffitte, einem der merkwürdigen Händler, wie sie nur Paris hervorbringt, die zuweilen kunstbeflissener, d. h. mit sichereren Instinkten begabt sind als die Kunstbeflissenen. Der große Schlager war für ihn die Vente seines Freundes Choquet im Sommer 1899 bei Petit. An drei heißen Nachmittagen, mitten in der toten Saison, wo sonst keine Katze in Paris ist, riß man sich um seine besten Sachen, die ein gestern noch als verrückt verschriener Wunderling gesammelt hatte.
Wenn diese Begeisterung nicht lediglich ein zur Überhitze gesteigerter Snobismus war, so ist sie bemerkenswert. Denn wenn man von Gogh absieht, hat niemand in der modernen Kunst an die Geschmeidigkeit des ästhetischen Aufnahmevermögens stärkere Zumutungen gestellt als Cezanne. Will man ihn analysieren, so finden sich Delacroix und Daumier, und die Holländer. Zuweilen glaubt man, daß er den alten Am. Gautier, den Freund Murgers gekannt hat, der die prachtvollen Stilleben machte. Aber neben alledem überrascht etwas ganz anderes, das rätselhaft bleibt, ja von weitem zuweilen als purer Wahnsinn erscheint. Es ist eine Vergrößerung, ohne daß man recht weiß, was vergrößert wird. Jede Kunst ist Übertreibung in irgend einem Sinne ; hier frappiert, daß sich der Sinn versteckt. Wenn ich einen schönen schwarzen Katzenbuckel sehe, so habe ich manchmal eine sehr angenehme Empfindung. Was ist sie ? Nicht lediglich Fartbe, denn es fehlt dem Fell der Kontrast ; es ist ein Tastgefühl in Verbindung mit der Freude an der, durch die einzelnen kaum wahrnehmbaren Härchen vertieften, Schwärze. Es trifft sich zufällig, daß die Katze in einem Zimmer oder vor einer merkwürdig fahlen Mauer steht. Außerdem leuchten ihre Augen dazwischen, ohne daß ich sie sehe, und die schlanken Beine bewegen sich, ohne daß meine Augen darauf achten. Alles das gibt das Schwarz des Katzenfells.
Aber wie ist so etwas im Bilde möglich ? Das latente Tastbedürfnis scheidet aus, das bei Katzenliebhabem keine geringe Rolle spielt und trotzdem habe ich hier ein noch stärkeres Lustgefühl. Die Bewegung scheidet aus, es handelt sich um ein blödes Stilleben, Stilleben haben keine Beine ; trotzdem fühle ich förmlich, wie etwas in meiner Pupille lebhaft zuckt, wie angesteckt von einer in einer höheren Dimension stattfindenden Bewegung. Es fehlt auch die merkwürdige, zufällige Wandwirkung des Zimmers, die der Katze zugute kam, weil sie dem Schwarz eine Menge kleiner Gegensätze gab ; hier ist es eine große, platte Fläche, die gleich in den Rahmen läuft, und trotzdem findet sich in dem Bild, in den drei oder vier Farben eine Fülle unendlich gesteigerter Gegensätze. Mit der Farbentheorie der Modernen ist hier gar nichts zu machen. Bei den Bemheims hängen Dinge, die genau das Gegenteil beweisen ; schwarze Bilder : auf einem Brett steht auf grauem Grund eine grüne Kaffeekanne und ein grüner Topf. Die Schatten sind pechschwarz und zwar nicht aus Versehen, sondern wie riesige Lappen, die den Hauptwert bilden. Herr Hessel hat eine Wand von 6 Cezannes, sie ist eins der sieben Weltwunder — wo die heterogensten Gegenstände Gobelinwirkungen zusammen geben. Man hat das Gefühl, daß die Rahmen gar nicht zu sein brauchten, daß man die Bilder aneinandemähen könnte, dass man alles mit ihnen machen könnte, was man mit einem Stück Tuch machen kann, ohne den eigentlichen, den wesentlichsten Wert zu zerstören. Man könnte Cezannes Koloristik mit einer Art Kaleidoskop vergleichen, in dem das Gesehene zusammengeschüttelt wird ; und er schüttelt so, daß Mosaikbilder daraus werden von ungeheuerlich kräftigen Farbenkontrasten. Die Zusammenhänge scheinen fast versehentlich zu entstehen, und trotzdem gehört das Ganze auf fast unheimliche Art zusammen. Seine Harmonien sind so stark, daß man versucht ist, zu glauben, es wäre der Farbe, lediglich der Farbe eine ähnliche starke überzeugende Macht gegeben wie der rhythmischen Linie. Er bedient sich zuweilen einer Komposition, die mit wahrer Wollust das Banale sucht ; der Zufall kann unmöglich ungeschickter so ein paar Äpfel und Birnen auf einen Tisch rollen lassen wie er sie hinlegt ; es ist nicht das Atom von Absicht dabei zu spüren. Seine Stilleben sind sich zum Verwechseln ähnlich. Wie oft hat er die lächerlich zusammengedrückte Serviette mit dem Teller, dem Topf und den Früchten gemacht. Und es ist mir noch jedesmal, nachdem ich solche Cezannesche Stilleben gesehen hatte, gewesen, als wäre mir ein halbes Dutzend unerhört primitiver Skulpturen oder dergleichen begegnet. Primitiv wirkt er, ohne sich auch nur im geringsten darum zu bemühen ; primitiv in der Wirkung, d. h. in dem eiskalten Größegefühl, das wir an gelungenen uralten Dingen geniegen, stilistisch ohne die Hilfe der Linie, nur durch dieses fabelhafte Farbenmosaik, das — es scheint fast Unsinn, es auszusprechen — nur die genaueste Sachlichkeit ausdrückt. Das ist das allermerkwürdigste daran : dieses Mosaik gibt im Eindruck haarscharfe Naturähnlichkeit. So ein Cezannescher Apfel ist gekonnt wie ein Kostüm bei Velasquez, mit der gewissen Selbstverständlichkeit, an der nicht zu rütteln ist. Er hat nichts weniger als das Auftreten des Revolutionärs, wenn man nicht etwa seine Akte im Freien heranzieht, in denen Daumier erscheint. Er ist weit stiller als später van Gogh war ; die Art seiner Farbenauftragung gibt sich manieriicher, er malt dünn im Vergleich zu den Farbenstrichen des anderen. Er ist ebenso weit entfernt von der Teilungsmanier der Neoimpressionisten, eher wirkt er holländisch ; man könnte ihn manchmal für einen indirekten Nachfolger van der Meers halten. Er malt das Leben wie jener seine Teppiche. Nur ist die Melodie, zu der die Holländer vielstimmige, komplizierte Akkorde brauchen, bei ihm auf reinere, stärkere Einzeltöne gebracht. Und dann denkt er, wie gesagt, nicht im allergeringsten an gefälligen Vortrag. Seine Akte sehen aus wie zerhackte Fleischklumpen. Alle Anatomie scheint in ihnen mit Füßen getreten, es ist nur Fleisch, dick und ungeschlacht, und trotzdem lebt es, nur daß man nie daran denkt, es mit den Händen zu greifen ; man möchte es mit den Augen aufsaugen. In seinen Regenlandschaften scheint die ganze Natur wegzuschwimmen, und trotzdem ist nichts von den realistischen Witzen darin, mit denen wohlbestallte Landschafter den Regen so naß wie möglich machen. Er hat nie einen Sonnenreflex gemalt, und doch steckt in seinen Bildern ein Licht, das einer nicht ganz gleich gewaffneten Nachbarschaft gefährlich werden kann. Er gehört der Generation Manets an und ist das Evangelium der Jüngsten. Sie nennen ihn den Weisen. Der Altar, an dem er selbst betet, ist Delacroix. Es genügt, seine Kopien nach dem Meister der Medea zu sehen. Er löst das, was man in Delacroix ahnt ; er malt aus ihm, was einst dieser, als er Rubens kopierte, aus dem großen Vlaamen herausmalte und was Rubens fand, als er die Italiener kopierte. Wie der eine den anderen wiedergegeben hat, ist eine Geschichte des Malerischen unserer neuen Kunst.
Cezanne ist ein Jahr jünger als Zola, also aus 1839. Zola besaß noch frühe Bilder aus der ersten Hälfte der Sechziger Jahre, da der Freund noch unter dem unmittelbaren Einfluß Delacroix’ Romantiker war. Vollard kaufte auf der Vente Zola das große prachtvolle „Enlèvement” aus dem Jahre 65, eine romantische Episode, freilich steckte die Episode mehr in dem kühnen Aufriß als im Gegenstand. Die ersten Anfänge Cezannes können 1858 nachgewiesen werden. Aus diesem Jahr stammt der „Esel” bei Vollard, eine kleine Grisaille, die von den Brüdern Le Nain des 17. Jahrhunderts gemacht sein könnte, und eine Anzahl vager holländischer Szenen, die der Künstler nach Kleinmeistern in Marseiller Galerien kopiert haben mag. Schon 59, in dem flotten Bildchen „Femme au perroquet” (in demselben Besitz) ahnt man Cezanne. Eine Frau am geöffneten Fenster hält auf der Hand einen Papagei. Die derbe Art läßt an einen verlaufenen Schüler von Franz Hals denken, nur hätte er nie die ganz freie Behandlung des Laubwerks gefunden, das den einen Teil des Fensters bedeck. Eine Menge kleiner Landschaften, oft auf Holz gemalt, gehören in diese Zeit oder ein wenig spatter ; es sind Palettenproben, die man auf Cezanne erkennt, auch wenn man nie so frühe Sachen von ihm gesehen hat ; der Pinsel hat schon die eigentümliche Wucht in der Touche, auch wenn er noch nichts Konkretes bildet.
Der große Cezanne entstand, als er noch in den Sechziger Jahren, unter dem ganz äußerlichen Einfluß Courbets — ebenso äußerlich etwa wie bei unserem Leibl, aber unentbehrlich — die prachtvollen, schwarzen Porträts und Stilleben malte, von denen ich eins beschrieben habe. Dann kam die Zeit von Auvers um das Jahr 70. Mit Pissarro und Vignon malte er in der Lieblingsgegend Daubignys die schönen Landschaften, die kräftigsten, breitesten der Siebziger Jahre. Sie ähneln den gleichzeitigen Pissarros, die man vielleicht einmal über alle späteren Werke des Künstlers stellen wird, so reich im Ton, so voll tiefer Farbenschwärmerei sind sie. Die von Cezanne haben mehr Männlichkeit, strengere Disposition, größere Kühnheit in den Maßen. Ein gesunder Posten Courbet blieb ihm alle Zeit erhalten. Das Derbe im Aufbau, das in seinen besten Gemälden wie Champagner prickelt, verlor er nie. Er folgte Pissarro in der Entwicklung zum Hellen, die Monet lehrte. Cezanne hat sich scheinbar nie so recht wie die anderen Impressionisten um eine Erneuerung der Technik gekümmert. Ohne Pissarro hätte er vermutlich immer ruhig sein Schwarz weiter gemalt und wäre dabei auch kaum weniger bedeutend geworden. Er blies wie Manet in jede Technik seinen höchst eigenen Odem hinein und machte sie dadurch bedeutend. Dafür behielt er das Ureigene, das sich bei Monet und Pissarro in technischen Wandlungen erschöpft. Auch Monet ist nie wieder so stark gewesen wie in den Siebziger Jahren. Man kann ihm die enorme Raffinierung des Mittels nie genug danken, aber sie kostete ihm etwas von seiner Kraft. Cezanne soll zuweilen ganz unvermittelt glänzende Dinge über Monet gesagt haben, die seine tiefe Überzeugung von den Vorteilen des neuen Metiers bewiesen ; er war jedenfalls darin kein Neuerer, sondern folgte gelassen, um dann in seiner Art sein wunderbares Auge mit noch weit höherer.
Meisterschaft als die anderen auszunützen. In einer Übergangszeit, die an Reizen reich ist, malt er die merkwürdigen Luftbilder, Skizzen, in denen nur eins ganz vollendet ist, die Atmosphäre. Das Bild bei dem Grafen Kessler, eines der vorzüglichsten, dürfte aus der ersten Hälfte der Achtziger Jahre stammen, der reichsten Produktionsepoche des Malers. Die Palette ist im Vergleich zu den früheren Landschaften viel reiner ; sie ist ganz dünn verwandt, das Weiß-Grau der Leinwand schimmert überall durch, namentlich auf dem ersten Plan, wo ein ganz dünnes Grün den Boden fast aquarellmäßig flüchtig deckt. Wo die Bäume wachsen, zieht sich ein heller Weg, der sich darauf beschränkt, den Ton der Leinwand reicher mit hellem Gelb, Grau und Spuren von Blau zu gestalten ; dann kommt wieder ein grünes Feld, von stärker grünen Tupfen eingesäumt, im übrigen genau im selben Ton wie der erste Plan. Es wird von dem dahinterliegenden Feld durch die relativ reichste Skala des niedrigen grünen Buschwerks getrennt. Dieser Reichtum ermöglicht das deutlich prononzierte Orange des Feldes, das sich wiederum nach hinten in hellere Töne verliert. Die Fassade des Häuschens ist von dem Ton des Weges vorne an den Bäumen, nur ein wenig deutlicher mit gelb versetzt, das Dach von dem Ziegelorange der Felder. In dem großen Himmel herrscht ein ganz leichtes Blau vor, es kämpft immer mit dem Ton des Grundes, der, wo die Bäume ihre grünen Wipfel bilden, deutlich hervorkommt.
Dieses Durchsichtige des Grundes durch die verschiedenen Farben, das Gemeinsame dieser Verschiedenheit und der wellige Aufbau der koloristisch gleichwertigen Pläne gibt die Luft, die man bei diesen Cezannes fast zu atmen scheint.
Von hier führt ein Schritt zu den Bildern von 86, die das, was vorher noch Skizze war, in greifbar meisterhafte Vollendung bringen.
Man wird die Provence nie sehen, ohne an Cezanne zu denken ; er malt sie mit einem wahren Fanatismus, der eine eigene Malerei erfindet, um das Eigene, das nur ihr gehört, zu treffen. Haarscharf steht sie vor uns, man glaubt Hunderte von Details auf den Bildern wiederzufinden. Tatsächlich ist es wiederum nur Farbe und Luft und eine Struktur der kleinen Pinselstriche, die das merkwürdige Land in einer noch merkwürdigeren Übertragung rekonstruiert. Er ist auch hier noch Pissarro gewissermaßen ähnlich ; in demselben Grade wie vorher, der bei so verschiedenen Temperamenten immer nur sehr beschränkt sein kann. Wie Manet bereicherte sich Cezanne immer mehr, er gab nie die früheren Errungenschaften auf, ja er hat selbst hier noch etwas von Delacroix. Natürlich mußte die großzügige Romantik, die in den kolossalen schwarzen Stilleben noch Platz hatte, jetzt einer geläuterten Ordnung weichen ; aber das Wesentliche an Delacroix, die fabelhafte Lebendigkeit der Touche, seine Baukunst mit der Farbe erhielt sich. Pissarro wurde zu derselben Zeit uniform in der Touche, er näherte sich seiner neo-impressionistischen Periode ; bei Cezanne spottet die Mannigfaltigkeit, wie er seine kleinen Pinselstriche setzt, aller Systeme und bleibt doch im höchsten Sinne systematisch. Der Instinkt, der ihn immer geleitet, gab ihm auch hier die unendliche Fülle, und mit einer Art physischen Instinktes genießt man die Bilder. Cezanne malt die Wärme seiner Heimat, man wird warm bei diesen Landschaften ; er schildert die ausgebrannte rote Erde, unter der man das harte Gestein wittert, das eine Jahrhunderte lang aufgespeicherte Glut ausstrahlt. Herrlich erfrischt die prunkende Vegetation neben diesem Sonnenbrand, das Grün, das überall wie kühles Gewässer den Boden tränkt. Ganz tief sinkt der ewige Himmel darauf hinab, in allen Tönen des reinsten Saphirs. Die Erde ist nur eine winzige Unterbrechung dieser ewigen Bläue.
In diesen Gemälden, die im ersten Augenblick im Vergleich zu den dramatisch bewegten früheren Werken anspruchslos erscheinen mögen, in diesem Zusammensickern der Farben zu einem ganz natürlichen Bilde, in der Reinheit der Palette, die sich auf Rot, Orange, Blau und Grün beschränkt, und jede Nuance mit größtem Reichtum ausdrückt, in dem ganz Harmonischen eines ganz natürlichen Geschmacks feiert die Kunst Cezannes unsterbliche Triumphe. Hier lernte van Gogh das Herausfließen des Rots aus dem Orange, die tiefe Physis koloristischer Wunder. Duret besitzt neben einem herrlichen kleinen Cezanne dieser Zeit „les terres rouges” zwei der merkwürdigsten van Goghs, die als unmittelbare Fortsetzung des Meisters gelten können : Schwefelgelbe Häuser mit tiefblauen Dächern und hellblauem Rauch, um die Wälder von purpurroten Bäumen flammen. Es sind aus Gelb und Blau und namentlich Rot gewirkte Teppiche, diesmal ausnahmsweise ganz flach gemalt, ganz ornamental mit gleichmäßig roten Konturen umrändert, die die kostbaren Purpurtöne in leuchtendes Feuer fassen.
Auch van Gogh war eine so ehrliche Natur wie Cezanne ; ebenso von innen heraus schaffend, daß man nach der ersten Überraschung der Natur nachgeht und von Realismus reden könnte. Halluzinationen über der brennenden Erde Cezannes, wie sie dort vorkommen mögen, wenn geniale Augen hinkommen, van Gogh war sich sicher nicht bewußt, daß er aus großen Vorgängern grosse Dekorationsformeln ableitete. Wer wird je den Reichtum fassen, den sie Bergen ! »
(Transcrire = traduction à revoir) :
« Cezanne et son cercle
Paul Cezanne
Cezanne était l’esprit le plus audacieux du cercle de l’École des Batignolles réuni autour de Manet, le révolutionnaire. Le principe le plus essentiel commun à toutes ces personnes n’était pas la couleur — différente selon chacun — mais la peinture à plat. En cela, Cezanne a même dépassé le chef du groupe. Il faut considérer qu’en ces temps d’évolution où les efforts de chacun tendent dans la même direction qui fermente dans les esprits, le chef de file est celui qui sera le plus éloquent. Pour ce poste, Cezanne n’était nullement le plus approprié. Il était de nature très réservée, ne voyant personne de la jeune génération ; des artistes qui lui doivent tout n’ont jamais échangé un seul mot avec lui. Son existence même a parfois été mise en doute. Depuis son séjour près du Dr Gachet, il n’a jamais, autant que je sache, quitté le sud de la France. Il vit, ai-je entendu dire, à Aix. Gachet le décrit comme l’antithèse exacte de Van Gogh, totalement incapable de formuler son but, absolument inconscient, un faisceau d’instincts, qu’il était soucieux de ne pas dissiper.
Le résultat fut donc pour lui une forme purement sensuelle de l’art. Il a donné ce qu’il pouvait et ce qu’il voulait, pas une once de plus, et dans des choses exterieures même pas tant que cela. Parfois, il ne s’est même pas donné la peine de recouvrir certaines petites taches blanches sur ses tableaux, et ce au désespoir d’honnêtes propriétaires actuels — alors que d’autres les recouvrent. Mais ce défaut superficiel n’est rien de plus ou de moins que le coin effiloché d’une belle vieille tapisserie. Parfois, toute la tapisserie se réduit à la chaîne. Et même dans ce cas, nous ne pouvons lui en faire reproche, parce que le tissu est toujours beau, même s’il ne montre que quelques fils.
Le caractère de Cezanne aurait pu le laisser dans l’ombre. Il ne lui vint pas à l’idée de signer ses tableaux, contrairement à Guys et Van Gogh, il n’a jamais donné aucun signe de vie, autrement que par ses tableaux, et encore ceux-ci ont dû lui être arrachés presque de force. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit devenu un vieil homme avant qu’une infime partie de ses compatriotes pensent à le remarquer. Ce n’est que depuis quelques années qu’il a commencé à compter au moins dans le marché de l’art. Comme Van Gogh, il doit cette reconnaissance à la petite boutique de Vollard de la rue Laffitte, un de ces marchands remarquables comme il n’en existe qu’à Paris, qui sont parfois les meilleurs connaisseurs, ou, plutôt, qui ont un instinct artistique plus sûr que les vautours de l’art. L’événement qui a établi sa réputation a été la vente de son ami Choquet chez Petit à l’été 1899. Pendant trois chaudes après-midis au cours de la morte saison, quand il n’y avait pas âme qui vive à Paris, les acheteurs se sont battus pour ses meilleures œuvres, rassemblées avec une bizarrerie qui avait été traitée de folle peu de temps auparavant.
Que cet enthousiasme ne soit pas simplement un déchaînement frénétique de snobisme est déjà assez remarquable. Parce que, mis à part Van Gogh, personne dans l’art moderne n’a connu une plus forte demande esthétique que Cezanne. À l’analyse, on trouve Courbet, Delacroix, Daumier, et les néerlandais. Parfois, on pourrait supposer qu’il a connu le vieux Am. Gautier, l’ami de Murger, qui a peint de magnifiques natures mortes. Mais, en plus de cela, on est étonné de quelque chose de différent, qui reste un mystère, et qui à distance apparaît parfois comme une pure folie. Il s’agit d’un élargissement, sans trop savoir ce qui est agrandi. Tout l’art de l’exagération dans tous les sens ; frappé ici que le sens caché. Quand je vois le dos d’un beau chat noir, donc je dois parfois une sensation très agréable. Qu’est-ce que c’est ? Fartbe non seulement parce qu’il lui manque la couche de contraste, il y a un sens du toucher dans le cadre de l’exercice de, à travers les différents poils à peine perceptibles de noirceur en retrait. Il se réunit par hasard que le chat est dans une chambre ou devant un mur étrange, pâle. En outre, leurs yeux s’illuminent entre les deux, mais je les vois, et les jambes grêles se déplacent sans mes soins oculaires. Tout cela donne le noir de la fourrure du chat.
Mais comment est-ce possible dans l’image ? Le Tastbedürfnis latente est différente de celle dans Katzenliebhabem joue un rôle non négligeable, mais j’ai un fort sentiment de plaisir. Le mouvement est exclu est un style de vie stupide, style de vie n’ont pas de jambes, mais je me sens littéralement comme quelque chose tics animés de mon élève, comme infecté par l’un prenant place dans un mouvement de dimension supérieure. Il manque aussi l’étrange effet, au hasard de la paroi de la chambre, qui a bénéficié du chat parce qu’elle a donné le beaucoup moins noir contraires, où il y a une grande surface plane qui tourne à droite dans le cadre, et trouve encore dans l’image, dans les trois ou quatre couleurs, une abondance infinie augmenté opposés. Aux couleurs de la théorie moderne a rien à faire ici. Dans les choses Bemheims qui prouvent exactement le contraire de la pendaison ; images en noir : sur une planche sur un fond gris est un pot de café vert et un pot vert. Les ombres sont pas noires, non par hasard, mais comme d’immenses lobes, qui forment la valeur vrac. M. Hessel a un mur de 6 Cezanne, il est l’une des sept merveilles du monde — celui où les éléments les plus hétérogènes Gobelinwirkungen ensemble. On a le sentiment que les cadres n’ont pas besoin d’être que vous pourriez aneinandemähen les photos que vous pourriez faire avec eux ce que vous pouvez faire avec un morceau de tissu, sans réel, pour détruire la valeur la plus importante. On pourrait comparer Cezannes colorimétriques avec une sorte de kaléidoscope dans lequel la vue est secoué ensemble, et il secoue afin que les images de la mosaïque sont de couleurs vives de contrastes scandaleux. Les corrélations semblent surgir presque par hasard, et pourtant tout cela ensemble est presque troublante. Ses harmonies sont si fortes que l’on est tenté de croire que ce serait la couleur, la seule couleur donnée un fort pouvoir de persuasion similaire à celle de la ligne rythmique. Il utilise parfois une composition qui explore le banal avec un vrai désir, le hasard ne peut absolument pas gênant pour rouler sur une table laisser quelques pommes et les poires, comme il les trouve, il n’est pas dans l’intention de atomique à le sentir. Ses natures mortes sont très semblables. Combien de fois a-t-il pris la serviette ridiculement compressé avec la plaque, le pot et les fruits. Et c’est toujours moi, après je n’avais vu une telle Cezannesche encore vie, été comme si je tombe sur une demi- douzaine de sculptures primitives écoutés ou analogues. Primitive, il fonctionne sans effort le moins faire ; primitive dans l’action, c’est à dire dans la taille glacial sentiment que nous geniegen des choses anciennes succès, stylistiquement sans l’aide de la ligne, qu’à travers cette mosaïque de couleurs fabuleuses — il semble presque absurde de dire cela — ne fait qu’exprimer l’objectivité la plus précise. C’est la chose la plus étrange à ce sujet : cette mosaïque est en forte impression cheveux ressemblance naturelle. Ainsi, un Cezannescher pomme est habilement comme un costume avec Velasquez, avec une certaine évidence, n’est pas le secouer. Il a rien de moins que l’émergence d’un révolutionnaire, si vous n’avez pas démarche s’appuie sur son record en plein air, où Daumier apparaît. Il est beaucoup plus silencieux que plus tard, Van Gogh était, la façon dont il Farbenauftragung adopter manieriicher, il peint mince par rapport aux couleurs des autres courses. Il est aussi éloigné du style de partition du néo-impressionnistes, il agit plutôt néerlandais, on pourrait envisager un successeur indirect de van der Meer lui parfois. Il peint la vie comme ça ses tapis. Seulement la hauteur à laquelle la nécessité polyphonique néerlandaise, des accords complexes, apporté avec lui le plus pur des tons plus puissants, simples. Et puis, il pense, comme je dis, pas le moindre de présentation agréable. Son regard d’enregistrement comme des morceaux de viande hachée. Tout semble Anatomy a débuté avec les pieds en eux, c’est juste la viande, la graisse et disgracieux, et y vit toujours, sauf que vous n’avez jamais pensé à attraper avec vos mains, vous voulez sucer avec vos yeux. Dans ses paysages pluie toute la nature semble nager loin, et toujours rien des blagues réalistes en elle, ce qui rend le paysage peintre wohlbestallte pluie mouillé comme possible. Il n’a jamais peint un soleil de réflexion, et pourtant il ya une lumière dans ses tableaux, qui peut être un dangereux voisinage des hommes armés comptent pas. Il appartient à la génération de Manet et de l’Évangile est le plus jeune. Ils l’appellent les façons. L’autel où il se prie Delacroix. Il suffit de voir ses copies du maître de Médée. Il remplace ce que l’on soupçonne de Delacroix, il peint de lui ce cette fois, comme il a copié Rubens, peint sur la grande Vlaamen et ce que Rubens était quand il a copié les Italiens. Comment a joué l’autre, est une histoire de la peinture notre nouvel art.
Cezanne est un an plus jeune que Zola, c’est-à-dire à partir de 1839. Zola avait toujours premiers tableaux de la première moitié des années soixante, comme l’ami était romantique encore sous l’influence directe de Delacroix. Vollard achète à la vente Zola, l’arrière-grand « Enlèvement » [121] à partir de l’année 65, un épisode romantique, bien que l’épisode était plus audacieux dans l’élévation de l’objet. Les premiers débuts en 1858 Cezanne peuvent être détectés. Pour cette année, est le « âne » chez Vollard, une petite grisaille, des Le Nain du xviie siècle pourrait être faite, et un certain nombre de scènes hollandaises vagues qui peut avoir été copié par de petits maîtres dans les galeries d’artistes Marseille. 59 Même dans le petit tableau rapide « Femme au perroquet » [R 26] (dans la même propriété) d’un des suspects Cezanne. Une femme à une fenêtre ouverte maintient sous la main un perroquet. La façon brute peut un étudiant de Franz Hals verlaufenen penser qu’il vient jamais tout à fait trouvé le traitement très libre du feuillage, qui surplombe une partie de la fenêtre. Un grand nombre de petits paysages, souvent peint sur bois, appartiennent à cette heure ou un peu d’éclaboussure, il y a gamme d’échantillons qui peuvent être vus sur Cezanne, même si vous n’avez jamais vu un tel truc précoce de lui, la brosse a été la force particulière dans le Touche, même si ce n’est rien de concret encore.
Le grand Cezanne est né quand il était encore dans les années soixante, sous l’influence de Courbet est tout à fait d’actualité – comme à l’extérieur que dans notre Leibl, mais indispensable – les magnifiques portraits en noir peint des natures mortes, dont je viens de décrire un. Puis vint le temps d’Auvers autour de l’an 70 Vignon, il peint avec Pissarro et la zone Daubigny préféré les beaux paysages, les plus forts, les plus larges de la soixante-dix. Ils ressemblent à l’ Pissarro simultanée, vous ferez peut-être une fois tous les travaux ultérieurs de l’artiste, si riche dans le ton, ils sont si pleins de profonde Farbenschwärmerei. La masculinité de Cezanne ont planification plus rigoureuse, plus d’audace dans les dimensions. A articles Courbet sain lui restait tout le temps. Le Derbé en cours de construction, les picotements comme le champagne dans ses meilleurs tableaux, il n’a jamais perdu. Il a suivi Pissarro dans le développement de Hellen, qui a enseigné Monet. Cezanne n’a apparemment jamais soigné tout à fait comme les autres impressionnistes à un renouvellement de la technologie. Sans Pissarro, il serait probablement toujours tranquillement peint en noir, et il deviendrait également un peu moins important. Il soufflait comme Manet dans chaque technique de son propre souffle en elle et a ainsi considérablement. Mais il a gardé l’inné, l’épuisement à Monet et Pissarro à des modifications techniques. Monet a également jamais été aussi forte que dans les années soixante-dix. Vous pouvez lui donner l’énorme raffinage de l’agent ne vous remercierai jamais assez, mais cela lui a coûté une partie de son pouvoir. Cezanne aurait parfois dit des choses assez brusquement brillants sur Monet, qui a prouvé sa profonde conviction des avantages de la nouvelle profession, il était certainement pas innovateur, mais suivait, puis à sa manière son merveilleux œil avec beaucoup plus élevé.
Exploit championnat que les autres. Dans une période de transition, qui est riche en stimuli, il peint les étranges photographies aériennes, des croquis dans lesquels un seul est entièrement terminé, l’atmosphère. L’image avec le comte Kessler, l’un des plus excellents probablement dater de la première moitié des années quatre-vingt, la plupart de la période de production du peintre. La gamme est beaucoup plus propre par rapport aux paysages précédents, il est utilisé assez mince, gris — blanc de la toile transparaît partout, surtout sur le premier plan où seule une mince vert recouvre le sol presque aquarelle modérément volatile. Où les arbres poussent, dessine un chemin lumineux qui se limite à rendre le ton de la toile riche en jaune vif, gris et des traces de bleu, et puis revient un champ vert bordé de pois verts supplémentaires, sinon exactement la même ton que le premier plan. Elle est séparée de la zone sous-jacente en raison de la relativement grande échelle de la faible bosquet vert. Cette richesse permet à l’orange clair prononzierte le terrain, qui à son tour se perd dans des tons plus clairs à l’arrière. La façade de la maison est seulement un peu plus clairement décalée par rapport à la tonalité de la voie à suivre sur les arbres avec le jaune, le toit de la brique orangée des champs. Dans le grand ciel prévaut un bleu très clair, il se bat toujours avec le bruit de la raison, où les arbres forment leurs feuilles vertes, se dégage clairement.
Effacer ce la raison des différentes couleurs qui est commun à ces différences et de la structure ondulée des plans coloristiquement équivalentes sont l’air qu’ils semblent presque de respirer dans ces Cezanne.
De là, une étape pour les images de 86 que la chose qui était auparavant toujours esquisse réalisation magistrale tangible.
Vous ne verrez jamais la Provence, sans penser à Cezanne, et il les peint avec un véritable fanatisme qui invente sa propre peinture pour faire le sien, qui n’appartient qu’à elle. Rasage il se tient devant nous, on croit centaines de détails pour récupérer les images. En effet, il est de nouveau seule couleur et la structure de l’air et un petit coup de pinceau qui reconstitue l’étrange pays dans une transmission plus particulière. Il est également toujours Pissarro certaine mesure similaire, dans la même mesure qu’auparavant, ce qui ne peut être que très limitée avec de tels tempéraments différents. Comme Manet Cezanne lui-même enrichi de plus en plus, il n’a jamais abandonné sur les réalisations antérieures, oui, même ici, il a quelque chose de Delacroix. Bien entendu, si le roman généreux qui a eu lieu dans la nature morte noir colossal, maintenant céder la place à un ordre raffiné, mais l’essence de Delacroix, le dynamisme fabuleux de Touche, son architecture avec la couleur a été préservée. Pissarro était uniforme en même temps dans la Touche, il s’approcha de sa période néo-impressionniste, Cezanne se moque de la rampe, comme il continue ses petits coups de pinceau, tous les systèmes et reste dans le sens le plus élevé de façon systématique. L’instinct qui l’a toujours guidé, lui a donné aussi l’abondance infinie, et avec une sorte d’instinct physique, vous pouvez profiter des images. Cezanne peint la chaleur de sa maison, il fait chaud dans ces paysages, il décrit la terre rouge brûlée, en vertu de laquelle on sent le hard rock qui a une séculaire refoulées rayonne ardeur. Merveilleusement rafraîchissant la végétation voyante à côté de ce coup de soleil, le vert, partout comme de l’eau fraîche imprègne le sol. Profond du ciel éternel s’abat sur tous les tons de pure saphir. La Terre est un tout petit break cet éternel bleu.
Dans ces peintures qui peuvent sembler modestes par rapport à la dramatique déplacé travaux antérieurs dans le premier moment, dans cette fuite de connexion de couleur à une image très naturelle, dans la pureté de la gamme, qui se limite au rouge, orange, bleu et vert, et chaque nuance est exprimée avec la plus grande richesse dans le très harmonique d’un goût très naturel célèbre l’ art de triomphes immortels de Cezanne. Voici van Gogh a appris à circuler dans le rouge de l’orange, le miracle coloriste physique profonde. Duret a côté d’un petit Cezanne magnifique cette fois, « Les Terres Rouges » deux des plus remarquables van Gogh, qui peut être considéré comme une continuation directe du Maître : maisons jaunes de soufre avec des toits bleus et profond fumée bleu vif à la flamme des forêts d’arbres pourpres. Il sont tricotés dans le tapis jaune et bleu et rouge surtout, cette fois exceptionnellement peint complètement plat, très ornementale cerclées avec des contours uniformes rouges, qui détiennent les tons violets précieux dans un feu vif.
Van Gogh était d’une nature aussi honnête que Cezanne, créant ainsi de l’intérieur, que l’on suit après la première surprise de la nature et pourrait parler de réalisme. Hallucinations sur la terre brûlante Cezanne, car ils peuvent se produire là-bas, quand les yeux brillants vont, van Gogh n’était certainement pas au courant qu’il tenait grandes formules de décoration de grands prédécesseurs. Qui pourra jamais saisir la richesse, les montagnes, il ! »
de La Sizeranne Robert, Les Questions esthétiques contemporaines, Librairie Hachette, Paris, 1904, 274 pages, p. 65 :
« L’« Impression » est une admirable metteuse en scène et ce n’est pas sans raison que Delacroix dans son Journal en 1859, Champrosay, 9 janvier, se promettait de réfléchir : « Sur la difficulté de conserver l’impression du croquis définitif. »
Inspirés par une idée juste de leur époque, inconsciemment pénétrés du désir de l’idéaliser, servis par des organes très pénétrants et très sensibles, enfin munis d’une retentissante étiquette, les impressionnistes, les Renoir, les Monet, les Pissarro, les Cezanne, les Sisley, pouvaient accomplir dans notre art du xixe siècle un rôle utile. »
Courant de l’année
Un livre posthume d’Antony Valabrègue est publié, Les Frères Le Nain.
Valabrègue Antony, Les Frères Le Nain, Paris, Librairie de l’Art ancien et moderne, 1904, 178 pages.
Courant de l’année
Wynford Dewhurst publie un livre Impressionist Painting. Its Genesis and Development, dont le chapitre ii s’intitule « The Forunners. Jongkind, Boudin and Cézanne ».
Dewhurst Wynford, « II The Forunners. Jongkind, Boudin and Cezanne », Impressionist painting, its genesis and development, Londres, Georges Newnes Limited, 1904, 127 pages, Cezanne p. 15-16 :
« From Boudin is an easy step to Cezanne, one of the pioneers of the movement before 1870. Paul Cezanne and Zola were schoolboys together in Aix. They left Provence to conquer Paris, and whilst Zola was a clerk in Hachette’s publishing office Cezanne was working out in his studio the early theories of Manet, of whom he was an enthusiastic admirer. Both men frequented the Cafe Guerbois, and there is little doubt that in the remarkable series of articles contributed to De Villemessant’s paper « L’Événement, » Zola was assisted by Cezanne, who had introduced the journalist to the artists he had championed. When the criticisms were republished in 1866, in a volume entitled « Mes Haines, » Zola dedicated the book in affectionate terms, « A mon ami Paul Cezanne, » recalling ten years of friendship. The writer went still further, for the character of Claude Lantier, hero of « L’Œuvre, » a novel dealing largely with artistic life and Impressionism, is generally supposed to have been suggested by the personality of Paul Cezanne.
For years Cezanne seldom exhibited, and his pictures are not known amongst the public. As to their merits, opinion is curiously divided. He has painted landscapes, figure compositions, and studies of still-life. His landscapes are crude and hazy, weak in colour, and many admirers of Impressionism find them entirely uninteresting. His figure compositions have been called « clumsy and brutal. » Probably his best work is to be found in his studies of still-life, yet even in this direction one cannot help noting that his draughtsman-ship is defective. It is probable that the incorrect drawing of Cezanne is responsible for a reproach often directed against Impressionists as a body a general charge of carelessness in one of the first essentials of artistic technique. Apart from this defect, Cezanne’s paintings of still-life have a brilliancy of colour not to be found in his landscapes.
In his student-days this artist had a great admiration for Veronese, Rubens, and Delacroix, three masters who had some influence upon Manet. Some of his latter methods showed a strong sympathy with the Primitives. The modern symbolists are his descendants, and Van Gogh, Émile Bernard, and Gauguin owe much to his example. Personally he unites a curiously shy nature with a temperament half-savage, half-cynical. Cezanne’s work is remarkable for its evident sincerity, and the painter’s aim has been to attain an absolute truth to nature. These ambitions are the keynotes of Impressionist art. »
Traduction :
« Passer de Boudin, l’un des pionniers du mouvement avant 1870, à Cezanne est une étape facile. Paul Cezanne et Zola étaient des camarades d’école à Aix. Ils ont quitté la Provence pour conquérir Paris. Alors que Zola était commis au bureau d’éditions Hachette, Cezanne travaillait dans son atelier les premières théories de Manet, dont il était un admirateur enthousiaste. Tous deux ont fréquenté le café Guerbois, et il y a peu de doute que, dans la remarquable série d’articles que Zola a écrits pour le journal de de Villemessant L’Événement, il ait été assisté par Cezanne, qui avait introduit le journaliste auprès des artistes qu’il avait défendus. Quand ses critiques ont été rééditées, en 1866, dans un volume intitulé Mes Haines, Zola lui a dédié le livre en termes affectueux, « À mon ami Paul Cezanne », rappelant dix ans d’amitié. L’écrivain est allé encore plus loin : le personnage de Claude Lantier, héros de L’Œuvre, un roman traitant en grande partie de la vie artistique et de l’impressionnisme, est généralement supposé avoir été inspiré par la personnalité de Paul Cezanne.
Pendant des années, Cezanne a rarement exposé, et ses tableaux ne sont pas connus du public. Quant à leurs mérites, l’opinion est curieusement divisée. Il a peint des paysages, des compositions de figures et des études de natures mortes. Ses paysages sont bruts et brumeux, de couleurs fades, et de nombreux admirateurs de l’impressionnisme les trouvent totalement inintéressants. Ses compositions de figures ont été qualifiées de « maladroites et brutales ». Probablement son meilleur travail se trouve-t-il dans ses études de nature morte, mais même dans celles-ci on ne peut s’empêcher de noter que son dessin est défectueux. Il est probable que le dessin incorrect de Cezanne est responsable d’un reproche souvent dirigé contre les impressionnistes, comme une charge générale de négligence dans l’une des premières bases de la technique artistique. Mis à part ce défaut, les tableaux de natures mortes de Cezanne ont un éclat de couleur qu’on ne trouve pas dans ses paysages.
Dans ses années d’étude, cet artiste avait une grande admiration pour Véronèse, Rubens, Delacroix, trois maîtres qui ont eu une certaine influence sur Manet. Certaines de ses dernières méthodes ont montré une forte sympathie pour les Primitifs. Les symbolistes modernes sont ses descendants, et Van Gogh, Émile Bernard et Gauguin doivent beaucoup à son exemple. Personnellement, il réunit curieusement une nature timide avec un tempérament de demi-sauvage, de demi-cynique. Le travail de Cezanne est remarquable par son évidente sincérité, et l’objectif du peintre a été d’atteindre une vérité absolue de la nature. Ces ambitions sont les maîtres mots de l’art impressionniste. »
Reproduction de La Route (« La route » ; Le Mur d’enceinte, FWN102-R275), et de « Pastel Portrait of Cezanne », par Auguste Renoir.
Vers 1904
Fabbri échange à Vollard le tableau Le Garçon au gilet rouge (FWN497-R659), pour une valeur de 3 000 francs, contre Homme assis (FWN530-R789) et un paiement de 2 000 francs.
Rewald John, The Paintings of Paul Cézanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 659, p. 426.


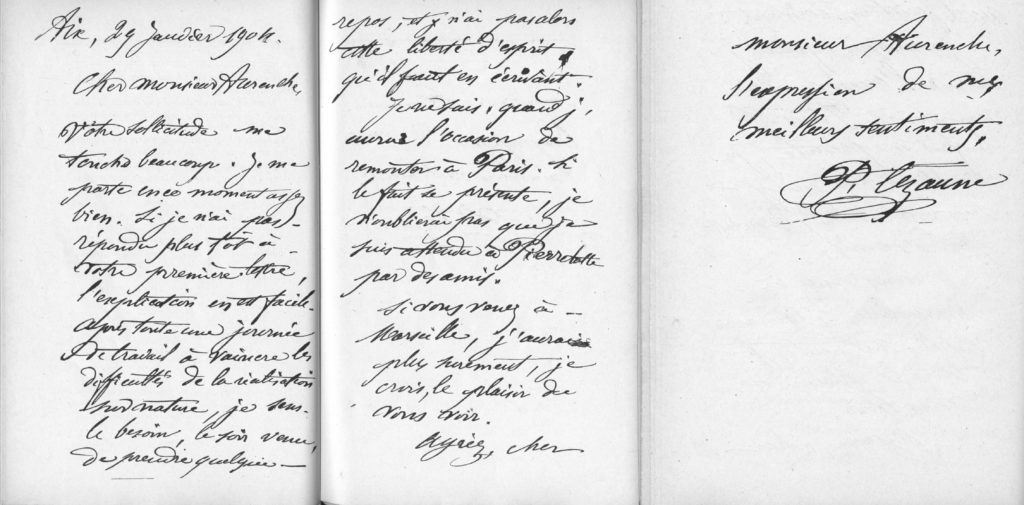
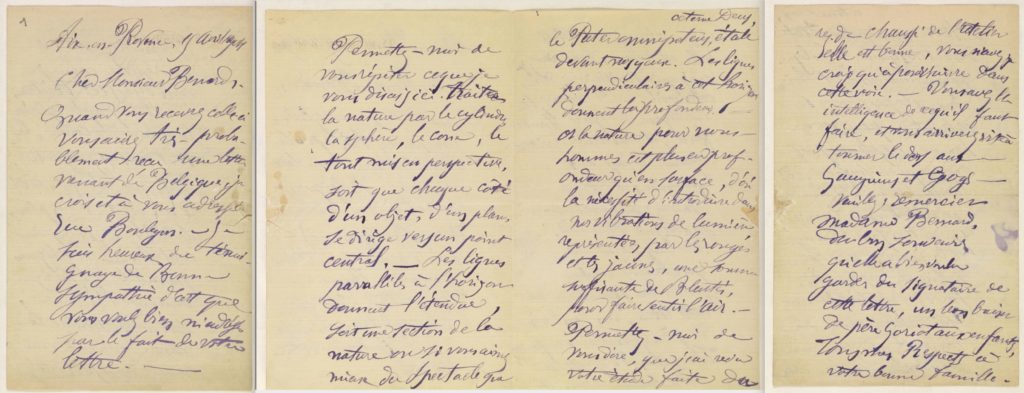
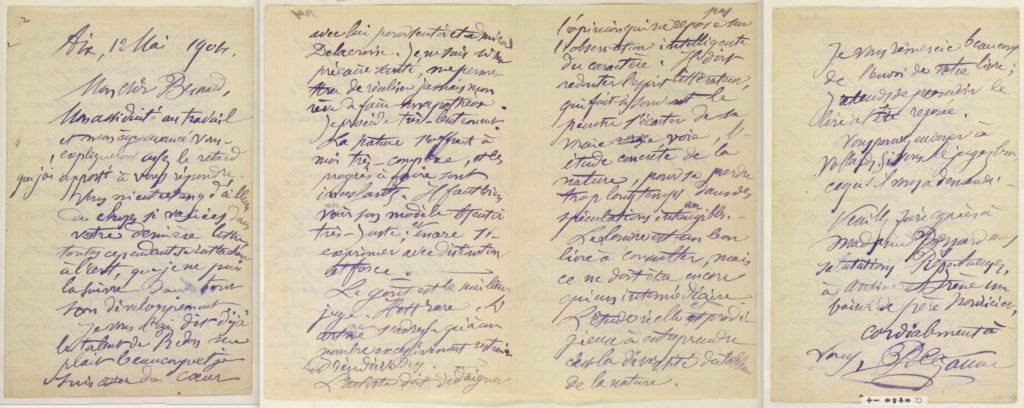
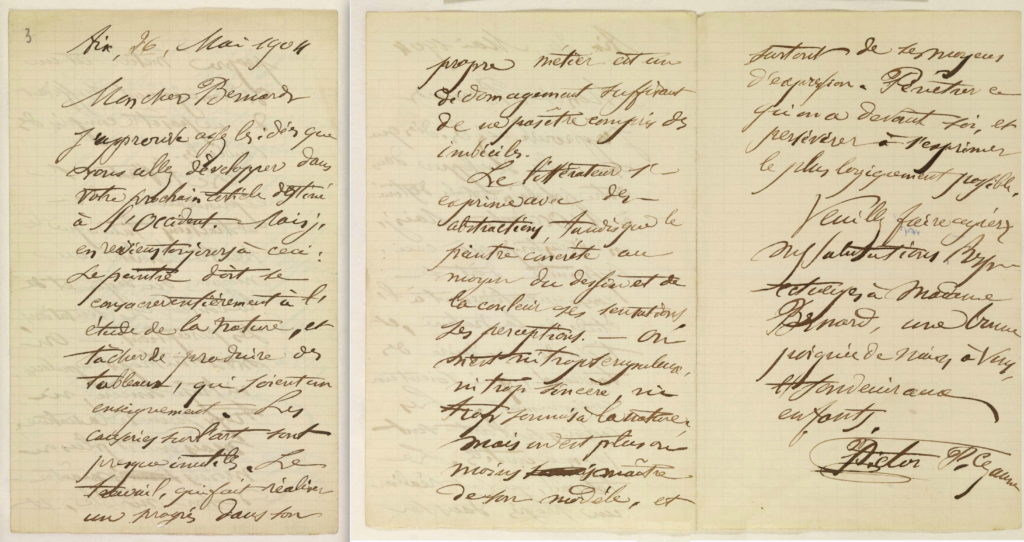
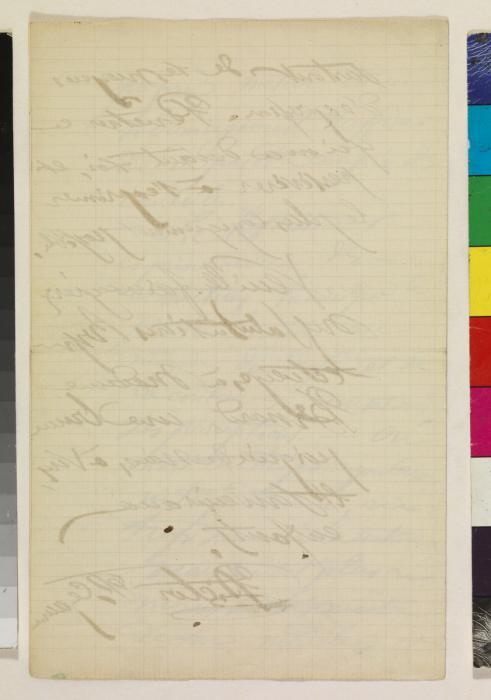
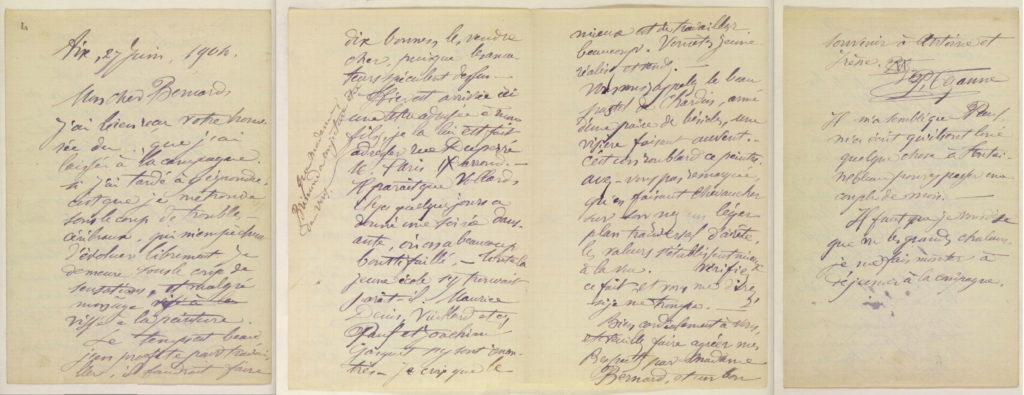
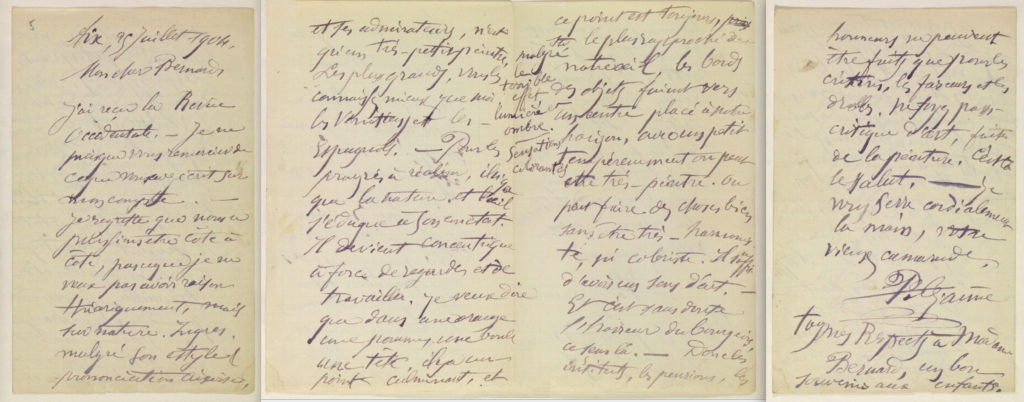
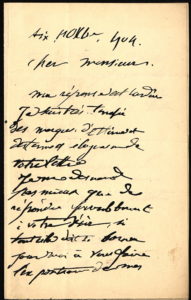
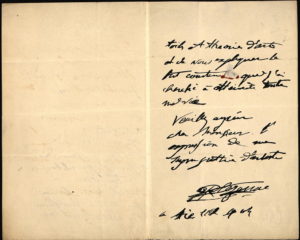
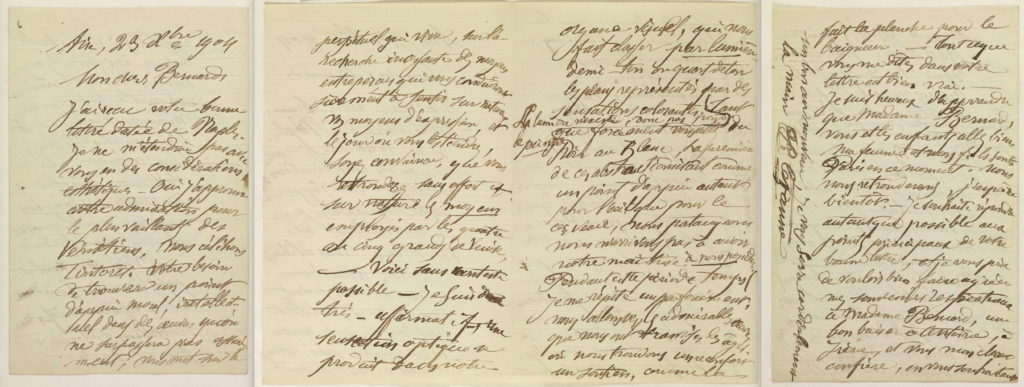

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.